
Les proches de l'adolescent ont dénoncé dans leurs auditions "des faits de harcèlement commis par des élèves de son collège, en raison de son homosexualité, depuis plusieurs mois".
34739 éléments (3198 non lus) dans 75 canaux
 Radio/sons
(113 non lus)
Radio/sons
(113 non lus)
 Sexo anecdotique
(669 non lus)
Sexo anecdotique
(669 non lus)
 Actu et info sexe
(635 non lus)
Actu et info sexe
(635 non lus)
 Ecrits / bds / Edition
(109 non lus)
Ecrits / bds / Edition
(109 non lus)
 BDSM/cuir/latex/
(29 non lus)
BDSM/cuir/latex/
(29 non lus)
 feminisme
(791 non lus)
feminisme
(791 non lus)
 Libertinage
(19 non lus)
Libertinage
(19 non lus)
 Info LGBTI
(833 non lus)
Info LGBTI
(833 non lus)
 Info LGBTI
Info LGBTI


Le ministre allemand de la Santé Karl Lauterbach a annoncé une levée des restrictions aux dons du sang par les hommes ayant des relations homosexuelles, datant des années 80 et la crainte d'un risque plus élevé de transmission du virus du VIH.
L’article L’Allemagne va lever les restrictions encadrant le don du sang par les hommes bis et homosexuels est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Enquête ouverte après le suicide dans les Vosges d'un adolescent de 13 ans, Lucas, victime d'homophobie et de harcèlement scolaire. Les obsèques auront lieu samedi à Épinal.
L’article Suicide d’un adolescent de 13 ans, Lucas, victime d’homophobie et de harcèlement scolaire est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Consty Bingam, plus célèbre sur les réseaux sous le pseudonyme d’Yves Mont Blanc, influenceur, designer et mannequin camerounais, la vingtaine, a été sauvagement agressé, dans la nuit du 5 au 6 janvier dernier, par une dizaine d'individus qui le trouvaient « trop différent », « efféminé, homosexuel ». Et compte tenu de sa notoriété, indubitablement fortuné.
L’article Agression d’un influenceur camerounais jugé « trop efféminé et homosexuel » est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

 La Wet For Me revient le 28 janvier 2023 à La Machine du Moulin Rouge pour glorifier la nuit et ses héroïnes, ses artistes et ses licornes. La nuit tou.te.s ...
La Wet For Me revient le 28 janvier 2023 à La Machine du Moulin Rouge pour glorifier la nuit et ses héroïnes, ses artistes et ses licornes. La nuit tou.te.s ... 
Cinq personnes ont comparu devant le tribunal d'Eldoret, dans l'ouest du pays, suspectées du meurtre du designer, mannequin et militant LGBT+ kényan Edwin Chiloba, rapporte la presse kényane. Ils avaient rapidement été interpellés après la découverte du corps sans vie du jeune homme, ce 4 janvier, dans une malle sur le bord d'une route.
L’article Cinq suspects en détention après l’assassinat du militant LGBT+ kényan Edwin Chiloba est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Simon Reynolds : « j’aime ces moments où l’underground rejoint l’overground » provient de Manifesto XXI.
Rencontre avec Simon Reynolds, à l’occasion de la parution de l’anthologie Hardcore regroupant ses textes majeurs, chez Audimat éditions. Le critique musical emblématique revient sur son expérience des raves anglaises, son idée du « continuum hardcore », comme sur son analyse des masculinités toxiques dans la musique.J’ai personnellement découvert le travail de Simon Reynolds avec son livre Retromania, un essai passionnant qui revenait sur l’obsession pour le passé de la musique des années 2000. Personnage clé de la critique musicale anglaise et internationale, capable de retracer avec beaucoup d’acuité l’évolution du post-punk, du glam ou de la club music comme de mettre en question la misogynie du rock, Simon Reynolds possède une écriture vivante et accessible, jamais ronflante et pourtant toujours riche en concepts éclairants. Parmi ceux-là, il y a l’idée du « continuum hardcore » qui revient sur une certaine continuité sonore et sociale de la musique électronique anglaise, du breakbeat « ‘ardkore » (comme l’appelaient alors les Anglais et Simon Reynolds dans ses livres) à la jungle jusqu’au 2-step, au UK Garage et au grime. Une théorie développée au fil de l’eau, de ses découvertes musicales et de ses réflexions personnelles présentées dans de nombreux textes au cours des années, eux-mêmes rassemblés dans l’anthologie Hardcore publiée il y a quelques mois par les éditions Audimat. Ces textes donnent à lire l’excitation d’un fan de musique propulsé dans une période d’ébullition créative folle. Mais aussi les mises en perspective d’un fin analyste des mécanismes économiques, politiques et humains à l’œuvre dans ces mouvements musicaux nés dans les raves et les clubs underground, soutenus par les radios pirates avant de conquérir le grand public. J’en ai profité pour passer une petite heure avec lui au téléphone.
Manifesto XXI : Pouvez-vous me raconter votre première rencontre avec la musique évoquée dans Hardcore?
Simon Reynolds : J’ai commencé à m’intéresser à la dance music lorsque j’étais étudiant. Mais je n’avais jamais participé au lifestyle qui allait avec, notamment parce qu’il y avait tout un aspect lié aux vêtements. La mode m’intéresse mais je suis assez nul avec les vêtements (sourire). Les raves m’attiraient car il y avait quelque chose de sauvage, hors de contrôle, de la sueur. J’avais toujours aimé la musique psychédélique et je trouvais ça intéressant de voir la house devenir « acid ». C’était une musique trippy mais d’une nouvelle façon, ça ne répétait pas les 60’s c’était quelque chose de complètement futuriste. Mes amis qui étaient jusque-là plutôt intéressés par l’indie rock ont commencé à aller en raves dans les années 1990. Il y avait aussi des groupes rock comme Primal Scream qui invitaient des DJs en première partie, ils expérimentaient. Orbital jouaient live aussi dans des contextes raves ou clubs. La foule était dingue, c’était comme assister à un événement religieux. Les gens dansaient d’une manière totalement nouvelle, on aurait dit des arts martiaux.
La foule était dingue, c’était comme assister à un événement religieux.
Simon Reynolds
J’étais époustouflé à la fois par la musique et par la foule. J’avais vu des photos et quelques articles sur cette culture, mais ça n’avait rien à voir avec le fait de vivre cette expérience en live, sentir la chaleur. Pendant une courte période, la Belgique a dominé le monde avec des disques apocalyptiques, presque wagnériens, de bombastic techno que j’adorais. Joey Beltram, qui venait de Brooklyn, sortait des disques chez R&S Records, qui étaient incroyables. Le ‘ardkore a pris la place de la house music. La musique est devenue plus dure, plus rapide, plus folle. C’est dans ce contexte que j’ai vraiment rejoint le mouvement rave. Il y a eu les radios pirates et l’apparition des breakbeats, les MCs chantaient sur les morceaux, les DJs scratchaient. Il y avait une influence jamaïcaine. Cette musique devenait un collage de techno, house, reggae, pop, musiques de films. Tout était mélangé à une vitesse folle. C’était en 1991-1992.
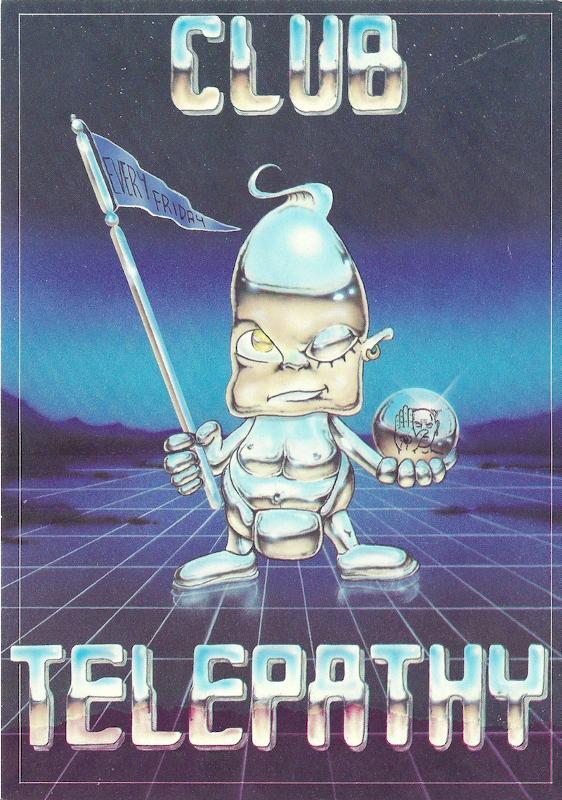 Une affiche de la rave Club Telepathy de 1993.
Une affiche de la rave Club Telepathy de 1993.
En vous trouvant confronté à ce nouveau mouvement, en particulier dans des contextes live, étiez-vous déjà dans une démarche analytique ?
J’étais sous ecstasy la plupart du temps (rires). J’avais eu l’idée un soir de faire une review collective et j’avais donc confié à mes amis des carnets de notes. Bien sûr quand je suis rentré chez moi le matin suivant, tout ce qui avait été écrit était illisible. Mais j’observais beaucoup la foule, le moment où elle ne fait plus qu’un, formant un gigantesque organisme. La façon dont les danseur·euses s’imitent les uns les autres également. C’est de cette façon que j’ai appris à danser. J’analysais les choses même en étant en train de danser dans un état second. Je sortais le week-end et la semaine j’écoutais cette musique sur les radios pirates. A cette époque, j’écrivais Sex Revolts avec ma femme, j’écoutais Can, j’allais en rave, tout cela se connectait dans mon esprit. Alors oui, j’analysais déjà des choses, mais je n’étais pas dans une posture analytique froide !
Dans les textes rassemblés dans Hardcore, on sent que votre subjectivité et votre enthousiasme sont au premier plan de vos analyses. On ressent la présence du fan, du journaliste et du critique. Comment trouvez-vous un équilibre entre ces différentes postures ?
C’est quelque chose de très organique. A cette époque, j’écrivais des chroniques de disques, forcément très subjectives pour le Melody Maker (magazine anglais aujourd’hui disparu, ndlr). J’utilisais beaucoup la première personne, dans une langue très libre, avec du slang, comme dans une conversation parlée. J’écrivais aussi pour des journaux à la façon d’un reporter, notamment pour un magazine d’art. Et puis il y avait les livres. On utilise ce terme je crois, « autho-theory », pour désigner quelqu’un qui se place au milieu de ce qu’il écrit. J’étais dans cette démarche. Je ne pense pas vraiment en termes de méthodes, je m’adapte au contexte de publication pour choisir un mode de discours. Je ne voudrais pas écrire quelque chose de complètement abstrait car j’essaie de communiquer, de partager ce que je ressens. J’étais un fan de cette musique qui avait mauvaise presse et j’ai endossé ce rôle de défenseur des mal aimés. A cette époque, beaucoup de gens trouvaient que c’était de la « garbage music for people on drugs ».
 Simon Reynolds © Adriana Bianchedi
Simon Reynolds © Adriana Bianchedi
Un peu comme cette vidéo où Iggy Pop s’énerve « I Hate this techno shit ».
C’est drôle car dans un autre livre que j’ai écrit sur la musique électronique (ndlr: Energy Flash), j’ai fait un parallèle entre Iggy Pop & The Stooges et la scène belge. Je disais que Iggy entouré de tout ce bruit était devenu un homme machine.
Le « continuum » recèle une certaine idée d’innovation, de rupture avec le passé, de mouvement vers le futur.
Simon Reynolds
Quand est apparue cette idée de « continuum hardcore » ?
En 1999, j’ai commencé à me rendre compte que cette culture évoluait d’une façon unique. Il y avait cette influence jamaïcaine, par exemple dans le rituel du « rewind », quand les danseur·euses aimaient tellement un morceau qu’ils demandaient au DJ de le jouer une seconde fois. Et puis, il y a eu aussi l’apparition du UK Garage, qui réinterprétaient des morceaux de l’époque jungle ou hardcore en prenant des samples clés, des mélodies et en les adaptant avec des nouveaux beats. Je me suis rendu compte que ces morceaux illustrent parfaitement l’idée d’un continuum. Des gens qui avaient commencé en faisant des morceaux jungle se sont mis à faire des beats UK Garage. Il y avait une continuité et un écosystème en Grande-Bretagne. J’ai commencé à utiliser le terme « continuum hardcore » de manière spontanée sur mon blog, en partant du principe que les lecteur·rices connaissaient l’histoire de cette musique. Je l’avais même raccourci en « nuum », prononcé « noummm ». Et puis des gens se sont mis à critiquer cette expression.
En lisant le livre, je me suis demandé ce qui avaient pu tant agacer certaines personnes dans cette idée de continuum hardcore. Car c’est une notion qui s’applique aussi à d’autres musiques. Je pense au métal notamment.
Le jazz aussi est un gigantesque continuum. Il y avait un gros club dubstep qui s’appelait Forward (qui se traduirait ici par aller de l’avant, vers le futur, ndlr). C’est un symbole intéressant qui incarne un certain état d’esprit. Ce que j’aimais dans l’idée du continuum c’est qu’il s’éloignait de la notion de “tradition”, beaucoup plus conservatrice. Il recèle une certaine idée d’innovation, de rupture avec le passé, de mouvement vers le futur. Les puristes du dubstep en l’occurrence n’aimaient pas ce que cette musique est devenue, plus noisy et maximaliste et rejetaient l’idée de continuum. Celui-ci s’oppose à l’idée du « rétro », le passé est le carburant pour écrire une musique futuriste.
Un moment qui m’a beaucoup intéressé dans le livre évoque le rejet du continuum de certains musiciens en quête d’une certaine légitimité. Ceux qui produisent une musique plus conceptuelle et cérébrale.
Au point de départ j’étais très enthousiaste de voir des éléments jazz ou ambient apparaître dans le hardcore. C’était une sophistication nouvelle, une recherche de respectabilité mais qui a été un peu trop loin. Quand j’ai vu des gens de la jungle ou du grime travailler avec des orchestres classiques sur des symphonies, je me suis dit « oh mon dieu ». La musique que je trouve la plus intéressante est celle qui mêle musicalité et une attaque un peu extrême sur l’auditeur·rice. C’est un mélange assez rare.
La musique que je trouve la plus intéressante est celle qui mêle musicalité et une attaque un peu extrême sur l’auditeur·rice.
Simon Reynolds
Vous évoquez aussi le rôle de la portion féminine du public des musiques hardcore, certains accusant le goût féminin d’être responsable d’une évolution vers plus de sentimentalité et des formats plus commerciaux…
C’est une culture très dominée par les hommes. Le dancefloor aux soirées drum’n bass est devenu à une époque une expérience très masculine, un peu comme les concerts de rock. Le UK Garage a changé cela. Je me souviens de commentaires dans les boutiques de disques « les filles adorent ce titre ». Le goût féminin est devenu une donnée importante. Il y avait aussi des femmes qui adoraient le côté agressif de la drum’n bass. Mais je trouvais intéressant de voir cette évolution vers une musique plus émotionnelle, plus sensuelle, un peu comme le lovers rock, cette forme de reggae plus doux qui avait été consciemment produite pour plaire aux femmes, en laissant de côté les thématiques religieuses par exemple au profit de récits du quotidien (voir par exemple la musique de Ken Boothe, ndlr). C’était une version plus pop du dub reggae originel. Ce moment où le garage et le 2-step arrivent est aussi marqué par la sortie de hits, qui se classaient n°1 pour la première fois dans l’histoire du continuum hardcore. Victoria Beckham a même chanté sur un tube garage.
Vous écrivez que ce succès populaire du UK garage et du 2-step vous a fait plaisir.
Je ne pense pas que la musique doive rester absolument underground. J’aime ces moments où l’underground rejoint l’overground, et ce depuis toujours. Comme quand un disque de Jimi Hendrix se classait numéro un dans les 60’s. Ensuite, l’underground devient autre chose et c’est très bien ainsi. C’est ce qui permet à la musique d’avancer.
La première fois que j’ai lu Retromania, je me suis senti assez déprimé, j’avais l’impression d’avoir raté les choses importantes et j’ai cherché un peu obstinément des contre-exemples de musiques contemporaines non versées dans la tentation retro.
Quand j’ai écrit le livre en 2010, j’avais vraiment l’impression que mon propos était pertinent et décrivait bien le contexte. Et puis, à partir de 2016, j’ai eu l’impression qu’il n’était peut-être plus aussi pertinent. Je pense que j’ai un peu raté tout ce qui s’est passé avec l’autotune par exemple, des artistes comme Migos, Future ou des producteurs comme DJ Mustard ou Metro Boomin. Tout ça était extrêmement moderne et lié au XXIème siècle. Et puis il y a eu SOPHIE et je me suis dit « le futur est de retour ! ». J’avais un blog qui s’appelait « Retromania » et j’avais fini par le fermer car j’avais l’impression d’être arrivé au bout de cette réflexion. Mais pas mal de gens continuent d’écrire sur les revivals, sur ces artistes ramenés à la vie par les hologrammes. Je pense que le livre décrit très bien cette culture du passé, de l’archive. Il y a aussi le fait que les plateformes de streaming encouragent les gens plus jeunes à écouter de la musique du passé, on parle de « catalog music ». Retromania reste pertinent pour comprendre ces mécanismes, même si actuellement j’entends beaucoup de musique du XXIème siècle, futuriste.
En 2021 vous avez écrit une nouvelle préface à votre livre Sex Revolts (sorti initialement en 1995) qui aborde la misogynie dans le rock. Comment jugez-vous ce livre aujourd’hui?
Il est toujours d’actualité notamment dans l’évocation des dynamiques hétérosexuelles à l’œuvre dans le rock. Mais il y a aussi une vraie évolution entre l’androgynie du rock des années 60 et 70 et les questions de transition et de genre dans la musique actuelle. Il y a une fluidité totalement nouvelle. SOPHIE a été innovante sur le plan musical mais aussi sur celui de l’identité par exemple. J’ai pas mal repensé au propos de Sex Revolts ces dernières années avec l’expansion de l’Alt Right, le mouvement des Incels, cette nouvelle masculinité toxique qui est proche de ce qu’on y a évoqué.
Ce que j’ai aimé dans le livre c’est cette impression de réaction à une situation que vous trouvez gênante. On sent un certain engagement qui est plutôt rare chez les rock critics qui restent souvent dans une posture d’analyse très historique et musicale. (La décision d’écrire Sex Revolts a été prise par Simon Reynolds et sa femme Joy Press après une soirée passée avec un musicien noise rock amateur de blagues pédo-pornographiques, ndlr).
La plupart de mes livres ont surtout été des histoires (post-punk, glam). Sex Revolts comme Retromania ont été plus aventureux sur la forme, moins académiques. Leur écriture a été plus guidée par des concepts et des idées.
Le continuum est brisé car la musique actuelle est beaucoup plus post-géographique qu’avant.
Simon Reynolds
J’ai emmené ma fille chez le dentiste il y a quelques jours et le docteur m’a dit que les enfants de nos jours ne mangeaient que des choses molles et que par conséquent leurs mâchoires n’étaient plus assez musclées. J’ai trouvé que c’était une parabole intéressante à la musique actuelle qui est souvent très planante, douce, shoegazy (même dans le métal). Pour finir, j’aimerais bien que vous me disiez où se trouve le continuum hardcore en 2022.
(rires) Il y a des gens qui font encore de la jungle ou du grime. On entend des échos du continuum dans la UK Drill je pense. Les radios pirates ont été remplacées par YouTube ou Snapchat. Je pense que le continuum s’est évaporé dans un nouvel âge très lié à l’image, aux vidéos et beaucoup moins aux DJs. La drill m’intéresse dans sa propagation et ses mutations : c’est une musique qui naît à Chicago, qui s’exporte à Londres puis des gens de Brooklyn s’inspirent ensuite de ce qui s’est fait en Angleterre, sans passer par Chicago, comme Pop Smoke. Les choses voyagent beaucoup plus vite dans le monde. Le continuum est brisé car la musique actuelle est beaucoup plus post-géographique qu’avant (l’afrobeat est un autre bon exemple de cela). Cette notion de continuum hardcore s’applique parfaitement à la fin des années 1990 et aux années 2000 mais elle cesse d’être adaptée à la musique d’après 2010 je pense. Et je suis cool avec ça, pas de problèmes (rires).
Hardcore, Audimat Editions, 280 p.
Sex Revolts, Joy Press/La Découverte, 496 p.
Relecture et édition : Pier-Paolo Gault, Apolline Bazin
Image à la Une : cover de Beltram Vol. 1 de Joey Beltram
Cet article Simon Reynolds : « j’aime ces moments où l’underground rejoint l’overground » provient de Manifesto XXI.

Environ 3,2 % des Anglais et Gallois, âgés de 16 ans ou plus, s’identifieraient LGB+, et 262,000 (0,5%) déclarent que « leur identité de genre est différente du sexe enregistré à leur naissance », selon un premier recensement ciblé, mené en mars 2021 par l’Office national des statistiques.
L’article Près de 1,8 million d’Anglais et Gallois LGBTQIA+, selon un recensement de l’ONS est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

La police kényane a ouvert une enquête après le meurtre du créateur de mode et militant LGBT+ Edwin Chiloba, 25 ans, dont le corps sans vie a été retrouvé dans une malle sur le bord d'une route, à quelques kilomètres de la ville d'Eldoret, dans la vallée du Rift.
L’article Indignation national au Kenya après le meurtre du designer et militant LGBT+ Edwin Chiloba est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Après Jérôme Boateng, reconnu coupable de coups et blessures sur son ancienne compagne, l’Olympique Lyonnais engage le très controversé Dejan Lovren, 33 ans, joueur croate récemment épinglé pour des gestes aux relents nazis et des propos homophobes. En conférence de presse, ce jeudi 5 janvier, son nouvel entraîneur Laurent Blanc a préféré esquiver, distinguant « …
L’article Dejan Lovren, nouvelle recrue de l’Olympique Lyonnais, accusé d’avoir entonné des chants nationalistes et tenu des propos homophobes est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.


 Dans le parc du petit village où vit mon père se trouve une cabine téléphonique anglaise qui n’a rien à y foutre, puisqu’elle se trouve en région PACA et que ...
Dans le parc du petit village où vit mon père se trouve une cabine téléphonique anglaise qui n’a rien à y foutre, puisqu’elle se trouve en région PACA et que ... 
Cet article Juliet Drouar, de la critique de l’hétérosexualité à la pratique du soin provient de Manifesto XXI.
Il incarne une des voix fortes du féminisme et des luttes queers actuelles. Militant et chercheur indépendant, Juliet Drouar poursuit le travail de critique de l’hétérosexualité dans la lignée de Monique Wittig, Adrienne Rich ou encore Christine Delphy. En plus de décortiquer les rouages du patriarcat, il accompagne celleux qui ont subi sa violence à travers son activité d’art-thérapeute. Ensemble, nous avons discuté des liens entre théorie politique et pratique du soin.Sorti peu avant les 5 ans de #MeToo, l’essai collectif La culture de l’inceste (Seuil) est un ouvrage essentiel. Co-dirigé par Juliet Drouar et Iris Brey, ce livre est un exploit de survivant·es. Il aurait pu ne pas exister tant il est difficile, encore aujourd’hui, d’écrire sur ce sujet (relire notre chronique ici). Le duo y consacre une déchirante introduction, hommage notamment au chercheur Tal Piterbraut-Merx qui s’est suicidé avant la publication. C’est avec iel que Juliet Drouar organisait dès 2019 une table-ronde sur le sujet de l’inceste au festival Comme nous brûlons. L’inceste est le « berceaudes dominations » que Juliet Drouar analyse et cherche à démanteler sans relâche. Son premier essai, Sortir de l’hétérosexualité (Binge Audio Editions) faisait ainsi la synthèse de plusieurs années de militantisme et de discussions portées notamment avec le festival Des sexes et des femmes, pour lequel nous nous sommes rencontré·es une première fois. Si sur le plan théorique, nous sommes de mieux en mieux armé·es, la prise en charge de la douleur des victimes reste un enjeu complexe. Comprendre aide mais ne fait pas tout. Alors que faire de soi une fois que l’on a pris conscience des violences qui nous ont abîmé ? Là encore, Juliet Drouar défriche et réfléchit une approche politique, queer et appliquée du soin.
Manifesto XXI – Avec Iris Brey, comment avez-vous constitué le groupe de personnes qui ont fait La culture de l’inceste ?
Déjà je dois dire que je regrette de ne pas avoir travaillé avec Matthieu Foucher. Je n’avais pas lu son article « A la recherche du #MeTooGay » donc je l’ai placé plus tard sur le plan de la pédocriminalité. On a d’abord cherché des personnes qui travaillent sur l’inceste en tant que système et non comme exception, et il n’y a pas tant de personnes qui ont produit des écrits. Dorothée Dussy c’était évident, c’est une des premières au plan national et international à en avoir parlé comme cela. Ensuite, on a cherché des personnes qui avaient déjà écrit sur le sujet ou qui avaient des travaux en lien. Par exemple, Ovidie n’avait pas écrit sur le sujet, mais on a bien sûr pensé à elle pour les représentations dans le porno.
Dans le livre vous abordez peu vos vécus intimes, est-ce un choix collectif ?
Non, c’était une liberté de choix pour chacun·e. Iris en parle dans l’introduction par exemple. Dans la fiction, avec la distance, il y a plus de nos histoires personnelles. L’imaginaire devient plus proche de ce que l’on peut raconter. Puis, il y a quand même toute une réflexion sur le point de vue situé dans le livre, y compris dans la recherche. Dans son texte, Dorothée Dussy explique comment des hommes blancs, assez âgés, promus, en sont arrivés à raccrocher l’inceste à un « tabou », lié à la personne avec qui on se marrie, plus qu’à une question de violences sexuelles. Ce n’est pas le sujet, le mariage, et dans les faits, ça n’empêche pas l’inceste. Cette conception est très ancrée et empêche de penser l’inceste pour ce que c’est, à savoir des agressions.
 Iris Brey et Juliet Drouar © Marie Rouge
Iris Brey et Juliet Drouar © Marie Rouge
L’essai se termine sur une fiction, pourquoi ce choix ? Tu y as déjà eu recours à la fin de ton premier essai, mais cela reste peu courant en France. Qu’est-ce que cela apporte selon toi ?
Dans Sortir de l’hétérosexualité, c’est grâce à Karine Lanini (mon éditrice chez Binge) que j’ai été encouragé à mélanger la théorie et la fiction. Ça permet de ne pas convoquer l’imaginaire de la domination en faisant abstraction de soi-même et des autres, ça permet de s’extraire de cet imaginaire qui construit des objets de recherche et non des sujets de recherche. L’abstraction relève du registre plus théorique. Resituer son point de vue c’est convoquer quelque chose de plus émotionnel, qui va tendre vers de la fiction ou l’auto-fiction. Pour moi c’est assez évident d’aller dans ce registre. Ce n’est pas encore très consacré en France mais de nombreuses personnes s’inscrivent dans l’autotheory (genre popularisé par notamment Paul B. Preciado et Maggie Nelson, ndlr).
Pour moi, c’est porteur d’espoir pour toutes les réflexions anti-dominations que ce livre, en tant qu’objet, puisse circuler.
Juliet Drouar
Avec le retentissement du podcast Ou peut-être une nuit de Charlotte Pudlowski et le livre La Familia grande de Camille Kouchner, il s’est passé quelque chose autour de l’inceste en France. Pourquoi cela émerge-t-il autant ici à ton avis ? Qu’est-ce que cela signifie ?
Aucune idée. Il y a une inscription récurrente dans les mouvements féministes de ces questions, du besoin [sociétal] de penser les femmes et les enfants comme mis·es à disposition. Il y a aussi des réflexions sur le tabou de l’inceste qui permet l’échange des femmes comme objet. Réfléchir au patriarcat amène à réfléchir à cet endroit-là. Pourquoi il y a une formalisation à un moment donné ? Je ne sais pas à quoi ça tient, mais j’ai le sentiment que ça tient à peu de personnes. Pour moi, c’est porteur d’espoir pour toutes les réflexions anti-dominations que ce livre, en tant qu’objet, puisse circuler. Aujourd’hui, il y a une couverture avec écrit « La culture de l’inceste » sur fond rouge dans l’espace public, c’est fort. C’est plein d’espoir de se dire que quelques personnes, sur une dizaine d’années, peuvent faire bouger des choses. Ça tient à peu de personnes, mais j’ai l’impression qu’il peut y avoir un effet boule de neige. Iris en parle bien dans l’intro, il s’est passé quelque chose entre le début de #Metoo et le moment où on est arrivé·es sur l’inceste, avec les travaux pionniers de Dorothée, de Charlotte, d’Axelle [Jah Njiké] ou de Tal [Pieterbraut-Merx].
Je pense aussi qu’il se passe quelque chose chez les journalistes. On a eu 3 pages dans Libé, ça n’aurait pas été possible avant. Ça veut dire que des personnes sont montées dans des rédactions. On a été surpris·es qu’autant de personnes dans la presse aient voulu s’emparer du sujet, avec leur militantisme, leur engagement. Il n’y a aucune pression, ça aurait pu ne pas se faire.
L’inceste, c’est une personne sur dix, ça se voit aussi à ces choix. Et avoir des conversations en famille reste incroyablement dur.
C’est un tel impensé, et un impensable, de pouvoir parler, transformer, les choses dans les familles que oui il y a presque une percée dans le collectif. Ça semble plus explorable d’en parler en dehors de la famille parce que tout semble toujours inamovible dans ce cadre. J’espère que les idées peuvent bien faire des aller-retours entre l’extérieur et la famille, via des objets (podcasts, livres…).
N’est-ce pas la plus grande guérison que de pouvoir mettre des limites ?
Juliet Drouar
Est-ce ton histoire qui t’a amené à devenir art-thérapeute ?
C’est une bonne question. (rires) C’est sûr que c’est la première fois de ma vie que je me sens être au bon endroit. Devenir thérapeute, c’est aussi chercher pour moi. C’est la volonté plus profonde en moi de comprendre et de trouver une appétence. Quand j’ai finalement trouvé, et difficilement, l’envie de vivre, je me suis dit que j’avais quelque chose à proposer. En plus de proposer des outils, j’ai eu l’envie de soutenir, de dire que c’est possible.
Je pense qu’il y a des aspects de soin et de justice dans ce choix. Je ne fais que de la thérapie située, c’est-à-dire qui prend en compte la personne et comment elle a été forgée par les dominations sociales. Chercher à comprendre, me soigner moi-même et si possible soutenir d’autres personnes dans cette démarche, ça me semble être ultimement politique.
Comment fait-on pour ne pas se brûler quand on cherche à soigner les autres ?
Il y a quelque chose de distinct, c’est-à-dire que je me soigne dans des endroits de thérapie qui sont à moi, qui me concernent. J’estime avoir trouvé une distance juste, mais ce travail me fait comprendre des choses sur moi rétroactivement. Parfois je m’entends dire des choses, et je réalise que c’est exactement ce que je voudrais me dire à moi-même. Il y a des espaces de correspondance, et puis il y a un endroit de soin dans le fait de tenir un cadre. N’est-ce pas la plus grande guérison que de pouvoir mettre des limites ? Pour moi, c’est une forme de soin, sans qu’il n’y ait d’inversion de place.
Il y a un manque criant de thérapeutes qui se situent politiquement, socialement, et qui ont de la réflexivité sur les outils transmis.
Juliet Drouar
Il me semble n’avoir jamais lu ton parcours personnel et militant entièrement décrit, peux-tu me raconter ton parcours et ta propre sortie de l’hétérosexualité ?
Alors mon parcours : j’ai fait un bac S et une prépa littéraire. Après j’ai compris ce qu’était une prépa (rires), et un prof m’a conseillé de passer les concours d’IEP. J’ai fait Sciences Po Grenoble, après j’ai fait une immense dépression. Je me suis installé en tant qu’artiste peintre, tout en ayant des jobs de cadre à temps partiel dans des start-ups. Là j’ai atterri dans une start-up en musicothérapie, et je me suis intéressé à la prise en charge de la douleur de manière non médicamenteuse. J’ai passé un diplôme universitaire d’art-thérapie, puis j’ai eu 2 ans de chômage qui m’ont permis de faire le travail que j’avais vraiment envie de faire, à savoir développer les festivals Des sexes et des femmes. J’ai eu le privilège d’y participer grâce à ce chômage, et ça m’a amené à aller plus loin dans la direction intellectuelle qui m’intéressait, celle des questions d’anti-domination. Ça a été deux années pour produire collectivement du « contre ». Tout cela m’a permis à un moment de me dire que j’allais m’installer comme art-thérapeute ou ouvrir un bar (rires). Ce sont les deux choses qui m’intéressaient le plus, parce que le bar c’est un endroit de soin en tant que queer.
Au final, c’est mon inscription théorique queer et féministe qui fonde la pratique thérapeuthique que je peux avoir aujourd’hui. Même si je ne vais pas en parler à chaque fois, c’est cette vision qui sous-tend ma pratique et ce n’est bien sûr pas une vision freudienne ou individualisante du monde. Sur le plan queer, personnel, j’ai été très tôt un « garçon manqué ». J’ai perçu assez vite les limites des rôles sociaux, ce qui m’a amené à m’inscrire en résistance, de manière plus ou moins consciente. Progressivement j’ai eu un parcours de garçon manqué, puis lesbienne, puis gouine, puis trans-pédé-gouine. J’ai changé petit à petit d’endroit.
Évidemment, il y a une forme de rage quand on en arrive à savoir ce qui a fait violence socialement, que ce n’est pas soi qui pose problème car on n’est que la résultante de déficiences et de dynamiques sociales; mais qu’il va falloir payer toute sa vie pour essayer de s’en soigner.
Juliet Drouar
Quels sont les outils que tu mobilises en complément de l’art-thérapie ?
On peut travailler sur le relationnel. Par exemple, ce qui pose problème dans des relations à l’extérieur peut se retrouver dans la relation avec le·la thérapeute. Si je le raccroche à la question de l’inceste ou des VSS, on peut retrouver un sentiment de défiance face à un·e thérapeute. Avec la sécurité du cadre de la thérapie, on va pouvoir essayer de faire autre chose de cette répétition : dire ce qui est en train de se passer et pouvoir chercher une nouvelle direction pour dépasser ça. Il peut aussi exister d’autres outils issus de la traumatologie par exemple. J’aime bien celui qui s’appelle « Internal family system » par exemple, qui permet de prendre conscience psycho-corporellement de différentes parties de soi. On peut se découvrir en partie enragé·es, ou découvrir d’autres endroits d’addiction par exemple. Cet outil permet de prendre conscience et redonner du sens à toutes nos manifestations psycho-corporelles.
Pour moi c’est un but incroyable que d’atteindre ce niveau d’empathie, de compréhension de soi-même. De mettre du sens dans tout ce que l’on fait, en essayant de diminuer la conflictualité ou la haine de soi que l’on peut ressentir. S’accepter dans la multiplicité de nos conduites et réactions c’est déjà quelque chose d’incroyable. Je me suis longtemps senti illégitime. Non pas que je me sente totalement légitime aujourd’hui, mais j’accepte un peu plus de prendre cette place. D’autant qu’il y a un manque criant de thérapeutes qui se situent politiquement, socialement, et qui ont de la réflexivité sur les outils transmis. On peut citer le Collectif Psy NoirEs qui fait un travail incroyable là-dessus. Il y a une vraie demande, et c’est ce qui m’a amené à bouger du cadre de l’art-thérapie stricto sensu. Beaucoup de personnes me contactent pour trouver un psy après m’avoir lu sur le plan politique. Or, je ne suis pas psychologue, et ça m’enjoint à réfléchir à comment je me place.
Ces dernières années, on constate que les discussions sur la santé mentale et la recherche de thérapies, notamment alternatives, se sont multipliées dans l’ensemble de la société. Qu’observes-tu dans le milieu queer ? Vois-tu une plus grande recherche aussi ?
Ce que je peux dire c’est qu’il faudrait au moins une enveloppe de 100€-200€ par mois pour qu’il y ait un vrai accès au soin. Ce n’est pas possible autrement. Évidemment, il y a une forme de rage quand on en arrive à savoir ce qui a fait violence socialement, que ce n’est pas soi qui pose problème car on n’est que la résultante de déficiences et de dynamiques sociales; mais qu’il va falloir payer toute sa vie pour essayer de s’en soigner.
Ce qui bouge pas mal je trouve c’est la conscientisation politique, par rapport à des soignant·es qui sont encore dans un prisme universaliste ou qui n’acceptent pas de se situer. Il y a une irrévérence dans le fait de refuser de faire la pédagogie sur ce qu’on est en train de vivre. En tout cas les personnes que je reçois ont une conscience politique forte sur le soin, ou au moins une conscience accrue des violences qu’iels ont subi pendant des soins psy et qu’iels refusent de subir à nouveau. Je pense que ce n’était pas aussi conscientisé avant, se dire que quelque chose n’est pas acceptable, se casser et chercher mieux. Je sens aussi une recherche d’être dans l’horizontalité, et de ne pas être étudié comme une chose.
Une dernière question, comme on a parlé de violence, de justice et de soi : comment peut-on bien gérer sa colère selon toi ? Quelle place accorder à cette énergie qui peut être motrice, sans se faire mal à soi ni aux autres ?
Je peux répondre sous deux angles. La colère est une émotion et donc une boussole. Or, le but de notre éducation a été de nous faire oublier nos émotions pour nous écraser à volonté. De là, est-on capable de savoir ce qu’il se passe dans notre corps quand on est en colère ? Où se loge notre colère ? Est-ce dans les bras, le poul qui s’accélère, des mâchoires qui se crispent ? Sensoriellement, suis-je capable de reconnaître ma colère ? Ensuite, l’outil de la colère enjoint de reconnaître que quelqu’un·e empiète sur nos limites. Donc, suis-je capable de détecter un léger agacement ? Une fois la colère détectée, puis-je replacer mes limites pour ne pas faire cocotte-minute ?
Une autre direction de réponse, plus dans l’optique d’un traumatisme, c’est qu’il peut y avoir un départ de colère pour nous défendre à un moment donné, mais qui perdure ensuite. Cette colère nous fait répondre à 1000 quand le stimuli est 1, et ça pose tout un tas de problèmes, notamment dans les relations. Dans ce cas, faire conflit pour faire relation ne fonctionne pas puisqu’il va plutôt y avoir sentiment d’agression en face, et donc soit fuite, soit combat. Quand on expérimente cette forme de décalage, l’enjeu en thérapie c’est d’essayer de creuser la distance entre les moments de traumatisme et ce qu’il se passe actuellement dans des relations, pour que la personne puisse faire conflit et relation. Évidemment que c’est une dimension délétère dans nos communautés.
La culture de l’inceste, Seuil, 208 p.
Sortir de l’hétérosexualité, Binge Audio Editions, 157 p.
Image à la Une : © Marie Rouge
Relecture et édition : Clément Riandey, Anne Plaignaud
Cet article Juliet Drouar, de la critique de l’hétérosexualité à la pratique du soin provient de Manifesto XXI.

Le gouvernement algérien a lancé une campagne visant à « sensibiliser » les consommateurs aux dangers de ces produits de « propagande LGBT » pour atteinte notamment aux « valeurs morales de la société ».
L’article Le gouvernement algérien en « campagne » contre les couleurs « arc-en-ciel » est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Révélation pop-soul outre-Manche, Joesef chante comme personne les ruptures amoureuses, les soirées alcoolisées et les maux de sa génération. Rencontre avec l’artiste écossais, qui sort son premier album, Permanent Damage, le 13 janvier et à qui l’on promet une très belle carrière.
L’article Joesef, Glasgow dans la peau est apparu en premier sur 360°.

La victime avait écopé de huit jours d’ITT. Le mis en cause a nié l'homophobie, sans convaincre toutefois les enquêteurs.
L’article Saint-Étienne : l’un des quatre suspects dans un guet-apens homophobe en garde à vue est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

 Ça y est, nous y sommes : une grande et belle année toute neuve. Et avant que tout le monde vienne essuyer ses vieux pieds dégueulasses sur le paillasson de ...
Ça y est, nous y sommes : une grande et belle année toute neuve. Et avant que tout le monde vienne essuyer ses vieux pieds dégueulasses sur le paillasson de ... 


STOP homophobie salue la fin d'une étape profondément dégradante et se félicite de cette victoire pour toutes les personnes trans.
L’article Fin de l’exigence du certificat psychiatrique pour le parcours de transition des personnes transgenres est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

De l'école jusqu'à l'élite, l'homophobie et la transphobie diffusent encore leur poison dans le sport. Pour y répondre, des initiative communautaires voient le jour, notamment en Suisse, pour réconcilier les personnes LGBTIQ+ avec le sport.
L’article Ces clubs de sport LGBTIQ+ qui mettent les discriminations hors-jeu est apparu en premier sur 360°.

Les écoliers confondraient les deux symboles et témoigneraient ainsi de leur homophobie. Mais les autorités scolaires refusent d'y voir une corrélation avec la hausse des cas de harcèlement constatée depuis peu dans les établissements privés de la région.
L’article En Suisse, des élèves dégradent leurs agendas scolaires illustrés d’un drapeau de la paix, assimilé au rainbow flag est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Désormais troisième personnalité du pays, derrière le président et le Premier ministre, l'élu de 46 ans s'est engagé à ce que la Knesset ne nuise jamais à la communauté LGBT+.
L’article En Israël, Amir Ohana devient le premier président ouvertement homosexuel du Parlement est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Un homme de 40 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris jeudi 29 décembre à six mois de prison avec sursis pour l'agression d'une jeune femme qui enlaçait sa compagne sur le quai du RER A de la station les Halles.
L’article Six mois de prison avec sursis pour une violente agression lesbophobe dans le RER parisien est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Ils avaient roué de coups trois jeunes hommes, à la sortie d'un bar du centre-ville, après les avoir menacés de mort et injuriés. Sans nier les faits de violence, ils réfutent le caractère homophobe, évoquant une soirée trop arrosée.
L’article Agression homophobe à Nice : quatre suspects jugés en juin prochain est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.


Les trois amis trinquaient dans un bar lorsqu'ils ont été injuriés et menacés de mort par quatre individus, qui les ont également suivi pour les attaquer ensuite dans la rue, en les rouant de coups.
L’article Trois jeunes, dont un délégué associatif, victimes d’une agression homophobe à Nice est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.




Couche #59: Depuis que j’ai entendu qu’être propriétaire foncier, c’est avoir accès à un tiers
L’article Une d’ces couches! est apparu en premier sur 360°.

Cet article Les 10 plus belles pochettes d’album de 2022 provient de Manifesto XXI.
Alors que l’année 2022 se clôt, nous avons compilé les 10 pochettes d’album qui ont accroché l’œil de la rédaction et ont participé à façonner nos expériences d’écoute.Dans un monde d’images, la présentation médiatique relève d’une importance particulière. Les espaces de représentation visuelle que sont les réseaux sociaux, les clips ou encore les pochettes d’album sont ainsi autant de moyens de promotion essentiels pour un·e artiste. En capturant le son d’un album, la pochette d’album offre un espace de réflexion artistique et un médium de création à part entière pour transcrire l’univers d’un·e artiste ou d’un groupe. La sélection des plus belles pochettes de 2022 nous plonge dans la contemplation de scènes qui explorent les schémas de l’identité et de l’altérité.
Cette année, nos coups de cœurs présentent pour beaucoup des portraits, comme la photographie pour l’album de King Princess ou la peinture inspirée de Francis Bacon pour celui de Perfume Genius. Les covers des projets de Lyzza et Rabit révèlent de leur côté une certaine esthétique de la corporalité, tandis que celles de 070 Shake, de Jenny Hval ou encore de Lykke Li dépeignent la solitude introspective des corps.
☆ 070 Shake – You Can’t Kill Me
 Artwork : Nicola Samori
Artwork : Nicola Samori
☆ PENDANT – Harp
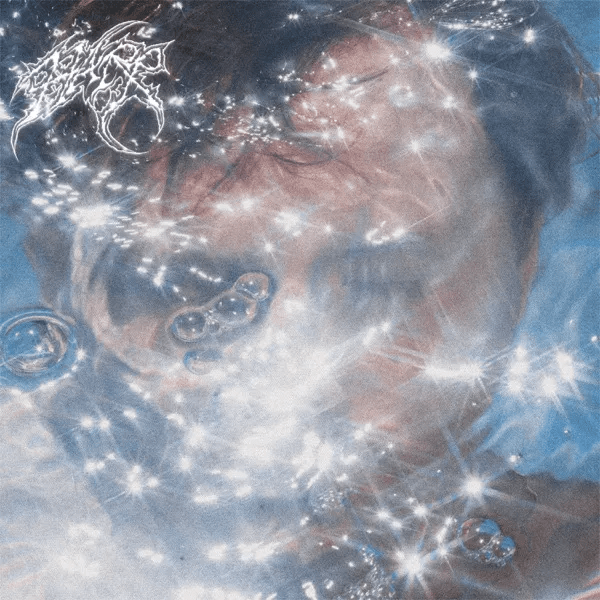 Photographie : Tonje Thilesen
Photographie : Tonje Thilesen
☆ Himera – Sharing Secrets
 Artwork : Otso Reitala
Artwork : Otso Reitala
☆ Jenny Hval – Classic Objects
 DA et photographie : Annie Bielski
DA et photographie : Annie Bielski
☆ King Princess – Hold On Baby
 Photographie : Collier Schorr
Photographie : Collier Schorr
☆ Lykke Li – EYEYE
 Artwork : Theo Lindquist
Artwork : Theo Lindquist
☆ Lyzza – Mosquito
 DA et photographie : Pe Ferreira
DA et photographie : Pe Ferreira
☆ Marina Herlop – Pripyat
 Artwork : Narr Eph
Artwork : Narr Eph
☆ Perfume Genius – Ugly Season
 Artwork : Nicasio Torres
Artwork : Nicasio Torres
☆ Rabit – What Dreams May Come
 Artwork : Linder Sterling
Artwork : Linder Sterling
Cet article Les 10 plus belles pochettes d’album de 2022 provient de Manifesto XXI.

Cet article Ateliers Médicis: à quoi devrait ressembler le bâtiment définitif ? provient de Manifesto XXI.
Singulier projet culturel fondé entre Clichy-sous-Bois et Montfermeil (Seine-Saint-Denis), Les Ateliers Médicis annonçaient il y a six mois leur installation dans un nouveau lieu vaste et fonctionnel, durable de surcroît, à l’horizon 2025. Une décision politique de la région vient de geler la réalisation de ce projet pourtant essentiel au territoire.La nouvelle est tombée brusquement, sans que les concerné·e·s n’aient été prévenu·e·s. Le 7 décembre dernier, la région Ile-de-France, présidée par Valérie Pécresse (LR), a annoncé la suspension pour 2023 de sa subvention de 150 000 euros aux Ateliers Médicis. Un camouflet pour la résidence d’artistes, fondée peu après les émeutes de 2005 pour apporter de l’art – et de l’air – sur des territoires trop souvent maintenus à l’écart des politiques publiques. En cause, selon la collectivité, le financement par l’établissement du festival « Les Chichas de la pensée », organisé par Mehdi Meklat.
En 2017, ce journaliste en vogue à l’époque avait été épinglé pour des tweets antisémites, homophobes, racistes et misogynes publiés entre 2010 et 2017 sous pseudo. Il avait tout de suite tenté d’éteindre le feu, s’excusant platement, plaidant l’erreur de jeunesse, suggérant aussi que ces saillies n’étaient que le fait d’un détestable personnage de fiction. Dans un livre, Autopsie (Grasset, 2018), il avait même renouvelé son mea culpa et faisait valoir un droit à l’oubli et la possibilité d’une seconde chance. Le festival dont il est le co-fondateur ressemble à cette seconde chance. L’événement gratuit, qui convie au long de rencontres passionnantes une nouvelle génération d’artistes et de penseur·euse·s issu·e·s de la diversité culturelle, a déjà été accueilli et salué par de nombreuses institutions à Paris et alentour – le Centre Pompidou, le Théâtre de la Ville, la Villette, les Magasins généraux et le Théâtre des Amandiers.
Mais la région n’a rien voulu entendre. Dans un communiqué, elle expliquait regretter que la direction des « Ateliers » « s’obstine à soutenir une personne ayant tenu de tels propos inacceptables […] Ces choix de programmation vont à l’encontre totale des valeurs de la République ». Ces arguments policés cachent mal, il faut le dire, les motivations idéologiques de la droite. Peu de doute que Mehdi Meklat, comme la plupart des personnalités soutenues par les Ateliers Médicis, représente tout ce que ce camp combat : une nouvelle garde jeune et engagée, irrévérencieuse s’il le faut. Les sanctions de la région ne se sont pas arrêtées aux dotations annuelles. L’Île-de-France a aussi menacé de retirer sa participation au financement du bâtiment définitif des Ateliers Médicis, sur lequel elle s’était engagée à hauteur de 5 millions d’euros. Sur 36 millions de budget total, ce n’est pas rien, surtout quand le permis de construire doit être déposé dans un mois. Mais la structure culturelle garde l’espoir d’un dialogue, quand bien même, pour l’heure, Valérie Pécresse oppose une fin de non-recevoir.
Nous avions discuté, il y a quelques mois, de ce nouveau lieu avec Cathy Bouvard, l’opiniâtre codirectrice des « Ateliers », et Nicola Delon, chargé du chantier avec Encore Heureux, un collectif d’architectes résolument engagé·e·s. Une construction vaste et fonctionnelle, normalement livrée en 2025, et qui devrait, plus que jamais, permettre aux Ateliers Médicis de remplir leur mission – rassembler par la création.
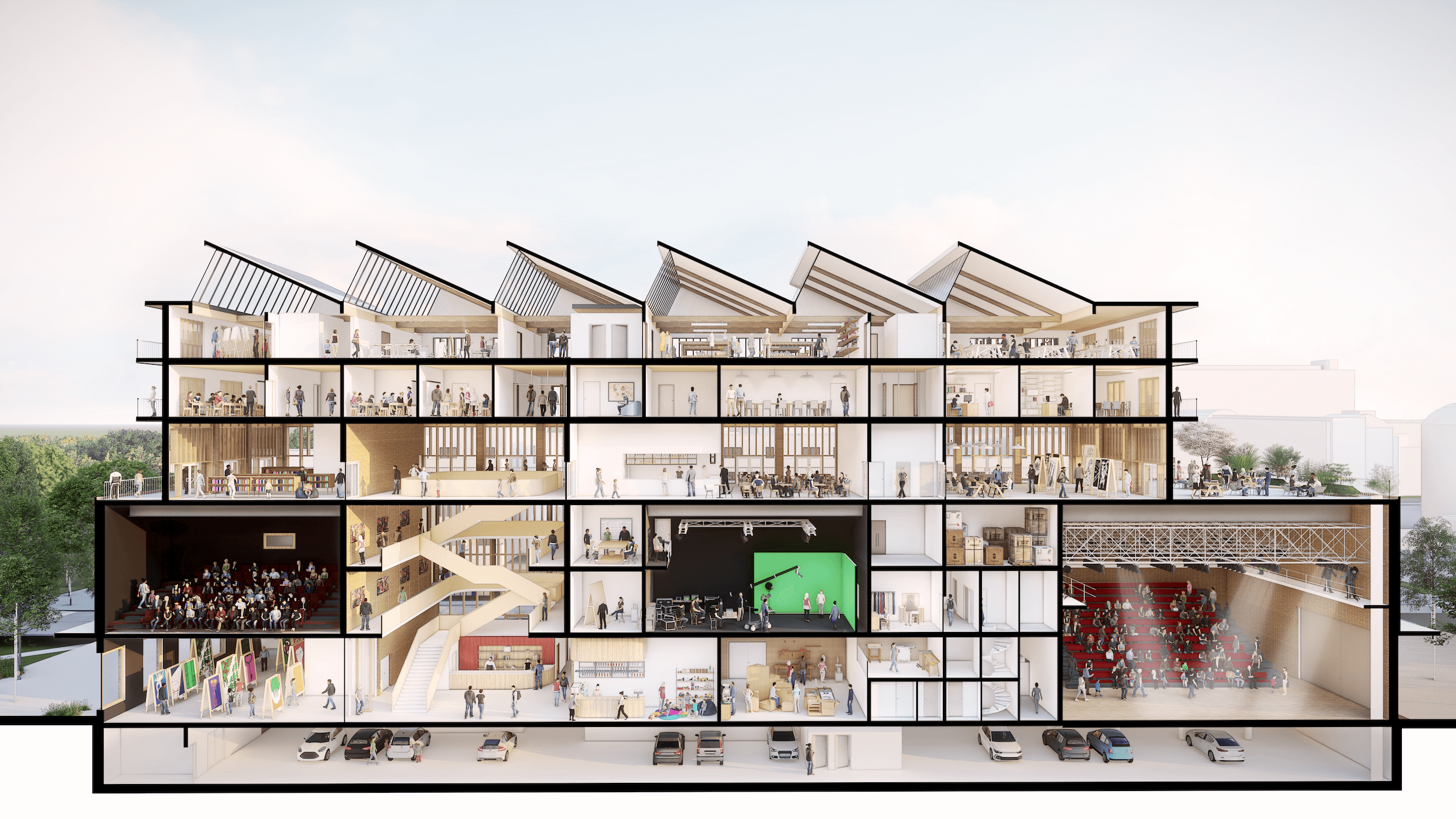 Ateliers Médicis 2025 – Perspective Coupe © Encore Heureux
Ateliers Médicis 2025 – Perspective Coupe © Encore Heureux
Manifesto XXI – L’équipe d’Encore Heureux a été désignée parmi 150 autres candidat·e·s pour construire le nouveau bâtiment. Cathy, pourquoi ce choix ?
Cathy Bouvard : Ce projet devait être mené par des architectes qui mesurent la porosité des Ateliers avec le territoire et respectent la dignité des parties prenantes. La pratique d’Encore Heureux s’illustre à la fois par une forme de modestie et de grande force architecturale. Leur proposition permettait d’envisager une forme qui soit belle, imposante, innovante, mais pas intimidante pour autant.
Comment les acteur·rice·s, nombreux·ses, ont-iels été mobilisé·es ?
C. B. : Une semaine de travail commun avait été organisée dès notre arrivée en 2018 avec Renan Benyamina (codirecteur des « Ateliers » depuis 2018 aux côtés de Cathy Bouvard, ndlr). Michel Lussault (géographe, expert des études urbaines et urbanistiques, ndlr), qui intervenait lors de cette concertation, nous a posé cette question : « Pourquoi vouloir ériger un bâtiment ? » Une interrogation simple mais que je trouvais très juste, et à laquelle nous devions répondre avec les résident·e·s. Il fallait réévaluer la fonction d’un espace culturel sur un territoire comme celui-là. Incarner ce projet, en faire un nouveau modèle ouvert et prospectif, penser un lieu où être ensemble, pouvoir faire langage commun.
Un temps de réflexion est aussi advenu en 2019, qui a alimenté un « cahier des rêves et des envies ». Ce cahier a été glissé dans le dossier à destination des architectes – et s’il y a bien un·e candidat·e qui en a tenu compte, c’était l’équipe d’Encore Heureux. Depuis début septembre, une permanence architecturale a débuté et doit durer tout le temps des travaux. Elle est tenue par Khadija Barkani, une jeune diplômée dans le domaine qui a déjà suivi le projet des Ateliers actuels et a travaillé avec nous à consulter les habitant·e·s. Cette clichoise d’origine incarne le courage et le talent des quartiers qui entourent le lieu, ces personnes qui se battent pour que ces territoires changent et prennent eux-mêmes la parole.
Nicola Delon : Construire un bâtiment revient systématiquement à répondre à une somme d’attendus gigantesque. Et donc à se mettre dans la peau de chaque acteur·rice. Dans ce cas, les attendus étaient d’abord politiques – porter une vision forte de culture et de lieu public –, mais aussi locaux – un endroit à cheval sur deux communes, avec leurs spécificités, leurs espoirs et leurs difficultés. Il fallait aussi tenir compte des équipes et des habitant·e·s, celleux d’aujourd’hui et de demain.
Trois axes principaux se sont distingués. Celui du symbole et de la fierté, d’abord, difficile à évaluer – nous voulions rendre les résident·e·s fier·ère·s de cet équipement sans basculer dans l’ostentation. Ensuite, celui de la fonction du lieu, actuelle ou future – comment l’architecture autoriserait à répondre à certains enjeux, qu’ils soient compris dans le cahier des charges ou relatifs aux potentiels usages ultérieurs du bâtiment. Celui, enfin, de la matérialité de l’architecture – il s’agirait de concevoir une construction en prise avec son temps, notamment sur la question écologique et de la biodiversité. La réponse est empreinte de tous ces éléments à la fois et nous a surpris·e·s nous-mêmes, ce qui est souvent bon signe.
En ville, et en particulier dans les quartiers populaires, la question de la circulation et du contrôle social reste cruciale. Le besoin d’un safe space avait été formulé par les habitant·e·s.
Cathy Bouvard
 Ateliers Médicis 2025 – Hall © Encore Heureux
Ateliers Médicis 2025 – Hall © Encore Heureux
La grande terrasse à douze mètres de haut a été pensée comme un espace incontournable du nouvel équipement.
C. B. : En ville, et en particulier dans les quartiers populaires, la question de la circulation et du contrôle social reste cruciale. Le besoin d’un safe space avait été formulé par les habitant·e·s. Comment pouvions-nous bâtir un espace public qui soit à la fois libre, sûr, et qui puisse paradoxalement échapper aux regards ? Dans l’équipe, nous imaginions d’abord un restaurant convivial, bon marché. Puis on s’est rendu compte que ce dont les résident·e·s avaient plutôt envie, c’était d’un espace exceptionnel, de qualité, un rooftop en haut duquel venir profiter avec ses ami·e·s ou inviter son·sa partenaire à admirer la vue.
N. D. : C’est assez contre-intuitif, je l’admets : on pourrait penser que, pour qu’un espace soit public et commun, il faudrait qu’il soit visible et de plain-pied. C’est en réalité l’inverse. Parce que l’espace public reste traditionnellement un endroit destiné à voir et être vu·e, un aménagement perché comme celui-là permet de recouvrer sa liberté. De s’élever non seulement physiquement – depuis là-haut, on apercevra la ville, mais aussi la forêt de Bondy, la tour Eiffel… – et mentalement. Sans négliger la possibilité, en y grimpant, de tomber ici sur une exposition, là sur un·e artiste en résidence ou un·e membre de l’équipe des Ateliers.
Ce nouveau bâtiment va donner l’occasion d’un rassemblement et d’un croisement bienvenus.
Cathy Bouvard
Comment s’articulent les autres espaces de création et de transmission ?
N. D. : En bas se trouvent la plupart des entités programmatiques au fonctionnement encombrant, dans lesquelles il faut un minimum de place pour entreposer du matériel et accueillir des livraisons – salle de diffusion, salle d’exposition, cinéma… Viennent ensuite, à douze mètres, les espaces publics, le restaurant et la terrasse. Puis, logées dans la tranche médiane du bâtiment, les salles réservées à l’équipe des Ateliers. Pour relier toutes les parties, les membres du personnel doivent pouvoir monter et descendre librement. En haut, ce sont enfin les espaces dédiés à la création, petits cocons baignés de lumière naturelle, sans personne qui ne vous marche dessus.
C. B. : Les locaux actuels nous empêchent d’être proches des artistes à moyen et long terme. On doit sans cesse pousser les murs. Ce nouveau bâtiment va donner l’occasion d’un rassemblement et d’un croisement bienvenus. D’autant que des projets aujourd’hui surtout virtuels prendront une dimension physique, comme la Cinémathèque idéale des banlieues du monde, la Renverse, ou l’école Kourtrajmé. Les jeunes futur·e·s artistes pourront croiser des artistes plus aguerri·e·s et échanger au quotidien avec elleux.
Une attention toute particulière a aussi été portée aux matériaux du bâtiment, qui doit devenir le premier équipement culturel bioclimatique de cette ampleur.
N. D. : Chez Encore Heureux, on parle toujours d’envisager le bon matériau, au bon endroit, en bonne quantité. Notre but n’est pas d’ériger des bâtiments spectaculaires sans béton ou tout en bois qui coûteraient une fortune et n’aboutiraient sans doute même pas, mais plutôt de bien placer le curseur pour mener des constructions réalistes et volontairement hétéroclites. D’où, notamment, la question du réemploi des matériaux. Pour les cloisons intérieures des Ateliers, nous allons utiliser de la terre crue assemblée à quelques kilomètres de là, à Sevran. Une usine de fabrication recycle depuis peu les millions de mètres cubes de terre issus des aménagements du Grand Paris. Or ce matériau, en plus d’être un très bon isolant, permet des murs solides et respirants. Et, ce qui ne gâche rien, présente un excellent bilan carbone.
La nouvelle gare de la ligne 16 du métro Grand Paris Express, qui sera aménagée juste devant les Ateliers, doit définitivement désenclaver le lieu et le quartier. Au risque de la gentrification ?
C. B. : Les habitant·e·s expriment de vraies craintes à ce sujet, c’est vrai. Iels ont peur que les loyers grimpent et d’être relégué·e·s plus loin, ce qui renforcerait leur sentiment de déclassement. Mais nous, aux Ateliers, ne sommes-nous pas déjà un symptôme du changement du quartier ? Notre opinion est forcément ambivalente. L’essentiel, c’est que nous gardions cette volonté de rassembler et de faire émerger des voix nouvelles de ces lieux périphériques – il n’a de toute façon jamais été question d’intervenir pour imposer une culture descendante, de dire : « Ceci est la bonne culture ». À ce titre, je continue à croire que l’enclavement est excluant, mortifère et la circulation décisive pour déplacer les centralités. De là à ce que nous fassions de Clichy-Montfermeil un centre… je crois qu’il y a encore de la marge.
Depuis leur fondation, les Ateliers ont gagné le pari de s’imposer comme un lieu d’action en lien avec les territoires, capable de rassembler une communauté de créateur·rice·s in situ, mais aussi de piloter des résidences à distance, et même de s’inscrire dans des festivals.
Nicola Delon
 Ateliers Médicis 2025 – Vue générale. © Encore Heureux
Ateliers Médicis 2025 – Vue générale. © Encore Heureux
Les Ateliers vont en tout cas enfin bénéficier d’un bâtiment à la hauteur de leurs ambitions. Regrettez-vous que ce changement d’échelle ait pris autant de temps ?
N. D. : À mon sens, la grande force de ce projet reste précisément d’être passé par une première phase – première phase non seulement rassurante, mais indispensable. Depuis leur fondation, les Ateliers ont gagné le pari de s’imposer comme un lieu d’action en lien avec les territoires, capable de rassembler une communauté de créateur·rice·s in situ, mais aussi de piloter des résidences à distance, et même de s’inscrire dans des festivals. La nouvelle équipe a su faire de Clichy-Montfermeil un centre inédit et placer cet endroit sur la carte. Que l’initiative ait d’abord été modeste, qu’elle ait même laissé perplexe, c’est selon moi ce qui lui a permis de monter en puissance et de déboucher sur un projet si mûr. Pour nous concepteur·rice·s, qui nous retrouvons parfois avec des cahiers des charges déconnectés des réalités, je peux vous dire que cet équilibre est précieux.
C. B. : Même si peu y croyaient, cet horizon du nouveau bâtiment est présent depuis les débuts des Ateliers, il y a huit ans. Ce n’est que l’aboutissement de huit ans nourris du réel, d’un travail de terrain. Je dois saluer, en ce sens, le soutien des pouvoirs publics – en particulier en cette période actuelle tendue, où ce lien constitue peut-être l’un des rares signes rassurants de leur engagement [pour rappel, l’entretien a été réalisé avant l’annonce de la suspension des subventions de la région Île-de-France, ndlr]. Tout du long, les collectivités et l’État ont investi dans les Ateliers. Iels ont montré que, même sur un territoire disqualifié comme celui-là, iels étaient prêts à faire pour nous, avec nous et chez nous. Que les périphéries, souvent maintenues à l’écart des pensées contemporaines, en valaient le coup.
Chronologie des « Ateliers »Image à la une : Ateliers Médicis 2025 – Vue de nuit © Encore Heureux
Cet article Ateliers Médicis: à quoi devrait ressembler le bâtiment définitif ? provient de Manifesto XXI.

Après des mois de tensions, les députés espagnols ont voté, en première lecture ce jeudi 22 décembre, un projet de loi, baptisé la « loi trans », qui permettra dès 16 ans de changer la mention de son genre via une simple déclaration administrative.
L’article Espagne : les députés adoptent un projet de loi sur l’autodétermination du genre dès 16 ans est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

J’aimerais que le Père Noël soit un drag king. J’aimerais le voir créer une culture
L’article J’aimerais que le Père Noël soit un drag king est apparu en premier sur 360°.

Cet article Le meilleur (et le pire) de ce qu’on a vu au cinéma en 2022 provient de Manifesto XXI.
Sans classement et dans le désordre, la rédaction de Manifesto XXI dévoile son top des films de l’année avant d’embrayer sur les crispations (parfois comiques) de son flop cinéma 2022.Alors qu’on se demande si Avatar 2 sauvera les salles de cinéma, on peut d’ores et déjà se réjouir qu’en France, le succès des blockbusters américains bénéficie via le système de taxation des entrées à des projets plus confidentiels, plus exigeants, ou tout simplement moins rentables. Si l’on craint toujours un désamour de la salle de cinéma post-covid et un certain effet d’uniformisation des productions « offertes » par les plateformes, il est bon de rappeler que le cinéma français était cette année vivant, innovant et passionnant mais également féminin, queer et politique. En primant Pacifiction d’Albert Serra ou Saint Omer d’Alice Diop, le prix Louis-Delluc a bien représenté la grande diversité de propositions que nous a offerte le cinéma français cette année. Sans plus attendre, voici dans le détail ces films qui ont fait notre cinéma 2022, pour le meilleur et pour le pire.
☆ Tops : féminismes pluriels, lutte décoloniale et thriller nucléaireBruno Reidal, Confession d’un meurtrier, de Vincent Le Port
Cantal, 1905. Bruno Reidal, 17 ans, est arrêté pour le meurtre d’un enfant de 12 ans. Comment expliquer le geste brutal de Bruno ? Entre désir refoulé, isolement campagnard et désintégration, Vincent Le Port explore les pulsions de mort ressenties par l’adolescent, au moment où la justice et la médecine s’emparent de la psychologie comme outil de contrôle et d’évaluation. Dans une nature isolée à la fois lieu de fuite et d’effroi, le film dépeint, de manière psychanalytique et intime, une époque et une réalité trop peu représentées au cinéma, sublimées par un travail d’éclairage et de cadre tout en subtilité au service du jeu magistral de Dimitri Doré.
Saint Omer, d’Alice Diop
C’est un premier long-métrage de fiction, dont la maturité fait déjà trôner Alice Diop dans la cour des grand·es et lui a valu un Lion d’Argent à la Mostra de Venise ainsi que la possibilité de représenter la France aux Oscars 2023. Celle qui trône, c’est aussi Guslagie Malanda, l’actrice incarnant Laurence Coly, dont la noblesse transforme parfois la cour d’assises en cour royale, et adoube par un simple regard Kayije Kagame. Le normative gaze s’embue de larmes et se transforme en émotion pure, faisant écho au cinéma de Céline Sciamma dans Portrait de la jeune fille en feu (Claire Mathon signe l’image de ces deux films). Alice Diop continue d’élargir l’espace cinématographique des sororités, éternellement caractérisées par leur nature entravée. Entravées par la langue du procès, qui s’associe avec la violence langagière de la science, de la psychologie, de la nation blanche, pour tenter d’enfermer résolument dans son réseau de sens une femme noire, avortant par avance toute possibilité de maternité. Il fallait donc réouvrir, dégager cet espace des maternités noires, pour consacrer Alice Diop comme une cinéaste majeure de sa génération. À ne manquer sous aucun prétexte.
 Fire of Love, Sara Dosa, 2022
Fire of Love, Sara Dosa, 2022
Fire of Love, de Sara Dosa
Magnifique – c’est le mot qui nous vient pour décrire le documentaire amoureux du couple de vulcanologues Maurice et Katia Krafft, timidement distribué dans quelques salles françaises avant de rejoindre la plateforme Disney+. L’amour indomptable pour le feu des volcans (illustré par les archives de Maurice et Katia, qui constituent un trésor d’images folles en 16 mm), et celui qui les unissaient dans toutes leurs aventures, inlassablement. La documentariste Sara Dosa nous conte leur histoire avec l’aide de Miranda July à la voix off et des 800 bobines de films archivées après la disparition des Krafft lors d’une éruption volcanique en 1991. Un trésor qui nous laisse amoureux·ses d’un travail de montage fantastique et du feu sous nos pieds.
Pacifiction, d’Albert Serra
Un thriller expérimental en terres polynésiennes, porté par la mise en scène dingue de l’enfant terrible espagnol Albert Serra (à qui l’on doit de nombreux films opaques et difficilement abordables) et la présence magnétique d’un Benoit Magimel dirigé à l’oreillette. Pacifiction fait partie des grands moments de cinéma de l’année, tant pour le délire paranoïaque sublimement mis en scène (la « scène de la vague » restera un souvenir monumental en salle de cinéma) que pour la temporalité suspendue de ce film qui nous laisse presque sous le choc, dans une incompréhension nucléaire.
La Nuit du 12, de Dominik Moll
Film risqué car hautement d’actualité, La Nuit du 12 retrace l’enquête d’un féminicide dont l’auteur n’a jamais été identifié. C’est au cœur de la brigade de police, exclusivement composée d’hommes, que l’action se situe et c’est tout un système masculiniste qui se dévoile sous nos yeux : la justice défaillante, les normes de genre qui enferment les hommes dans le silence de leur trouble intérieur et la violence meurtrière de la masculinité. Dominik Moll nous montre que, si les féminicides sont le fait d’individus, c’est bien la société tout entière et ses institutions phallocrates qui sont le terreau de cette violence. Un film féministe majeur à l’heure où encore plus de 100 femmes sont mortes de la violence des hommes en 2022.
 The Souvenir : Pt 1, Joanna Hogg, 2020
The Souvenir : Pt 1, Joanna Hogg, 2020
The Souvenir : Pt I et II, de Joanna Hogg
Événement des festivals lors de sa sortie en 2020, on a dû attendre 2022 pour que sorte enfin en France la fresque auto-fictionnelle de Joanna Hogg. Retraçant en deux parties sa relation d’emprise avec un junkie mythomane, The Souvenir est un diptyque visuellement somptueux qui parvient à parfaitement retranscrire ce mélange de passion et de violence qui caractérise la relation toxique. À l’écran, on découvre Tilda Swinton dans une de ses prestations les plus dépouillées, et dans le rôle de sa fille, sa vraie fille, Honor Swinton Byrne.
Foragers, de Jumana Manna
Le travail visuel et plastique de l’artiste Jumana Manna est dédié à la documentation des systèmes d’oppression colonialistes et l’articulation du pouvoir sur la terre de Palestine. Dans son dernier film Foragers, présenté en compétition officielle au festival Visions du Réel, la réalisatrice compose élégamment un objet témoin du combat des cueilleur·ses palestinien·nes de plantes sauvages. Le zaatar (décrit dans le film comme « le plat national des Arabes ») et sa cueillette sauvage sont devenus un enjeu politique fort contre l’occupation israélienne et ses tentatives de récupération des produits agricoles de Palestine. Entremêlant fiction et documentaire familial, Foragers nous parle d’abord d’appropriation culturelle et de contrôle social : thématiques indissolubles de la lutte décoloniale.
Les Cinq Diables, de Léa Mysius
Découverte avec Ava en 2017, on attendait avec impatience le retour de Léa Mysius. Remarqué au festival de Cannes, Les Cinq Diables était présenté comme un film de genre à la française où une petite fille voyage dans le temps grâce à son odorat surdéveloppé. De ce postulat intrigant, la réalisatrice nous livre un film d’atmosphère parmi les plus mystérieux de l’année. Sans trop en dévoiler, le temps d’une scène de karaoké d’anthologie, Les Cinq Diables est aussi et surtout une superbe romance lesbienne qui donne envie de s’époumoner sur « Total Eclipse of the Heart » avec une Adèle Exarchopoulos rayonnante.
 Les Cinq Diables, Léa Mysius, 2022
Les Cinq Diables, Léa Mysius, 2022
Ninjababy, de Yngvild Sve Flikke
Comédie norvégienne sur la grossesse, Ninjababy nous raconte l’histoire de Rakel, illustratrice de 23 ans qui se découvre enceinte, et bien décidée à avorter. Mêlant à la prise de vue réelle des séquences animées où s’exprime le bébé-ninja éponyme, le long-métrage a le mérite de nous présenter un personnage original et jusqu’au-boutiste qui ne doute jamais de son refus de devenir mère. Produit avec un budget réduit mais un très bon scénario et des idées de mise en scène à revendre, Ninjababy est l’une des meilleures comédies féministes de l’année.
L’Innocent, de Louis Garrel
Jusqu’ici le cinéma de Louis Garrel oscillait entre le passable et l’anecdotique. Et puis vint L’Innocent, une comédie populaire comme le cinéma français nous en propose si peu. Un film divertissant, humain et drôle où Garrel déploie une intrigue assez simple autour de personnages complexes et passionnants. Si Anouk Grinberg nous a habitué à son talent, Noémie Merlant n’a jamais été si impressionnante et elle est définitivement la révélation du film. Renouvelant les genres de la comédie romantique et du film de braquage, L’Innocent assume sa part de sensibilité et de délicatesse et se classe désormais parmi les grands divertissements populaires français.
☆ Flops : de la fausse lutte des classes au malaise sexisteSans filtre, de Ruben Östlund
Faire des films grossiers (dans tous les sens du terme), situés chez les ultra-riches avec des castings à 95% blancs « pour critiquer la déconnexion des 1% » est-il la nouvelle stratégie des cinéastes boomers pour rouler tout le monde dans la farine et gagner reconnaissance critique, public et même une Palme d’Or ? Dans la lignée de son précédent film The Square, Ruben Östlund se surpasse dans Sans filtre pour critiquer les 1% (ou plutôt l’humanité entière) sans aucune subtilité. Bien que formellement parfait, le film se conclut avec une morale douteuse : les pauvres seraient-ils, au fond, tout aussi médiocres que les riches, tout ne serait-il pas qu’une question de point de vue ? Les deux palmes remises à Östlund à moins de cinq ans d’intervalle ne font que symboliser ce que la bourgeoisie aime avant tout : se voir représentée, même dans sa médiocrité, car au bout du compte, c’est toujours elle qui reste au centre du cadre.
 Sans filtre, Ruben Östlund, 2022
Sans filtre, Ruben Östlund, 2022
Chronique d’une liaison passagère, d’Emmanuel Mouret
Charlotte et Simon se rencontrent à Paris. Simon trompe sa femme avec Charlotte. Iels souhaitent la légèreté d’une liaison simple, finissent par tisser des liens romantiques plus forts. Charlotte rencontre Louise lors d’un plan à trois avec Simon. Charlotte et Louise tombent amoureuses. Le tout sur fond de musique classique pianissimo et de plusieurs détours dans les cafés, parcs et intérieurs de la capitale. Ce n’est pas une mauvaise blague sur le cinéma bourgeois de l’entre-soi, mais les grandes lignes scénaristiques du dernier long métrage d’Emmanuel Mouret. Avec un casting peu original (Sandrine Kiberlain en jeune femme énergique et Vincent Macaigne en quarantenaire sous xanax), il ne dit décidément rien de nouveau sur les relations romantiques. Il faut même attendre un fantasme sexuel bien hétéronormé pour que l’amour lesbien soit possible… arrêtez tout.
En corps, de Cédric Klapisch
Le retour de Cédric Klapisch signe l’adoubement du nouveau boomer du cinéma français : une danseuse de ballet blessée rencontre la danse « hip-hop », reconnecte avec son corps et finit par trouver l’amour. Le script laissait déjà à désirer tant les clichés y sont faciles, et il a suffi d’une scène tournée au Centquatre à Paris pour comprendre que ce qui intéressait Cédric Klapisch ne relève pas d’une simple méconnaissance des milieux de la danse et des arts vivants, mais plutôt d’un vieux fantasme déconnecté. Le tout est recouvert de dialogues aseptisés et de comique malaisant…
Don Juan, de Serge Bozon
La perspective de voir Virginie Efira porter des perruques semblait être une raison suffisante pour justifier l’existence du Don Juan de Serge Bozon, mais c’était sans compter sur la ringardise absolue d’une énième adaptation du mythe de cet homme à femmes rongé par ses passionnelles obsessions. Si l’on conçoit tout à fait ce qui le rend fou amoureux de Virginie Efira, on reste plus perplexe face aux clichés archaïques transmis par le film ainsi que par son absence totale d’innovations tant formelles que thématiques. Et puis à l’image du reste du film, les perruques que porte Virginie Efira sont tout bonnement insultantes.
Les Nuits de Mashhad, d’Ali Abbasi
Ou comment on peut réaliser un film bien rétrograde et misogyne en pensant être un auteur féministe. Honorée d’un prix d’interprétation féminine pour son rôle de journaliste enquêtant sur un tueur en série, Zar Amir Ebrahimi a elle-même subi de plein fouet la misogynie de la société iranienne en étant forcée à l’exil suite à la divulgation d’une sextape. Malheureusement, en filmant crûment des féminicides les uns après les autres, Ali Abbasi reproduit bêtement la violence qu’il pense dénoncer. On est très mal à l’aise devant ces scènes de meurtres de travailleuses du sexe que le réalisateur semble sublimer comme s’il avait oublié de traiter son sujet avec un minimum d’humanité.
 Mascarade, Nicolas Bedos, 2022
Mascarade, Nicolas Bedos, 2022
Mascarade, de Nicolas Bedos
Isabelle Adjani en diva over-drama n’est jamais une mauvaise idée. Sauf quand il y a Nicolas Bedos derrière la caméra et qu’on peut sentir pendant 2h22 son dégoût pour les femmes qui vieillissent (comment osent-elles ?). Outre la misogynie, on regrettera le sentiment de déjà-vu offert par cet ersatz de Sunset Boulevard ou de Pandora. Le panache de ces illustres modèles est ici remplacé par une réalisation tape-à-l’oeil qui, si elle sied plutôt bien à la Côte d’Azur, ne parvient toutefois pas à nous faire oublier le cynisme absolu du film et de son réalisateur.
Les Animaux fantastiques : les Secrets de Dumbledore, de David Yates
Voilà une saga qui aura réussi à surpasser la déjà médiocre tentative du Hobbit dans l’exercice « continuer à presser le citron à fric de franchises légendaires à partir de textes de 50 pages des auteurs originaux ». Par où commencer ? Si seulement il n’y avait que l’absence de scénario et d’enjeu dans cette série de trois films au commentaire politique vain sur « la montée des extrêmes »… Mais non ! Il y a aussi la transphobie puante de J.K. Rowling (en charge de l’écriture des films), et Ezra Miller (longtemps une icône queer en devenir) auteur de violences sous substances et impliqué dans une sombre histoire de maltraitance d’enfants qui joue un rôle central. Enfin, Johnny Depp empêtré dans son affaire de violences conjugales avec Amber Heard. Des animaux, tout sauf fantastiques.
Sélection et rédaction : Samy Khoukh, Louise Malherbe, Benjamin Delaveau, Clément (Luki Fair)
Relire :
Les 20 meilleurs films de 2021
Les plus gros ratés cinema de 2021
Image à la Une : Saint Omer, Alice Diop
Cet article Le meilleur (et le pire) de ce qu’on a vu au cinéma en 2022 provient de Manifesto XXI.


Cet article Hyd, l’ange volcanique provient de Manifesto XXI.
Le 11 novembre dernier, Hyd a sorti son premier album, Clearing, sur le label anglais PC Music. Il succède à l’EP éponyme Hyd sorti l’an passé sur le même label. L’artiste y poursuit son exploration de la pop dans des sonorités shoegaze et éthérées. Ensemble, nous avons discuté des cycles de l’eau, du feu, de la terre et d’émotions.Hyd est le projet musical de Hayden Dunham, artiste plasticien•ne pluridisciplinaire résident•e à Los Angeles. La première fois que j’ai entendu parler d’iel c’était avec « Hey QT » : une chanson présentant une boisson énergisante pop et pétillante. Le clip qui accompagne la track met en scène Hayden aka QT qui met au point la boisson dans son laboratoire futuriste. Il a marqué pour beaucoup le début de l’ère PC Music et d’une rencontre artistique incroyable, celle de SOPHIE et A.G. Cook qui ont co-produit la track avec Harriet Pittard aux vocals. Depuis, Hayden expose régulièrement ses sculptures à New-York. En 2019 iel réalise, avec de nombreuxses collaborateurices, une performance audiovisuelle au MoMa intitulée « 7 Sisters ». Deux années plus tard sort son premier EP sur le label PC Music, une référence en matière de musiques pop expérimentales.
À 17 ans, Hayden a réalisé son rêve et quitté sa terre natale du Texas – ancienne terre volcanique, connue pour ses figures de cowboys et rangers – pour voyager en Islande afin de rencontrer les volcans de l’île (qui en recense pas moins de 130 actifs!). C’est le paysage qui sera choisi pour les visuels et clips de son précédent EP. La palette est minérale, du vert, du noir, du blanc, aux couleurs du territoire. Hayden n’a pas peur de s’engouffrer dans les rochers de cette terre glaciale et brûlante pour performer dans les montagnes et la boue. L’artiste porte le traditionnel pantalon de garçon vacher, en souvenir du Texas, et s’enduit de terre dans un enclos ou au bord du ruisseau.
 Clearing, Hyd (© Michael Bailey Gates)
Clearing, Hyd (© Michael Bailey Gates)
Avec les visuels de Clearing, Hyd élargit sa palette de couleurs. Le trinôme ancestral – rouge, blanc, noir – reste récurrent. Hyd m’explique la symbolique derrière ces choix: « Le rouge vient du pigment de l’argile broyée, il est aussi la couleur du feu et du sang. Le noir est le résultat de la transformation du feu en charbon et en cendres. Il se trouve aussi dans la terre. Enfin le blanc, la couleur du lait. La couleur change avec les éléments, c’est une sensation. » Une sensation mais aussi une transformation : « Une forêt qui brûle refroidit si vite quand l’incendie s’arrête. Le vert des arbres, transformé en fumée rouge, devient charbon et cendres. Dans celles-ci se trouvent les graines de la future forêt ». Hyd me confie se sentir comme une de ces graines prise dans le cycle de la vie: « Quelques fois nous ressentons des émotions si fortes que nous croyons qu’elles vont demeurer ainsi pour toujours. » Mais non, la graine reçoit de l’eau, du soleil, elle change d’état, et éclot. Comme la vie, la lune, l’eau, les émotions ont leur cycle.
Être sur terre c’est comme être dans un câlin géant entre le soleil et les roches internes en fusion.
Hyd
Hayden se sent particulièrement connecté avec le magma, les volcans lui procurent de l’énergie et c’est pour cette raison qu’iel les visite régulièrement « avec son cœur ». Sa fascination découle de la puissance de cette matière : « Le magma est un bout de soleil qui sort de terre et envoie des rayons UV puissants. Il faut mettre des lunettes de soleil pour ne pas se brûler. Être sur terre c’est comme être dans un câlin géant entre le soleil et les roches internes en fusion.» Cette image me réchauffe, j’imagine un câlin perpétuel, ainsi nous serions toujours entouré•es. Un symbole représente cette relation: deux cercles collés en miroir de part et d’autre d’une ligne. Hyd me le mime avec son doigt, les cercles sont les planètes et la ligne droite nous représente. De quoi se sentir moins seul•e.
Cette fascination pour le magma, lumineux, coloré et dangereux contraste avec le climat glacial de l’île. L’hiver est rude, la neige abondante, les températures négatives, en décembre, le soleil est présent seulement quatre heures par jour. Le froid contre le chaud, la douceur contre la rugosité, deux contrastes que nous retrouvons dans la musique de Hyd. Jónsi, originaire d’Islande, et Alex Somers, qui y a vécu, ont collaboré sur cet album. Leur chanson « Oil + honey » est un véritable onguent. La voix feutrée crée le rythme, celui d’une berceuse. Accompagnée d’une chorale de chœurs doux en canon et du son du carillon, elle procure un véritable sentiment d’apaisement. La magie opère et elle peut éclairer chaque chambre de douces lumières semblables à des aurores boréales.
Le magma est aussi créateur de sources d’eau chaude et l’eau c’est la « number one girlfriend » de Hayden. Iel l’adore et la consomme tous les jours sous des formes différentes en fonction de ses humeurs : Il y a d’abord l’eau de source, pour les moments de fatigue ou citadins (la magie fonctionne en visualisant l’eau sortir toute claire de la montagne avec ses minéraux). Puis, l’eau de pluie commercialisée aux Etats-Unis par Richards’s rainwater a un goût spécial car elle vient des nuages. L’eau volcanique redonne de la chaleur et de la vigueur. Et enfin il y a l’eau du robinet ! Hyd les aime toutes. Nous retrouvons l’eau sur la couverture de l’album. Un bain pour se nettoyer, de l’eau pour régénérer nos cellules. Dans les paroles aussi les liquides sont omniprésents. Du miel pour cicatriser, du lait pour fortifier une dent grâce au calcium, de l’huile pour nourrir notre peau. Clearing diffuse ses doux fluides sonores à nos oreilles et nos corps, c’est un album pour se renforcer et guérir.
La musique est un moyen de communication essentiel pour Hyd. Elle était au centre de sa relation avec son ex-amoureuse. Le couple avait un studio à la maison, et c’est comme ça que tout a commencé, un dialogue s’est créé entre le chant et la parole. La musique est également présente dans toutes ses relations amicales. C’est en traînant avec A.G Cook que de nombreuses idées d’Hayden émergent, pareil avec Caroline Polachek qu’iel connaît depuis ses 18 ans. La musique est une partie naturelle et précieuse de leur amitié, et évidemment, ces deux artistes ont collaboré sur son premier album.
Contrairement aux sculptures qui sont exposées à un endroit précis, pendant un moment donné, la musique est une sculpture d’air qui traverse les espaces. Hyd imagine comment l’air peut tenir dans un corps et comment un paysage de 2 minutes peut devenir une chanson. « La musique est un outil de connexion universel qui peut se révéler catalyseur. » Quand Hyd ressent un sentiment, iel entend un son. C’est-à-dire qu’au cours d’une conversation les mots de l’autre s’accompagnent de musique, déjà existante ou non. C’est une forme de synesthésie sonore.
Pour la tournée qui suit la sortie de l’album, Hyd se prépare à éclore. Hydratation et randonnées sont au programme. Ses tenues de scène sont pensées comme un cycle, il y a les tenues d’eau, d’air, de fumée, et de feu. Au fil de la tournée et en fonction de ses émotions, son style évolue. C’est une manière de s’augmenter, qui se retrouve même dans son merch: des graines de poche pyrotechniques et une gourde extincteur.
Les trois fois où j’ai vu Hyd en concerts, j’ai ressenti une présence émotionnelle intense. Son regard est direct et profond. Sa manière de se tenir sur scène est unique et totale. Tel•le un•e capitaine du navire, iel regarde au loin la marée humaine avec prestance. Iel me confie que : « c’est une manière d’être présent•e, ne pas dissocier. Il faut accepter ses émotions, même quand la tristesse est là, avant de monter sur scène. Assumer et sentir la musique se diffuser au travers de son corps vers celui des autres. » Tel un cinquième élément, Hyd est honoré•e d’être sur scène et de partager cet espace avec le public, l’air circule autrement. Iel donne tout dans le moment présent, pour une traversée des émotions épique.
« Je sens la musique se diffuser au travers de mon corps vers celui des autres présents dans la salle, mais aussi aux autres non présents ». SOPHIE, qui a collaboré à l’album, est décédée avant sa sortie. « Only living for you » est une de leur collaboration. C’est une merveilleuse lettre d’amour. Les paroles sont intenses. Hyd s’adresse à son amoureuse « Fille, je ne vis que pour toi, je ne jouerais que si tu joues avec moi, je ne tomberais que si tu tombes avec moi, je ne m’envolerais que si tu t’envoles avec moi». C’est le climax de l’album. Avec toutes les autres chansons, elles s’élèvent vers SOPHIE comme des offrandes.
Image à la Une : Fire © Michael Bailey Gates
Cet article Hyd, l’ange volcanique provient de Manifesto XXI.

Rien de plus familial que les fêtes de Noël. Mais qui dit «famille» ne dit pas forcément liens du sang. Preuve en est le concept aussi queer que précieux de «famille choisie».
L’article La famille choisie, pilier des Noëls queer est apparu en premier sur 360°.

Avec I Wanna Dance With Somebody, la réalisatrice Kasi Lemmons brosse le portrait émouvant de l'icône. Sans éluder les côtés sombres de la chanteuse, morte d’une overdose en 2012, à 48 ans.
L’article Whitney Houston, une ascension aussi fulgurante que mouvementée est apparu en premier sur 360°.

Cet article Bienvenue dans la Zhona provient de Manifesto XXI.
Zhona, c’est la soirée qui finance le festival OPPYUM, dont s’est tenue la quatrième édition au début du mois de décembre au 35/37. Une soirée off the record, bien cachée sous le périphérique parisien.On est samedi soir (comme tous les jours d’ailleurs dirait JUL), et bien évidemment, j’ai la flemme d’aller dormir. On est le 3 décembre, il fait un froid de gueux et cette semaine au 35/37 se déroule un festival de vidéo dédié à la performance : OPPYUM. J’ai ouï dire que, pour financer ce festival, se tient une teuf méga secrète qui s’appelle Zhona. Elle a lieu sous le périphérique dans le 19e arrondissement. J’ai envie de dire let’s go mais l’accès n’y est pas si simple. Pas d’événement Facebook, pas de préventes et encore moins d’adresse d’accès au site. Je me munis de mon téléphone et j’appelle Bryan Courtois, co-organisateur du festival Oppyum, et donc de Zhona, pour avoir plus d’infos.
Un terrain de jeu« On a créé le festival Oppyum il y a quatre ans, et ce soir, c’est la deuxième édition de Zhona. On a eu l’idée de ce festival après avoir fait le constat qu’il y avait un manque cruel de représentation de la vidéo performance, même à l’international » m’explique Bryan.
Sur les coups de minuit /une heure, je mets mon plus beau (et plus gros) manteau, et je m’en vais vers quelque part sous le périph’ dans le nord de Paris. Après m’être faufilée sous une espèce de pont, j’arrive devant une porte bien cachée. Une meuf tient une liste et tout le monde attend sagement son tour. Ce n’est pas la peine d’insister, je ne vous dirai pas où se trouve ce lieu ! « On voulait sortir du cadre club pour plusieurs raisons. Premièrement, pour des raisons de sécurité. Il est très compliqué d’organiser une teuf safe dans un club, car tu es obligé·e de bosser avec la sécurité et le staff de ce club. Souvent, leur manière de travailler ne correspond pas du tout à la nôtre. » En effet, ici, c’est à la cool. Confiance et bienveillance règnent. Seulement deux agents s’affairent à ce que ça ne soit pas le boxon dehors, pour ne pas se faire repérer j’imagine. On ne reverra plus de sécu à l’intérieur. Bryan reprend : « Les clubs ont aussi un public à eux et nous pouvons avoir du mal à gérer le mélange de nos deux communautés. Et puis, surtout, je trouve qu’il y a des espaces qui se prêtent plus à la fête qu’une simple boîte de nuit toute sombre un peu vide d’énergie. Là, le lieu est assez incroyable ». En effet, je ne vais pas être déçue. Franchement, derrière cette petite porte au milieu de rien, il y aurait pu y avoir tout et n’importe quoi tellement on a du mal à se figurer ce qu’elle peut cacher.
J’entre dans la Zhona. « C’est un terme portugais, car nous sommes brésiliens. En Amérique du Sud, la zhona, c’est le quartier où se trouvent les TDS, et notamment les TDS transgenres. On a voulu se réapproprier ce terme et en faire un lieu d’inclusion et non pas d’oppression et de discrimination. Au Brésil, 80% des personnes trans sont TDS. On a simplement eu envie d’offrir un terrain de jeu à cette communauté trop souvent opprimée, pour se rencontrer et s’amuser ensemble. » La porte s’ouvre, donc, et je longe un mur jusqu’à des escaliers qui descendent sur une immense salle haute de plafond. Au mur est projetée la vidéo du festival OPPYUM. « Le problème des performances à proprement parler, c’est qu’elles ne sont souvent accessibles qu’à des personnes en particulier : des gens qui travaillent dans l’art par exemple… Pour un public plus large, ça peut vite devenir compliqué d’y accéder. Grâce à la notion de vidéo performance et le fait de capturer ce moment, on essaie de partager au plus grand nombre » détaille Bryan.
Ou en tout cas de partager la curation aux personnes qui sont ici et qui ont été triées sur le volet. Pour venir esquisser des twerks sur le dancefloor de Zhona, il faut que tu te procures le lien où tu achèteras ta prévente en le demandant sur Instagram. Mais il ne suffit pas de le demander, il faudra encore que les organisateurs acceptent de te l’envoyer. Dans la petite foule (ce qui n’est vraiment pas désagréable), je rencontre Maléna, une Péruvienne de 23 ans : « Ne pas permettre à n’importe qui de venir faire la fête avec nous, je trouve ça très bien. Je ne sors plus en club depuis un moment par exemple. On n’a pas toujours envie de se retrouver avec des gens qui ne sont pas de notre milieu ou qui ne comprennent pas qui nous sommes. »
Je lui demande de préciser : « Quand je sors, je me fais tout le temps juger. Quand tu es une personne trans, ça dérange. La nuit, j’aime performer une féminité qui est exacerbée, les gens ne comprennent pas toujours. À partir du moment où on prend le pouvoir sur nos corps et nos façons de s’exprimer, ça agace cette société encore pleine de préjugés misogynes. Ici, on est vraiment tranquil·les. » Pour d’autres, le fait que la sélection à l’entrée soit sévère peut avoir ses limites : « Je comprends, car notre communauté à envie d’être tranquille. Mais il faut trouver un juste-milieu et ne pas aller dans l’extrême. Ici, je pense quand même qu’il a été trouvé » me confie Antoine, 25 ans, modasse de profession.
« Notre Zhona doit être préservée. »Très franchement, en tant que pré-retraitée de la night qui ne supporte plus rien ni personne au cours d’une soirée en exté, je trouve que l’ambiance est chanmée. Ça faisait longtemps que je n’avais pas eu tant d’espace pour danser et vu tant de gens chaleureux·ses sans pour autant être soûlant·e·s (oui, je suis un monstre). « On ne veut pas que notre soirée soit accessible. Notre Zhona doit être préservée. On vend nos places sur Instagram en faisant un check des profils des personnes qui nous envoient leur demande. On essaie de faire une selection qui soit uniquement queer et safe, donc nous sommes très sélectifs pour que notre soirée reste une Zhona en sachant qu’aujourd’hui, la techno devient très mainstream et hétéro. » La démarche de Bryan et Daniello tente de s’inscrire à l’inverse de cette tendance hypercapitaliste qui gangrène la techno depuis quelques années. « On souhaite juste pouvoir rembourser notre festival, tout en préservant notre Zhona en tant que safe place. On ne fait pas cette soirée pour générer des bénéfices » poursuit le créateur d’OPPYUM.
Le line-up est 100% queer et féminin, il est encore trop rare qu’on en voit des comme ça. Ça ravit également Maléna : « Ce qui diffère aussi des autres soirées techno ici, c’est le line up. Déjà, il n’y a que des meufs, et puis beaucoup de meufs trans ou racisées. C’est quand même beaucoup plus inclusif que ce que peut proposer la scène parisienne. » On danse toustes aux sons de XD-Eric, une DJ qui fait partie du collectif brésilien Chernobyl, et l’ambiance est à son climax. C’est le moment où je vous laisse pour aller danser et où je vous dis également – je l’espère – à l’année prochaine pour une nouvelle édition de Zhona.
« Tous les jours c’est samedi soir », c’est la chronique de Manifesto XXI sur la nuit et la fête. Ici, pas d’analyse musicale ni de décryptage de line-up. L’idée est plutôt de raconter avec humour ce monde de la fête que l’on connaît tout bas. Qu’est-elle devenue après plus d’un an de confinements ? Qui sort, et où ? Et bien sûr, pourquoi ? Manon Pelinq, clubbeuse aguerrie, entre papillon de lumière et libellule de nuit, tente d’explorer nos névroses interlopes contemporaines, des clubs de Jean-Roch aux dancefloors les plus branchés de la capitale.
Relire :
Image à la Une : © Bilel Ouannassi
Cet article Bienvenue dans la Zhona provient de Manifesto XXI.

Cet article Nos 8 clips préférés de 2022 provient de Manifesto XXI.
Pour une belle mise en valeur auditive, tout bon projet se doit d’avoir un visuel adapté et précis. On a été servi·e·s cette année, on vous présente ici les 8 clips qui nous on le plus touché.Pour finir doucement en décembre et suivre la folie des classements de fin d’année de la presse musicale, illustré par notre Top 11 des meilleurs des EP et albums de l’année, la rédaction musique a sélectionné huit clips, huit beautés visuelles sorties cette année. Entre nouvelles technologies de captures, inspirations d’anciennes générations et créations plastiques, tout y est.
☆ Shygirl – Come For Me
Ce visualiser de « Come For Me » filmé au drone parcourt des bois et des ruisseaux tout en courbes, allant de paire avec la sensualité du beat et l’écriture de Shygirl. En restant suggestif, on peut en dire beaucoup. La star apparaît quand même à la fin, perdue dans les branches, mousses et feuillages.
CW
☆ LSDXOXO – DRaiN
Réalisé par Leanne Mark & Soul SuleimanReprenant l’esthétique pop des chambres d’adolescent·es des clips dans années 2000, notamment celui de « Possibly Maybe » de Björk, LSDXOXO a dit à propos de cette chanson qu’il aurait voulu l’entendre plus tôt dans sa jeunesse, n’ayant pas eu de modèle d’identificaton de chanson d’amour noire et gay.
CW
☆ Nosaj Thing – Condition ft. Toro y Moi
Réalisé par Phil Nisco & Donovan NovotnyEntre plusieurs parties de ping pong, il est difficile de retrouver une certaine narration dans le dernier clip de Nosaj Thing. Ici on touche plus à une approche de contemplation, proche du documentaire. Une esthétique léchée avec une multitude de façon de tourner et de présenter l’image. Entre zooms, suivis de sujets, capture d’écrans de télé,… la vidéo est détaillé jusqu’au dernier plan. Jusqu’aux détails graphiques sur l’image illustrant la vidéo et les choix typographiques, tout y est impeccable et maitrisé.
MD
☆ Hudson Mohawke – Stump
Réalisé par kingcon2k11Connu pour ses montages surréaliste et dérangeants, kingcon2k11 applique complétement sa sensibilité pour illustrer le projet d’Hudson Mohawke tout aussi perturbant. Un visuel superbe de presque cinq minutes où Datamoshing et intelligence artificielle se rejoignent. Appliquant cette technique à des plans de drones de paysages pour un visuel dystopique et horrifique.
MD
☆ Frankie Cosmos – F.O.O.F.
Réalisé par Cole MontminyPour ce clip, le réalisateur et artiste Cole Montminy a tricoté une mélodieuse couverture en patchwork. Chaque carré est dessiné avec du feutrage, qui ajoute du relief. Le dessin naïf des fibres de laine, animé en stop-motion, illustre les paroles de la chanson. Il répond aux sonorités douces et feutrées de la voix de Greta Kline. À l’arrivée de l’hiver, ce dessin-animé est un véritable réconfort.
JH
☆ FKA twigs – pamplemousse
Réalisé par Aidan Zamiri & Yuma BurgesDepuis la sortie de sa mixtape Caprisongs en janvier, FKA twigs nous régale de ses clips. « Pamplemousse » est le dernier en date. Comment mieux marquer l’année 2022 qu’en utilisant cette technique émergente d’image d’intelligence artificielle, dans un effet faussement stop-motion? En une minute trente l’artiste nous éblouit avec sa grâce de danseuse transhumaine, toujours sexy.
JH
☆ Paloma – Love l’artère
Grande gagnante de la première saison de Drag Race France, Paloma est une comedy queen et une cinéphile accomplie. C’est avec toutes ses sœurs du casting que sa majesté (aka Hugo Bardin) a choisi de tourner le clip de son premier single, imaginé pour son court-métrage éponyme Paloma (à voir absolument aussi). Dans une ambiance mi Rocky Horror Picture Show, mi nanar à la française, la séance de cinéma ne pouvait que dégénérer avec toutes ces folles reines de beauté réunies…
AB
☆ Caroline Polachek – Welcome To My Island
Réalisé par Matt Copson & Caroline PolachekC’est la petite pépite de fin d’année : Caroline Polacheck enchaîne les clips qui annoncent son deuxième album Desire, I Want To Turn Into You à paraître le 14 février 2023. Après le très beau Sunset, c’est au tour du titre éponyme de l’EP de s’animer. L’image et la gestuelle de l’artiste sont parfaitement maîtrisées. Caroline Polachek montre une facette drôle, voire potache de son univers à travers ses transformations en sphinx, en volcan, ou encore un tableau in utero où des spermatozoïdes évoluent autour d’elle. Une touche d’absurde qui donne de la force à sa pop hypnotisante.
AB
Sélection et rédaction : Charles Wesley, Apolline Bazin, Max Deleus, Julia Henderson
Cet article Nos 8 clips préférés de 2022 provient de Manifesto XXI.

Ne rêvez pas de contes d’hiver: vivez-les à Gstaad. Que vous souhaitiez skier, faire une randonnée hivernale, du ski de fond, des ballades en raquettes, de la luge ou plutôt vous détendre grâce à des moments de bien-être ou de dégustation: ses montagnes et forêts enneigées vous attendent.
L’article Gstaad: la destination où l’on ne peut qu’aimer l’hiver est apparu en premier sur 360°.

Si la pratique sévit également auprès des hommes, surtout bis et homosexuels, les unions hétérosexuelles contraintes restent un fléau pour les femmes lesbiennes, queers et transgenres en Afrique.
L’article « Mariages forcés » : La réalité des femmes lesbiennes, queers et transgenres en Afrique est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

La préfecture de police de Paris en dénombrait 286 sur les 8 premiers mois de 2021, contre 441 sur la même période en 2022. Une augmentation de +55%. donc et tous les quartiers sont exposés.
L’article Les plaintes pour lgbt+phobie ont explosé en Ile- de-France : +55% par rapport à 2021 est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Besoin d’aide pour développer votre media ? L’incubateur d’Hôtel71 vous attend ! provient de Manifesto XXI.
L’espace lyonnais Hôtel71 lance un appel à candidature pour son incubateur de médias émergents, avec à la clé, un an d’accompagnement et de partage de ressources. On vous explique tout.Vous portez un projet de média avec un concept éditorial inédit, ou une solution technologique créative ? Hôtel71 peut vous aider à passer un cap. Lancé en 2021, l’incubateur porté par l’association Arty Farty (qui produit Nuits Sonores) a déjà accompagné les magazines Censored, Flush, Mosaïque ou encore le podcast T’as de beaux lieux. Le dispositif est ouvert à des structures de toute la France et l’appel à candidature pour la prochaine promotion est en cours jusqu’au 23 décembre 2022. 20 projets seront sélectionnés par le jury qui s’appuiera sur des critères d’innovation éditoriale ou technologique, mais aussi « les perspectives de développement, la volonté de créer des synergies avec les autres bénéficiaires, et la vocation d’intérêt général ».
Le but d’Hotel71 est d’offrir aux structures émergentes une boîte à outils qui leur permettrait de développer leur société, tout en gagnant leurs éperons pour, à l’avenir, être capable d’entreprendre, développer, créer, mettre en réseau et valoriser leurs engagements. Concrètement, cela passe par un programme d’accompagnement généraliste, un plan d’accompagnement personnalisé, des rencontres, des masterclass, du coaching individuel, un cycle de conférences… Parmi les structures qui contribuent à l’accompagnement, on compte StreetPress, l’agence sans tête, Brief.me, le Fonds pour la presse libre, l’INA, l’ONG Makesense, ou encore le Paris Podcast Festival.
L’incubateur déploie ainsi l’artillerie lourde pour donner les armes aux structures « portées par les nouvelles générations » qui ont bien besoin d’allié·es, d’une main tendue qui leur sorte la tête de l’eau. Hôtel71 s’engage pour « préserver et renforcer l’indépendance des acteurs et actrices dans le secteur de la culture et des médias, gage de pluralisme et de diversité, (…) dans un moment de grande fragilité démocratique », comme on peut le lire dans leur communiqué de presse.
Image à la Une : © Juliette Valero
Article sponsorisé
Cet article Besoin d’aide pour développer votre media ? L’incubateur d’Hôtel71 vous attend ! provient de Manifesto XXI.



Cet article Les 13 meilleurs EP et albums de 2022 provient de Manifesto XXI.
À quelques jours de l’arrivée de 2023, l’heure est désormais aux bilans et rétrospectives. On conclut l’année sur les treize albums et les EP qui ont le plus marqué la rédac.Comme chaque fin d’année, la rédaction musique se réunit pour débattre des albums et EP qu’elle a préférés en 2022. En résulte une sélection de treize projets, aussi différents que les rédacteur·ices musique, pour une fin d’année en beauté.
✩ 070 Shake – You Can’t Kill Me
070 Shake figurait déjà dans notre top album 2020 pour Modus Vivendi et confirme, deux ans plus tard, tous les espoirs qu’on avait pu placer dans sa musique. You Can’t Kill Me approfondi sa recherche d’un RnB sans frontières et assure la relève avec ses productions impeccables et son sens évident de la texture. Pour sa subtilité et sa richesse, cet album décroche sans mal sa place dans ce top.
LS
✩ Black Country, New Road – Ants From Up Here
Tout indie-kid qui se respecte aura suivi cette année le feuilleton de Black Country New Road : après un premier album en 2021, où nous pleurions en cœur pour la première fois, Ants From Up Here consacre notre début d’été. Fatalement devenu un sextuor juste avant la sortie de ce deuxième album et ce, après le départ du chanteur Isaac Wood, nous nous accrochons à ce dernier épitaphe du splendide pour continuer sereinement nos vies fortes en émotions.
EF
✩ Bjork – Fossora
Au cas où vous seriez passé à côté – (comment?), Fossora est le dixième album de la matriarche de l’experimental pop, paru en septembre. Après l’éther de Utopia (2017) elle dig ici comme jamais, inspirée cette fois de la vie des champignons, du hummus et des réseaux souterrains. Inévitable.
CW
✩ Charlotte Adigéry et Boris Pupul – Topical dancer
Voilà un duo qu’on souhaite voire durer. Né de la rencontre entre Charlotte Adigéry et Boris Pupul, Topical dancer a accompagné toute cette année 2022 sans qu’on s’en lasse tant il synthétise parfaitement l’esprit du moment, dans sa composition et dans ses messages. C’est un disque incroyablement intelligent, piquant et émouvant, qui aborde aussi bien le racisme et le sexisme que la parentalité et l’amour de soi. Pour couronner le tout, la version live est impeccable.
AB
✩ Eris Drew et Octo Octa – Day After a night with U
En 2022, on a continué à explorer les moyens de rendre le dance-floor plus safe et à questionner nos rapports, parfois toxiques, qu’on entretient avec la musique électronique. Cet EP de deux titres remet l’amour au centre de la réflexion. “I found the real one” confesse Eris Drew dans la première chanson de l’EP. Octo Octa répond dans “Stars and Water” avec une déclaration instrumentale, réelle peinture des astres sous lesquelles elles se trouvaient. Pour plus de lendemain d’amour dans nos oreilles en 2023.
EF
✩ George Riley – Running in Waves
Que de douceurs pour finir l’année, alors pourquoi pas mettre en avant une de ces dernières, sortie en septembre. Un an après une apparition sur le projet de Anz sur le titre You Could Be, George Riley se démarque et installe sa sonorité dans le paysage Art Pop. Produit par Vegyn (qui a produit une partie de l’album Blonde de Frank Ocean), les deux anglais prouvent encore une fois sur cet album qu’iels gèrent entièrement la branche du genre Electronica. Gros gros crush pour le morceau “Honesty”, aux violons qui massent le crâne.
MD
✩ John Keek – Do You Love John Keek ?
Sacré titre pour un premier opus. La voix grave et suave de John Keek se marie parfaitement à des mélodies très inspiré de tubes pop des années 80. Chaque titre innove dans des effets, silences et structures surprenantes.
MD
✩ Laze – Lost treasures
Pour son premier EP, la jeune productrice Laze a réussi à créer un détonnant cocktail de rave, break, trance et drum & bass. Avec ces 5 titres, elle a réalisé une synthèse joyeuse et fine de rythmiques et de couleurs. Le tout augure de beaux jours pour le dancefloor de Marseille d’où la jeune artiste rayonne.
AB
✩ Pom Poko – This is our house
Pom Poko est un groupe de noise norvégien doux comme un fjord. Dans leur dernier EP This Is Our House, la pochette art naïf donne le ton : les quatre musicien·nes construisent en quatre chansons leur maison musicale. Leurs outils: une voix tendre, des riffs abracadabrants. Le résultat est une comptine explosive ! Recommandé pour les amateur·ices de Deerhoof.
JH
✩ Safety Trance – Noche de Terror
Safety Trance (aka Cardopusher) a pour ambition d’emmener le reggaeton vers de nouveaux territoires. Il s’est uni avec Arca pour faire éclater leur zèle latinx sur « El Alma Que Te Trajo » avec un synthé sexy équivalent à leur collaboration sur Prada/Rakata. Noches de Terror est une fusion radicale d’hardcore, d’électro et de noise. À vos risques et périls.
CW
✩ Shygirl – Woe
Shygirl l’a décidé : 2022 sera son année. Rien de plus que des prods léchées, un flow à toute épreuve et une identité visuelle de nouvelle reine du dancefloor pour nous entrainer sur cette fin d’année dans son univers post-club hyper-pop dont nous avions besoin pour affronter l’hiver ! Pour l’after : les « Club-shy mix » de Poison.
EF
✩ Steve Lacy – Gemini Rights
Si vous n’étiez pas à l’Elysée Montmartre les 16 et 17 décembre dernier, vous avez probablement manqué l’un des meilleurs concerts de l’année. Steve Lacy y jouait son dernier disque, Gemini Rights, un album versatile et minimaliste qui concentre avec brio toutes les influences du jeune musicien. RnB et rock, jazz et funk, vintage et indéniablement moderne, ce nouvel effort confirme ce qu’Apollo XXI (son premier album) semblait déjà nous dire : Steve Lacy est un immense artiste.
LS
✩ Weyes Blood – And in the Darkness, Hearts Aglow
La suite de l’album Titanic Rising sorti en 2019 est arrivée, And In the Darkness, Hearts Aglow est son nom et elle est majestueuse. La couverture l’annonce, Nathalie Mering est photographiée telle une princesse magique avec son cœur lumineux. Un mélange entre une fleur de Fantasia et la Belle de Cocteau. La musique de Weyes Blood est cinématographique et merveilleuse – au sens littéraire – ses chansons racontent des histoires, ce sont des contes modernes. Avec ses mélodies harmonieuses, ses violons et sa voix liturgique Weyes Blood compose des soundtracks de vie. En réponse à la noirceur et l’inquiétude du monde d’aujourd’hui, Nathalie nous propose de visualiser des lanternes en chacun•e de nous: nos cœurs.
JH
Sélection et rédaction : Eva Fottorino, Charles Wesley, Apolline Bazin, Max Deleus, Julia Henderson
Cet article Les 13 meilleurs EP et albums de 2022 provient de Manifesto XXI.


Grand rendez-vous sportif LGBTIQ+, les EuroGames 2023 se tiendront en juillet à Berne. L'événement a besoin de votre soutien.
L’article Soutenez les EuroGames de Berne est apparu en premier sur 360°.

Marius Diserens est spécialiste en question de genre et de diversité et se charge de garantir une large inclusion au sein du magazine. Il partage avec nous ses réflexions actuelles autour du féminisme et des vies LGBTIQ+.
L’article Le mot du mois: Écoféminisme est apparu en premier sur 360°.

C'était une promesse du président Volodymyr Zelenskyy, évoquée après sa rencontre avec Joe Biden en 2021 pour une Ukraine « inclusive et respectueuse des droits des personnes LGBT+ ».
L’article Le parlement ukrainien adopte un projet de loi contre les discriminations LGBTQIphobes est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Les associations STOP homophobie, Mousse et Adheos ont déposé plainte avec constitution de partie civile, ce vendredi 16 décembre, contre l’organisation sénégalaise islamique JAMRA, suite à la publication de nombreux posts injurieux et incitant à la haine et à la violence homophobes sur leur page Facebook « Jamra Ong Islamique », suivie par plus de …
L’article Plainte contre l’organisation sénégalaise islamique JAMRA pour injures et appel à la haine homophobes est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Chaque mois, Payot Librairie propose une sélection littéraire queer avec, ce mois-ci, Julia Reynaud, Monsieur de Sainte Paluche et Colm Tóibín. De quoi trouver l'inspiration pour vos cadeaux de Noël.
L’article La sélection livres queer de fin d’année est apparu en premier sur 360°.

Le procès de Patrice Evra s'est tenu ce jeudi 15 décembre devant le tribunal de police qui a requis une amende de 1500 euros, dont 300 avec sursis, pour ses propos homophobes de 2019.
L’article Une amende de 1 500 euros requis contre Patrice Evra pour injure homophobe est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Magnétique Nord réchauffe décembre à la Station provient de Manifesto XXI.
Les 16 et 17 décembre, le Collectif MU investit la Station – Gare des Mines pour la huitième édition de son festival d’hiver, Magnétique Nord. Deux soirées qui réchaufferont la fin décembre au feu de sonorités nouvelles, venue de l’Est de la France.Voilà huit ans que le Collectif MU s’attache à partager son goût des musiques alternatives et underground. Festival nomade, c’est à La Station Gare des Mines que Magnétique Nord a cette fois posé bagages. Pour l’occasion, la loupe est braquée sur l’Est français. Tout le week-end, la programmation dresse le portrait de cette région, vivier de rock, d’électronique et de sonorités expérimentales.
Le festival s’ouvrira sur la projection de La Grande Triple Alliance Internationale de l’Est, un film de N. Drolc et G. Marietta. Le documentaire tentera de rassembler les quelques pièces du grand puzzle fourbe qu’est ce collectif protéiforme et pluridisciplinaire, qui agit originellement entre Metz et Strasbourg. Puis, Badaboum lancera les hostilités musicales en faisant résonner son punk-rock corrosif dans La Station, avant de laisser la place à France et ses sonorités froides, parcourues de larsens déchirants. Oï Boys enchaînera pour un live de street-wave aux accents punk. Et enfin, Guillaume Marietta AKA DJ Winamp prendra les platines pour clôturer cette première soirée, qui s’achèvera à 02:30.
Samedi soir, rendez-vous à 22 heures. Ce deuxième jour nous fera quitter les sentiers battus du rock par les tambourinements de batteries, direction les chemins plus sinueux des musiques expérimentales. Pour ouvrir la marche, Liliane Chlela, dont l’électro ultra-texturée gronde comme de la lave en fusion. Yeun Elez et ses chansons éthérées, soufflées comme le vent qui joue dans les nuages, investiront la scène avant qu’Officine ne vienne clôturer les lives avec les guitares vrillées de son punk-métal. Mika Oki, Saint Georges et Thi-Léa se relaieront pour trois DJ sets qui viendront étirer la nuit jusqu’à 5h30. Si le thermomètre affichera 0 degrés dehors, le festival Magnétique Nord aura tout ce qu’il lui faut pour réchauffer ce dernier week-end avant les Fêtes.
Pour prendre vos places, cliquez ici.
image mise en avant : Titouan Massé
Cet article Magnétique Nord réchauffe décembre à la Station provient de Manifesto XXI.




Cet article Bastien Vivès au FIBD : la pédocriminalité, une exception culturelle française provient de Manifesto XXI.
Pour ses 50 ans, le Festival International de BD d’Angoulême avait choisi de mettre à l’honneur Bastien Vivès, artiste dont une partie de l’œuvre représente de l’inceste et de la pédo-pornographie. Face à une intense mobilisation en ligne, le festival a annoncé aujourd’hui sa déprogrammation… sans remettre en question la pertinence même de son choix initial.Début 2020, quand elle quitte la salle des César, Adèle Haenel crie « La honte » mais aussi, « Bravo la pédophilie ». Malgré la publication du Consentement de Vanessa Springora, l’affaire Matzneff et le travail acharné de militant·es, la France se refuse toujours à faire le lien entre #MeToo et la pédocriminalité. Pire, le milieu de la culture français rechigne à prendre en compte les réflexions sur les mécanismes de dominations produites ces cinq dernières années. Tout le discours tenu autour de la défense du projet de carte-blanche à Bastien Vivès au festival de la Bande Dessinée d’Angoulême, et puis son annulation, le prouve.
Sexisme, inceste et pédo-pornographie: dans le regard de Bastien VivèsEn 2018, nous avions édité un article Lolita a bon dos, le problème avec Bastien Vivès. Le texte fait état du sexisme dans l’œuvre de cet artiste célèbre qui venait également de publier Petit Paul (Glénat), une BD pédo-pornographique représentant des scènes d’inceste. Depuis, Vivès a produit bien d’autres romans graphiques, et il est régulièrement invité dans des médias (comme Le Monde cet été, France Inter en octobre) sans que ses œuvres pornographiques ne soient jamais sérieusement abordées.
Or, le 28 novembre, le Festival International de Bande Dessinée d’Angoulême annonçait une exposition « Dans les yeux de Bastien Vivès ». Depuis cette annonce, la colère était palpable en ligne avec notamment deux pétitions pour demander la déprogrammation de l’exposition : l’une lancée par le Mouvement Écoles d’Art en Danger d’Angoulême, et l’autre par Arnaud Gallais (co-fondateur de l’association Be Brave). Celle-ci compte plus de 100 000 signatures. A ce contexte déjà tendu s’est ajoutée la promotion de Falcon Lake, adaptation d’une œuvre de Vivès par Charlotte le Bon.
C’est la première fois que l’œuvre de cet artiste fait l’objet d’une mobilisation de cette ampleur. Pourtant, dans un article publié sur Libération, le 11 décembre, le co-directeur artistique du festival d’Angoulême Fausto Fasulo indiquait que la déprogrammation n’était pas envisagée car « Ce serait une défaite philosophique énorme ». Mais une défaite pour qui au juste ? Pour la grandeur de l’art ou pour l’ego d’une équipe curatoriale ?
Représenter des « tabous » qui n’en sont pasDans Libé, l’éditeur de Bastien Vivès, Benoît Mouchard, s’inquiétait aussi : « Est-il désormais impossible de représenter les tabous ? ». Ce que peinent à comprendre ces messieurs qui entourent l’artiste, c’est que ce qu’ils appellent « bouffonnerie », pour les victimes de pédocriminalité, c’est : 20 ans d’espérance de vie en moins, des parcours de vie fracassés, des problèmes de santé chroniques non pris en charge, un taux de suicide à la courbe exponentielle, la perpétuation de la chaîne de la violence.
Ce qu’ils appellent « tabous » ne révèle que leur décalage avec la réalité. L’inceste et la pédocriminalité ne sont malheureusement pas des actes anormaux. C’est même la norme : en France, elles concernent au moins 1 enfant sur 10, sous le regard permissif de l’Etat français, qui a toujours traîné des pieds pour ne serait-ce que regarder l’ampleur du problème en face – on se souvient de la bataille parlementaire hallucinante autour de la demande de la protection des enfants contre les violences sexuelles, qui a connu tous les freinages possibles de la part de l’exécutif. Ainsi, l’interdit n’est pas l’inceste, tous les chiffres, même les plus restrictifs, le démontrent de façon éclatante. L’interdit, c’est de dire qu’on a été victime. En cela, l’inceste est « le berceau des dominations » pour reprendre le titre de l’ouvrage pionnier de la chercheuse Dorothée Dussy. A quoi bon prétendre faire de l’art en représentant des actes criminels, quand la société est incapable de prévenir la violence contre les plus vulnérables ?
Dans une pédocriminalité systémique, comment peut-on assurer sans aucun doute que les 9 093 exemplaires vendus de Petit Paul seront lus avec une distance critique ? Dans un contexte où ces représentations « burlesques » de la pédocriminalité (selon les mots de Vivès dans Libé) sont considérées comme « bouffonnerie », impossible de se poser réellement la question du fantasme, de son innocuité et du passage à l’acte. Ce qui est certain en revanche, c’est qu’il y a des gens qui meurent – littéralement – pour produire de la pensée sur la pédocriminalité, comme le raconte l’introduction du brillant essai La culture de l’inceste (Seuil).
Voir cette publication sur InstagramLa « liberté d’expression », un permis de laisser-faireUne publication partagée par Festival de la BD d’Angoulême (@bdangouleme)
Sans prendre position sur ce problème de fond, le communiqué de déprogrammation du FIBD se targue de rappeler que l’œuvre de Bastien Vivès relève de « la liberté d’expression » et ce sont les menaces reçues par l’auteur qui expliquent l’annulation de l’exposition. Certes, les gens sont en colère et n’y vont pas gentiment pour dire leur indignation. S’il faut le rappeler avant de poursuivre, rien ne peut justifier le harcèlement et les menaces de mort à l’encontre d’une personne, même un auteur dont l’œuvre est condamnable. Cependant, la « liberté d’expression » est trop souvent utilisée comme argument paratonnerre à toute remise en question pour des personnes dominant·es dans le champ des arts, leur conférant de fait un statut d’exceptions à la loi. Cette dernière est pourtant claire : la pédopornographie est interdite… sauf si vous arrivez à en faire quelque chose parlant le langage des institutions culturelles ? De « beau ».
Le communiqué rappelle que Bastien Vivès n’est à ce jour visé par aucune plainte et n’a à notre connaissance commis aucun crime. Malheureusement en France, même des aveux en bonne et dûe forme ne suffisent pas à condamner, ni l’homme, ni l’artiste. Roman Polanski, après ses aveux de viol sur une fillette de 13 ans, est protégé de la justice américaine par la France. Il continue d’être récompensé par les institutions françaises et rayonne. Il en va de même pour les violeurs qui publient leurs aveux en Une de Libération (toujours eux…), jamais inquiétés d’être rattrapés par la justice. Bref, Vivès pourrait bien crier sur les toits qu’il est coupable : cela ne suffirait pas à le rendre persona non grata.
Ce qui nourrit la révolte de celles et ceux qui s’élèvent contre ce choix curatorial aujourd’hui, c’est que célébrer le regard de Vivès autorise, loin d’une subversion, à maintenir le statu quo : un permis d’objectifier, agresser, violer, et d’en rire. En France, seulement 1% des viols sont condamnés. Quand on légitime un créateur dont une partie de l’œuvre réifie les femmes et les enfants, s’amuse d’actes criminels, le pire reste acceptable, cool. A Libé, le co-directeur du FIBD parle d’un esprit « trollesque » pour caractériser l’œuvre de Vivès… Lorsqu’il est perpétré par un dominant, le harcèlement n’est plus un délit dont on s’offusque, mais du “troll” dont on se délecte. L’artiste publiait encore cet été une série de caricatures lesbophobes sur son compte Instagram (depuis supprimées) qui ne nous ont pas du tout fait rire.
Ces dernières années, la liberté d’expression, ce fondement de la vie démocratique, a été trop souvent utilisé comme un cache-misère intellectuel. Une fin de non-recevoir aux voix qui s’élèvent pour dire que oui, certaines choses ne sont plus acceptables.
Le FIBD face à ces responsabilitésLa classe politique mais aussi la gauche Libération justement, celle qui domine la vie culturelle, artistique et intellectuelle de ce pays, n’a jamais fait son devoir d’inventaire vis-à-vis de sa célébration historique de la pédocriminalité, de la “pédophilie”. Oui, la pédocriminalité est un système normalisé en France, et les institutions culturelles jouent un rôle clé dans le maintien des systèmes de domination. Le FIBD est le plus grand événement du 9e art en France, c’est une institution professionnelle. Que doit-on comprendre alors quand on choisit de célébrer un homme qui a publiquement écrit des horreurs sur une de ses collègues et produit une caricature humiliante de son travail ? Dans un post ce lundi 11, Emma, l’autrice de La Charge mentale a exposé les commentaires violents qu’a formulé Bastien Vivès à son égard, avant de publier sa parodie La Décharge mentale (Les Requins Marteaux) qui met en scène une famille incestueuse. Au bout du compte, Vivès s’est donc rendu coupable de menaces sur la dessinatrice Emma mais surtout ses enfants*, alors qu’il dessine de la pédopornographie et a déjà déclaré que l’inceste « ça m’excite à mort ».
Dans son communiqué le FIBD prétend ne pas avoir eu connaissance des propos immondes sur l’inceste tenus par Bastien Vivès à plusieurs occasions. Soit, mais l’existence même de Petit Paul, La décharge mentale et Les Melons de la colère suffisaient à écarter son nom. Pourquoi faire rayonner le travail de cet auteur, par ailleurs déjà récompensé de multiples fois ? La BD française compte nombre d’autrices géniales, qui en plus se sont mobilisées contre le sexisme dans leur domaine. En faisant le choix initial de Vivès, le FIBD leur a craché au visage.
Le FIBD voudrait maintenant se poser en lieu de débat avec un « forum prospectif » où les personnes qui ont pris la parole ces derniers jours seront invitées. Qu’il est cynique de prétendre s’acheter la paix à peu de frais maintenant que toutes les personnes victimes de pédocriminalité sont humiliées. Il faudra être à la hauteur dans la manière de poser les termes du débat en janvier. Dans les pages de Libé, avant annulation, il était fait mention de deux discussions, l’un sur la « liberté d’expression » et l’autre sur « la représentation érotique des rapports hommes-femmes dans le monde post-#MeToo ». Un intitulé encore une fois, dramatiquement à côté de la plaque.
Nombre de talents seront rassemblés aux 50 ans du FIBD. Quels moyens seront réellement alloués pour trancher ces « questions aussi anciennes que l’art » comme le dit le communiqué ? Qui sera mobilisé pour qu’il reste une trace de ces échanges, qui concernent l’industrie de la BD et la société dans son ensemble ? Peut-on in fine encore espérer que le monde l’art réussisse à tirer des leçons de cet épisode ? Le défi est devant vous, chèr·es organisateur·ices du FIBD.
Image à la Une : Couverture de Petit Paul, Bastien Vivès (Glénat, 2018)
* Mise à jour le 16 décembre, 11h : Bastien Vivès a publié un communiqué sur son compte Instagram jeudi 15 décembre 12h. Il y présente notamment ses excuses à Emma.
Cet article Bastien Vivès au FIBD : la pédocriminalité, une exception culturelle française provient de Manifesto XXI.


Cet article L’univers d’Olympe4000 en 10 références provient de Manifesto XXI.
Naviguant entre les scènes de Berlin et Paris, Olympe4000 développe une musique techno, technique et efficace de plus en plus reconnue. Il y a quelques semaines nous avons croisé la DJ et productrice au NDK Festival. Elle nous a partagé les 10 éléments – personnes, ouvrages, artistes – qui l’inspirent dans son quotidien.On suit maintenant Olympe4000 depuis quelques temps, elle avait notamment participé à notre compilation (R)AGE, parue en 2021. Il nous tardait de rencontrer cette artiste pleine d’énergie, de sororité et de spontanéité lors de son passage au NDK Festival. « Ce que je propose c’est vraiment un décloisonnement des styles. (…) J’ai fait très longtemps de la musique, une dizaine d’années de batterie, j’ai fait du solfège et après je me suis spontanément tournée vers Ableton, la prod etc. avec mon frère on s’était acheté des machines. Au final je me suis rendue compte que les machines ce n’était pas vraiment pour moi, j’ai décidé de me recentrer sur les logiciels, j’ai commencé la prod et puis j’ai pris des cours intensifs.(…) Sur (R)AGE pour Manifesto c’est la première track que j’ai véritablement sortie. » se remémore-t-elle. C’est le troisième jour du festival et elle s’apprête à monter sur scène : « La programmation je la trouve géniale cette année, car ici il y a plein de meufs avec qui on a commencé en même temps en fait. On a une vraie solidarité entre nous sur scène, je suis copine avec Saku Sahara, Bambi et Bernadette par exemple. C’est beau de voir que l’on avance toutes ensemble, et notamment avec les meufs de Zone Rouge qui sont là aujourd’hui. »
Lors de cet événement, Olympe nous a partagé les 10 inspirations personnelles qui font l’artiste qu’elle est aujourd’hui.
Les 10 inspirations d’Olympe4000« Pour tout son parcours artistique, politique, et les idées qu’elle défend. »
« Des regards critiques toujours différents sur la musique à retrouver ici. »
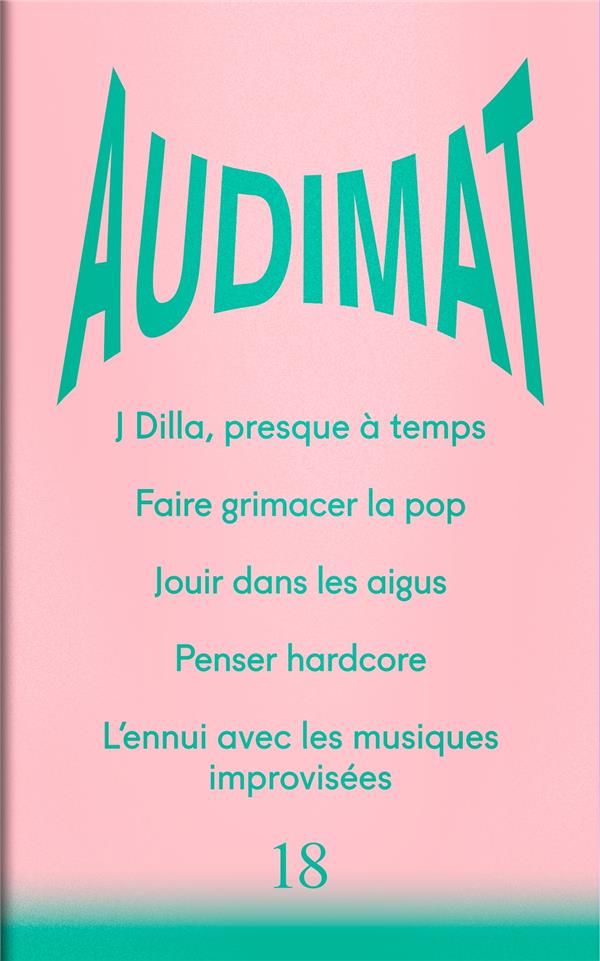 Le dernier tome de la revue Audimat
Le dernier tome de la revue Audimat
« Car ce que j’aime le plus au monde, c’est apprendre de nouvelles choses et échanger. »
« Un gouffre de l’histoire musicale, une source sans fin de connaissances, que j’explore pendant des heures. »
(Tout simplement, il suffit de jeter un oeil à la photo de profil Instagram d’Olympe.)

« Une écrivaine franco-cubaine, l’une des premières à écrire des ouvrages érotiques au début du XXème siècle, elle parle de ces amours adultères, du désir et du plaisir féminin, des tourments et des réflexions sur la condition des femmes. Elle défendait que nos vies rêvées doivent engendrer nos vies réelles. »
« Militante antiraciste française, fondatrice du Comité vérité et justice pour Adama et milite contre les violences policières. »
« Un livre datant de 2004, où Damasio canalise sa colère dans l’écriture. C’est un roman initiatique : une planète habitée par un terrible vent, un vent sans fin, un vent à toute force, qui la balaye en permanence. Toute la vie en est marquée : les êtres qui l’habitent, semblables à nous en tout point, ont pourtant évolué, techniquement et culturellement, dans une autre direction, sous l’influence de cette invincible et permanente tempête, privilégiant le mouvement et l’incertitude à toute forme de construction ou de technologie. »
« Depuis 2015, le duo tresse une pop techno hybride aux multiples niveaux de lectures. Mêlant les codes du black metal à une chanson française électronique réinventée, GARGÄNTUA ne ménage pas son public. Entre le trash et l’ironie, c’est un vibrant décalage que le groupe réussit à provoquer, fédérant adeptes et néophytes en une seule et même marée humaine qui fête ce moment de choix où tout est permis. GARGÄNTUA s’impose comme une figure émergente de la nouvelle scène francophone et marque sa récente collaboration avec PIAS en dévoilant l’EP Immoral & Illégal. »
Écouter et suivre Olympe4000 : Instagram, Facebook, Spotify, SoundCloud
Photo de couverture : Olympe4000 par Grégory Forestier pour NDK Festival
Article relu et édité par : Pier-Paolo Gault
Cet article L’univers d’Olympe4000 en 10 références provient de Manifesto XXI.



À l’approche de Noël, la distinction «fille»/«garçon» tend à disparaître des catalogues et des rayons. Mais les vêtements et jouets genrés demeurent bien souvent présents. Heureusement, de plus en plus de marques brisent les codes.
L’article Vêtements et jouets genrés: diviser pour mieux vendre est apparu en premier sur 360°.

« Une avancée cruciale vers l’égalité, la liberté et la justice, pas seulement pour quelques-uns mais pour tout le monde » a salué le président américain en signant la loi, sous les acclamations de plus de 5000 invités.
L’article États-Unis : Joe Biden promulgue la loi protégeant le mariage égalitaire dans tout le pays est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Victoire pour les associations LGBT : les personnes vivant avec le VIH pourront désormais servir dans la police nationale, sans discrimination liée à leur état de santé.
L’article Fin de la discrimination liée au VIH dans la police nationale est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.




Le Tribunal correctionnel de Paris a condamné 11 personnes pour harcèlement et menace homophobes dans l’affaire Eddy de Pretto. Mousse et STOP homophobie s’étaient portées parties civiles aux côtés de l’artiste.
L’article Trois à six mois de prison avec sursis pour les cyberharceleurs d’Eddy de Pretto est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Klein Zage : l’écriture comme réconfort provient de Manifesto XXI.
Klein Zage sortait fin octobre son premier LP Feed The Dog sur le label Rhythm Section, une introspection poétique et consciente sur les choses de la vie.Si Sage Redman est originaire de Seattle, berceau de la musique grunge, ses déménagements successifs à Londres, Berlin et New York et les changements de décors façonnent son processus musical et son style d’écriture. Ses deux précédents projets, Womanhood (2019) et Tip Me Baby One More Time (2020), mêlent des sons inspirés de la scène house et techno des années 80 et 90 à des commentaires sociaux parlés sur les thèmes de la féminité et de la vie urbaine. Avec Feed The Dog, Sage explore un nouveau terrain, redéfinit son image en tant qu’artiste et s’affranchit des limites du genre. Ce que l’on pourrait considérer comme un nouveau départ rejoint en réalité la musique qu’elle a toujours faite, mais qui n’était jusqu’alors jamais parvenue à nous. À l’intersection de l’alt-pop, du trip-hop et du shoegaze, cette collection de morceaux dévoile la profondeur lyrique de l’artiste, autant que sa sensibilité émotionnelle.
 © Drew Reilly
© Drew Reilly
Manifesto XXI – Dans le communiqué de presse, on peut lire que l’album est « à la fois du réalisme d’observation, un appel au secours et une lettre d’amour à Londres ». Qu’as-tu voulu exprimer dans ce disque ?
Klein Zage : Avec cet album, je voulais exprimer un sentiment profond de réconfort. Il y a de la nostalgie, de la mélancolie, mais dans l’ensemble, il s’agit d’acceptation et de satisfaction à un moment précis de la vie.
Il y a quelque chose de très beau dans le fait d’avoir d’autres choses dans sa vie pour recontextualiser son ego et élargir sa définition de soi.
Klein Zage
Comment se sont déroulées la création et la composition de cet album ?
Certaines de ces chansons sont restées en studio pendant de nombreuses années, constamment réécrites, réarrangées, dotées d’une nouvelle vie ; d’autres ont été composées en une traite et étaient bien plus brutes lorsqu’elles sont arrivées.
Ton style musical a évolué depuis tes précédents projets, ton processus a-t-il également évolué ? En quoi ce nouvel album est-il différent de ce que tu as fait auparavant ?
Même si j’ai sorti des musiques très différentes sous le nom de Klein Zage auparavant, c’est le type de musique que je fais depuis le plus longtemps. Les musiques club que j’ai pu sortir auparavant étaient des écarts assez amusants par rapport à mon style d’écriture habituel. La sortie de ce disque donne l’impression de boucler la boucle, de revenir à mes racines et aux influences qui m’ont traversée quand j’étais enfant et jeune adulte, et ça m’a semblé vraiment naturel.
L’écriture a toujours été pour moi une forme de réconfort et un moyen de traiter ou d’observer intentionnellement les choses qui se déroulent dans ma vie.
Klein Zage
Ta posture d’artiste semble également avoir évolué, peux-tu m’en parler ?
Je n’en suis pas certaine ! Cet album a définitivement une note plus sérieuse que les EPs Womanhood et Tip Me Baby One More Time, pour lesquels j’avais usé de sarcasmes et fait preuve d’un peu plus d’humour dans la production et les paroles. Feed The Dog est globalement beaucoup plus émotionnel et sincère. J’ai également pensé qu’il était approprié de me centrer sur la pochette de l’album et la vidéo pour incarner les thèmes de l’album.
Il peut être difficile de montrer autant d’honnêteté dans des textes, comment te sens-tu lorsque tu poses des mots sur des émotions ? Et en réécoutant aujourd’hui ces chansons ?
Je ressens une véritable sensation de catharsis, comme une libération de choses que je porte quotidiennement en moi, parfois sans le savoir. L’écriture a toujours été pour moi une forme de réconfort et un moyen de traiter ou d’observer intentionnellement les choses qui se déroulent dans ma vie. Ces chansons résument vraiment un moment particulier pour moi, une période de ma vie où je ressentais beaucoup de choses en même temps. Les réécouter me transporte, c’est le moins que l’on puisse dire !
 © Drew Reilly
© Drew Reilly
Partages-tu autant de sentiments dans la vie avec tes proches ?
J’aimerais me considérer comme une personne émotionnellement intelligente, mais je suis introvertie et j’ai parfois du mal à exprimer mes sentiments avec éloquence dans une conversation, à défendre mes intérêts. Peut-être donc qu’il m’est toujours apparu plus facile de le faire en musique.
Prendre soin de ceux que tu aimes, chérir les trivialités de la vie semble avoir beaucoup d’importance pour toi.
Il y a quelque chose de très beau dans le fait d’avoir d’autres choses dans sa vie pour recontextualiser son ego et élargir sa définition de soi. Je me suis toujours sentie comme quelqu’un qui jouait deux rôles à la fois. Le tiraillement entre le rôle d’aidant et celui d’artiste en moi a souvent cédé la place à l’ambition personnelle. Le confort et le bonheur d’être heureuse dans un rôle humble – que ce soit celui d’épouse, de mère, de sœur, etc. – m’ont fait réfléchir aux attentes de notre société concernant la carrière et l’ambition, et aux stigmates souvent associés à la poursuite d’une activité créative, à l’idée que si l’on s’engage dans un domaine artistique, il faut se recentrer sur soi-même et être égoïste.
Le thème de la famille semble occuper une place importante dans ta vie. Qui considères-tu comme ta famille aujourd’hui ?
Ma famille est petite. C’est mon mari et partenaire créatif Joe, même si nous nous sommes récemment séparés. C’est mon chien Steves et mon chat Bobby Bacala. C’est ma sœur, qui est aussi ma meilleure amie. Il y a aussi des ami·es que je considère comme ma famille, et iels se reconnaîtront.
La vidéo de « Bored, With You » est sortie en même temps que l’album. Quelle a été la direction artistique derrière ce clip ?
Le clip était une ode à Kozel’s, un restaurant dans le nord de l’État de New York. Il m’a servi de deuxième maison ces deux dernières années, depuis que j’ai quitté la ville, et il représente vraiment tout ce que j’admire dans une entreprise familiale. D’un point de vue esthétique, c’est aussi un espace incroyable, parfaitement daté, avec un énorme bar en acajou, des portraits de famille aux murs et une bonne dose d’accessoires des Red Sox. J’adore Twin Peaks et une grande partie des images que le réalisateur Murdo Barker Mill et moi-même avons utilisées pour la vidéo faisaient référence à la beauté catatonique d’un espace d’accueil vide et à un cadre étrange, boisé, au milieu de nulle part. Depuis la sortie de Tip Me Baby One More Time, j’ai toujours voulu tourner une vidéo dans un restaurant vide et ce clip en était la parfaite occasion. Ça fait aussi écho aux thèmes de l’album – le sentiment de confort solennel dans un lieu chaleureux, un lieu qui célèbre la famille, où les familles viennent depuis des générations pour se réunir et partager un repas.
La photo de la pochette du disque semble avoir été prise au même endroit que celui où la vidéo a été tournée. Peux-tu me raconter son histoire ?
Oui, c’est bien ça ! Kozel’s est vraiment devenu le point d’ancrage visuel de l’album. La photo devait mettre en évidence des thèmes similaires à ceux de la vidéo. Je porte un peu une tenue spéciale « déjeuner d’affaires », mais assise seule dans un endroit où tant de gens se sont réunis avant moi. Je trouvais important, d’un point de vue visuel, de m’asseoir à une table pour quatre, et non pas seule au bar.
Relecture et édition : Pier-Paolo Gault
Cet article Klein Zage : l’écriture comme réconfort provient de Manifesto XXI.

Jusqu’au 19 février 2023, l’Institut du Monde Arabe, à Paris, donne la parole à une vingtaine d’artistes queer dans un tour d’horizon de la création contemporaine artistique d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.
L’article Représenter un orient queer est apparu en premier sur 360°.

Commentateur pour CBS Sports, il avait récemment dénoncé son refoulement d'un stade et détention au Qatar pour avoir porté un T-shirt arc-en-ciel.
L’article Le journaliste sportif américain Grant Wahl décède en plein match au Qatar est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

L’adultère sera ainsi passible d’un an de prison et les couples non-mariés qui habitent ensemble pourraient encourir jusqu'à six mois de prison.
L’article Indonésie : le Parlement criminalise les relations sexuelles hors mariage est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

La mobilisation était générale. Nous l’avions toutes et tous sollicités et ce samedi soir, présente en tribune à Doha pour assister au match de l’équipe de France face à l’Angleterre (quart de finale), la ministre des Sports française Amélie Oudéa-Castera nous a fait la surprise d’arborer un polo bleu avec les épaules et les manches …
L’article Droits LGBT+ : Au Qatar, la ministre des Sports française arbore un pull aux manches « arc-en-ciel » est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Le texte voté jeudi interdit aux agents d’état civil, quel que soit l’Etat, de discriminer les couples « en raison de leur sexe, race, ethnicité ou origine ».
L’article Le Congrès américain adopte une loi protégeant le mariage pour toutes et tous est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Virgile : collisions sonores de l’intime à l’universel provient de Manifesto XXI.
À l’occasion de la sortie de son premier EP Deflection of Realness sur le label berlinois Unguarded, on a rencontré le jeune producteur marseillais Virgile. Entre field recording et expérimentations électroniques, son univers cherche à s’émanciper des tendances pour toucher à plus grand que soi.Performances de poésie sonore, lives d’ambient expérimentale en pleine nuit, banquets et scénographies féériques en après-midi, au bord de l’eau ou sur les hauteurs des calanques… La scène alternative marseillaise ne cesse de se renouveler, au rythme de collectifs sans nom qui repensent nos façons de se réunir, de boire, de manger, et d’écouter de la musique. C’est au détour d’une de ces joyeusetés printanières, entre les murs d’une chapelle abandonnée dans le nord de la ville, que j’ai été pour la première fois happée par les nappes magistrales de Virgile. Dissimulé sous sa casquette à strass et ses cheveux longs, le musicien virevoltait entre son ordinateur, sa guitare et son synthé, chef d’orchestre de paysages sonores fantastiques qu’il faisait naître devant nos yeux.
Sorti le 4 novembre sur le label berlinois Unguarded, son premier EP Deflection of Realness raconte la création d’un monde. D’une genèse argileuse (« Emerge From Mud »), on entend résonner les échos de chants lointains, rapidement noyés dans une floraison d’arpèges sous delay lancinant. On pourrait croire au début d’une berceuse (« Dawn Ritual »), avant que le frissonnement des cordes (« Swamp ») se fracasse contre les textures glitchées chaotiques, les rythmiques imprécises et les voix saturées jusqu’à frôler la noise dissonante (« We Shall Fall »). Six titres électroniques imprévisibles, dans lesquels on ne sait plus bien si c’est du larsen que naît l’harmonie, du calme que surgit la tempête, peut-être l’inverse, ou tout ça à la fois.
 Virgile, Deflection of Realness © artwork Nino Mombrun
Virgile, Deflection of Realness © artwork Nino Mombrun
Une collision des contraires qui s’explique par un processus créatif expansif proche de l’improvisation. À l’image de sa musique, le flot de paroles de Virgile est généreux lorsqu’on le rencontre sous le soleil d’un matin sur la Plaine. « Je commence souvent par les détails, des choses un peu aléatoires. Je dirais même qu’à la base, c’est presque du bruit, du sound design. Je pars du matériau sonore, ensuite j’essaye de le rendre musical, de trouver ce qui va bien sonner à l’intérieur de ça. Parfois ce sera juste une note par-ci par-là, des petites harmonies. Du coup j’arrive assez rapidement à une forme hyper destructurée et chaotique, dans laquelle il faut que je mette de l’ordre. Je ne me fais vraiment pas de cadeau, c’est toujours une galère après ! »
Cette ligne ténue entre l’expérimentation et la contrainte, entre la liberté et la discipline, Virgile l’a travaillée tout au long d’un parcours marqué par un enseignement classique dont il a appris à se détacher. Il commence la guitare à l’âge de 6 ans, poursuit des cours particuliers à Tokyo avant de revenir en France et d’intégrer le conservatoire régional de Nancy à l’adolescence, avec une grande virtuosité technique mais sans aucun bagage en solfège. On lui propose des classes aménagées à cheval entre deux cycles, un emploi du temps intenable qui lui laisse quelques traumas et l’amène à une première rupture radicale. « Petit, j’étais comme un singe savant, je jouais de la guitare avec un très bon niveau technique mais pas forcément beaucoup de musicalité. La formation classique a tendance à résumer la musique à une partition, une suite de notes, sans prendre forcément en compte les caractéristiques de l’instrument, son timbre et ses particularités. Ce rejet du conservatoire m’a permis de découvrir la musique vraiment différemment. »
 © Corinne Lê
© Corinne Lê
Au lycée, l’ambient et en particulier l’album Bad Vibes de Shlohmo marquent le jeune musicien déjà désabusé, « notamment dans l’utilisation qui y est faite de la guitare, sur quelques accords très simples en boucle. On peut faire varier une note selon des facteurs différents, la spatialisation, plein de subtilités… » Il en tire des envies nouvelles, et des expérimentations, dont celle de « jouer avec des instruments désaccordés. C’est un bon exercice pour prêter attention au son en lui-même ». Une passion du détail et du réel que Virgile développe à travers le field recording, inspiré par les environnements naturels hors des villes, qu’il vient teinter d’artefacts numériques, en bon enfant d’une génération qui a trouvé refuge dans les jeux vidéo et les réseaux virtuels, « une fuite de la réalité, seul·e chez soi derrière son ordinateur ou son téléphone ».
Après quelques projets précédents qu’il juge non aboutis et efface finalement des internets, cette première sortie en tant que Virgile consacre la naissance d’une identité artistique plus affirmée. Mais s’il utilise désormais son propre prénom, « il ne s’agit pas de moi. On met forcément de soi dans ce qu’on raconte, mais exposer son intimité dans la forme la plus brute aux autres, ce n’est pas toujours agréable. Il faut transposer son histoire dans une narration, dans une histoire ». Une quête d’universalité qui entend aller au-delà des tendances, de l’esthétique, des goûts et des couleurs de l’époque, pour toucher à plus grand que soi. La recherche d’une musique hors du temps, et clairement hors des 4-temps.
Deflection of Realness by VirgilePhoto à la Une : © Maxime Morice
Cet article Virgile : collisions sonores de l’intime à l’universel provient de Manifesto XXI.

Vladimir Poutine a entériné ce 5 décembre sa loi contre la « propagande LGBT » et « agents étrangers », qui durcit la législation qui existait déjà en Russie depuis 2013. Le texte, entré en vigueur ce 8 décembre, proscrit désormais toute « présentation positive des relations non traditionnelles » dans l’espace public, dans les médias en …
L’article Auto-censure des commerces russes menacés par la loi contre la « propagande LGBT » est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.



La région Ile-de-France, présidée par Valérie Pécresse, suspend ses financements pour 2023 aux Ateliers Médicis, un espace culturel situé en Seine-Saint-Denis qui accueille en résidence l'auteur Mehdi Meklat, dont les tweets antisémites, homophobes, racistes et misogynes avaient suscité la polémique en 2017.

Alors que la quinzaine de la visibilité intersexe a débuté à Lyon le 26 octobre, il faut noter un arrêt fondamental pour le droit des personnes intersexes, rendu la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) le 19 mai dernier.
Dans cette affaire, dirigée contre la France (M. contre France), Mö se plaint que la justice française ait refusé de faire aboutir sa plainte pour « violences ayant entraînées une mutilation ou une infirmité permanente sur mineur de 15 ans ou personne vulnérable » , dénonçant ainsi son assignation forcée au sexe féminin, subie dès son plus jeune âge, avec des opérations chirurgicales lourdes alors même que Mö n’avait aucun problème de santé.
La CEDH a jugé la plainte irrecevable, indiquant que Mö n’avait pas épuisé toutes les voies de recours nationales (une condition obligatoire pour se tourner vers la CEDH). La Cour aurait pu s’arrêter là, mais ce n’est pas le cas. Elle prend l’initiative de préciser que l’absence d’intention de nuire des médecins n’exclut pas que des violences aient été commises: ‘“un acte de nature médicale, réalisé sans nécessité thérapeutique et sans le consentement éclairé de la personne qui en est l’objet, est susceptible de constituer un mauvais traitement” . Ainsi la Cour pose pour la première fois que les mutilations médicales d’enfants intersexes contreviennent à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme disposant que “nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants”.
Bien qu’il soit extrêmement décevant que le recours ait été jugé irrecevable par la Cour, le positionnement de la CEDH est tout à fait encourageant pour l’avenir. Et ce d’autant plus que la nouvelle loi de bioéthique, et en particulier son article 30 relatif à la prise en charge des “enfants présentant une variation du développement génital”, n’interdit pas ces mutilations alors qu’elles sont dénoncées par l’ONU depuis 2016 et qu’une résolution pour les bannir a été adoptée par le Parlement européen en 2019.
La loi doit être complétée par un arrêté “fixant les règles de bonnes pratiques de prise en charge”. Espérons que le positionnement de la CEDH, qui sonne comme un avertissement, inspirera les rédacteur·rices de cet arrêté et les encouragera à dissuader le corps médical de pratiquer à l’avenir des mutilations sans aucun intérêt thérapeutique.
L’article Mutilations des enfants intersexes : une décision porteuse d’espoir est apparu en premier sur Hétéroclite.

STOP homophobie recherche un.e étudiant.e en gestion de projets évènementiels, pour l'organisation de nos conférences, rencontres annuelles, pour la marche des Fiertés Paris/IDF également, ainsi que Fiertés Rurales
L’article Recherche d’un.e alternant.e chargé.e de <em>projets événementiels</em> est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

STOP homophobie recherche un.e étudiant.e en gestion de projets évènementiels, pour l'organisation de nos conférences, rencontres annuelles, pour la marche des Fiertés Paris/IDF également, ainsi que Fiertés Rurales
L’article Recherche d’un.e alternant.e chargé.e de <em>projets événementiels</em> est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.

Cet article Transvocalités 5/5 : Rabit, une transience queer provient de Manifesto XXI.
Dans Transvocalités, notre chroniqueur Charles Wesley sonde comment les voix enregistrées, samplées, traitées, pouvant participer d’un processus émancipatoire, s’incarnent au sein des musiques électroniques actuelles. Pour ce cinquième épisode, il rencontre Rabit, un artiste Texan discret mais affirmé, voire revendicatif. Sur What Dreams May Come, il met en lumière une transience queer. La transience, en génie électrique ou mécanique, est une réponse transitoire, réponse d’un système à un changement d’un équilibre ou d’un état stable. Celle-ci n’est pas nécessairement liée à des événements brusques mais à tout événement qui affecte l’équilibre du système. Par analogie, ce projet musical de Rabit fait entendre des voix qui existent dans un système, en le défiant ou en s’y adaptant librement.Précédé d’un hiatus, son projet instrumental et électronique, What Dreams May Come, paru le 25 novembre sur son label Halcyon Veil, s’éloigne du club et essaie de faire coïncider les attraits de la mixtape à ceux de l’album et du journal intime. En résulte un projet constellée de voix (celles d’Embaci, de Lauren Auder, de John Beltran & Baby Blue, de Eartheater…) qui, dans une orchestration souple, semblent toutes s’interconnecter. Méfiant des réseaux sociaux, où pour lui il est plus question d’argent et d’égo que d’art, il préfère jouer le moins possible à ce jeu là. En dehors des lives, il veut explorer des espaces et temporalités différentes, comme les galeries d’art qui demandent un type d’attention que le stream ou l’écoute en concert/chez soi ne permettent pas. Collaborateur par le passé de Björk et de Arca (« Losss », Utopia (2017)), rendez-vous donc avec Rabit, un artiste encore trop méconnu.
Manifesto XXI : What Dreams May Come semble aller plus loin que tes albums précédents. Il y a de nouveau des paysages sonores expérimentaux brillants, mais cette fois les instruments acoustiques se mêlent davantage aux textures numériques. Serais-tu d’accord de dire que celui-ci est plus contemplatif et ancré, peut-être moins abrasif ? Il s’étend aussi plus sur la durée.
Je suis d’accord avec tout ça. J’ai fait un effort pour rencontrer l’auditeur·ice à mi-chemin, entre une voie plus accessible et une approche toujours personnelle, si cela fait sens.
Jusqu’ici j’ai eu mon propre agenda : je n’ai pas d’objectif comme « je veux que ça soit diffusé, ou que les gens jouent ça dans leur voiture ». Avec What Dreams May Come, ça a été pareil, avec plus de temps dans la phase de montage, de réflexion, d’écoute. En tant que musicien, cela a été interne et nuancé. C’est une combinaison de ce que j’écoute depuis mon hiatus, depuis Utopia (Björk). Ce projet c’est un ensemble, un album collaboratif. Il s’agissait de tendre la main à des personnes qui, selon moi, avaient une étincelle créative à laquelle je m’identifiais, que je pensais précieuse et intéressante, et de leur donner un espace pour faire leur truc. En quelque sorte, qu’iels rentrent dans ce collage. On peut entendre également d’autres musicien·nes, et l’album rend aussi compte de la façon dont je pourrais produire le son d’autres personnes en ce moment.
Les cordes ajoutent de la chaleur aux rythmes et à l’électronique, et il y a une intimité palpable dans ce projet. Parfois, c’est comme si nous étions assis sur un canapé avec quelqu’un·e, écoutant ce qu’iel avait à dire dans l’instant T.
Comme parler à un ami pour voir comment iel va. Il n’y a rien de prévu à la conversation, vous voulez juste leur laisser de l’espace, parler ou être. J’apprends que cela fait partie d’être un bon ami. Parfois il n’y a rien à dire, il faut juste être disponible. Je voulais adapter mon album à différentes manières d’utiliser l’audio dans cette optique chaleureuse et amicale.
La musique électronique ne me satisfaisait pas. J’étais genre, faire des sons, faire des morceaux c’est cool mais je n’étais pas épanoui en tant qu’adulte. Je voulais mûrir et parler des défis et des étapes auxquelles différents ami·es faisaient face dans leur vie.
Est-ce une conséquence de la pandémie le besoin de collaborer autant ?
C’est peut-être plutôt dû à la nature transitoire des personnes queer. À certains de mes ami·es avec qui je parlais pendant la réalisation de l’album, je leur ai dit de m’envoyer des notes vocales. Des ami·es ou des personnes avec qui j’ai joué des concerts et avec qui j’étais en contact, qui vivaient dans un état différent, que nous étions en pandémie ou non. Mais, c’est vrai que le temps passé chez moi, dans mon propre espace, m’a permis d’être plus créatif et de remettre en question ce qu’est un album, ce qu’est une mixtape, ce qu’est un journal et me demander si ces choses ne peuvent pas toutes être fusionnées.
Les gens ont des histoires à partager et à travers les réseaux sociaux, vous n’apprenez pas à les connaître
Rabit
Tu appelles What Dreams May Come « un document vivant des temps présents ».
Oui. Si vous voyez la première vidéo de “No Ceiling” avec Embaci, elle a été réalisée durant le premier été de la pandémie, en juillet 2020, avec des amie·s DJ, etc. Depuis mars tout était fermé, on avait prévu une journée plage, et on s’est dit on a qu’à toustes se retrouver dans cette maison, avant que tout le monde reparte dans différentes directions. Et on a tourné, il n’y avait pas de pression, pas de moodboard, pas de stylistes, on s’est habillé·es, coiffé·és, une version visuelle DIY des histoires que j’essaye de raconter.
C’est comme un album choral, avec de nombreuses voix impliquées. Ont-elles toutes quelque chose en commun ?
J’ai coupé beaucoup de pistes pour en faire une déclaration claire, pour qu’elle suive une histoire.
Je me sens insatisfait des réseaux sociaux, c’est tellement capitaliste et compétitif d’une manière ringarde. Surtout pour les musicien·nes. En tant qu’artiste et musicien, je ne suis la plupart du temps pas intéressé par la vente, c’est peut-être pourquoi je ne suis pas partout, et que je ne suis pas financièrement là où je voudrais être. Mais je vois mon travail comme lorsque vous entrez dans une galerie ou un musée, ce n’est pas un échange financier la plupart du temps. J’apporte simplement des choses aux gens, je détourne leur attention de l’endroit où iels se trouvent pour porter leur attention là où nous en sommes au Texas, où j’en suis dans ma vie, où je trouve de la beauté.
Donc, j’ai travaillé avec ces personnes parce qu’il y avait une résonance émotionnelle entre nous, que je me reconnaissais dans leur travail. Par exemple, l’interlude de “The Growth” est avec Lagniappe. Elle est rappeuse, interprète, danseuse, sans être connue en tant que poète, personnage public ou autre. Mais les gens ont des histoires à partager et à travers les réseaux sociaux, vous n’apprenez pas à les connaître. En demandant à ces personnes d’envoyer une note vocale et de parler de ce qu’iels voulaient, c’est, à ma manière, une façon d’être politique. Les gens pensent qu’être politique, c’est être agressif et montrer ce qui ne va pas. Il y a beaucoup d’artistes politiques qui m’ont influencé dans la façon dont ils communiquent. J’ai grandi avec Rage Against the Machine, j’étais straight edge, anti-establishment, ce n’est pas nouveau pour moi. Mais il y a différentes façons d’être politique, et donner aux gens cet espace, pour juste être, ça valait la peine d’essayer.
Beaucoup se sont mis·es à prendre un micro pendant le confinement. Iels ne pouvaient plus mixer en club, et pour survivre il fallait produire de la musique. Désolé mais il y a beaucoup de mauvaises choses qui en sont sorties. Enfin, ça ne me parlait pas. Dans mon cas, au début, cet album, je voulais que ca soit ma version The Gay Chronic de Dr. Dre. C’est un super producteur, et son talent est aussi de reconnaître la voix des autres, ce qu’iels pouvaient faire.
Ce que j’essaye de dire, c’est qu’être un artiste ne veut pas dire être au centre de l’attention. Quand j’ai entendu Eartheater, par exemple, je me suis dit, ok, wow. Pour une personne underground, elle a une capacité à moduler sa voix très intéressante. Mais la production ne me parlait pas tellement. Donc je me suis dit que j’aimerais produire des sons pour elle et intuitivement je lui ai demandé de participer à l’album. J’ai aussi croisé le chemin d’Embaci. C’est des graines que j’ai plantées, et mon hiatus m’a permis de prendre de la distance avec la musique électronique et d’investir mon intuition. Je m’en fous si ça rentre dans un genre, si je vais me faire de l’argent avec… Ça devait être fait.
Il y a différentes façons d’être politique, et donner aux gens cet espace, pour juste être, ça valait la peine d’essayer
Rabit
Comment en es-tu arrivé à collaborer avec l’artiste visuelle Linder Sterling ? Votre travail est exposé dans plusieurs endroits il me semble ?
J’étais vaguement familier de ses photomontages et de ses photographies pour les livres de Morrissey. Quand l’audio était terminé, on a collaboré avec environ vingt artistes visuelles, et il y a eu beaucoup d’échanges entre nous et Lane Stewart qui s’occupe de la DA de Halcyon Veil avec moi. Elle avait les photographies qu’on avait prises dans une maison où il y avait des chambres d’enfants, et celle qui est restée était ouverte à l’interprétation. Avec les ailes de papillon et les autres détails qu’elle a ajouté, elle n’est ni sombre, ni lumineuse.
On a fait une expo en mai à Houston avec les premières ébauches de l’imagerie. Linder a en ce moment une expo à la maison Charleston, qui était la maison de Duncan Grant (1885-1976) et sa partenaire Vanessa Bell (1879-1961). C’était une maison safe pour les artistes queer à cette période encore très oppressive. Cet endroit était donc idéal pour inaugurer l’imagerie. Et à Los Angeles, Linder a aussi un solo show à la galerie Blum & Poe où se trouvent aussi des œuvres vidéos sur lesquelles on a collaboré.
What Dreams May Come avait besoin de respirer en dehors du club, qui a ses limites, et de s’épanouir dans les galeries. L’objectif n’était pas de montrer à la scène dance/électronique qu’on est des artistes, mais plutôt d’exister dans les lieux de l’art contemporain, là où, comme je le disais, la rencontre avec le travail est différente.
Beaucoup d’entre nous bougent beaucoup car ça fait partie du queerness ; pour grandir, mais aussi parce que certaines familles ne comprennent pas une sexualité, un genre mouvant·e
Rabit
Tu parlais de Transience Queer tout à l’heure, tu peux élaborer sur cette idée ?
Je parlais de Queer Transience pas en terme d’identité, mais plutôt en terme du mouvement d’amie·s, de groupes dans différentes villes. La société dans son entièreté ne semble pas capter parfois, mais c’est aussi une question de survie. Beaucoup d’entre nous bougent beaucoup car ça fait partie du queerness : pour grandir, mais aussi parce que certaines familles ne comprennent pas une sexualité, un genre mouvant·e. Dans certains cas, il est nécessaire de t’éloigner de ta famille de sang pour en trouver une autre, et trouver qui tu es, et ce que tu veux devenir.
Et le terme “Transvocalités”, qu’est-ce qu’il raconte pour toi ?
Quelque chose de spacieux. J’adore aussi le mot interprétatif. Parce que c’est comme ça que je vois l’album, l’espace dans lequel je me trouve. Une manière spacieuse d’exister.
Aussi, lorsque je pense à mes ami·es trans, c’est important de ne pas juger où iels en sont. Beaucoup d’hétéros veulent arriver à un point fixe, et peuvent empiéter sur l’intimité des personnes trans, du style : « et qu’est-ce qu’iel a entre les jambes maintenant ? ». Ce que j’ai appris c’est que je me fous d’avec qui mes potes veulent baiser, ou comment iels s’identifient. Iels te le diront s’iels tiennent à te le dire, et quand que tu ne sais pas, tu ne peux pas juger, surtout lorsque tu es engagé·e dans une relation amicale.
Donc, rien n’est figé. Et oui, ce terme a pour moi à voir avec un endroit spacieux, où tout change tout le temps.
« Losss » est l’un de mes morceaux préférés de Björk. Tu as contribué à la production avec Arca. Comment était-ce de fusionner les rythmes et les sons avec le lyrisme, les paroles ? Et de collaborer avec une telle légende ?
Elle est souvent seulement considérée comme une chanteuse. Les gens ne se rendent pas compte à quel point elle est engagée dans la production. C’est sa vision. Elle peut rester avec des chansons pendant des années et les laisser grandir.
Je lui ai envoyé un beat, et elle l’a time-strétché (étirement du tempo) dans un logiciel. Donc le tempo a radicalement changé. Elle a aussi coupé les percussions en tout petits morceaux. Elle devait les imbriquer avec l’ensemble instrumental et vocal. Quelque temps plus tard, je suis passé à New York chez elle car elle avait besoin d’autres beats pour une section du morceau, un bridge, si on peut appeler ça comme ça. Et pendant à peu près deux ans, on a dialogué. Mais c’est elle la cheffe. La master-mind. Je suis comme elle, si je dois faire un truc, je le ferai quoi qu’il arrive. Period.
À l’inverse tu as aussi remixé « History of Touches », comment était-ce de travailler avec la voix de Björk, et ajouter une structure musicale autour ?
Ce remix est un peu étrange. Je n’avais pas de but en le faisant, genre « je vais faire une balade, ou faire comme ci ou comme ça ». Le sujet de la chanson est plutôt triste, et la voix m’apparaissait assez méditative. C’est ce qui a attiré mon attention, et c’est cet aspect avec lequel j’avais envie de jouer. Presque comme quand tu as une pensée. J’aime bien cette chanson sur cet album (Vulnicura) parce que quand tu as une relation et qu’elle se délite, tu peux le comprendre, mais ce n’est pas chose aisée d’en discuter, de le mettre en mot. C’est cette intimité dans la voix qui m’a plu. Et lorsqu’elle m’a demandé un remix j’étais évidemment partant !
Enfin, pour l’anecdote, pourquoi Rabit, avec un seul b ?
(rires) Quand j’ai rencontré mon partenaire, mon mari, c’est marrant mais je crois que j’étais assez timide, et je suis toujours introverti. Je ne suis pas le genre de personne qui se sent forcé de dire quelque chose quand je n’ai rien à dire. Et au tout début il était genre « Pourquoi es-tu si silencieux ? Qu’est ce qui ne va pas ? ». Et on allait marcher dans ce parc. Un jour on était avec un·es de ses ami·es, et des lapins couraient autour, et il a sorti « Ah ça c’est toi, lorsque les gens arrivent, tu t’en vas ».
À ce moment, je faisais de la musique mais je n’étais pas encore prêt à sortir ou poster quoi que ce soit. Et un jour quelqu’un·e m’a demandé un CD et je devais écrire quelque chose dessus. Le premier nom qui m’est venu est Rabit. J’ai enlevé une lettre pour l’altérer. Et il m’a suivi.
What Dreams May Come est disponible sur toutes plateformes de streaming et bientôt en vinyle.
Relecture : Pier-Paolo Gault
Image à la Une : Rabit par Tony Krash
Cet article Transvocalités 5/5 : Rabit, une transience queer provient de Manifesto XXI.

Cet article Transvocalités 5/5 : RABIT, UNE TRANSIENCE QUEER provient de Manifesto XXI.
Dans Transvocalités, notre chroniqueur Charles Wesley sonde comment les voix enregistrées, samplées, traitées, pouvant participer d’un processus émancipatoire, s’incarnent au sein des musiques électroniques actuelles. Pour ce cinquième épisode, il rencontre Rabit, un artiste Texan discret mais affirmé, voire revendicatif. Sur What Dreams May Come, il met en lumière une transience queer. La transience, en génie électrique ou mécanique, est une réponse transitoire, réponse d’un système à un changement d’un équilibre ou d’un état stable. Celle-ci n’est pas nécessairement liée à des événements brusques mais à tout événement qui affecte l’équilibre du système. Par analogie, ce projet musical de Rabit fait entendre des voix qui existent dans un système, en le défiant ou en s’y adaptant librement.Précédé d’un hiatus, son projet instrumental et électronique, What Dreams May Come, paru le 25 novembre sur son label Halcyon Veil, s’éloigne du club et essaie de faire coïncider les attraits de la mixtape à ceux de l’album et du journal intime. En résulte un projet constellée de voix (celles d’Embaci, de Lauren Auder, de John Beltran & Baby Blue, de Eartheater…) qui, dans une orchestration souple, semblent toutes s’interconnecter. Méfiant des réseaux sociaux, où pour lui il est plus question d’argent et d’égo que d’art, il préfère jouer le moins possible à ce jeu là. En dehors des lives, il veut explorer des espaces et temporalités différentes, comme les galeries d’art qui demandent un type d’attention que le stream ou l’écoute en concert/chez soi ne permettent pas. Collaborateur par le passé de Björk et de Arca (« Losss », Utopia (2017)), rendez-vous donc avec Rabit, un artiste encore trop méconnu.
Manifesto XXI : What Dreams May Come semble aller plus loin que tes albums précédents. Il y a de nouveau des paysages sonores expérimentaux brillants, mais cette fois les instruments acoustiques se mêlent davantage aux textures numériques. Serais-tu d’accord de dire que celui-ci est plus contemplatif et ancré, peut-être moins abrasif ? Il s’étend aussi plus sur la durée.
Je suis d’accord avec tout ça. J’ai fait un effort pour rencontrer l’auditeur·ice à mi-chemin, entre une voie plus accessible et une approche toujours personnelle, si cela fait sens.
Jusqu’ici j’ai eu mon propre agenda : je n’ai pas d’objectif comme « je veux que ça soit diffusé, ou que les gens jouent ça dans leur voiture ». Avec What Dreams May Come, ça a été pareil, avec plus de temps dans la phase de montage, de réflexion, d’écoute. En tant que musicien, cela a été interne et nuancé. C’est une combinaison de ce que j’écoute depuis mon hiatus, depuis Utopia (Björk). Ce projet c’est un ensemble, un album collaboratif. Il s’agissait de tendre la main à des personnes qui, selon moi, avaient une étincelle créative à laquelle je m’identifiais, que je pensais précieuse et intéressante, et de leur donner un espace pour faire leur truc. En quelque sorte, qu’iels rentrent dans ce collage. On peut entendre également d’autres musicien·nes, et l’album rend aussi compte de la façon dont je pourrais produire le son d’autres personnes en ce moment.
Les cordes ajoutent de la chaleur aux rythmes et à l’électronique, et il y a une intimité palpable dans ce projet. Parfois, c’est comme si nous étions assis sur un canapé avec quelqu’un·e, écoutant ce qu’iel avait à dire dans l’instant T.
Comme parler à un ami pour voir comment iel va. Il n’y a rien de prévu à la conversation, vous voulez juste leur laisser de l’espace, parler ou être. J’apprends que cela fait partie d’être un bon ami. Parfois il n’y a rien à dire, il faut juste être disponible. Je voulais adapter mon album à différentes manières d’utiliser l’audio dans cette optique chaleureuse et amicale.
La musique électronique ne me satisfaisait pas. J’étais genre, faire des sons, faire des morceaux c’est cool mais je n’étais pas épanoui en tant qu’adulte. Je voulais mûrir et parler des défis et des étapes auxquelles différents ami·es faisaient face dans leur vie.
Est-ce une conséquence de la pandémie le besoin de collaborer autant ?
C’est peut-être plutôt dû à la nature transitoire des personnes queer. À certains de mes ami·es avec qui je parlais pendant la réalisation de l’album, je leur ai dit de m’envoyer des notes vocales. Des ami·es ou des personnes avec qui j’ai joué des concerts et avec qui j’étais en contact, qui vivaient dans un état différent, que nous étions en pandémie ou non. Mais, c’est vrai que le temps passé chez moi, dans mon propre espace, m’a permis d’être plus créatif et de remettre en question ce qu’est un album, ce qu’est une mixtape, ce qu’est un journal et me demander si ces choses ne peuvent pas toutes être fusionnées.
Les gens ont des histoires à partager et à travers les réseaux sociaux, vous n’apprenez pas à les connaître
Tu appelles What Dreams May Come « un document vivant des temps présents ».
Oui. Si vous voyez la première vidéo de “No Ceiling” avec Embaci, elle a été réalisée durant le premier été de la pandémie, en juillet 2020, avec des amie·s DJ, etc. Depuis mars tout était fermé, on avait prévu une journée plage, et on s’est dit on a qu’à toustes se retrouver dans cette maison, avant que tout le monde reparte dans différentes directions. Et on a tourné, il n’y avait pas de pression, pas de moodboard, pas de stylistes, on s’est habillé·es, coiffé·és, une version visuelle DIY des histoires que j’essaye de raconter.
C’est comme un album choral, avec de nombreuses voix impliquées. Ont-elles toutes quelque chose en commun ?
J’ai coupé beaucoup de pistes pour en faire une déclaration claire, pour qu’elle suive une histoire.
Je me sens insatisfait des réseaux sociaux, c’est tellement capitaliste et compétitif d’une manière ringarde. Surtout pour les musicien·nes. En tant qu’artiste et musicien, je ne suis la plupart du temps pas intéressé par la vente, c’est peut-être pourquoi je ne suis pas partout, et que je ne suis pas financièrement là où je voudrais être. Mais je vois mon travail comme lorsque vous entrez dans une galerie ou un musée, ce n’est pas un échange financier la plupart du temps. J’apporte simplement des choses aux gens, je détourne leur attention de l’endroit où iels se trouvent pour porter leur attention là où nous en sommes au Texas, où j’en suis dans ma vie, où je trouve de la beauté.
Donc, j’ai travaillé avec ces personnes parce qu’il y avait une résonance émotionnelle entre nous, que je me reconnaissais dans leur travail. Par exemple, l’interlude de “The Growth” est avec Lagniappe. Elle est rappeuse, interprète, danseuse, sans être connue en tant que poète, personnage public ou autre. Mais les gens ont des histoires à partager et à travers les réseaux sociaux, vous n’apprenez pas à les connaître. En demandant à ces personnes d’envoyer une note vocale et de parler de ce qu’iels voulaient, c’est, à ma manière, une façon d’être politique. Les gens pensent qu’être politique, c’est être agressif et montrer ce qui ne va pas. Il y a beaucoup d’artistes politiques qui m’ont influencé dans la façon dont ils communiquent. J’ai grandi avec Rage Against the Machine, j’étais straight edge, anti-establishment, ce n’est pas nouveau pour moi. Mais il y a différentes façons d’être politique, et donner aux gens cet espace, pour juste être, ça valait la peine d’essayer.
Beaucoup se sont mis·es à prendre un micro pendant le confinement. Iels ne pouvaient plus mixer en club, et pour survivre il fallait produire de la musique. Désolé mais il y a beaucoup de mauvaises choses qui en sont sorties. Enfin, ça ne me parlait pas. Dans mon cas, au début, cet album, je voulais que ca soit ma version The Gay Chronic de Dr. Dre. C’est un super producteur, et son talent est aussi de reconnaître la voix des autres, ce qu’iels pouvaient faire.
Ce que j’essaye de dire, c’est qu’être un artiste ne veut pas dire être au centre de l’attention. Quand j’ai entendu Eartheater, par exemple, je me suis dit, ok, wow. Pour une personne underground, elle a une capacité à moduler sa voix très intéressante. Mais la production ne me parlait pas tellement. Donc je me suis dit que j’aimerais produire des sons pour elle et intuitivement je lui ai demandé de participer à l’album. J’ai aussi croisé le chemin d’Embaci. C’est des graines que j’ai plantées, et mon hiatus m’a permis de prendre de la distance avec la musique électronique et d’investir mon intuition. Je m’en fous si ça rentre dans un genre, si je vais me faire de l’argent avec… Ça devait être fait.
Il y a différentes façons d’être politique, et donner aux gens cet espace, pour juste être, ça valait la peine d’essayer.
Comment en es-tu arrivé à collaborer avec l’artiste visuelle Linder Sterling ? Votre travail est exposé dans plusieurs endroits il me semble ?
J’étais vaguement familier de ses photomontages et de ses photographies pour les livres de Morrissey. Quand l’audio était terminé, on a collaboré avec environ vingt artistes visuelles, et il y a eu beaucoup d’échanges entre nous et Lane Stewart qui s’occupe de la DA de Halcyon Veil avec moi. Elle avait les photographies qu’on avait prises dans une maison où il y avait des chambres d’enfants, et celle qui est restée était ouverte à l’interprétation. Avec les ailes de papillon et les autres détails qu’elle a ajouté, elle n’est ni sombre, ni lumineuse.
On a fait une expo en mai à Houston avec les premières ébauches de l’imagerie. Linder a en ce moment une expo à la maison Charleston, qui était la maison de Duncan Grant (1885-1976) et sa partenaire Vanessa Bell (1879-1961). C’était une maison safe pour les artistes queer à cette période encore très oppressive. Cet endroit était donc idéal pour inaugurer l’imagerie. Et à Los Angeles, Linder a aussi un solo show à la galerie Blum & Poe où se trouvent aussi des œuvres vidéos sur lesquelles on a collaboré.
What Dreams May Come avait besoin de respirer en dehors du club, qui a ses limites, et de s’épanouir dans les galeries. L’objectif n’était pas de montrer à la scène dance/électronique qu’on est des artistes, mais plutôt d’exister dans les lieux de l’art contemporain, là où, comme je le disais, la rencontre avec le travail est différente.
Beaucoup d’entre nous bougent beaucoup car ça fait partie du queerness ; pour grandir, mais aussi parce que certaines familles ne comprennent pas une sexualité, un genre mouvant·e.
Tu parlais de Transience Queer tout à l’heure, tu peux élaborer sur cette idée ?
Je parlais de Queer Transience pas en terme d’identité, mais plutôt en terme du mouvement d’amie·s, de groupes dans différentes villes. La société dans son entièreté ne semble pas capter parfois, mais c’est aussi une question de survie. Beaucoup d’entre nous bougent beaucoup car ça fait partie du queerness : pour grandir, mais aussi parce que certaines familles ne comprennent pas une sexualité, un genre mouvant·e. Dans certains cas, il est nécessaire de t’éloigner de ta famille de sang pour en trouver une autre, et trouver qui tu es, et ce que tu veux devenir.
Et le terme “Transvocalités”, qu’est-ce qu’il raconte pour toi ?
Quelque chose de spacieux. J’adore aussi le mot interprétatif. Parce que c’est comme ça que je vois l’album, l’espace dans lequel je me trouve. Une manière spacieuse d’exister.
Aussi, lorsque je pense à mes ami·es trans, c’est important de ne pas juger où iels en sont. Beaucoup d’hétéros veulent arriver à un point fixe, et peuvent empiéter sur l’intimité des personnes trans, du style : « et qu’est-ce qu’iel a entre les jambes maintenant ? ». Ce que j’ai appris c’est que je me fous d’avec qui mes potes veulent baiser, ou comment iels s’identifient. Iels te le diront s’iels tiennent à te le dire, et quand que tu ne sais pas, tu ne peux pas juger, surtout lorsque tu es engagé·e dans une relation amicale.
Donc, rien n’est figé. Et oui, ce terme a pour moi à voir avec un endroit spacieux, où tout change tout le temps.
« Losss » est l’un de mes morceaux préférés de Björk. Tu as contribué à la production avec Arca. Comment était-ce de fusionner les rythmes et les sons avec le lyrisme, les paroles ? Et de collaborer avec une telle légende ?
Elle est souvent seulement considérée comme une chanteuse. Les gens ne se rendent pas compte à quel point elle est engagée dans la production. C’est sa vision. Elle peut rester avec des chansons pendant des années et les laisser grandir.
Je lui ai envoyé un beat, et elle l’a time-strétché (étirement du tempo) dans un logiciel. Donc le tempo a radicalement changé. Elle a aussi coupé les percussions en tout petits morceaux. Elle devait les imbriquer avec l’ensemble instrumental et vocal. Quelque temps plus tard, je suis passé à New York chez elle car elle avait besoin d’autres beats pour une section du morceau, un bridge, si on peut appeler ça comme ça. Et pendant à peu près deux ans, on a dialogué. Mais c’est elle la cheffe. La master-mind. Je suis comme elle, si je dois faire un truc, je le ferai quoi qu’il arrive. Period.
À l’inverse tu as aussi remixé « History of Touches », comment était-ce de travailler avec la voix de Björk, et ajouter une structure musicale autour ?
Ce remix est un peu étrange. Je n’avais pas de but en le faisant, genre « je vais faire une balade, ou faire comme ci ou comme ça ». Le sujet de la chanson est plutôt triste, et la voix m’apparaissait assez méditative. C’est ce qui a attiré mon attention, et c’est cet aspect avec lequel j’avais envie de jouer. Presque comme quand tu as une pensée. J’aime bien cette chanson sur cet album (Vulnicura) parce que quand tu as une relation et qu’elle se délite, tu peux le comprendre, mais ce n’est pas chose aisée d’en discuter, de le mettre en mot. C’est cette intimité dans la voix qui m’a plu. Et lorsqu’elle m’a demandé un remix j’étais évidemment partant !
Enfin, pour l’anecdote, pourquoi Rabit, avec un seul b ?
(rires) Quand j’ai rencontré mon partenaire, mon mari, c’est marrant mais je crois que j’étais assez timide, et je suis toujours introverti. Je ne suis pas le genre de personne qui se sent forcé de dire quelque chose quand je n’ai rien à dire. Et au tout début il était genre « Pourquoi es-tu si silencieux ? Qu’est ce qui ne va pas ? ». Et on allait marcher dans ce parc. Un jour on était avec un·es de ses ami·es, et des lapins couraient autour, et il a sorti « Ah ça c’est toi, lorsque les gens arrivent, tu t’en vas ».
À ce moment, je faisais de la musique mais je n’étais pas encore prêt à sortir ou poster quoi que ce soit. Et un jour quelqu’un·e m’a demandé un CD et je devais écrire quelque chose dessus. Le premier nom qui m’est venu est Rabit. J’ai enlevé une lettre pour l’altérer. Et il m’a suivi.
What Dreams May Come est disponible sur toutes plateformes de streaming et bientôt en vinyle.
Relecture : Pier-Paolo Gault
Image à la Une : Rabit par Tony Krash
Cet article Transvocalités 5/5 : RABIT, UNE TRANSIENCE QUEER provient de Manifesto XXI.

La Commission européenne a adopté ce 7 décembre une proposition de règlement visant à harmoniser au niveau de l'UE les règles de droit international privé relatives à la filiation.
L’article Bruxelles veut renforcer la reconnaissance des familles homoparentales dans toute l’Union Européenne est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

La Commission européenne a adopté ce 7 décembre une proposition de règlement visant à harmoniser au niveau de l'UE les règles de droit international privé relatives à la filiation.
L’article Bruxelles veut renforcer la reconnaissance des familles homoparentales dans toute l’Union Européenne est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.


Pour garder les pieds sur terre, rien ne vaut un plongeon la tête la première dans les étoiles. Ce mois, le signe à l’honneur est le Sagittaire.
L’article Attraction des astres, votre horoscope de décembre est apparu en premier sur 360°.

Cet article Infinite Wellness, l’étincelant tourbillon musical d’Ultraflex provient de Manifesto XXI.
Le duo norvégo-islandais Ultraflex revient avec son second album, Infinite Wellness (Street Pulse Records), une véritable plongée dans un univers audio/visuel DIY flamboyant et teinté d’ironie.Ultraflex est l’union née du coup de foudre mutuel entre Kari Jahnsen (NO), aka Farao, et Katrín Helga Andrésdóttir (IS), aka Special-K. Si leur premier album Visions of Ultraflex s’inspirait de l’électro disco soviétique et est-européenne des années 80, Infinite Wellness élargit ses influences pour faire évoluer la tracklist entre disco, italo et funk, mélangée à des sensibilités new age, des accords de jazz inattendus et des torsions mélodiques. Avec leur fausse innocence et leur charme sournois, les deux artistes nous embarquent dans leur univers brumeux et vibrant, révélé par leurs clips expérimentaux kitchs et conceptuels. Rencontre par écrans interposés avec Kari et Katrín, respectivement depuis Berlin et Reykjavik.
Ce projet est censé être une chose positive dans nos vies et ça nous apporte beaucoup de wellness, infinitely.
Kari Jahnsen
 © Douglas Dare
© Douglas Dare
Manifesto XXI – J’aimerais parler de la façon dont vous vous êtes rencontrées. Certaines interviews mentionnent que c’était sur Tinder. Est-ce vraiment le cas ?
Kari (avec un sourire au coin des lèvres) : Eh bien… Oui, peut-être.
Katrín : On a plusieurs histoires sur l’origine de notre rencontre. L’une d’elles est qu’on s’est rencontrées sur Tinder, une autre, que nos parents sont sortis ensemble. Chacun·e peut choisir celle à laquelle iel veut croire.
Comment avez-vous commencé à travailler ensemble, et comment le groupe s’est-il créé ?
Kari : En 2019, on a écrit une pièce commandée par les festivals de musique électronique scandinaves Extreme Chill et Insomnia. On s’est tellement amusées qu’on a décidé de tout enregistrer et de sortir un album. C’est comme ça que le projet a commencé.
Comment vos projets personnels influencent-ils la façon dont vous travaillez ensemble sur Ultraflex ?
Katrín : On fait toutes les deux de la musique depuis très longtemps avec nos projets solo, avec d’autres groupes, donc je pense qu’on prend tout ce qui est à disposition dans la boîte à outils pour l’infuser dans Ultraflex.
Kari : Avec l’expérience de ces autres projets, on sait aussi ce qu’on ne veut plus faire. Avec Ultraflex, on a aussi voulu éviter tous les aspects épuisants/énervants/non inspirants de nos précédentes expériences.
Les scènes musicales de vos pays respectifs influencent-elles aussi le projet ?
Kari : Oui, beaucoup ! Je peux peut-être mentionner quelques artistes norvégiens : un projet norvégien/allemand qu’on aime beaucoup s’appelle Easter, sinon Okay Kaya – qui est une amie, elle a fait certaines de nos vidéos et a été une grande source d’inspiration et de soutien pour notre premier album.
Katrín : Je pense à Smerz aussi. La scène berlinoise nous a aussi inspirées, parce que Kari y vit, qu’on y a passé beaucoup de temps et que j’y vivais quand on a commencé à travailler ensemble. Il y a Sean Nicholas Savage qui y vivait, je crois qu’il a déménagé depuis, Jane de TOPS. En Islande, je dirais qu’on est plus influencées par les personnes les plus proches de nous, nos ami·es. Jóhanna Rakel, qui a réalisé les clips pour « Under The Spell » et « Never Forget My Baby » sur le dernier album. Il y a un groupe que j’aime beaucoup mais que je n’ai écouté que récemment donc je ne sais pas dans quelle mesure il a inspiré cet album : c’est russian.girls qui font un genre de musique électro rave des années 90. On écoute aussi toutes les deux le podcast de Björk.
Quand votre processus de création a-t-il commencé pour cet album ?
Kari : Il y a assez longtemps, en janvier 2021. Katrín était à Berlin pendant un mois et c’était pendant le confinement strict, où rien n’était ouvert. On n’avait le droit d’avoir la visite que d’une seule personne à la fois. On a travaillé sur des idées de nouvelles chansons pendant un mois, puis je suis allée en Islande au printemps 2021, et on n’a pas terminé l’album, mais on est allées très loin dans toutes les chansons. Puis, à l’automne 2021, on a fait le mixage. Je pense que l’album a été terminé à Noël.
Katrín : Ou même un peu plus tard, car je me souviens qu’on a sorti « Relax » avant d’avoir fini de mixer le reste de l’album, c’était en mars ou quelque chose comme ça.
À propos du titre de l’album, que signifie le bien-être dans vos vies ? Avez-vous une wellness routine ?
Katrín : Infinite + Wellness [infini et bien-être en anglais, ndlr] était une combinaison de mots qu’on trouvait à la fois luxuriante, gracieuse et plaisante, mais aussi un peu ironique. Il y a beaucoup d’aspects du bien-être qui sont incroyables, mais qui peuvent aussi être un peu capitalistes. On fait toutes les deux un peu de yoga et on mange assez sainement.
Kari : Je pense qu’il en est aussi du projet en lui-même, de la relation de travail et de la relation amicale qu’on a entre Katrín et moi, qui consiste à s’amuser. Ce projet est censé être une chose positive dans nos vies et ça nous apporte beaucoup de wellness, infinitely (rires).
Katrín : C’est un bien-être pour l’âme, pas nécessairement pour le corps !
Avez-vous eu une ligne directrice pour cet album ?
Katrín : Je pense que pour le dernier, on avait davantage un cadre pour ce qu’on allait faire, celui-ci était un peu plus organique.
Kari : Au début, on pensait qu’il s’agirait plus d’un album sur le bien-être, étant donné qu’on pensait que tous les morceaux auraient des thèmes liés au bien-être. Mais finalement, ce n’était le cas que pour un seul, le premier, « Relax ».
Katrín : Le morceau a dû être écrit pendant le confinement, ou commencé à l’être à ce moment-là. Il parle de toutes ces choses qui nous manquaient vraiment dans la fête. C’est aussi une chanson sur la passion et la romance, et je pense qu’elle agissait comme une sorte d’évasion et de fantasme pendant le confinement.
La fête et la romance peuvent aussi faire partie du bien-être d’une certaine façon.
Kari : Oui, absolument. Sortir en club est une sorte d’activité thérapeutique pour moi, je ne le fais pas assez.
Quelle a été votre approche pour ce nouvel album par rapport au précédent, Visions of Ultraflex ?
Katrín : On a eu beaucoup plus de temps.
Kari : Oui, ça s’est étalé sur une longue période de temps, ce qui était bien et plus libérateur je suppose. J’ai aussi été enceinte pendant ce processus.
Katrín : Enceinte, puis mère d’un nouveau-né !
Kari : Donc on a eu le temps de réfléchir à des idées entre chaque fois qu’on s’est réunies.
Katrín : C’était bien ! Ça a permis de les faire fermenter. Le processus de mixage a aussi pris du temps, c’est comme si on avait pressé tout le jus de l’album.
En dehors de la musique, l’univers esthétique d’Ultraflex semble être une partie importante de votre projet. Quelle place accordez-vous à l’aspect visuel du projet ?
Kari : Il est aussi important que la musique. On a décidé dès le début qu’Ultraflex serait autant axé sur l’aspect visuel que sur la musique, donc les clips ne sont pas seulement censés représenter les chansons, ils sont censés être des œuvres en elles-mêmes. La pochette du vinyle a été réalisée par une graphiste islandaise extraordinaire, Greta Þorkels, dont le travail est une œuvre d’art en soi. Je pense que ça représente très bien les chansons, mais que c’est aussi une chose à part entière…
Katrín : Et qui pourrait vivre de manière autonome !
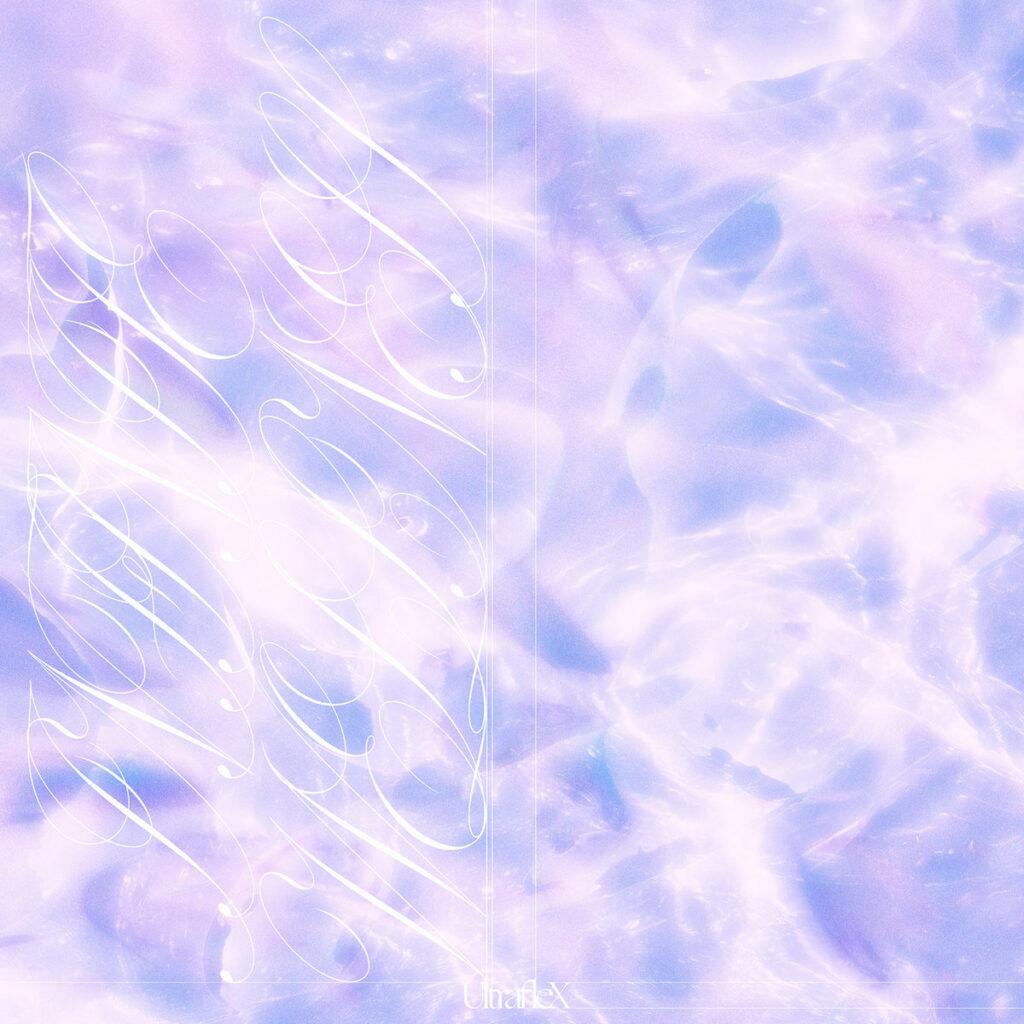 Artwork Infinite Wellness © Greta Þorkels
Artwork Infinite Wellness © Greta Þorkels
Comment choisissez-vous les artistes avec lesquel·les vous collaborez ?
Katrín : Ce sont surtout nos ami·es ou des gens avec qui on a déjà travaillé, car on fait toutes les deux de la musique depuis… toujours. Par exemple, Greta faisait partie de nos ami·es. La seule personne qui nous était totalement étrangère et qu’on a découverte sur Instagram est Lisa Mård, qui a fait le nail art pour le clip de « Relax ». Sinon, tout s’est fait par le biais de nos relations et de nos ami·es.
Pour finir, y a-t-il un·e artiste qui vous a particulièrement inspirées dernièrement ?
Katrín : On a tellement d’inspirations, presque trop ? Je peux dire Kari Bremnes. Pour la décrire, je dirais que c’est la musicienne que nos parents écoutent. On fait référence à elle dans l’intro de « Melting Away ». Je suis aussi très inspirée par Eartheater, je suis fan d’elle depuis un moment.
Kari : Il y a aussi Erika de Casier. On aime aussi beaucoup The Zenmenn, un groupe berlinois. J’ai chanté sur leur album, ils font principalement de la musique instrumentale.
Katrín : Finalement, ils font de la wellness music !
Relecture et édition : Pier-Paolo Gault
Cet article Infinite Wellness, l’étincelant tourbillon musical d’Ultraflex provient de Manifesto XXI.

En vue de l’assemblée synodale de 2023 à Rome, cinquante prêtres italiens ont rendu publique leur orientation sexuelle, déplorant les effets dévastateurs d'une doctrine « hypocrite qui les contraints au silence pour survivre » ou à quitter la vie sacerdotale, évoquant même des cas de suicide...
L’article Italie : cinquante prêtres font leur coming-out pour dénoncer « l’homophobie intériorisée » de l’Eglise est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

En vue de l’assemblée synodale de 2023 à Rome, cinquante prêtres italiens ont rendu publique leur orientation sexuelle, déplorant les effets dévastateurs d'une doctrine « hypocrite qui les contraints au silence pour survivre » ou à quitter la vie sacerdotale, évoquant même des cas de suicide...
L’article Italie : cinquante prêtres font leur coming-out pour dénoncer « l’homophobie intériorisée » de l’Eglise est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.

Les mêmes critères d’admissibilité sont dorénavant appliqués à tous les donneurs de sang, peu importe leur orientation sexuelle.
L’article Le Québec ouvre le don du sang aux hommes bis et homosexuels sans période d’abstinence est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

 Quelle Wet ! Merci à tou.te.s les artistes et à nos sorcières qui ont fait de cette dernière 2022 une édition particulièrement … humide !! En attendant bientôt des nouvelles ...
Quelle Wet ! Merci à tou.te.s les artistes et à nos sorcières qui ont fait de cette dernière 2022 une édition particulièrement … humide !! En attendant bientôt des nouvelles ... 

Et voilà, c’est déjà le dernier numéro de l’année et pour affronter l’hiver en douceur, on vous propose une sélection de pépites 100% musicales.
L’article Les Pépites de décembre-janvier est apparu en premier sur 360°.

“Un notable marginal” : tel est le bel oxymore qu’Antoine Idier, commissaire de l’exposition Dans les marges (et ancien collaborateur d’Hétéroclite), emploie pour décrire Michel Chomarat. Bibliophile, collectionneur et figure incontournable de la vie gay lyonnaise, celui-ci a signé, il y a trente ans, une “convention de prêt à usage” avec la Ville de Lyon, par laquelle il mettait à la disposition de la Bibliothèque municipale son propre fonds d’archives. C’est cet anniversaire que célèbre cette exposition. On y retrouve tous les dadas de cet explorateur infatigable des traces du passé : l’occultisme, Nostradamus, la franc-maçonnerie, l’anarchisme, la culture populaire et les luttes de tous les groupes opprimés (immigrés, prostituées, “aliénés”, homosexuels, personnes trans, etc). Dans les marges met en lumière quelques-unes des pièces les plus marquantes de cette très riche collection. Celle-ci fait la part belle aux minorités sexuelles, à travers des magazines et des fanzines gays, lesbiens ou trans du monde entier, un jukebox de chansons évoquant l’homosexualité, des affiches du Mouvement de libération des femmes, de l’ExisTransInter ou de la Marche des Fiertés lyonnaise, des tracts, des brochures, des photographies de travestis, de femmes à barbe ou de couple d’hommes en train de danser… Leur présence aux côtés d’un traité de cartomancie du XVIIIe siècle, de pamphlets anti-maçonniques ou d’images d’Épinal évoquant la piété populaire peut sembler baroque de prime abord. Mais cet assemblage n’est hétéroclite qu’en apparence : il propose en effet une interrogation cohérente sur la façon dont se construit l’historiographie et sur la place qu’elle accorde aux catégories sociales déconsidérées. Alors que le serpent de mer d’un centre d’archives LGBT+ à Paris refait périodiquement surface et que des initiatives communautaires décentralisées voient le jour dans plusieurs grandes villes de France, Dans les marges nous rappelle ainsi l’importance de conserver les témoignages de l’histoire des minorités.
À voir
Dans les marges, jusqu’au 28 janvier 2023 à la Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 boulevard Vivier-Merle-Lyon 3 / 04 78 62 18 00
bm-lyon.fr/expositions-en-ligne/dans-les-marges-30-ans-du-fonds-michel-chomarat
Visites guidées les samedis 17 décembre et 28 janvier à 15h.
L’article Une expo se plonge “Dans les marges” à la BM de Lyon est apparu en premier sur Hétéroclite.

Cet article S’exporter sinon rien, un échange avec Léa Sen provient de Manifesto XXI.
Associant habilement les sons de sa guitare à sa voix, Léa Sen touche par sa douceur et son honnêteté sur scène. Elle revient le temps d’un concert sur Paris pour une prestation aux envolées sublimes, touchant autant à la folk qu’aux sonorités intenses de la musique électronique.Depuis l’île britannique et en particulier Londres, la compositrice française Léa Sen touche le cœur de cette scène art pop française qui a souvent besoin de s’exporter pour être enfin comprise et acceptée. Avec un premier EP délicat sorti cette année et des collaborations bien choisies, la chanteuse/compositrice pousse progressivement sa musique dans une scène qui la comprend entièrement. Nous avons pu échanger délicatement avec elle avant son concert au Café de la Danse dans les backstages du Pitchfork Festival Paris.
Manifesto XXI – Peux-tu te présenter pour celle·ux qui ne te connaîtraient pas ?
Léa Sen : Je m’appelle Léa Sen. J’ai 23 ans. Je viens de Cergy dans le 95. Mais je vis à Londres, en Angleterre, depuis maintenant trois ans. J’ai déménagé juste avant la quarantaine. C’était un peu un moment bizarre pour bouger à Londres ! Je fais de la musique, je chante, je produis, j’écris. Et aujourd’hui, je rentre à Paris pour faire mon deuxième concert dans la capitale. La première fois je faisais la première partie de Nilüfer Yanya, c’était en mars au Trabendo.
Qu’est-ce qui t’a poussée à aller en Angleterre et à Londres ? T’y plais-tu ?
Parfois Paris c’est un peu fermé artistiquement. C’est un peu difficile d’y faire de la musique déjà : je chante en anglais, je ne me sentais pas forcément représentée ici, ou pas complètement comprise. Je voulais aller dans un pays où tout le monde va dans des sens complètement différents, où tout le monde chante, dans une grande variété de langues. Avec plein de styles un peu bizarres, une place pour ces styles-là avec un budget dédié, etc. À Londres il y a vraiment des gens qui sont investis. Quand je suis arrivée, dès la première semaine, je me directement retrouvée avec des personnes qui comprennent vraiment ce que je fais artistiquement.
 © Alex Waespi
© Alex Waespi
Ta performance ce soir reprend-elle ce que tu as fait en tournée en mars avec Nilüfer Yanya ou tu y incorpores de nouveaux éléments ?
Cette année je me suis surtout penchée sur mon premier EP sorti en mai et les nouveaux morceaux de mon deuxième, qui arrivent bientôt. Du coup le live ne sera pas vraiment différent, mais les morceaux oui. Quand le confinement se terminait, tout le monde était en « précipitation » pour faire des scènes, Il fallait absolument accepter toutes les dates. C’était beaucoup de pression, je me suis dit alors que j’allais aller dans l’autre sens, afin d’être vraiment à l’aise sur scène. Pouvoir juste improviser, chanter mes morceaux de la façon dont j’ai envie. Et puis aussi à cause de cette période, il y a moins de budget pour les lives. Donc je suis toujours toute seule pour l’instant.
J’allais te le demander, tu n’as pas encore toute une team de musicien·nes qui te suivent ?
J’adorerais, mais non pas encore ! J’aimerais trop, je discute pour ça avec plein de musicien·nes. J’ai fait des sessions de répétitions, mais c’est vraiment une question de budget. C’est aussi une question de temps, pour construire réellement un beau show, tu vois ? J’ai vraiment pas du tout envie de transmettre quelque chose de bâclé. Je sais qu’il faut tester, tenter, faire des erreurs et accepter que ça ne soit pas forcément parfait au début. Mais j’essaye de mettre ça en place pour l’année prochaine et de construire quelque chose de vrai.
Toujours guitare et voix sur scène, tu ne joues pas d’autres instruments sur ce live ?
Oui ! Alors j’ai aussi mon SP404, un sampler, avec lequel je lance des petits morceaux des prods que j’ai faites. Par exemple, j’ai un nouveau morceau qui s’appelle « No », avec un drone en fond sonore que j’ai enregistré avec ma Microcosm, une pédale d’effet qui a plein de delay [des échos, ndlr], des petits trucs un peu modulaires, elle est trop bien et très bizarre, j’aime beaucoup, ça part dans tous les sens.
Est-ce que tu vas beaucoup utiliser cette pédale ce soir ?
Je l’ai utilisée en live avec Nilüfer Yanya, et cette année dans plusieurs festivals. Mais là je vais moins l’utiliser, j’ai envie de pouvoir me concentrer un peu plus sur ma prestation acoustique. Sinon, je passe un peu trop de temps sur la pédale comme une scientifique. Mais c’est pour ça que la prochaine étape, ce serait d’avoir quelqu’un qui m’aide avec.
Tu as déjà joué au Pitchfork Festival à Londres la semaine dernière, comment s’est passée ta performance ?
Ça s’est super bien passé ! J’ai joué au Roundhouse, j’étais allée voir la chanteuse anaiis là-bas, quand j’ai déménagé à Londres.
Tu es entourée d’excellent·es artistes de la scène art pop ce soir, y a-t-il un·e artiste avec qui tu souhaiterais t’associer ?
À Pitchfork Paris oui, Astrønne. C’est une inspiration depuis des années. Quand je l’ai découverte – j’avais peut-être 18 ans – sur Instagram, on s’est vite connectées. On a commencé à s’envoyer des messages et à discuter de musique. Elle chante en français et en anglais, mais la plupart de ses morceaux sont en anglais, ils ne sont pas encore sortis. On a fini par se dire qu’il fallait qu’on se voie. Alors j’ai pris un bus pour aller la voir à Rennes et on a fait des morceaux, des covers qu’on a mises sur Youtube ! On les a sorties quand on avait 18 ans en scred, personne ne savait. Le fait qu’on soit sur la même scène l’une après l’autre, c’est génial, ça m’inspire de ouf. Beaucoup de gens ne savent pas du tout qu’on se connaît.
 © Alex Waespi
© Alex Waespi
Je t’ai découverte via la playlist de Vegyn, qui a récemment réalisé un remix d’une de tes tracks, comptes-tu pousser les remixes plus loin ?
Totalement ! Avec les remixes, je veux vraiment prendre mon temps pour que ça ait du sens, pas juste musicalement mais aussi humainement entre artistes. Mais oui, Vegyn je n’oublierai jamais : je ne sais pas pourquoi, un jour je me réveille à 4 heures du matin, je regarde mon téléphone et je vois un message de Vegyn. J’avais 20 ans et je n’avais pas de label, pas de manager, rien du tout. À cette époque, personne ne savait que j’avais fait des tracks avec Joy Orbison, ce n’était pas encore sorti. Il m’a juste envoyé un message sur Instagram. Je lui ai demandé comment il m’avait trouvée, il m’a répondu qu’il cherchait de nouveaux·lles artistes, de nouveaux sons. Mais c’est vraiment fou. Il a fait le remix quelques mois après.
Comment se passe ta nouvelle signature avec Partisan Records, sachant que tu étais en indépendant avant ça ?
J’ai signé avec elleux l’année dernière en octobre, je vais peut-être re-signer avec elleux sur le long terme parce que c’était juste pour un EP. Je les adore, iels sont trop cool. Avant je faisais tout, toute seule. Du coup c’est ma première team, iels sont basé·es à New York, mais certain·es sont à Londres.
Qu’est-ce qu’on peut attendre de toi dans les prochains mois ?
Alors, j’ai fini mon deuxième EP. Le premier est sorti en mai, You of Now, Pt. 1. J’ai vraiment pris mon temps. La deuxième partie, faut qu’elle ait du sens pour moi. Je l’ai finie en septembre, j’avais commencé à composer sur la tournée avec Nilüfer Yanya. Il y a beaucoup de morceaux que j’ai enregistrés dans des pays différents. J’en faisais même dans le van de la tournée !
Testais-tu les morceaux que tu créais en chemin sur scène ?
Oui ! À tous les concerts, il y a un morceau qui s’appelle « Again » qui sera sur le deuxième EP, c’était un processus trop cool et nouveau pour moi, j’étais vraiment en train de le produire et de l’écrire en même temps, tout en étant dans le van ou à l’hôtel. Du coup je donnais une version différente tous les soirs. Ça me permettait de poser ma guitare sur le côté et de danser.
En attendant ses prochaines sorties, le premier EP de Léa Sen You Of Now Pt. 1 est disponible sur toutes les plateformes.
Relecture et édition : Pier-Paolo Gault
Cet article S’exporter sinon rien, un échange avec Léa Sen provient de Manifesto XXI.

La casquette Romantiqueer Accessoire indispensable de la dyke, on a craqué pour la nouvelle casquette
L’article La hotte de Vagin Pirate est apparu en premier sur 360°.

Alors qu'il était questionné sur son ressentie à l’idée de disputer une compétition dans un pays où l’homosexualité est passible de poursuites pénales, le milieu offensif de l’équipe de France a affirmé son soutien aux membres de la communauté LGBT+, « peu importe où il serait dans le monde », a-t-il assuré.
L’article Antoine Griezmann affirme depuis le Qatar que la communauté LGBT+ aura toujours son soutien est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Du 2 au 17 décembre, le Théâtre de Vidy propose Foucault en Californie. Cette pièce mise en scène par Lioner Baier d’après un récit autobiographique de Simeon Wade relate le voyage psychédélique du célébrissime philosophe français sur la côte ouest des USA.
L’article Trip Foucault avec Lionel Baier est apparu en premier sur 360°.

Les deux hommes ont été condamnés pour avoir eu des rapports sexuels, considérés comme « inappropriés » dans l'armée, dont ils ont aussi été bannis.
L’article Deux soldats indonésiens condamnés à sept mois de prison pour homosexualité est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Lutte contre le VIH/sida : et si la PrEP avait un genre ? provient de Manifesto XXI.
Le 1er décembre, c’est la journée mondiale de lutte contre le sida. À cette occasion, on a décidé de parler de la PrEP : l’efficacité de ce traitement préventif a beau être prouvée, sa démocratisation reste un enjeu majeur de la lutte contre l’épidémie.L’année dernière, le Mucem ouvrait l’exposition VIH/sida, l’épidémie n’est pas finie !, une première dans une institution de cette importance. Nous avons suivi l’événement de près, en réalisant une série de podcasts en cinq épisodes autour de l’exposition. Dans le cadre de ce projet, nous avons rencontré de nombreuses personnes concernées, artistes, scientifiques, chercheur·ses, et nous sommes fièr·es de publier aujourd’hui l’entretien réalisé avec Hippolyte Regnault. Vous pouvez entendre sa voix dans le 4ème épisode de notre série, dédié à la réduction des risques et à la prévention. Doctorant et chercheur en science politique, Hippolyte s’intéresse à la PrEP, traitement préventif permettant aux personnes susceptibles de contracter le virus de se protéger d’une éventuelle infection au VIH.
Si ce médicament est remboursé par la Sécu et peut a priori être prescrit à tout le monde, sur le terrain, la réalité est toute autre. Les femmes, les personnes trans, mais aussi les personnes migrantes ou les travailleur·ses du sexe n’ont que très peu accès au traitement. Dans son travail de recherche, Hippolyte Regnault étudie l’impact que les rapports de genre, de race, de classe, de sexualité peuvent avoir sur la démocratisation de la PrEP auprès des publics les plus vulnérables face au virus.
Et parce que la prise de ce médicament soulève toujours des controverses à grand renfort de stigmatisations diverses (comme à peu près tout ce qui est lié au VIH), il nous semblait important de mettre en avant sa parole en cette journée mondiale de lutte contre le sida.
La PrEP, ça n’est pas seulement un médicament, mais une prise en soin globale des personnes intéressées, avec des dépistages IST complets tous les trois mois, des consultations médicales, des propositions de vaccination, et même parfois un accompagnement en sexologie, en addictologie…
Hippolyte Regnault
Manifesto XXI – Pour celleux qui n’en auraient pas une idée très claire, c’est quoi la PrEP ? Et dans quel cadre t’intéresses-tu à ce traitement ?
Hippolyte Regnault : C’est une bithérapie préventive qui a pour principe assez simple de proposer à des personnes qui n’ont pas le VIH, qui n’utilisent pas systématiquement le préservatif et sont donc à risque de contracter le virus, un médicament actif contre ce même virus et qui protège de l’infection. J’ajouterais que la PrEP, ça n’est pas seulement un médicament mais une prise en soin globale des personnes intéressées, avec des dépistages IST complets tous les trois mois, des consultations médicales, des propositions de vaccination (hépatites A et B, papillomavirus), et même parfois un accompagnement en sexologie, en addictologie, etc.
Dans ma thèse, je m’intéresse à la PrEP et aux innovations biomédicales de lutte contre le VIH/sida, au prisme des rapports sociaux de genre et de sexualité. L’idée, c’est d’aller renseigner les manières dont la PrEP est structurée par des rapports sociaux de genre et de sexualité et, dans le même mouvement, comment elle contribue à les reproduire. On peut en effet considérer les espaces par lesquels transite le médicament comme des espaces où les normes de genre et de sexualité s’actualisent, se (re-)construisent, mais peuvent aussi être contestées. Autrement dit, la question que je pose, c’est celle du genre de la PrEP. (1)
Pourquoi les femmes cis ne représentent que 3% des utilisateurices de la PrEP, quand elles représentent environ 35% des nouvelles infections par le VIH en Europe ?
Hippolyte Regnault
Qui prend la PrEP aujourd’hui ?
Ce sont en très grande majorité (96,97%) des hommes cis ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH). Les femmes cis, elles, ne représentent qu’une part très faible des utilisateurices de la PrEP, environ 3%. Pour les personnes trans, on ne dispose pas de données nous permettant de connaître la part exacte. Si ces stats ont le mérite d’exister, elles restent probablement inexactes : on sait maintenant que les personnes transféminines sont souvent agrégées aux hommes cis gays dans les donnés, et que les personnes transmasculines passent régulièrement pour cis auprès de médecins prescrivant la PrEP, ce qui les insivibilise. C’est déjà un problème en soi.
Alors pourquoi les femmes cis ne représentent que 3% des utilisateurices de la PrEP, quand elles représentent environ 35% des nouvelles infections par le VIH en Europe ? Il y a un gap considérable entre ces deux chiffres, et le constat est alarmant : il y a un besoin de santé publique, un outil qui fonctionne, mais beaucoup de personnes concernées ne s’en saisissent pas.
Comment peut-on expliquer ce blocage ?
En termes de recherche, de promotion et de communication, la PrEP a été pensée avec et autour des HSH. Des hommes cisgenres, blancs, plutôt citadins et surtout de classe moyenne ou aisée. Pour promouvoir la PrEP auprès de cette catégorie de personnes, les décideurs publics ont insisté sur l’adaptabilité et la flexibilité du traitement : si la PrEP peut se prendre en continu, comme une pilule, on peut aussi la prendre « à la demande », c’est-à-dire de façon ponctuelle, avant et après un rapport à risque. (2)
Si ce schéma de prise permet d’adapter le médicament à sa sexualité, son efficacité n’a été démontrée que pour les personnes assignées « homme » à la naissance, pour la raison assez simple que la très grande majorité de participant·es de l’étude étaient des hommes cis gays. En fait, on n’a pas pu tester la protection de la PrEP « à la demande » dans les muqueuses vaginales. Autrement dit, aujourd’hui en France, on ne prescrit pas la PrEP « à la demande » aux personnes ayant des relations vaginales réceptives. Ce n’est pas possible pour les femmes cis, les personnes transmasc et non-binaires assignées « femme » à la naissance, et c’est encore très flou pour les personnes transfem ayant effectué une vaginoplastie. En pratique, ces personnes ne peuvent pas passer d’un schéma de prise continu à un schéma discontinu, pour adapter le médicament à leur propre sexualité. À mon sens, c’est l’un des éléments centraux permettant d’expliquer que les hommes cis gays soient presque les seuls à utiliser la PrEP comme moyen de protection de l’infection par le VIH.
Il semble parfois que les politiques de santé publique tentent d’appliquer la stratégie de prévention ayant fonctionné chez les hommes cis gays à d’autres catégories de population, sans prendre en compte leurs spécificités.
Hippolyte Regnault
Donc ces schémas de prises pourraient fonctionner pour d’autres groupes que les hommes cis gays, mais la recherche ne nous permet pas encore de l’affirmer ?
Tout à fait, et c’est une des questions que je pose dans ma thèse. Je pense que les inégalités d’accès à ce traitement se construisent au moment de la recherche, et la question du genre n’est pas toujours posée, ou pas assez justement. J’en donnais un exemple juste avant : la prise intermittente de la PrEP est interdite aux personnes ayant des relations vaginales réceptives. Mais cette restriction d’utilisation est basée sur des connaissances en biologie qui restent très parcellaires. On postule sans l’avoir établi que le médicament serait moins bien absorbé dans les muqueuses vaginales. On se rend compte maintenant que c’est finalement les hormones dites « féminisantes », et non pas les muqueuses qui pourraient jouer sur l’absorption… Enfin bref, pour le moment, c’est l’ignorance quasi-totale. Et c’est sur la base de cette ignorance scientifique qu’on restreint l’utilisation de la PrEP à certaines catégories de sexe et de sexualité.
Aujourd’hui, les personnes qui prennent la PrEP sont essentiellement issues de classes moyennes et supérieures : pour quelles raisons ?
C’est impossible d’extraire les rapports sociaux de genre et de sexualité d’autres rapports sociaux, notamment de race, de classe, de précarité et de nationalité. C’est le principe du concept d’intersectionnalité. On voit par exemple que la proportion de bénéficiaires de la CMU ou de l’Aide médicale d’État parmi les utilisateurices de la PrEP est faible (respectivement 7,4% et 1,1%), alors que ce médicament est relativement disponible en France. Il est remboursé à 100% par la Sécu pour toute personne résidant sur le territoire depuis plus de trois mois. Les raisons qui permettraient d’expliquer ce différentiel sont assez similaires à celles qu’on a évoquées plus tôt, notamment en termes de promotion et de communication, destinées à des HSH, cis, blancs, citadins et aisés. Il semble parfois que les politiques de santé publique tentent d’appliquer la stratégie de prévention ayant fonctionné chez les hommes cis gays à d’autres catégories de population, sans prendre en compte leurs spécificités.
Pourtant, tu le disais, la prescription de la PrEP est censée être assez simple…
La PrEP est homologuée en France depuis 2016, et si au départ elle ne pouvait être prescrite qu’à l’hôpital, depuis juin 2021, elle peut être initiée par n’importe quel·le médecin généraliste. Cette extension est encourageante, il est a priori plus facile d’accéder à la PrEP en France, mais on manque de recul pour savoir si cette mesure aura un impact direct. En effet, ça n’est pas toujours facile de trouver un·e généraliste avec qui on peut parler de sexualité, de consommation de drogues, d’identité de genre ou bien de travail du sexe (sujets qui peuvent être abordés dans le cas des suivis PrEP). Il y a aussi des médecins qui ne connaissent pas la PrEP et ne sont pas formé·es à prescrire ce médicament, avec tout ce que ça demande en connaissances communautaires sur les parcours des personnes, mais aussi en capacités d’écoute et de non-jugement. Dans les faits, je crois que pour le moment, très peu de généralistes acceptent de se mouiller et d’initier des suivis PrEP chez d’autres catégories de populations que les hommes cis gays.
Dans le cadre des controverses liées à la promotion du traitement, la PrEP a exposé certaines populations minorisées à une stigmatisation homophobe et misogyne, prenant appui sur des stéréotypes socialement et culturellement genrés.
Hippolyte Regnault
Il y a donc encore de nombreux freins à cette prescription ?
Oui, les recherches sur la PrEP aux États-Unis et en France ont suscité des réticences et des résistances, une sorte de panique morale qui ressurgit sous différentes formes selon le contexte. On avait peur que l’utilisation de la PrEP entérine l’abandon du préservatif. Force est de constater qu’aujourd’hui, après près de quarante ans de lutte contre l’épidémie, le préservatif et les stratégies de promotion qui y sont liées ne suffisent pas à enrayer la course de l’épidémie. Là où en 2018, on observe pour la première fois en France une inflexion de la courbe des nouvelles infections par le VIH, qu’on peut vraisemblablement attribuer à un premier « effet PrEP ».
L’un des principaux arguments des détracteurices de la PrEP, c’est de dire que le déploiement du médicament conduit à une recrudescence des autres IST – les hépatites, la chlamydia, la gonorrhée, la syphilis… C’est aussi de dire que l’argent public finance une sexualité « débridée » chez certaines catégories de population. Dans le cadre des controverses liées à la promotion du traitement, la PrEP a donc exposé certaines populations minorisées à une stigmatisation homophobe et misogyne, prenant appui sur des stéréotypes socialement et culturellement genrés. C’est notamment le cas de l’expression « putes à Truvada » qui, aux tout débuts du médicament, et notamment sur les réseaux sociaux, cherchait à pointer du doigt les hommes cis gays ayant fait le choix de la PrEP (Truvada étant le nom du médicament princeps breveté pour la PrEP).
Le préservatif ne suffit pas, c’est un fait établi sur plus de quarante ans. La PrEP fonctionne, c’est aussi un fait établi.
Hippolyte Regnault
Alors, si on va dans le sens de ces argumentaires conservateurs, on a effectivement observé une recrudescence des IST. Mais ce n’est pas possible de dire que c’est uniquement à cause de la PrEP. Dans le cadre du suivi médical auquel se plient les personnes sous PrEP, sont dépistées toutes les IST de manière trimestrielle. On effectue alors davantage de dépistages, et logiquement, plus on cherche, plus on trouve. Il y a bien sûr d’autres facteurs qui entrent en jeu pour expliquer cette recrudescence des IST, comme le changement des mœurs sexuelles en lien avec la démocratisation de l’utilisation des applications de rencontre, qui aurait amené à une multiplication des partenaires sexuel·les. Mais de manière générale, il n’est pas possible de condamner la PrEP en agitant le drapeau rouge des IST, ou bien de la dépense publique. Le préservatif ne suffit pas, c’est un fait établi sur plus de quarante ans. La PrEP fonctionne, c’est aussi un fait établi. Est-ce qu’elle est la solution miracle ? Probablement pas : on a vu qu’elle ne suscitait pas ou peu de demande auprès de populations spécifiques. Mais c’est une arme supplémentaire dans la lutte contre une épidémie qui, rappelons-le, n’est pas près de finir.
On a évoqué tout à l’heure les personnes migrantes, un des groupes les plus touchés par le VIH. Comment expliquer qu’iels accèdent si peu à la PrEP aujourd’hui ?
En effet, le ralentissement global des nouvelles infections VIH observé en 2018 en France ne concerne pas les personnes nées à l’étranger. À côté de ça, on sait maintenant que pour les femmes originaires d’Afrique subsaharienne, l’infection au VIH se produit dans 40% des cas après l’arrivée sur le territoire français. On pourrait se dire qu’il y a encore un gros travail de prévention à faire à destination de ce public-là, mais c’est mal considérer la réalité de ces personnes, leurs parcours, leurs priorités, qui bien souvent relèguent la santé sexuelle à un rang secondaire. Il faut qu’on puisse comprendre ça en premier lieu, plutôt que de se positionner comme des éducateurices dont ces personnes auraient besoin. Ce dont ces personnes disent nécessiter, c’est un logement salubre, manger à leur faim, se protéger d’éventuelles grossesses. On n’est pas là pour faire du prosélytisme sur la PrEP, il faut donc adopter une approche globale de la santé sexuelle. On observe d’ailleurs que les assos qui suivent les personnes migrantes ne peuvent plus faire exclusivement de la prévention car elles font ce que l’État n’est pas en mesure de garantir : de l’accompagnement pour l’accès aux droits.
La panique morale que tu évoquais tout à l’heure est-elle aussi un enjeu pour ce public-là ?
Panique morale, le mot est ici trop fort, mais des réticences et des résistances, ça oui, c’est ce qu’on est en train d’observer avec FASSETS, un des projets sur lesquels je travaille en ce moment et qui cherche à favoriser la santé sexuelle des travailleuses du sexe immigrées à Marseille. On se pose la question des freins et des leviers au déploiement de la PrEP chez ce public-là en particulier.
Il y a déjà un facteur conjoncturel. Depuis les lois de 2016 visant à lutter contre le système prostitutionnel et depuis le début de la crise sanitaire, on assiste à une précarisation incroyable du travail du sexe en France. Ça s’est notamment traduit par l’interruption de certaines interventions associatives, ce qui a souvent entraîné une rupture de lien entre les assos et les personnes auxquelles elles s’adressent. Mais il y a d’autres facteurs, comme le fait que les pouvoirs publics aient tendance à faire l’amalgame entre traite humaine et travail du sexe : on considère ces femmes commes des victimes qui ne seraient pas à même de reconnaître leurs besoins, les manières d’y répondre, notamment de suivre un traitement journalier comme la PrEP. Cet amalgame prend racine dans des représentations racistes et sexistes, et il se fait au détriment d’une analyse plus complexe de la réalité vécue par ces femmes dans leur diversité. C’est pourquoi on observe des réticences au niveau institutionnel et médical à ne serait-ce que présenter la PrEP à ces femmes TDS immigrées. Alors de là à le leur proposer… Résultats des courses, sur le terrain, on observe qu’elles ne connaissent pas ce médicament ou le confondent avec le TPE, qui est le traitement préventif d’urgence à prendre à l’hôpital dans les 72 heures après avoir été exposé·e à une infection éventuelle par le VIH.
Il est urgent d’inclure davantage les femmes TDS immigrées des systèmes de production et de partage de connaissances sur la santé sexuelle.
Hippolyte Regnault
Finalement, à l’éclairage de nombreux travaux de sciences sociales, on peut interpréter cette méconnaissance de la PrEP. L’ignorance n’est pas qu’une absence de savoir, ou bien un simple trou dans la connaissance : elle est socialement située. C’est-à-dire qu’elle est produite par un certain nombre de facteurs, dépendant de rapports sociaux comme la race et le genre, qui excluent les femmes TDS immigrées des systèmes de production et de partage de connaissances sur la santé sexuelle. Au vu des statistiques épidémiologiques, il est pourtant urgent de les y inclure davantage, notamment dans le cadre de projets de recherche communautaire.
Justement, tu es investi dans un projet de recherche communautaire avec des travailleuses du sexe. Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont vous travaillez ?
Dans le cadre de FASSETS, des médiatrices en santé sont salariées. Elles sont parfois des travailleuses pairs, c’est-à-dire qu’elles ont eu une expérience de TDS, mais elles sont surtout issues des communautés de nationalité les plus représentées dans le travail du sexe à Marseille (Nigéria, Afrique du Nord, Amérique du Sud, Europe de l’Est). Dans le cadre de ce projet de recherche communautaire, on essaie aussi de faire participer les femmes concernées aux processus de production et de partage des connaissances. C’est encore à l’état d’hypothèses pour le moment, mais leurs perspectives permettent d’établir des systèmes de représentation et d’appropriation du médicament très différents de ceux qu’on avait pu observer chez les hommes cis gays. Chez les travailleuses du sexe, ça permet de délimiter des frontières dans leur sexualité entre le travail et le plaisir. Ça permet aussi de diversifier les services proposés en fonction du type de protection utilisé.
Car oui, la PrEP peut être utilisée comme un outil de travail : le travail du sexe est un travail, et dans le cadre de ce travail, la santé sexuelle est un bien privé qu’il est possible de mettre en marché. Ce n’est pas seulement un bien public qu’il s’agit de promouvoir via des politiques de santé : à la fin du mois, s’il manque 50€ pour payer le loyer, certain·es TDS acceptent déjà des prestations non protégées par le préservatif pour augmenter le prix du service. Ces perspectives, on n’aurait pas pu les avoir sans impliquer les personnes concernées dans les projets de recherche.
<iframe src="https://embed.acast.com/$/61d484103b4a0600121fc69b/prevention-et-reduction-des-risques-des-outils-pour-la-lutte" frameBorder="0" width="100%" height="110px" allow="autoplay"></iframe>(1) La thèse d’Hippolyte Regnault est financée par l’Agence nationale de recherche sur le sida et les maladies infectieuses émergentes (ANRS-MIE), il dépend de l’IRISSO à l’Université Paris Dauphine, et du laboratoire SESSTIM (rattaché à Aix Marseille Université).
(2) Depuis 2015, les résultats de l’essai clinique français Ipergay ont permis de démontrer l’efficacité d’une prise ponctuelle de la PrEP : il s’agit en somme de prendre deux cachets de médicament au moins deux heures avant un éventuel rapport à risque, puis un autre cachet 24 heures après le rapport, un dernier 48 heures après, et ainsi de suite si d’autres rapports sexuels ont lieu entre temps.
Interview réalisée en février 2021 par Soizic Pineau, mise à jour en novembre 2022 par Hippolyte Regnault
Édition et relecture : Anne-Charlotte Michaut et Soizic Pineau
Visuel à la une : Dana Galindo
Retrouvez notre série de podcasts VIH/sida, l’épidémie n’est pas finie !
Épisode 1 – Une histoire sociale et politique au musée
Épisode 2 – Luttes d’hier et d’aujourd’hui
Épisode 3 – Stigmatisation : une épidémie à la marge ?
Épisode 4 – Prévention et réduction des risques, des outils pour la lutte
Épisode 5 – Transmettre : un devoir de mémoire
Épisode bonus – Art et luttes : quelles mises en récit ?
Cet article Lutte contre le VIH/sida : et si la PrEP avait un genre ? provient de Manifesto XXI.

Sans avoir mené de grande étude anthropologique sur le sujet, il me semble pouvoir affirmer
L’article Clash civilisationnel est apparu en premier sur 360°.

Le Sénat américain a voté, mardi 29 novembre, par soixante et une voix contre trente-six, le « Respect for Marriage Act », un texte qui devrait protéger le mariage égalitaire dans l’ensemble des Etats-Unis. Il était déjà garanti par la Cour suprême des Etats-Unis depuis 2015, mais après sa volte-face sur le droit à l’avortement, beaucoup …
L’article Le Sénat américain vote une loi protégeant le mariage pour toutes et tous dans l’ensemble du pays est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Tu as beau être totalement au clair avec toi-même, les préjugés contre les personnes séropositives existent malheureusement toujours. Voici comment y faire face.
L’article En parler ou pas: comment se défendre contre la stigmatisation liée au VIH est apparu en premier sur 360°.

Le Parlement de Singapour a révoqué, mardi 29 novembre, la « section 377A » de son Code pénal qui datait de l’époque de la colonisation britannique et pénalisait l’homosexualité jusqu’à deux ans d’emprisonnement. En février dernier, un collège de juges avait déjà décrété que la loi gardait un rôle symbolique, mais qu’elle ne pourrait plus …
L’article Singapour décriminalise l’homosexualité, mais inscrit l’interdiction du mariage égalitaire dans sa Constitution est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Christelle Murhula : « Il faut que la révolution romantique soit collective » provient de Manifesto XXI.
Dans son nouveau livre Amours silenciées, repenser la révolution romantique depuis les marges, Christelle Murhula fait le constat d’un manque : alors même que ces concepts émanent des franges de la société, celles-ci sont absentes des discussions autour de la déconstruction de l’amour. Pourquoi les solutions clés en main vendues par les féministes mainstream pour révolutionner le couple évincent-elles les femmes noires et/ou précaires ?Chaque mois, ou presque, une nouvelle parution vient s’ajouter à la pile déjà bien fournie de livres prophétisant la fin de l’amour amoureux tel qu’on le connaît. Outre leur obsession pour des « solutions miracles » censées anéantir le couple cis-hétéronormé, ces ouvrages ont un autre point commun : le fait d’invisibiliser les personnes à la marge. Ainsi, les gros·ses, les handi·es, les queers, les racisé·es et les noir·es ne sont pas convié·es à la révolte. Les personnes qui se battent simultanément contre plusieurs oppressions ne se retrouvent pas dans ces discours pensés par et pour les blanc·hes, bourgeois·es et hétérosexuel·les, alors même que ce sont elleux qui ont pavé le chemin. Dans une société gangrenée par la (fausse) figure de la femme noire forte et sacrificielle à qui l’on refuse la vulnérabilité, le repos, le romantisme et l’empathie, il semble évident que l’accès à l’amour n’est pas le même pour toustes. bell hooks et Audre Lorde ont beau avoir posé les premières pierres de l’amour subversif, elles sont rarement citées, leurs propos sont récupérés, édulcorés, et leurs théories sont revendues des décennies plus tard comme des concepts inédits et révolutionnaires. Dans Amours silenciées, repenser la révolution romantique depuis les marges, la journaliste et autrice Christelle Murhula remet les pendules à l’heure. Interview.
Il y a des femmes qui n’ont pas le temps de se poser toutes ces questions sur la révolution romantique. Leur priorité est de sortir de la précarité.
Christelle Murhula
 © Eva Belizaire
© Eva Belizaire
Manifesto XXI – Quand tu parles d’amours silenciées, de quelles amours parles-tu, au juste ?
Christelle Murhula : Je parle des femmes qui ne sont pas représentées lorsqu’il s’agit de parler d’amour romantique. C’est-à-dire les femmes racisées, en situation de handicap, grosses, queers… Toutes les personnes qui ne sont pas des femmes blanches, bourgeoises, valides et hétérosexuelles, en somme. Mais les amours silenciées, ce sont aussi toutes les formes d’amour non romantiques et passées sous silence, comme l’amitié ou l’amour communautaire, par exemple.
Sur le marché de l’amour, les femmes noires sont, au choix, ignorées, fétichisées, ou on leur refuse toute forme de romantisme ou de désir. Dans ce contexte, à quoi ressemble la révolution romantique pour elles ?
Bien avant qu’elle passe par la façon dont on peut dater des gens, la révolution romantique passera par le fait de réussir à s’aimer soi-même. Nous sommes en France, dans un société raciste et misogyne, donc il est difficile de réussir à le faire sans avoir à lutter contre une haine de soi bien ancrée. Il faut également mettre sur la table le fait que pour nous, femmes noires, l’accès à l’amour est différent de celui qu’ont les femmes blanches, notamment.
D’ailleurs, dans ton échange avec Douce Dibondo dans le podcast On peut plus rien dire de Judith Duportail, vous disiez que la révolution romantique avait déjà eu lieu dans les marges, notamment queers et/ou noires, et que ces revendications n’ont été prises au sérieux que lorsque des femmes privilégiées s’en sont emparé.
Oui. bell hooks avait tout dit il y a vingt ans. Audre Lorde avait tout dit dans les années 70. Les féministes noires américaines avaient un temps d’avance. En France, la notion de « révolution romantique » vient de Costanza Spina de Manifesto XXI. Son travail a été invisibilisé, détourné et vidé de son sens. Et, surprise, il s’agit d’une femme lesbienne. Comme d’habitude, il faut toujours attendre que ce soit les femmes les plus privilégiées de la classe sociale « femmes » qui s’emparent d’un concept pour que celui-ci devienne valide et médiatisé. Ça a notamment été le cas avec le concept de sororité ou encore avec celui d’intersectionnalité.
Te reconnais-tu dans la vague de révolution romantique telle qu’elle est vendue aujourd’hui ?
Absolument pas ! Les femmes qui la vendent parlent toutes d’amour et d’inégalité au sein du couple. Quand je lisais ça, je me disais « encore faudrait-il que j’aie accès au couple » ! En tant que femme noire issue de banlieue parisienne, je fais face à plein de paramètres sociaux, comme le classisme ou le racisme. Je n’avais pas le temps de réfléchir à tout ce dont elles parlaient, car j’ai surtout dû survivre à d’autres choses liées à l’amour ou au romantisme. Je ne m’étais même pas considérée comme un être romantique jusque-là…
Les femmes noires sont rendues très vulnérables par la société, mais personne ne nous accorde cette vulnérabilité.
Christelle Murhula
Dans la conclusion de ton livre, tu dis « l’amour romantique reste le plus centralisé dans nos vies, au détriment des autres formes ». Pour les femmes noires qui vivent une double oppression, le sexisme et le racisme, est-ce que ça ne serait pas aussi un moyen de se sentir validées et d’acquérir une valeur sociale ?
Certaines femmes marginalisées ne se considèrent « normales » qu’une fois qu’elles réussissent à être avec quelqu’un, parce que le fait qu’on les regarde dans cette société relève de l’exception. Être en couple romantique peut d’ailleurs aussi être le facteur d’une ascension sociale.
Dans le podcast On peut plus rien dire, tu disais que certaines femmes n’avaient pas d’autre choix que de se mettre en couple monogame pour sortir de la précarité et n’avaient pas le temps de penser au polyamour ou à d’autres formes de relations. Là aussi, on n’a pas toustes le même accès à ces solutions qu’on nous vend « clés en main » ?
Il y a des femmes qui n’ont pas le temps de se poser toutes ces questions sur la révolution romantique. Leur priorité est de sortir de la précarité, et le couple monogame peut être le moyen de bénéficier d’une potentielle ascension sociale. Celui-ci permet d’obtenir un accès plus simple à la propriété ou au logement, et ne constitue pour certain·es pas une option parmi d’autres, mais simplement la seule option pour s’en sortir. C’est une façon de s’échapper d’un milieu social ou d’un environnement géographique, de quitter le foyer familial et d’espérer une stabilité financière. On oublie de parler à ces femmes-là. On est dans une bulle privilégiée où on a le temps d’analyser tous ces concepts, mais ce n’est pas le cas de tout le monde.
La sphère romantique est un espace très vulnérable, d’autant plus pour les femmes noires qui peuvent y vivre une multitude d’oppressions de la part de leur partenaire intime. C’est quelque chose que tu as pu personnellement remarquer ?
On est vulnérables car on est sujettes à une pièce qui comporte deux faces. D’une part, on est confrontées au rejet total. D’autre part, à la fétichisation. Pour trouver un équilibre, c’est donc compliqué. Il y a également l’idée que les femmes noires sont forcément fortes et peuvent tout encaisser dans les relations, qu’elles soient romantiques, amicales ou familiales, d’ailleurs. On projette sur nous la figure du care, de la personne qui s’occupe de tout le monde sans broncher, qui supporte toutes les formes de violence et dont on félicite la résilience sans aucune empathie. Si les femmes blanches devaient supporter un quart de ce que les femmes noires se prennent dans la tête depuis leur enfance, notamment en termes de rapport à l’amour, je suis certaine qu’elles susciteraient davantage la compassion. On est donc rendues très vulnérables par la société, mais personne ne nous accorde cette vulnérabilité.
Tu dis que les femmes noires sont un genre à part entière. Peux-tu expliquer pourquoi ?
On est à mille lieues de ce qui est censé représenter la féminité classique valorisée par les sociétés occidentales (douceur, discrétion, beauté normée, etc). On nous dénie totalement ce statut de femme. Cela se retrouve dans la misogynoir et dans le fait de comparer les femmes noires à des joueurs de football, à associer la couleur de leur peau à du charbon… On a dû grandir avec des hommes de notre propre race qui nous déniaient aussi cette féminité, à travers des insultes comme « Fatou » ou encore « Niafou ». Nous ne sommes pas des femmes aux yeux des hommes : cette féminité, on doit la gagner. C’est pour cela que je cite souvent Gloria Hull : « Toutes les femmes sont blanches, tous les Noirs sont des hommes, mais nous sommes quelques-unes à être courageuses. » Quand on parle de genre, on parle du genre des femmes blanches et pas de celui des femmes noires. Notre genre vient après, on doit sans cesse le rappeler, le prouver.
Les femmes blanches aussi doivent se documenter sur leurs propres privilèges. Il faut que la révolution soit collective.
Christelle Murhula
Selon toi, pourquoi les femmes noires ne partent-elles pas du même pied d’égalité en termes de rencontres ?
On est en bas de l’échelle de la société et de la désirabilité. Socialement, on ne représente pas quelque chose de respectable et de valorisé. Pour les gens, toutes races confondues, c’est un déclassement social que d’être en couple avec une femme noire.
Dans ton livre, tu évoques le lesbianisme politique et expliques que c’est un luxe que de vouloir et de pouvoir s’extraire de la société normative. Quand on est déjà à la marge, est-ce une solution viable ?
Ce n’est pas le lesbianisme politique qui va nous protéger du racisme dans les relations ou nous sortir du regard blanc. Ce n’est pas la solution miracle pour toustes. Pour certaines, c’est s’ajouter une autre discrimination et une autre perspective d’oppression.
Le polyamour est également brandi comme une solution miracle. Pourtant, on y rencontre encore des dynamiques de pouvoir et des déséquilibres, notamment selon le capital normatif des différent·es partenaires.
Premièrement, le polyamour, ce n’est clairement pas pour tout le monde. Certaines personnes sont monogames et se forcent à adopter des schémas polyamoureux pour faire « la révolution de l’amour ». C’est donc une nouvelle injonction qui peut se créer. Ensuite, le polyamour n’est pas exempt des dynamiques racistes et sexistes qui existent déjà dans la société. Il faut se poser certaines questions. Est-ce que le polyamour est considéré comme tel quand c’est une personne noire qui le pratique, ou est-ce considéré comme de la polygamie ? Est-ce que dans un couple polyamoureux, la ou les femmes ont autant de partenaires que le ou les hommes ?
À ton échelle, comment essayes-tu de révolutionner l’amour en tant que femme noire ?
Ma perspective de solution, ça a été d’écrire ce livre et de rappeler que les femmes noires existent et font face à des dynamiques différentes. La révolution romantique, c’est pour tout le monde. Nous aussi, nous avons le droit d’y réfléchir.
D’ailleurs, on parle beaucoup de solutions individuelles pour mener à bien cette révolution, mais peut-on vraiment s’affranchir seul·e du modèle blanc, hétérosexuel et normé du couple ?
Non. Qui lit mon livre ? Qui écoute Le Cœur sur la table, ou se pose ce genre de questions ? En grande majorité, ce sont des femmes. Rien ne va changer si les hommes ne se mettent pas au boulot sur ces sujets. Ce sont les femmes qui font tout le travail, en produisant du contenu et/ou en tentant de les éduquer sur ces concepts. On reste statiques, car seules les femmes s’en emparent. Les femmes blanches aussi doivent se documenter sur leurs propres privilèges. Il faut que la révolution soit collective, et on en est encore loin.
Tu dis que les femmes font tout le travail. C’est d’autant plus vrai pour les femmes noires, qui se retrouvent souvent au front des luttes, comme le note le journaliste Anthony Vincent. Comment l’expliques-tu ?
On a dû apprendre à se défendre toutes seules. Alors, lorsqu’on est témoin d’une injustice, on va au front pour les autres et on se prend les coups en premier. On a ce truc un peu sacrificiel de se dire « personne n’y va, alors on va y aller ». On réfléchit et on manifeste avant tout le monde. Pour autant, nous n’avons jamais le droit à la plainte ou à l’empathie. On attend de nous qu’on prenne soin des autres en toutes circonstances. Je pense que c’est aussi pour cela qu’on nous ôte notre féminité : on n’a le droit à aucune forme de vulnérabilité.
Tu évoques l’amour noir, ou Black love, dans ton livre. Pour toi, s’agit-il d’une piste de solution pour révolutionner l’amour ?
Je suis gênée par le fait qu’on ne parle d’amour noir que sous le prisme de l’amour romantique. Pour moi, ça va plus loin que cela. C’est simplement s’aimer soi-même en tant que personne noire et aimer sa communauté, sans pour autant fermer les yeux sur ses problématiques propres. Je crois que cette optique-là pourrait changer tellement de choses. Je pense aussi que cet amour de soi sera plus présent pour les générations futures et fera bouger les lignes.
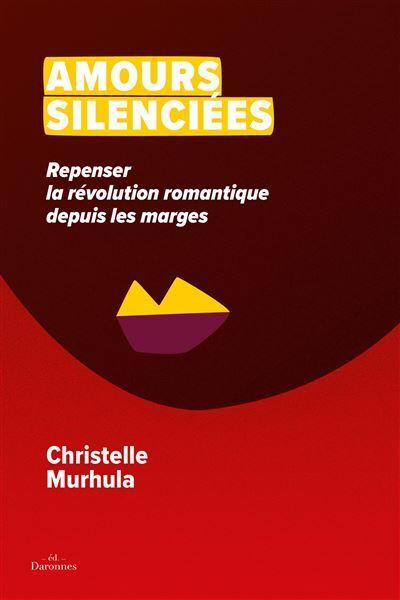
Christelle Murhula, Amours silenciées, repenser la révolution romantique depuis les marges, éd. Daronnes, 2022
Image à la Une : © Eva Belizaire
Relecture et édition : Sarah Diep
Cet article Christelle Murhula : « Il faut que la révolution romantique soit collective » provient de Manifesto XXI.



Un supporter italien a surgit sur la pelouse pendant la deuxième période du match, brandissant un drapeau « arc-en-ciel », avant de se faire plaquer par les agent de sécurité.
L’article Qatar 2022 : Quand un spectateur interrompt le match Portugal-Uruguay avec un drapeau « arc-en-ciel » est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Pour son édition 2022, le festival Les Urbaines fait vivre plus de quarante spectacles gratuits dans des lieux répartis entre Lausanne, Renens et Chavannes. À découvrir du 2 au 4 décembre.
L’article Les Urbaines: faire émerger l’art est apparu en premier sur 360°.

Sara est née en Espagne, il y a bientôt trois ans, d'un couple de femmes, anglo-bulgare, qui se sont également mariée sur place. Mais la Bulgarie ne reconnaît pas les mariages de même sexe et refuse d’accorder le statut de parents à ses deux mères.
L’article « Baby Sara », 3 ans, apatride, la Bulgarie refusant d’accorder le statut de parents à ses deux mères est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Se dédouanant de toute haine, le pasteur Aaron Thompson s'est réjoui du massacre de Colorado Springs, estimant que c'était « une bonne chose » que ces personnes, des « homos », aient été assassinées.
L’article Quand un pasteur baptiste « se réjouit » de la fusillade lgbtphobe qui a fait 5 morts au Colorado est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

La Cour suprême de l’Inde a consenti vendredi 25 novembre à l'examen d'une requête déposée par un couple d’homosexuels qui réclame la reconnaissance de leur mariage, et donc des unions de personnes de même sexe.
L’article La Cour suprême de l’Inde envisage de légaliser le mariage pour toutes et tous est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Après une série d’incidents (vêtements confisqués, supporters refoulés ) et face à fronde européenne et menaces d’actions judiciaires , la FIFA vient d’annoncer aux fédérations nationales de football que le « drapeau arc-en-ciel » et autres symboles de soutien à la communauté LGBTQ+, durement réprimée au Qatar, étaient désormais autorisés dans les stades. Une levée …
L’article Qatar 2022 : sous tension, la FIFA autoriserait finalement les couleurs arc-en-ciel dans les stades est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Ce 22 novembre, alors que l’Arabie Saoudite affrontait l’Argentine, la police et les services de sécurité du stade Lusail, à Doha, ont harcelé le journaliste brésilien, Victor Pereira, pour un drapeau du Pernambouc, un Etat du Brésil, que les agents avaient pris pour celui des Fiertés LGBT+. Le premier arbore également un arc-en-ciel depuis 1917, …
L’article Mondial 2022 : un journaliste harcelé par la police qatarie après une confusion entre un drapeau régional brésilien et celui des Fiertés LGBT+ est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Les députés russes ont adopté ce jeudi 24 novembre des amendements qui élargissent considérablement le champ d’application d’une loi interdisant la « propagande » LGBT+, en plein virage conservateur du Kremlin accompagnant son offensive militaire en Ukraine
L’article La Russie bannit toute « propagande » LGBT est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Loyle Carner, Cheval de Troie du rap provient de Manifesto XXI.
Avec hugo, Loyle Carner signe un troisième album puissant, qui plonge sans concession dans son intime politique. Pour discuter de son album, on a rencontré l’un des rappeurs anglais les plus talentueux de sa génération.« Listen, let me tell you what I hate » (Écoute, laisse moi te dire ce que je hais). hugo s’ouvre sur un « Hate » rageur et névralgique qui évoque les stéréotypes racistes avec lesquels Loyle Carner s’est construit. Plus incisif que les précédents, ce nouvel opus porte un discours ouvertement cathartique et politique. Durant les trois ans qui nous séparent de son dernier projet, il est devenu père. Et pour lui, qui s’est toujours senti amputé d’une partie de son histoire n’ayant jamais eu accès à la culture noire qui fait la moitié de son identité, il est important de se reconnecter à ses racines. Le caractère testamentaire de son œuvre découle alors de son besoin de colmater, pour son fils, les brèches encore ouvertes de son identité. « Because my kid will probably have them blue eyes / And won’t understand / The pain that’s in mine (…) Because I never wanna hear / The same cry / From a kid who doesn’t fit in / To the world that he live in » (Parce que mon enfant au probablement leurs yeux bleus / Et ne comprendra pas / Ma douleur / Parce que je ne veux jamais entendre / Les mêmes pleurs / D’un enfant qui ne s’intègre pas / Dans le monde qui est le sien) déclame-t-il dans « Nobody Knows ».
Au fil des morceaux, il s’interroge sur sa place dans le monde en tant qu’homme métis, en tant que rappeur, en tant que père et fils. Ses textes rapportent cette quête d’identité dans une société lourdement marquée par un racisme systémique dont il fait les frais en grandissant. Sa musique est un message, un discours, qui mêle l’intime à la revendication. C’est que pour lui, il n’existe que très peu de différence entre le poète, le musicien et le politicien. On retrouve donc en featuring John Agard, poète afro-guyanais qui interprète Half-Cast, son poème le plus célèbre, ainsi qu’Athian Akec, jeune noir londonien engagé en politique, qui se bat pour la justice sociale et raciale en Angleterre. Ce dernier est invité sur « Blood on my Nikes », un titre qui s’intéresse au « knife crime », les meurtres au couteau, de plus en plus nombreux à Londres, qui ont selon lui pour origine le mépris politique envers les plus précaires.
Émouvant par sa sincérité totale, puissant par l’acuité de l’écriture et efficace par ses productions qui revisitent des structures de rap old-school, le Londonien signe un très bel album – qui a l’avantage d’être brillamment retranscrit sur scène. Sur des productions toujours largement empreintes d’influences jazz, il n’omet pas de nous surprendre dans des outros magnifiées d’un penchant plus indie, comme sur « Plastic », pamphlet sur la superficialité du monde. La poésie de Loyle Carner n’a jamais si bien résonné que dans hugo. Héritage, représentation, Red Hot Chilli Peppers et Cheval de Troie : on est revenu avec lui sur cet album.
Tu viens de sortir ton troisième album. Tu en es content ?
Oui, je suis très fier de hugo. Ça faisait longtemps que je n’avais pas sorti de projet et, selon quelques personnes avec qui j’en ai parlé, l’album semble aider les gens, à leur faire comprendre ce qu’iels ressentent, à dealer avec des relations compliquées… Ça veut dire qu’il remplit son rôle, qu’il fait son job dans le monde. Et ça c’est vraiment cool.
À travers les différentes étapes que tu traverses dans ton album, on sent que ça a été un long processus d’écriture, que tu as beaucoup changé aussi.
J’ai travaillé sur ce disque pendant trois ans. C’est agréable de travailler dans la durée et je pense que pour faire quelque chose dont on est vraiment fier, qui compte, il faut y consacrer du temps. Parfois le processus était dur ou fatigant, parfois il me mettait à l’épreuve, mais je pense que c’est le but. J’ai été obligé de me pousser, émotionnellement.
Et j’ai changé, oui. J’ai eu un fils et c’était quelque chose d’assez énorme, déjà. Ça a mis ma vie sens dessus dessous. J’ai dû mûrir, ça a calmé mon égo, m’a rendu plus humble et j’en avais bien besoin. Ma mère me disait souvent « tu verras, quand tu auras des enfants tout sera différent pour toujours » et j’en riais doucement. Mais en fait, j’en suis là et c’est vrai. Devenir père m’a forcé à devenir plus courageux. J’ai été obligé de me regarder d’une façon très différente, d’être complètement honnête avec moi-même, de regarder toutes ces parties de moi que je n’aime pas, toutes celles qui me rendent triste, qui me ralentissent ou me fatiguent, pour les affronter. Parce que si on ne le fait pas, c’est l’enfant qui en souffre.
 © Jesse Crankson
© Jesse Crankson
La question de l’héritage semble être très importante pour toi. À travers ton album, tu évoques l’héritage que tu veux laisser à ton fils, celui que tu n’as jamais reçu de ton père, celui que tu es allé chercher en Guyane… Est-ce que tu considères ta musique comme une forme d’héritage personnel que tu construis petit à petit ?
Tout à fait. Mon plus grand souhait est que dans vingt, trente ou cinquante ans, ma musique puisse encore être une amie pour les gens. Que les gens puissent l’écouter et se sentir réconfortés ou soutenus. J’aimerais que mon fils, quand il sera plus grand, puisse être fier. Qu’il puisse dire à ses ami·es « mon père s’est battu pour ça. Il a parlé de ça et a aidé ces gens ». L’héritage c’est très important, c’est tout ce qu’on a.
Pour l’écrire, tu as dû te reconnecter à ton père biologique, à ton histoire. Tu es allé en Guyane pour tourner le clip de « GeorgeTown »… Qu’est-ce tu en as appris en tant qu’artiste ?
J’ai appris à être plus curieux et ouvert d’esprit, à être plus généreux de mon temps aussi. J’ai appris à ne pas croire que j’étais meilleur que n’importe qui et à rester ouvert à ce que les gens ont à dire, même s’iels ne partagent pas mon opinion. À dire : OK, fais moi changer d’avis, aide moi à voir les choses de ton point de vue, aide moi à comprendre. J’ai gagné ça en allant en Guyane. Parce qu’on ne partage pas la même culture, et pourtant c’est la mienne. J’ai ré-appris beaucoup de choses d’une autre manière et ça m’a bouleversé.
On sent aussi que tu as été inspiré par des choses différentes. Qu’est-ce que tu as écouté pendant que tu composais cet album ?
Kendrick Lamar, Alpha Mist, des artistes de jazz, Toro y Moi, Red Hot Chilli Peppers…
Les Red Hot ? Je n’aurais pas deviné…
Californication, en particulier ! J’adore la façon dont Anthony Kiedis, le chanteur, écrit. J’aime énormément cet album. Je ne l’avais jamais entendu quand j’étais enfant ! Il y a des choses comme ça, qu’on manque. Ma copine me l’a fait écouter un jour et j’en suis tombé amoureux. « Scar Tissue » ou « Porcelain », ce sont des morceaux qui veulent dire beaucoup pour moi.
Le manque de représentation de ma communauté dans ces métiers a fait que je ne pouvais pas m’y projeter.
Loyle Carner
Tu as invité sur l’album le poète John Agard et le politique anglais Athian Akec. Qu’ont-ils apporté à ta musique ?
En fait, je vois Athian comme un poète au même titre que moi. Et je vois John Agard comme un politique, au même titre que Malcolm X ou Athian. Tu connais l’histoire du Cheval de Troie ? L’armée qui entre dans la ville en se cachant dans un cheval en bois… Je me vois un peu comme ça. Les gens me voient sourire, avec ma tête de mec sympa et vont écouter ma musique. Et là je peux leur faire entendre des choses qu’ils n’auraient peut-être pas écoutées autrement. Je l’ai pris comme un devoir, surtout avec Athian. Il faut le mettre en avant, que les gens l’écoutent.
C’était important pour toi de les inviter sur les morceaux et pas seulement de les citer ?
Oui, bien sûr. Je pourrais complètement dire ce qu’ils disent. Mais quand quelqu’un·e dit quelque chose qu’iel pense vraiment, ça s’entend et se ressent. Si je l’avais dit, ça n’aurait pas eu autant d’impact.
Tu racontes que tu enregistres souvent les morceaux en une prise, pour garder l’émotion pure du texte.
Oui, et sur cet album en particulier, ça s’est beaucoup fait. Certains morceaux ont été réalisés extrêmement rapidement. On était au studio avec des amis, des musicien·nes jazz. Les musicien·nes jazz sont tellement talentueux·ses. Iels s’en foutent, iels jouent leurs idées et si les gens n’aiment pas, iels disent ok et passent à autre chose. Tous les jours on jouait peut-être dix ou vingt choses qu’on avait en tête et parfois des choses biens en sortaient. Par exemple, « Plastic » a été faite en peut-être dix minutes. Je l’ai écrite, on l’a enregistrée, tout le monde s’est dit que c’était cool et on est passés à autre chose. On n’y a pas pensé pendant quelques jours. Ça donne un recul très agréable sur sa propre musique.
Cette façon de rester au plus proche de l’émotion rappelle les formations d’acteur·ices. Tu as été en école de théâtre, quelles similitudes tu trouves entre le métier de comédien et celui de musicien ?
Ce pour quoi j’étais bon, en cours de théâtre, c’était pour être moi-même devant les gens. Ça parait simple, mais c’est extrêmement difficile. J’étais connecté à mes émotions, je les autorisaient à paraître. Je n’avais pas réalisé à quel point ça m’avait changé jusqu’à ce qu’en cours, mes amis me demandent comment je pouvais être aussi transparent avec ce que je ressentais. J’ai dis que je n’en savais rien. Mais je crois que ça s’est retranscrit dans ma musique. Je ne me sens pas mal à l’aise à l’idée d’être en colère, d’être contrarié, d’être en deuil. Je me connecte à toutes ces émotions, je les accepte et je m’autorise à ressentir tout ce que je ressens. Je pense que c’est la meilleure façon de passer à travers les mauvais moments. Si on ressent des émotions négatives et qu’on les refuse, ça empire. Mais si on s’autorise à les ressentir, ça nous passe dessus et puis ça s’en va.
Si j’avais dit à mes potes que je voulais devenir chef, par exemple, ils m’auraient dit « non mec, on ne fait pas ça nous ». Inconsciemment, on intègre cette pression sociale.
Loyle Carner
C’est une chose à laquelle tu penses en concert ? Tu entres sur scène comme un·e acteur·ice monte sur scène pour jouer un Tchekhov ?
J’ai plutôt tendance à imaginer la scène comme une paire de chaussons. Je les enfile et je me relaxe. La musique que je compose veut dire tellement pour moi, que c’est très facile de l’incarner. Les émotions sortent toutes seules, je n’ai pas à y penser. Je dis des choses en lesquelles je crois profondément et chaque fois que je les rappe, chaque partie de mon cerveau se connecte immédiatement à tous les souvenirs que ça m’évoque. Il m’arrive même de m’énerver sur scène, parce que je parle de choses révoltantes. Par exemple j’adore jouer « Hate » en live et laisser toutes ces émotions sortir, c’est extrêmement cathartique.
Dans « Hate » justement, tu dis « they say it was all that you could be if you were black, playing ball or maybe rap, and they would say it like a fact (…) all my teachers where you at ? ». (Ils disaient que c’est tout ce que tu pouvais être, si tu étais noir : faire du rap ou du foot. Ils disaient ça comme un fait. (…) Tous mes profs, vous êtes où ?). Est-ce que tu considères que les professeur·es et les services publics dans leur globalité ont une certaine responsabilité dans les questionnements que tu as à propos de la construction de ton identité ?
Ce n’est pas une attaque contre les professeur.es. Ma mère est prof, ma copine est prof, les profs sont incroyables, celles et ceux qui font bien leur travail. Mais iels sont rares aujourd’hui, parce que c’est un métier difficile, peu payé et très mal considéré. Chaque prof qui débarque dans une école se dit qu’iel va changer la vie des enfants. Mais après deux ou trois ans, iels réalisent qu’iels ne reçoivent aucun respect en retour, et deviennent tendu.es et énervé.es.
Mais je pense que oui, ce cadre d’éducation a une grande place dans notre construction. Je n’avais jamais vu quelqu’un qui me ressemblait jouer dans une pièce de théâtre ou être astronaute, par exemple. Donc je n’ai jamais pensé que c’était possible pour moi. C’est très compliqué d’imaginer quelque chose que l’on n’a jamais vu, le manque de représentation de ma communauté dans ces métiers a fait que je ne pouvais pas m’y projeter. En revanche, je voyais beaucoup de gens qui me ressemblaient qui faisaient du rap, du foot. Et dans les films, ils vendaient de la drogue ou commettaient des crimes. À l’école c’est ce qu’on me disait, que j’allais finir dans le rap ou le foot. Pourtant j’aimais beaucoup l’anglais mais personne ne m’a jamais dit que je pourrais écrire un roman, une pièce ou un film. On ne m’a jamais appris que c’était possible pour moi.
Tu penses que c’est la raison pour laquelle tu as fais du rap et pas autre chose ?
Bien sûr. Il y a de la pression sociale qui se répercute sur tout, chez mes amis aussi. Si j’avais dit à mes potes que je voulais devenir chef, par exemple, ils se seraient foutus de moi, ils m’auraient dit « non mec, on ne fait pas ça nous ». Inconsciemment, on intègre cette pression sociale. J’aimerais combattre ça. Je pense à Tyler The Creator ou Childish Gambino, qui sont des gens qui n’en ont rien à foutre de ce qu’on attend d’eux. Ils font des choses incroyables et ils reçoivent énormément d’amour, de toutes les communautés, pas seulement la communauté noire ! Parce que n’importe qui peut les regarder et se dire « ok, tu es noir et tu peux faire n’importe quoi, pas seulement du rap ou du foot ».
C’est encore cette idée de Cheval de Troie ! Tu t’es dit « ok je vais faire du rap, mais une fois à l’intérieur je vais combattre ces stéréotypes racistes ».
Exactement ! Je n’y avais jamais pensé comme ça, mais c’est très beau. Il faut jouer au jeu pour changer le jeu, non ? Donc oui, je suis un rappeur, si on me regarde de loin, qu’on ne me voit pas très bien, on se dit « tiens, c’est un rappeur là-bas ». Mais dès qu’on se met à fouiller dans ce que je fais, on peut voir que tous ces stéréotypes n’existent pas chez moi.
Est-ce qu’écrire à propos de ces blessures et se les réapproprier pour créer ton art t’aide à les combattre ?
Complètement. Ça montre à mes blessures que je n’ai pas peur d’elles. Je pense que si on ne verbalise pas, tout grandit, tous nos problèmes. Dès qu’on se met à en parler, on se dit « oh, ce n’est pas si gros finalement ». Et puis on peut les faire disparaître en une pichenette. Il faut les accepter pour pouvoir les combattre.
 © Jesse Crankson
© Jesse CranksonLe rap, dû à sa culture des clash, des battles, du « rap game », est plutôt un milieu d’égo, de compétition. Toi, tu débarques avec ta vulnérabilité, tu parles de tes doutes, tes faiblesses, tes peurs… Qu’est-ce que ça fait de se positionner dans ce monde sans être dans la démonstration de force ?
C’est un vrai soulagement. Quand j’étais plus jeune je voulais être dangereux, que les gens me voient comme quelqu’un de mauvais. Alors c’est vraiment merveilleux, parce qu’aujourd’hui, je peux faire la même chose que tous les mecs qui font du rap, mais je n’ai rien à prétendre, je peux être moi-même. Et c’est très amusant. Ma mère me disait souvent « si tu peux faire tout ce que tu veux et que tu peux être toi-même en le faisant, tu as gagné. Peu importe que tu gagnes moins d’argent ou que tu vives dans une plus petite maison : si tu es toi-même chaque jour et que les gens t’apprécient pour ce que tu es vraiment, c’est que tu as gagné ». Ça a toujours été mon rêve, que les gens puissent me voir pour ce que je suis, et qu’iels m’apprécient pour ça. Ou qu’iels ne m’apprécient pas, d’ailleurs, ça n’a pas d’importance.
Avec le petit recul que tu as maintenant, qu’est-ce qui te rend le plus fier dans cet album ?
Les collaborations que j’ai pu faire et le fait d’être resté ouvert. Ouvert au monde et aux idées des gens avec qui j’ai travaillé. Je suis aussi fier d’avoir été courageux, d’avoir parlé de ces merdes dont les gens ne parlent pas, à savoir le ressenti que peut avoir un homme métis face au racisme systémique. Parce que c’était effrayant parfois, de dire ces choses intimes et politiques. Je me demandais pourquoi je ne faisais pas plutôt quelque chose de chiant, de banal.
Tu t’es dit que ce serait mal reçu ?
Oui, par moment je me disais que je devrais plutôt parler de fêtes et de belles voitures, que les gens n’avaient peut-être pas envie d’entendre ce que j’avais à dire, qu’iels avaient peut-être simplement envie de danser. Je me demandais : Pourquoi je parle de moi ? Ça n’intéresse personne. Mais malgré tout, je me suis dit que c’était important, alors je l’ai fait.
Tu peux nous parler un peu de Chilli Con Carner ?
C’est une école de cuisine que j’ai ouverte pour les enfants qui ont des TDAH (trouble déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, ndlr). Ça fait sept ou huit ans maintenant que ça existe, j’ai commencé à 20 ans, donc ça fait un moment. On a fait la session annuelle cet été et, pour moi, c’est toujours la meilleure semaine de l’année. C’est l’occasion de passer du temps avec ces enfants qui m’apprennent toujours tellement. Iels ont l’esprit tellement ouvert, iels réfléchissent hors de toutes les cases et détestent les règles ! Parfois, je leur dis de faire quelque chose d’une certaine façon, iels me répondent « pourquoi je ne pourrais pas faire ça comme ça plutôt ? ». Et moi je me dis « bah oui, pourquoi pas ? ». Je me sens extrêmement chanceux, ayant moi-même un TDAH, de me retrouver dans cette position et de pouvoir être inspiré par ces enfants, à chaque instant.
C’est encore une forme d’héritage. Tu as appris à cuisiner avec ta mère quand tu as toi-même été diagnostiqué, ça t’a beaucoup aidé et aujourd’hui tu transmets ce savoir à ton tour.
Oui, c’est vrai, c’est ce qu’on essaye de transmettre. On voit une vingtaine d’enfants par an, ce qui n’est vraiment pas énorme, mais si chaque enfant le transmet à un autre enfant, que cet autre enfant fait de même, l’histoire se répand. C’est une des choses qui compte le plus pour moi, dans ce que je fais. Quand je croise des gens dans la rue qui m’arrêtent pour me dire « J’ai un TDAH, je sais que toi aussi et tu m’aides à me comprendre et à m’aimer » ça me donne envie de pleurer. Parce que quand j’étais enfant, même si ma mère me comprenait, je n’ai jamais eu ce modèle, qui me ressemblait et qui me faisait me sentir normal. Aujourd’hui, je peux être ce modèle pour quelques personnes et c’est un énorme privilège.
Loyle Carner sera à l’Olympia à Paris le 29 janvier 2023.
Relecture et édition : Pier-Paolo Gault
Image de couverture : © Jesse Crankson
Cet article Loyle Carner, Cheval de Troie du rap provient de Manifesto XXI.

Cet article Films Femmes Méditerranée, des rencontres dédiées aux regards du Sud provient de Manifesto XXI.
Films singuliers, regards pluriels, leçons de cinéma et récits initiatiques : la 17ème édition des Rencontres Films Femmes Méditerranée s’ouvre à Marseille le 26 novembre et présente au public le travail de réalisatrices et faiseuses de films des territoires méditerranéens. L’équipe de programmation nous a parlé de cette nouvelle édition.Depuis 17 ans, l’association met en avant le travail des cinéastes femmes du pourtour méditerranéen en organisant des séances de films, débats et rencontres professionnelles à Marseille et en région. Une partie de l’équipe de FFM – Ambre Veau, Camilla Trombi, Christine Ishkinazi et Jacotte Saussois – a répondu à nos questions. La géographie couverte par les recherches des programmateurices s’agrandit, les cinématographies présentées au public vont peu à peu toucher de nouveaux territoires en fonction, aussi, des urgences politiques : « L’Iran est devenu une priorité pour nous, et nous allons dédier ces rencontres aux cinéastes et artistes iraniennes. »
Une programmation plurielleProgrammation exigeante, le festival s’engage à défendre le cinéma féminin du Sud. En ouverture, Sous les figues d’Erige Sehiri – qui donnera une « leçon de cinéma » au Videodrome 2 le 29 novembre – film de femmes, rebelles et cueilleuses, en lutte avec les structures coloniales et patriarcales tunisiennes. Les adolescences et les jeunesses sont désireuses d’émancipation dans El Agua de Elena Lopez Riera ou Freda de Gessica Geneus ; le cinéma documentaire se fait en dérapage contrôlé avec Françoise Romand, qui sera mise à l’honneur avec la projection de plusieurs de ses films et réactivation d’une aventure cinématographique expérimentée en 2007 à Bagnolet, et qui aura cette fois lieu dans les tours Labourdette à Belsunce. Balada, réalisé par Aida Begic, clôturera cette édition des Rencontres : « Quelque chose nous a vraiment enthousiasmé·es avec ce film, et la clôture c’est aussi un moyen de le mettre en avant et d’encourager le public à s’y intéresser. »
Quarante films se succèderont jusqu’au 1er décembre dans plusieurs lieux de cinéma à Marseille et en région ; la décentralisation du festival est au cœur de l’action de l’association. Les films et certaines invitées sont aussi présents à Aix-en-Provence, Digne-les-Bains ou La Ciotat. « On accompagne les films et les réalisatrices à la demande des exploitants, parce que le public est en demande de rencontres avec les cinéastes, de rétrospectives… »
 Freda, de Gessica Généus, 2022, Nour Films
Agir pour un meilleur accès aux métiers du cinéma
Freda, de Gessica Généus, 2022, Nour Films
Agir pour un meilleur accès aux métiers du cinéma
L’association fait aussi vivre les films au-delà des Rencontres FFM tout au long de l’année en organisant des ateliers ciné-débat (dans le centre pénitentiaire des Baumettes, avec l’Ecole de la deuxième chance, Solidarité Femmes 13) : « On essaie de créer des moments de rencontre, par exemple en invitant Rokhaya Diallo qui a présenté son documentaire La Parisienne démystifiée et a répondu aux questions des participant·es. »
« En discutant avec les réalisatrices, on s’est rendu compte qu’elles avaient beaucoup de difficulté à produire un deuxième film, donc on a imaginé un appel à projets diffusé dans la région Sud et Nord de la Méditerranée. » Quatre ans déjà que les journées professionnelles sont organisées, permettant aux réalisatrices sélectionnées de présenter leur projet de film à des producteur·ices et à participer à des ateliers d’écriture ou de pitch.
Nouvel acte militant fort, les séances des Rencontres Films Femmes Méditerranée sont gratuites pour les étudiant·es, les personnes âgées de moins de 26 ans, les demandeur·ses d’emploi et les bénéficiaires des minimas sociaux. « Nous souhaitons faciliter un renouvellement du public, toujours dans le but de démocratiser l’accès au cinéma d’art et essai. »
Voir la programmation complète
Cet article Films Femmes Méditerranée, des rencontres dédiées aux regards du Sud provient de Manifesto XXI.

La construction du premier établissement public conçu comme maison de retraite queer est en cours d’achèvement en Espagne. Un projet unique, financé par la Région de Madrid, qui vise à lutter contre l’exclusion des senior·e·x·s LGBTIQ+.
L’article Vivre ensemble pour vieillir sans discrimination est apparu en premier sur 360°.

Plusieurs supporters du pays de Galles, ainsi qu'un journaliste américain, Grant Wahl, ont été refoulés du stade Ahmad-Bin-Ali à Doha, avant le match États-Unis – pays de Galles, pour des « bobs et t-shirts aux couleurs arc-en-ciel ».
L’article Qatar 2022 : Supporters et journalistes refoulés du stade pour des « bobs et t-shirts arc-en-ciel » est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Le père du tireur présumé qui a fait cinq morts et au moins dix-huit blessés au Club Q de Colorado Springs, a exprimé ses condoléances, s'avouant toutefois « soulagé de ne pas compter d’homosexuel dans sa famille ».
L’article Tuerie LGBTphobe du Colorado : le père du tireur « rassuré que son fils ne soit pas gay » est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.


Cet article Noires et queers, comment définir sa beauté à la marge de la marge ? provient de Manifesto XXI.
Être queer, c’est renverser les codes de la cis-hétéronormativité. Mais quand on est Noir·e dans une société blantriarcale et que nos corps et nos identités sont déjà hors du cadre, c’est une réalité bien différente de celle des queers blanc·hes… Comment se réapproprier nos corps, nos identités et nos esthétiques dans une société qui nous ignore ou nous fétichise ?À leurs yeux, mon corps noir n’est désirable que s’il est objet. Dès qu’il se meut ou qu’il désire, il dérange ou indiffère. À la minute où il s’incarne, il encombre et doit disparaître. Au mieux, on le réduit en bouillie jusqu’à ce qu’il ne devienne qu’un résidu de carcasse à fétichiser. Les muscles de mes cuisses sont obscènes, mon nez épaté est obscène, mes cheveux crépus sont obscènes, mes fesses sont obscènes, mon rire est obscène, la couleur brune de ma peau est obscène, les cicatrices de mon âme sont obscènes, et par-dessus tout, la personne qui habite ce corps noir est obscène. Difficile d’imaginer qu’il puisse exister au-delà de toutes ces obscénités. Difficile d’envisager des peurs, des envies, des vulnérabilités, des colères, des doutes, des blagues grivoises, des questionnements, et des sentiments bouillonnants derrière ce voile noir dessiné d’avance. M’aimeriez-vous toujours si je ne flattais pas l’image que vous avez construite de moi ? Accepteriez-vous mon plaisir et ma nudité si iels n’étaient pas seulement commandés par votre désir ? Pourquoi ne supportez-vous ma flamboyance que sous la lumière des projecteurs que vous braquez ? Regardez au plus proche de vous, et dites-moi quelle couleur vous voyez, quelle teinte prévaut dans les rangs les plus serrés de vos allié·es ? À croire qu’il faut du courage pour aimer quelqu’un comme moi. À croire que je ne suis qu’une théorie mais qu’en pratique, je ne m’applique pas, que je n’existe qu’à l’horizontale ou en pixels dans des sextos. Si vous ne supportez pas le libre arbitre de corps opprimés, fermez les yeux. Comment faire pour montrer la lumière à quelqu’un qui refuse de voir l’obscurité ? Je n’ai plus besoin de votre validation. Il n’y a d’obscène que votre indifférence. »
Ces lignes, je les ai écrites après une énième réflexion sur ma place dans les milieux queers blancs parisiens en tant que personnes sexisée noire. Je ne suis pas out depuis très longtemps. Pourtant, il ne m’a pas fallu beaucoup de temps pour me rendre compte que même dans la marge, il existe des dizaines d’autres franges. Les gros·ses, les handi·es, les personnes transgenres, non-binaires ou racisées y sont toujours effacé·es.
C’est aussi une réflexion que Costanza Spina a eue dans les colonnes de Manifesto XXI dans un article sur le capital beauté des personnes queers. Après sa lecture, je me suis longuement interrogé·e sur les spécificités liées au fait d’être Noir·e ET queer. Le papier en question parlait de la tendance des milieux queers à créer de nouvelles injonctions à être belleau, sexuellement actif·ve, et à prôner une sexpo [attitude sex positive] parfois toxique. Il parlait aussi de l’existence d’une esthétique queer qui dépouillerait la notion de son sens politique et excluerait les personnes qui ne jouent pas le jeu, les moches et les pauvres et celleux que la mode n’intéresse pas.
Mais que dire de ce capital beauté et de cette injonction à une esthétique queer quand on est Noir·e, soit déjà hors des canons et parfois des codes occidentaux ? Les normes de beauté ici critiquées sont aussi et surtout eurocentrées et racistes. « Il y a énormément de choses à dire sur l’hypersexualisation du corps noir, sa fétichisation et sa libération dans les milieux queers blancs. Sur le marché de la rencontre, par exemple, les personnes sexisées noires sont les moins “appréciées” de toutes et rencontrent le moins de succès, toutes races confondues. On nous complimente pour nous “empouvoirer”, on copie nos codes esthétiques et notre vocabulaire, à la limite, on couche avec nous, mais peu de gens nous considèrent comme de potentiel·les partenaires de vie, comme des sujets de désir et de plaisir. Qu’en penses-tu ? » Par téléphone, notes vocales interposées ou avachi·es sur un canapé, Nubia, Douce Dibondo, Mariana Benenge, Lucie et Audrey W. me répondent.
Une marge dans la margeJe ne vais pas vous mentir, j’ai mis plus de temps que prévu à rédiger cet article qui m’a donné du fil à retordre. À chaque ligne que je réussissais à extraire de ma tête et à coucher sur le document Word resté ouvert depuis quelques semaines, j’ai dû prendre de longues pauses pour me changer les idées. Je me suis forcé·e à digérer les vérités qui prenaient une forme trop tangible pour mes blessures encore béantes. Bien sûr, je n’ai pas découvert que j’étais Noir·e hier. En revanche, j’admets, avec un peu de honte, à peine commencer à prendre conscience de l’impact du regard blanc sur ma vision de moi-même et les freins que mon besoin de validation a pu mettre dans ma vie amoureuse et sexuelle.
J’enfonce une porte ouverte, mais même à la marge de la société hétéro-centrée, il existe des discriminations auxquelles les milieux queers n’échappent pas. Entre autres, le racisme suinte jusque dans les relations entre LGBTQIA+. Dans une interview donnée au média The Voice en 1984, James Baldwin expliquait comment la question sexuelle survient après la question de la couleur et comment celle-ci constitue un aspect supplémentaire auquel les Noir·es sont confronté·es : « Une personne gay noire, qui est une énigme sexuelle pour la société, est déjà, bien avant que la question de la sexualité n’y entre, menacée et marquée parce qu’il ou elle est noir·e. […] Le monde gay en tant que tel n’est pas plus prêt à accepter les Noir·es que partout ailleurs dans la société. »
Les milieux queers aussi sont pétris d’une sexualisation des corps noirs qui ne date pas d’hier. Nos corps sont hypersexualisés et fétichisés par les Blanc·hes du fait de la colonisation et de l’esclavage. Pour Audrey W., lesbienne noire de 40 ans qui travaille dans le domaine juridique, on continue encore de voir les personnes noires comme des personnes dont le corps ne leur appartient pas : « D’une certaine manière, je trouve que ça nous oblige à répondre à cette image hypersexualisée que la société nous renvoie. Moi par exemple, quand j’ai commencé à sortir avec des femmes, la sexualité prenait beaucoup de place dans ma tête. »
On doit également jongler avec le mythe selon lequel les personnes queers et racisées n’existent pas, alors même que cet effacement est étroitement lié à la colonisation, puisque la plupart des communautés afrodescendantes ne connaissaient ni la binarité de genre, ni l’hétéronormativité telles qu’on les connaît aujourd’hui, avant la suprématie blanche. Et c’est sans compter la négligence totale du rôle qu’ont joué les personnes racisées dans les luttes queers. « Il y a beaucoup d’effacements, explique Audrey W. Donc si on continue nous-mêmes à nous effacer les un·es les autres, même de façon intra-communautaire, les personnes racisées vont continuer d’être occultées des discussions. La seule manière d’éviter que ça ne se produise, c’est d’en parler tout le temps. »
Nubia, artiste non-binaire, a quant à lui remarqué une différence de traitement selon les coiffures adoptées : « Quand j’avais mon afro, les gens me fétichisaient énormément. Selon que j’aie des tresses, des locks ou le crâne rasé, je ne subis pas le même harcèlement dans la rue et ce ne sont pas les mêmes personnes qui m’approchent. Et ça, c’est quelque chose que les personnes blanches ne vivent pas. C’est comme si, à leurs yeux, il n’y avait que quelques types de Noir·es, et qu’on n’avait pas le droit d’être plus. »
 © Adama Anotho
© Adama Anotho
On a beau faire partie de la « grande famille » des LGBTQIA+, on ne part pas sur le même pied d’égalité en termes d’accès à la parole ou de dynamiques de relations. Nubia, qui fréquente actuellement une femme blanche, explique : « Je vois bien que la façon dont on me perçoit m’a traumatisé. Il y a des moments où j’ai peur de m’habiller de certaines façons, j’ai peur de la dégoûter, j’ai peur qu’elle me trouve bizarre ou qu’elle ne me trouve pas désirable. Ça va un peu mieux puisqu’elle me rassure beaucoup, mais cette appréhension existe. D’autant plus qu’elle ne remarque pas toujours les situations racistes que je peux rencontrer au quotidien. Et j’hésite souvent à les pointer du doigt au risque de passer pour l’islamogauchiste du coin. »
Moi aussi, lorsque j’ai fréquenté des personnes blanches, je me suis souvent auto-censuré·e jusque dans mon vocabulaire ou dans ma façon de danser par peur du jugement et de la fétichisation. Ce sont des configurations très vulnérables dans lesquelles l’envie de plaire mène à un effacement de soi et à une forme d’hypervigilance dans le cadre intime. Dans des relations polyamoureuses ou ouvertes avec des personnes blanches, beaucoup de personnes noires m’ont également confié avoir trouvé que l’autre y gagnait davantage grâce à son capital normatif…
« Leurs standards ne sont pas les nôtres »Nos ancêtres n’avaient même pas le droit d’avoir des cheveux, leurs maîtres les rasaient parce qu’ils voulaient les éloigner le plus possible de leur humanité et/ou de leur féminité. Avoir des cheveux longs et sains peut donc être très important.
Les personnes noires et queers n’ont pas toujours le « luxe » de coller à l’esthétique queer qui joue sur les codes du moche, du bizarre et du décalé. Iels peuvent, par exemple, se sentir obligé·es d’adopter un look plus lisse pour être accepté·es et ne pas trop faire de vague. « Il faut être parfaitement maquillé·e et tiré·e à quatre épingles, car certains stéréotypes font qu’on est obligé·e de rentrer dans une case, raconte Nubia. Il y a une peur de faire “sale”. Inconsciemment, on se dit “je suis déjà Noir·e, je ne vais pas en rajouter une couche”. »
Il n’y a pas longtemps, je suis tombé·e sur un TikTok qui soulevait justement cette question de l’accès des personnes noires à l’esthétique dite queer. La queerness est souvent perçue à travers un prisme blanc et beaucoup d’aspects qui font que les gens ont « l’air queer » sont beaucoup plus accessibles aux Blanc·hes. Même lorsque des personnes racisées ont une esthétique queer, celle-ci est toujours effacée par leur race. Nous devons alors fournir des efforts supplémentaires pour que les gens considèrent qu’il y a une possibilité que nous fassions partie de la communauté. Avoir des cheveux courts, teints ou décolorés est un exemple typique « d’esthétique queer », de manière très caricaturale. Pour de nombreuses personnes racisées, avoir de longs cheveux non teints est, au contraire, culturellement significatif. Nos ancêtres n’avaient même pas le droit d’avoir des cheveux, leurs maîtres les rasaient parce qu’ils voulaient les éloigner le plus possible de leur humanité et/ou de leur féminité. Avoir des cheveux longs et sains peut donc être très important. D’autant plus qu’en grandissant, nous n’avons souvent pas eu la chance d’apprendre à prendre soin de nos cheveux naturels et que le faire à présent peut être une opportunité de réclamer une certaine liberté et identité.
Dans le regard blanc, nos corps ne nous appartiennent pas. Mariana Benenge, chorégraphe, styliste et co-créatrice des soirées P3 entre femmes, confie : « Je ne regardais pas mon corps, je ne m’étais jamais demandé si je me trouvais belle ou pas. Dès que je suis entrée dans la mode, j’en ai pris conscience. On me disait que j’avais les épaules larges, pas assez de hanches, et on m’a masculinisée, comme on le fait avec beaucoup de femmes noires. On m’a aussi souvent dit que je ne ressemblais pas assez à une lesbienne à cause (ou grâce) au privilège que j’ai de me présenter de manière féminine, et j’ai même fini par y croire. »
Pour l’autrice et journaliste Douce Dibondo, la solution est simple : elle refuse radicalement de jouer le jeu des standards du blantriarcat : « Pourquoi on veut être accepté·e par un milieu qui ne nous correspond pas, ne nous comprend pas, ne nous aime pas et n’a pas d’empathie pour nous ? Pourquoi on s’évertue à vouloir être inclu·es, même dans les sphères les plus intimes comme dans nos sexualités, dans nos rapports à l’autre ou dans le couple ? Leurs standards ne sont pas les miens, leur esthétique n’est pas la mienne. »
« J’ai pris possession de mon plaisir et de mon désir »Pour ma part, le milieu sexpo queer a été à double tranchant : d’un côté, je le ressens parfois comme une nouvelle injonction qui ne fait que valider ce que tout le monde attend d’une personne sexisée noire, à savoir être sexuelle et sexy ; et de l’autre, ça me permet de l’être avec un peu plus de liberté et de libre-arbitre.
Outre le fait qu’aucune représentation de couples queers et racisés n’existe et qu’il peut donc être difficile pour les personnes noires LGBTQIA+ de se projeter dans des relations au-delà du sexe, on ne nous a pas appris à parler de notre plaisir. « Je suis Congolaise, explique Mariana Benenge. Je suis une blédarde, donc parler de plaisir, de désir et tout ça, ce n’est pas quelque chose qu’on m’a appris. Dans mon éducation, c’était un sujet censé être hyper intime. »
Pour ma part, le milieu sexpo queer a été à double tranchant : d’un côté, je le ressens parfois comme une nouvelle injonction qui ne fait que valider ce que tout le monde attend d’une personne sexisée noire, à savoir être sexuelle et sexy ; et de l’autre, ça me permet de l’être avec un peu plus de liberté et de libre-arbitre, de trouver un espace « safe » où être sujet plutôt qu’objet dans ma sexualité et mon expression de genre. C’est avant tout une reprise du pouvoir.
En fréquentant des personnes blanches, je dois en amont actionner toute une réflexion pour savoir si cette personne est vraiment intéressée par moi ou si elle est intéressée par mon physique ou ce qu’elle peut retirer de mon image. Ça pourrait être plus simple et plus léger, et ça demande un engagement émotionnel et intellectuel important. C’est presqu’un job à part entière.
Audrey W.
Pour les personnes noires et queers, se sexualiser d’elles-mêmes peut permettre de renverser le stigmate. Nubia, qui publie de temps à autre des photos où il se met en scène de façon dénudée, explique que sur les réseaux, il est, quoi qu’il arrive, sexualisé et préfère donc décider de lui-même quand et comment cette sexualisation aura lieu : « Dans la mode, je suis souvent perçu comme un objet, pas seulement parce que je suis queer, mais surtout parce que je suis métis noir. Lors de mes premières expériences amoureuses avec des personnes blanches, je voyais qu’elles ne cherchaient souvent que du sexe avec moi et ne voulaient pas forcément que notre relation se sache. Sur Instagram, je ne me sentais pas vu pour qui je suis réellement, donc j’ai décidé de montrer le vrai moi via ce que les gens ont envie de voir, c’est-à-dire une certaine forme de sexualisation. »
D’autant plus que l’hypersexualisation des corps et de la nudité découle d’une vision occidentale et coloniale. La nudité, surtout chez les personnes sexisées, n’a pas toujours été vue comme quelque chose de sexuel, pré-colonisation. « Parfois, on a envie de se mettre à poil, et ce n’est pas pour autant qu’on s’hypersexualise, raconte Nubia. En tant que personne perçue comme une femme noire, j’ai l’impression d’avoir été beaucoup sexualisée, et le fait de pouvoir le faire quand j’en ai envie et comme j’en ai envie, c’est de la réappropriation de moi-même. »
Voir cette publication sur Instagram
Selon Lucie, une ingénieure lesbienne de 24 ans, pour les personnes noires et queers, la sexualité peut aussi être un moyen détourné d’accéder à des personnes quand on n’a pas les clés de la vulnérabilité : « Dans le milieu queer et noir que j’ai côtoyé, j’observe qu’il y a pas mal de précarité émotionnelle et une difficulté à se sentir en sécurité pour entrer dans la vulnérabilité, notamment en raison de traumas et d’insécurités. La société nous violente tous les jours et nous fragilise, cela peut créer une barrière humaine, des craintes et des appréhensions dans notre rapport intime à l’autre. »
Pour elle, le sexe peut être communément vu comme quelque chose de primaire, d’accessible ; l’endroit parfait pour donner à la fois accès à une relation humaine et indirectement à une relation émotionnelle. En revanche, les discussions autour de la sexualité et de notre rapport au corps ne sont pas accessibles à toustes. « J’ai l’impression que tout le monde est à la recherche d’intimité, de connexion et d’espace pour être soi-même librement, ajoute-t-elle. Mais c’est difficile de légitimer ses besoins émotionnels auprès de soi et auprès des autres, alors que l’envie de sexe, elle, est plus communément acceptée et encouragée. »
Black loveLes Blanc·hes ont tendance à avoir une vision unilatérale et réduite de ce qu’est une personne racisée ou encore une femme noire queer. Iels nous voient rarement au-delà de nos corps comme objets, de notre identité, et de nos luttes liées à cette identité. Iels ne comprennent pas que nous sommes multiples.
Audrey W. se confie : « En fréquentant des personnes blanches, je dois en amont actionner toute une réflexion pour savoir si cette personne est vraiment intéressée par moi ou si elle est intéressée par mon physique ou ce qu’elle peut retirer de mon image. Ça pourrait être plus simple et plus léger, et ça demande un engagement émotionnel et intellectuel important. C’est presqu’un job à part entière. » Pour elle, la solution se trouve donc dans le fait de ne fréquenter presque qu’exclusivement des personnes noires et queers. « Le milieu parisien auquel je me sens appartenir, c’est le milieu queer noir lesbien. Au départ, ce qui m’a aidée à naviguer dans ces identités, c’est d’avoir intégré certains groupes, des associations ou d’aller à certains événements ou manifestations. Ça a été le premier canal en matière de rencontres avec des personnes queers et noires, comme moi. »
Nubia aussi remarque que fréquenter des personnes qui lui ressemblent lui évite d’être confronté à davantage de discriminations : « Quand ce ne sont pas des personnes queers et racisées, même s’il n’y a pas forcément de mauvaises intentions, il y a toujours des questions ou des remarques. Au contraire, si je suis avec quelqu’un qui vit un peu la même chose que moi d’un point de vue racial, sexuel et de genre, c’est plus facile. Je n’ai pas à me justifier ou à devoir expliquer qui je suis. »
« Je me tourne vers des inspirations d’autres gens noirs qui ont une esthétique qui me correspond, autant dans la spiritualité que dans la dissidence ou dans l’amour communautaire, renchérit Douce Dibondo. Je ne me mêle pas au milieu queer blanc : je les vois de loin, je les côtoie, mais je n’ai pas un besoin fondamental d’être acceptée par elleux, parce que je prône l’amour noir. Je date des personnes noires. Ainsi, je suis protégée. C’est fini la remise en question perpétuelle de mon identité, de mon esthétique ou de ma légitimité. » Quand elle n’est pas dans un espace avec des personnes qui peuvent la comprendre, Mariana Benenge avoue avoir peur qu’on invalide ses ressentis : « Je me suis donc vite entourée de personnes qui ont le même vécu et les mêmes croyances. »
Pour ma part, faire communauté avec des personnes à qui je n’ai pas besoin d’expliquer le b.a.-ba de mon identité et avec qui je n’ai pas peur d’être moi-même, dans toute ma complexité et mes insécurités, m’a sauvé·e. Entre autres, le fait d’avoir rejoint la chorale afroféministe Maré Mananga a ouvert la porte à cet amour communautaire guérisseur et libérateur. Et donc, même si je côtoie toujours des personnes non-noires, me retrouver en non-mixité choisie m’apporte un repos, une force, une joie et un amour que je ne retrouve pas ailleurs. Les relations mixtes et les rapports inter-communautaires ne sont pas impossibles, mais ne peuvent se construire sainement que si les personnes à qui la norme profite prennent conscience de leurs privilèges et de leurs biais.
Comme James Baldwin l’a expliqué, former une coalition sur le seul critère de la préférence sexuelle n’est pas solide. Faire partie d’une communauté en non-mixité noire et queer a l’avantage d’offrir un espace plus sûr dans lequel on n’a pas à se battre pour être intégré·e. D’ailleurs, quand on parle d‘intégration ou d’inclusivité, cela signifie bien qu’on réfléchit encore à partir d’un regard blanc. On serait hors norme, différent·e, et on devrait dire merci quand on nous donne voix au chapitre ou qu’on nous regarde comme des humains.
Bien sûr, même le cocon de l’entre-soi racisé et queer n’est pas exempt de violences et de discriminations intra-communautaires, comme le remarque Lucie. Entre autres, l’âgisme, le colorisme et l’hyper-valorisation des personnes qui répondent aux critères de beauté occidentaux résistent encore, même dans les rangs les plus serrés. Malgré la persistance de certaines normes et violences dans les espaces en non-mixité choisie, j’y vois l’espoir et la possibilité de façonner des esthétiques et des codes hors des modèles dominants, mais aussi de construire nos propres dynamiques à la marge, sans l’aval du centre. En tant que personne noire et queer, j’ai souvent été contrainte de jouer un rôle et de montrer au monde une version jouée ou surjouée de moi-même pour tenter de passer entre les mailles des violences. Aujourd’hui, avec l’aide des mes adelphes, je m’attache à découvrir chaque jour quelles parts de mon identité, de ma personnalité et de mes goûts sont authentiques, et quelles sont celles que j’ai forgées pour me protéger. Le chemin est long et fastidieux, mais il vaut le coup.
Image à la Une : © Adama Anotho
Audrey Couppé de Kermadec est artiste, journaliste et militant·e.
Relecture et édition : Apolline Bazin, Clément Riandey et Sarah Diep
Cet article Noires et queers, comment définir sa beauté à la marge de la marge ? provient de Manifesto XXI.

En janvier dernier, plusieurs individus avaient agressé dans le quartier de Pissevin, à Nîmes, un homme, alpagué par l'un d'eux sur un site de rencontres. Mais en guise d'une relation intime, la victime sera violentée et dépouillée, notamment de son véhicule.
L’article Guet-apens homophobe à Nîmes : Cinq suspects interpellés est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.


Ce mercredi 23 novembre, pour leur entrée en lice face au Japon, les joueurs allemands se sont cachés la bouche sur la photo d'équipe, en protestation aux menaces de sanctions sportives de la Fédération internationale de football (FIFA) pour empêcher notamment le port du brassard « One Love » au Qatar.
L’article Mondial 2022 : L’Allemagne dénonce la FIFA et le Qatar est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.


Dans son dernier film, Les Amandiers, la cinéaste fait revivre l’école de théâtre fondée par
L’article Valeria Bruni Tedeschi nous emporte avec Les Amandiers est apparu en premier sur 360°.

Les Quilts, ces patchworks à la mémoire des personnes décédées des suites du VIH ont accompagné visuellement l’épidémie. À l’occasion du 1er-Décembre, PVA-Genève organise une exposition qui met en valeur les archives photographiques, où l'on retrouve ces puissants patchworks.
L’article Patchwork de vies est apparu en premier sur 360°.

En 2022, près de la moitié des personnes séropositives en Suisse a plus de 50 ans. Comment avancent-elles en âge alors que le VIH est quasiment devenu une maladie chronique dans les pays occidentaux ? Le point avec deux spécialistes de la question.
L’article Vieillir avec le VIH est apparu en premier sur 360°.

L’ancienne internationale d’Arsenal Alex Scott, désormais consultante télé pour la BBC, a bravé les menaces en arborant fièrement le brassard en faveur de l’inclusion et contre les discriminations.
L’article Quand une journaliste de la BBC défie le Qatar et la FIFA en arborant le brassard « One Love » (VIDEO) est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Depuis des mois, la parole « anti-trans » nauséabonde et haineuse, s’est décomplexée, répandue, banalisée, formant ainsi une alliance improbable entre transphobes de tous bords profitant d’une tribune offerte par des médias et des institutions complices.
L’article La transphobie ne se débat pas, elle se combat ! est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

D’après le quotidien allemand Welt, la DFB (fédération allemande) envisage une action en justice contre la FIFA, suite à ses menaces de sanctions en cas de port du brassard anti-discriminations « One Love ». Plusieurs sélections européennes, dont l’Allemagne, devaient l’arborer pendant les matchs. Il s’agirait d’une demande de protection juridique provisoire jusqu’à la fin …
L’article La Fédération allemande envisage d’attaquer la FIFA qui la menace de sanctions en cas de port du brassard « One Love » est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.


Cet article Pour soutenir le Planning Familial, Friction organise une grande tombola et une soirée provient de Manifesto XXI.
Après une rentrée marquée par la multiplication d’attaques transphobes, l’équipe de Friction magazine a décidé d’organiser une soirée pour soutenir l’action du Planning Familial. Un événement militant et solidaire de qualité, à ne surtout pas manquer !Le 18 août dernier, le Planning Familial – mouvement féministe et d’éducation populaire en lutte depuis 65 ans – publiait une affiche avec un homme enceint, avec la légende « Au Planning, on sait que des hommes aussi peuvent être enceints ». Cette représentation de la politique d’accueil inconditionnelle de l’association a déclenché de violentes réactions : sur les réseaux sociaux, l’ONG a subi des attaques de la part de militant·es d’extrême droite et de TERFs ; les militantes transphobes Marguerite Stern et Dora Moutot ont interpellé Elisabeth Borne dans une lettre ouverte pour faire part de leur « inquiétude » et certain·es sont même allé·es jusqu’à appeler au retrait des subventions à la structure.
Si la vague de soutien a elle aussi été au rendez-vous, cet épisode a révélé l’ampleur des connexions entre l’extrême droite et les mouvements transphobes. Dans un contexte mondial où le droit à l’avortement est menacé et les violences contre les personnes queers augmentent, comme en témoigne la tragédie du club Q dans le Colorado, les instants de réunion dans la joie sont d’autant plus précieux. Pour agir tout en se faisant du bien, l’équipe de Friction magazine a donc imaginé la soirée du samedi 26 novembre à la Folie. Un beau moment de fête pour réunir la communauté et tous·tes ses allié·es, et c’est Laurier The Fox, l’illustrateur du Planning, qui signe l’affiche !

Tout d’abord au cœur de l’événement, il y a une tombola géante dont les gains iront au Planning. Parmi les très beaux lots à gagner, il y a notamment : des revues Well Well Well et Ourses à plumes, un massage Maison Bergamote, des livres des éditions Cambourakis et On ne compte pas pour du beurre, des entrées à la Wet For Me et au cabaret La Bouche, des œuvres de Safia Bahmed-Schwartz… Les tickets coûtent seulement 3€, et les participant·es qui ne pourraient pas venir à la soirée seront tenu·es au courant par email.
La soirée se déroulera en deux temps : d’abord un apéro (entrée libre) avec la tombola, des DJ sets et des shows drag. Les queens et le king de cette nuit de revendications sont Clémence Trü, Robin des Doigts, Victoria Sucrette et Emily Tante ! Viendra ensuite le club, à partir de 23h (9€ en prévente / 12€ sur place). Et parce que l’union fait la force, surtout en ces temps sombres, l’équipe de Friction a convié des collectifs amis pour nous offrir la plus belle nuit de célébration possible. À l’affiche, on retrouvera le jeune collectif With Us, porté par la productrice Desire (qu’on interviewait récemment), et destiné à promouvoir des artistes trans et non-binaires. Il y aura aussi La Discoquette, qui vient de célébrer son 5ème anniversaire cet automne, et Bragi Pufferfish (co-orga de la Beautiful Skin). Calor Ultra Gliss, le collectif de la DJ F/cken Chipotle, complète la fine équipe.
Cet événement est l’occasion de rappeler que Planning fait aussi un travail essentiel de prévention et d’éducation à la santé sexuelle ! Alors, sortez bien couvert·es.
Cet article Pour soutenir le Planning Familial, Friction organise une grande tombola et une soirée provient de Manifesto XXI.



Mélissa Camara, qui a milité à SOS homophobie ainsi qu'à Oser le féminisme, ouvre une porte. Elle se présente elle-même comme une femme noire lesbienne. C'est une première dans l'histoire d'Europe Écologie Les Verts et dans l'histoire politique qu'une telle personnalité se présente pour devenir cheffe de parti. Raison de plus pour mieux connaître son parcours, ses engagements et ses motivations. Interview.

Meneuse de revue au cabaret de Madame Arthur et au Carrousel de Paris pendant vingt ans, Bambi est l’une des premières femmes ouvertement trans* à s’être emparée de l’espace médiatique. Un quotient queer qui s’annonce spectaculaire.
L’article Bambi, reine de cabaret et icône trans* est apparu en premier sur 360°.

C'est que le capitaine de l’équipe de France aurait déclaré dans une vidéo de lutte contre l’homophobie, tournée en mars dernier mais jamais diffusée, dans lequel seuls trois joueurs des Bleus témoignaient.
L’article Pour Hugo Lloris, les chants homophobes, c’est du « folklore », « ça fait partie du décor » est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Anaïs-Tohé Commaret & Konstantinos Kyriakopoulos : la meilleure version de la flemme provient de Manifesto XXI.
À l’occasion de leur exposition InnerVision curatée par Extramentale, à voir jusqu’au 10 décembre à la galerie Edouard Manet (Gennevilliers), nous avons rencontré la cinéaste Anaïs-Tohé Commaret et le sculpteur Konstantinos Kyriakopoulos pour parler de leur collaboration, mais aussi de leur rapport aux injonctions sociales et à la façon dont celles-ci influencent leur pratique.Quand les rêves d’avant semblent déjà morts et que ceux du présent nous échappent, ne reste-t-il qu’à s’évaporer ? C’est l’un des questionnements soulevés par les films de la réalisatrice franco-chilienne Anaïs-Tohé Commaret, diplômée des Beaux-Arts de Paris et prix du jury du Salon de Montrouge l’année dernière. Dans sa série Disparaître, produite par la plateforme d’art contemporain Extramentale sur laquelle les vidéos sont diffusées au comptes-gouttes depuis février 2021, elle s’intéresse aux fantômes, ceux et celles qui refusent d’habiter une forme définitive, en quête d’alternatives dans une réalité qui les oppresse.
Son nouveau court métrage 8 (Huit) est projeté en exclusivité jusqu’au 10 décembre au sein de l’exposition InnerVision, curatée par Extramentale à la galerie Edouard Manet à Gennevilliers. En projetant les deux premiers épisodes de la série Disparaître et la vidéo Placenta chips dans d’autres salles de la galerie, la jeune cinéaste entend déplacer le cinéma de son espace traditionnel : chaque œuvre est proposée avec un format d’écran spécifique et des conditions de visionnage qui lui sont propres. Une façon de rappeler, peut-être, que la réalité est toujours une question de point de vue et d’expérience vécue de l’intérieur.
 Capture d’écran tirée de l’épisode 1 de Disparaître par Anaïs-Tohé Commaret, 2021, visible sur la plateforme Extramentale
Capture d’écran tirée de l’épisode 1 de Disparaître par Anaïs-Tohé Commaret, 2021, visible sur la plateforme Extramentale
Sollicité pour l’occasion, le sculpteur Konstantinos Kyriakopoulos prolonge l’univers onirique du film à travers une installation qui en illustre une des scènes phares. D’origine grecque, également diplômé des Beaux-Arts de Paris et aujourd’hui résident de la Fondation Fiminco, l’artiste refuse de travailler seul. Une posture dont la cohérence va jusque dans le format sur lequel il a choisi de travailler : le lit. Il l’envisage comme un lieu de grève et d’accueil pour les corps, où reposent les formes et les idées de manière passive et gratuite, en dehors de la logique productiviste du monde. Pour InnerVision, il a conçu une salle de cinéma où les sièges ont été remplacés par des lits, éclairés par des réverbères, comme une lueur qui veille sur les rêves des fantômes.
Chiffre du cycle infini, de la transformation et du mouvement perpétuel, le « 8 » pourrait aussi être une boucle de liaison. Entre les époques ou les générations. Dans celle qui est la nôtre, en partie désenchantée lorsqu’elle prend des allures pessimistes de fin du monde, il semble y avoir quelque chose qui relève d’un état intermédiaire de transformation. Cet entre-deux inhérent à l’adolescence. C’est l’un des fils rouges de notre discussion avec les deux artistes, que l’on a rencontré·es à quelques heures du vernissage.
La flemme, c’est une des réponses à la pression subie. Comme si ne rien faire, s’allonger et dormir, était une manière un peu punk de choisir son avenir.
Anaïs-Tohé Commaret
 Salle 1. Anaïs-Tohé Commaret, 8 (Huit), film, 22 minutes, 2022 et Konstantinos Kyriakopoulos, Elephant, 2022, acier, peinture, lampes, verre, câbles, matelas, draps, bois. 150x300x800 cm © Margot Montigny
Salle 1. Anaïs-Tohé Commaret, 8 (Huit), film, 22 minutes, 2022 et Konstantinos Kyriakopoulos, Elephant, 2022, acier, peinture, lampes, verre, câbles, matelas, draps, bois. 150x300x800 cm © Margot Montigny
Manifesto XXI – Anaïs, ton travail s’oriente beaucoup vers « les fantômes », ces personnages entre deux mondes. Qu’est-ce qui t’attire vers eux ?
Anaïs-Tohé Commaret : Les fantômes n’ont pas de forme, ils ne choisissent pas de forme définitive. Je crois que je me sens moi-même un peu comme ça. Comme en recherche d’un endroit où être et où me sentir bien. J’ai la sensation que tout est un peu intermédiaire, même dans mon art. Est-ce que je fais du cinéma ou de la vidéo ? Se définir est quelque chose que je trouve violent finalement. Les personnages que je montre sont héroïques dans ce non-choix : iels choisissent de ne pas faire de choix.
La flemme est un terme qui revient beaucoup, autant dans les dialogues du film que dans le langage courant de notre génération. Avez-vous l’impression que le monde donne la flemme ?
Anaïs : La flemme, c’est une des réponses à la pression subie. Il y a une manière d’être un peu léthargique face à la vie : comme si ne rien faire, s’allonger et dormir, était une manière un peu punk de choisir son avenir. J’ai le sentiment qu’on est toujours poussé·es à devoir être les meilleur·es dans une société individualiste, à faire des choix, à se mettre en avant. Ces questions-là sont oppressantes pour les jeunes générations, et pour moi aussi d’ailleurs. Je me sens angoissée par ces questions-là. Alors quelque part oui, la flemme.
Konstantinos Kyriakopoulos : Je trouve que les personnages des films d’Anaïs portent en elleux un refus et incarnent ce « non ». En ce sens, dire non est différent de ne pas choisir, c’est déjà un choix et une posture. C’est un des liens entre son travail et le mien, cette passivité qui est une manière de dire non et de s’émanciper. C’est une de mes postures artistiques, être à la fois passif et actif au sens où je ne porte pas d’idées mais je porte d’autres gens, des corps et des projets, d’autres pratiques. Ne pas accepter de faire un travail solo, ne pas accepter une seule et unique esthétique. C’est une forme de choix aussi.
L’être humain est dans une suite de rites qui se bouclent. La technologie change simplement la forme et le cadre de ces rites.
Konstantinos Kyriakopoulos
Votre collaboration a démarré avec l’idée de la veilleuse que l’on retrouve dans le film 8 (Huit) et dans la salle d’exposition avec les lits. Pourriez-vous m’expliquer plus en détail le choix de cet objet-là ?
Konstantinos : Nous savions déjà que nous ferions une exposition quand Julia Marchand [commissaire d’exposition et fondatrice de la plateforme Extramentale] nous a mis en relation. On voulait illustrer cette scène du film où Fatim veille sur une personne endormie mais nous ne voulions pas nous contenter de faire uniquement un lit. La veilleuse était l’objet le plus proche de cette idée. Elle symbolise l’idée que le lit n’est pas seulement un espace de sommeil mais aussi de vie à part entière. Nous aimions aussi la symbolique du fait de veiller sur quelqu’un.
Anaïs : Il y aussi quelque chose autour de la nuit. Pour moi, c’est là que les personnages se réveillent, se révèlent, et peut-être que cette source de lumière met en valeur ces moments-là. La lumière, c’est aussi le cinéma, la projection.
Konstantinos : Quand tu fermes les yeux, tu projettes des rêves. Personnellement je ne rêve pas. Mais ça m’a toujours touché de dormir avec des gens qui me racontent leurs rêves.
 Salle 1. Anaïs-Tohé Commaret, 8 (Huit), film, 22 minutes, 2022 et Konstantinos Kyriakopoulos, Elephant, 2022, acier, peinture, lampes, verre, câbles, matelas, draps, bois. 150x300x800 cm © Margot Montigny
Salle 1. Anaïs-Tohé Commaret, 8 (Huit), film, 22 minutes, 2022 et Konstantinos Kyriakopoulos, Elephant, 2022, acier, peinture, lampes, verre, câbles, matelas, draps, bois. 150x300x800 cm © Margot Montigny
Croyez-vous en une résurgence du magique ? Il y a une forte présence de l’onirisme dans l’univers de tes films, Anaïs. On a parfois la sensation que tes personnages sont en proie à des forces fantastiques prêtes à les dissoudre.
Anaïs : L’aspect onirique est plutôt quelque chose d’instinctif qui s’exprime dans ces images vaporeuses et floues. Mais ce flou illustre cette idée de ne pas choisir quelque chose de définitif. La dissolution, c’est clairement quelque chose que je ressens. L’idée des fantômes y est directement liée. On fantasme beaucoup une forme finale, on se dit « plus tard je serai comme ci ou comme ça », mais en réalité j’ai l‘impression qu’il n’y a pas de plus tard, ce sont juste des formes et des silhouettes que tu habites et qui s’enchevêtrent tout le temps. Il n’y a pas de forme finale et je trouve que c’est oppressant de se dire qu’on doit habiter une personnalité pour toujours, comme si on devait atteindre la « meilleure version de soi-même ». Ça n’est pas humain de se voir quasiment comme des produits.
Konstantinos : D’autant plus que cette idée de « forme finale », c’est surtout une image finalement, c’est plutôt une « forme finale de la meilleure image de soi-même ». Donc le geste de disparaître ou d’être passif, c’est aussi une manière d’en prendre le contrepied. De ne pas être une image mais d’être, tout simplement. Ce qui implique le droit d’être contradictoire.
Anaïs : Pour faire un parallèle avec Placenta chips [une autre de ses pièces à voir dans l’exposition, ndlr], j’ai des amies qui sont également TDS avec qui nous discutons de ces questions-là, être mère ou non. Qu’est-ce que ce serait d’être la mère parfaite ? Cette idée nous oppresse en tant que femmes. Finalement, ces personnages-là racontent à quel point iels n’ont pas envie de ça.
 Salle 1 et Salle 2, avec en fond Anaïs-Tohé Commaret, Placenta chips, film, 3 minutes ; 6 minutes, 2022 © Margot Montigny
Salle 1 et Salle 2, avec en fond Anaïs-Tohé Commaret, Placenta chips, film, 3 minutes ; 6 minutes, 2022 © Margot Montigny
Vous êtes tous·tes les deux né·es dans les années 1990, une période parfois fantasmée aujourd’hui. Est-ce que vous avez des souvenirs de cette époque ?
Anaïs : J’en ai des souvenirs mais je n’en suis pas nostalgique.
Konstantinos : Je m’en souviens peu mais je considère qu’aujourd’hui, c’est pareil avec des dispositifs différents. Pour moi, l’être humain est dans une suite de rites qui se bouclent. Aujourd’hui il y a un intérêt pour le shifting par exemple, que l’on semble découvrir maintenant grâce à internet mais qui sont en réalité des procédés beaucoup plus anciens et quasi ancestraux. La technologie change simplement la forme et le cadre de ces rites.
Pour finir, le format du court métrage semble en vogue ces temps-ci, posant des questions quant à l’avenir du cinéma : est-ce que le court métrage pourrait devenir une alternative voire une nouvelle norme ?
Anaïs : Ces formats courts, je les ai faits de manière un peu cynique en réalité ! J’en ris un peu mais je trouve ça terrible d’être obligé·e de faire des formats courts pour qu’on s’y intéresse. En faisant Disparaître avec Extramentale, je voulais au départ me moquer des séries. On le voyait comme une anti-série et finalement ça a pris comme ça, et c’était un peu le piège. En réalité, si je pouvais, je ferais des films de cinq heures ! J’aime les temps longs. Ils évoquent aussi le temps du sommeil, le temps que cela prend pour s’endormir, pour entrer dans sa tête, et je trouve ça important de laisser les choses s’installer. Par exemple, 8 (Huit) dure plus de vingt minutes et comporte volontairement des longueurs. J’avais envie qu’il y ait des temps de pause et, puisque nous sommes sur des matelas, qu’il y ait la possibilité de dormir.
 Capture d’écran tirée de l’épisode 2 de Disparaître par Anaïs-Tohé Commaret, 2022, visible sur la plateforme Extramentale
Capture d’écran tirée de l’épisode 2 de Disparaître par Anaïs-Tohé Commaret, 2022, visible sur la plateforme Extramentale
InnerVision, par Anaïs-Tohé Commaret en collaboration avec Konstantinos Kyriakopoulos, une proposition par Extramentale, du 10 octobre au 10 décembre 2022 à la galerie Edouard Manet (Gennevilliers), du mardi au samedi de 14h à 18h30 et sur rendez-vous.
Photo à la Une : © Anaïs-Tohé Commaret
Relecture et édition : Sarah Diep et Anne-Charlotte Michaut
Cet article Anaïs-Tohé Commaret & Konstantinos Kyriakopoulos : la meilleure version de la flemme provient de Manifesto XXI.

L’Angleterre, le pays de Galles, la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse, qui avaient prévu de porter pendant le Mondial le brassard « One Love » contre les discriminations, indiquent finalement y renoncer, face à la menace de « sanctions sportives » annoncée par la FIFA.
L’article Qatar : plusieurs sélections européennes menacées de « sanctions » par la FIFA en cas de port du brassard anti-discriminations est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Prise de risque parachève sa nostalgie dans 4evermore provient de Manifesto XXI.
Prise de risque transforme son intimité en (anti)chambre de la création dans son premier album. Sorti le 7 octobre dernier sur le label White Garden, 4evermore rend hommage à la créativité des adolescences solitaires. Manifesto XXI a rencontré la bedroom artist pour discuter de sa pop scintillante bercée d’amitiés musicales.Casquette playboy sur la tête, blondeur étincelante et moon boots aux pieds, c’est le coeur plein de gratitude que Dearbhla, de son vrai prénom, nous a rencontré sur la terrasse d’un café du vingtième arrondissement. Elle le déclare sans pudeur : « Sans mes amie·s rencontré·es via les plateformes musicales, je ne serai clairement pas là où je suis aujourd’hui. Je suis leur plus grande fan. ». Révélée sur soundcloud, elle collabore depuis de façon régulière avec le label White Garden. Depuis 2018, prise de risque produit une autotune angélique pour retomber dans ses tribulations de jeunesse.
 Photo : Robin Voisin
Photo : Robin Voisin
En artiste autodidacte, Dearbhla écoute tout ce qu’on lui propose dès son plus jeune âge. Originaire de Dublin, son enfance est bercée par la pop UK entendue à la radio. À 5 ans sa famille déménage dans la campagne du sud-ouest de la France. L’ennui habite alors ses après-midis jusqu’à la découverte de MTV sur le câble familial. Pop stars des années 2000 et le thrills des débuts d’internets lui permettent de cultiver sa chambre à elle. En 2015, Dearbhla tombe sur les productions aériennes du label chinois Genome 66.6 Mbp et notamment de l’artiste noctilucents. Passion immédiate pour la scène internet post-2010 et notamment pour l’hyperpop et le cloud rap. Des années de digging au compteur, c’est en 2018 qu’elle s’essaye à la composition, parée de son micro et de l’application Garage Band sur Iphone 5. Déjà les contours de Prise de Risque se dessinent : des compositions oniriques et des textes chantés avec l’effet extreme tuning. L’artiste nous l’assure : « Je ne connaissais aucune théorie musicale, même pas les notes mais j’avais envie de m’amuser. ».
L’EP déploie quatre compositions pop simples et épurées dans une célébration des sonorités électroniques de l’univers Nintendo. Reverb à gogo, crescendos pop et chimères autotunées, l’EP s’ouvre sur le réveil strident de « runner up ». Une composition par Pourpre, artiste collaborant aussi sur White Garden, sublimée par la voix suave de Prise de Risque. Derrière chaque titre, des moments de création collective : « Un jour on allait en friperie à vélo et j’avais un air en tête. On est rentré·es et on l’a retranscrit. On en a fait plus de 1000 versions. La principale est rythmée et s’ouvre sur un sample de Britney. Recomposée avec un synthé léger et une basse, elle est devenue progressivement plus touchante et sentimentale. ». Côté visuel, l’EP s’accompagne d’un poster disponible sur Bandcamp. L’univers naïf et vaporeux pensé par Janomax s’est soldé par un heureux hasard : « Sans qu’on se soit concertées, elle m’a envoyé la première version du visuel et j’étais choquée ! Le téléphone à clapet et le sac matelassé bleu : je les ai ! ».
 Visuel par Janomax
Visuel par Janomax
4evermore est un album témoin du fourmillement artistique entourant prise de risque. Amor Fati, qu’elle a rencontré lors de ses pérégrinations sur les réseaux, a mis sa pierre à l’édifice avec la composition du titre « art school ». Derrière le morceau rapide aux accents hyperpop « nintendogs never die », se cache une composition de bdstf sur laquelle Dearbhla pose sa voix. Chaque track résonne comme une ritournelle dès la première écoute et produit un ensemble nostalgique proche de l’anachronisme. Prise de risque souhaite que cet album réconforte les auditeur·rices comme elle a pu l’être par la musique découverte. Elle conçoit l’album comme un acte de générosité : « Je voulais donner aux autres, ce que les autres me procurent avec leurs sons. Quand des personnes me disent qu’iels ont été touchés par l’album, ça me fait tellement plaisir, c’est déjà gagné. ».
« y2k c’est une déclaration nostalgique à ces moments suspendus qu’on n’a pas envie de voir se terminer. Ces relations qu’on traverse en oubliant de les chérir parce qu’on ne mesure pas immédiatement leur importance. ».
Selon les confessions de prise de risque, à la genèse de l’album il y a une des premières compositions solo de l’artiste : le titre y2k sorti en 2020. C’est une période de création assez floue pour Dearbhla qui jongle entre son travail d’aide-soignante et le confinement dans son 20m2 rennais. Prise de risque se souvient pour nous : « y2k c’est une déclaration nostalgique à ces moments suspendus qu’on n’a pas envie de voir se terminer. Ces relations qu’on traverse en oubliant de les chérir parce qu’on ne mesure pas immédiatement leur importance. ». Elle nous le glisse d’ailleurs à demi-mot : « Je travaillais à l’époque avec des résident·es en EPHAD et ces relations sont très éphémères. On ne sait pas si ces personnes seront toujours là quand on y retourne le lendemain. ». Aujourd’hui dans l’EP, le titre revêt une nouvelle dimension dans son crescendo mélodique respectivement mixé et masterisé par le producteur Timothée Joly et l’artiste Lorenzo Targhetta, membre de High Heal.
Un album bijou pour une artiste à suivre de très près.
On pourra retrouver prise de risque le 23 novembre à Bruxelles pour Le Schlub avec Zulu et Gadevoi.
Et le 25 novembre sur la scène du Chinois à Montreuil pour une soirée curatée Soulfeeder avec entre autres Fetva, t0ni et Himera.
4evermore de Prise de Risque est disponible depuis le 7 octobre sur le label White Garden.
Image à la une : Robin Voisin
Relecture par : Eva Fottorino
Cet article Prise de risque parachève sa nostalgie dans 4evermore provient de Manifesto XXI.