Icône absolue de la scène LGBTIQ+ romande, Catherine d’Oex nous parle sans retenue de son parcours et de son art. Portrait
L’article Catherine d’Oex: «Voyager à l’intérieur de soi» est apparu en premier sur 360°.
34739 éléments (3198 non lus) dans 75 canaux
 Radio/sons
(113 non lus)
Radio/sons
(113 non lus)
 Sexo anecdotique
(669 non lus)
Sexo anecdotique
(669 non lus)
 Actu et info sexe
(635 non lus)
Actu et info sexe
(635 non lus)
 Ecrits / bds / Edition
(109 non lus)
Ecrits / bds / Edition
(109 non lus)
 BDSM/cuir/latex/
(29 non lus)
BDSM/cuir/latex/
(29 non lus)
 feminisme
(791 non lus)
feminisme
(791 non lus)
 Libertinage
(19 non lus)
Libertinage
(19 non lus)
 Info LGBTI
(833 non lus)
Info LGBTI
(833 non lus)
 Info LGBTI
Info LGBTI

Icône absolue de la scène LGBTIQ+ romande, Catherine d’Oex nous parle sans retenue de son parcours et de son art. Portrait
L’article Catherine d’Oex: «Voyager à l’intérieur de soi» est apparu en premier sur 360°.

 De la journée des droits des femmes au premier single de la compilation numéro 2 de Barbi(e)turix, on vous liste tout ce qu’il ne faudra pas manquer en ce mois ...
De la journée des droits des femmes au premier single de la compilation numéro 2 de Barbi(e)turix, on vous liste tout ce qu’il ne faudra pas manquer en ce mois ... 
68 pays criminalisent encore aujourd'hui l'homosexualité, portant ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée. Dans l’intimité, entre adultes consentants, les personnes sont libres d’adopter le comportement sexuel de leur choix. Rien ne justifie que les États réalisent une immixtion dans la vie privée en pénalisant l’homosexualité.
L’article Tribune : Nous exigeons une dépénalisation de l’homosexualité, partout et maintenant ! est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.



Gymnase intercantonal de la Broye, en 2008, deux intervenants prennent la parole. Ils vivent tous
L’article «De temps en temps, une claque» est apparu en premier sur 360°.

Le Parlement Ougandais devrait examiner dès ce mercredi 1er mars sur une nouvelle proposition de loi contre les actes homosexuels, qui se propagent dans le pays, selon des théories conspirationnistes, évoquant des forces internationales à l’œuvre.
L’article L’Ouganda planche sur une nouvelle loi anti-homosexualité est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.


Dans cette chronique, je continue de discuter avec Julien. Un homme cisgenre, hétéro, avec qui je partage certaines de mes pensées. Il est fictif, sans être irréel. Julien ça pourrait être toi, moi et/ou nous.
L’article Bon appétit est apparu en premier sur 360°.

Cet article De la fourmilière à l’open-space : Flora Aussant à la Galerie du Crous provient de Manifesto XXI.
Les œuvres de Flora Aussant mêlent quelque chose d’hallucinatoire à l’esthétique aseptisée du monde du travail. Ici, des personnages en costumes de business-man et woman déambulent entre les pierres et les écorces, et des bouquets de champignons côtoient des câbles d’ordinateur. Issue du champ de la photographie, duquel elle s’émancipe avec la présentation de nombreux objets, l’artiste nous narre une drôle de fable qui parle de contrôle, de performance, de capitalisme et de fourmis. Elle présente sa première exposition personnelle à la Galerie du Crous, à découvrir jusqu’au 4 mars 2023.Flora Aussant nous plonge dans un monde mi-bureautique, mi-organique, dans lequel la forêt de Brocéliande chantonne les contes et légendes contemporaines du capitalisme. Digging for a home or a grave raconte des humain·es en perte de sens, shooté·es à l’absurdité de notre société, qui auraient consommé trop de discours sur l’entrepreneuriat de soi.
Avec une douceur parfois clinique et teintée d’absurde, son travail photographique, vidéo, de sculpture et d’installation interroge la place qu’occupent les fourmis dans nos imaginaires collectifs. Les références aux petits invertébrés sont récurrentes dans l’exposition, et prennent différentes formes : une fourmi de métal s’extrait d’une bouche humaine, des arcs de bois évoquent leur structure d’insecte, et partout des références à la fourmilière, tant à ses tunnels et dédales intérieurs qu’à la butte de terre extérieure.
 © Flora Aussant
© Flora Aussant
L’un des points de départ de la réflexion de l’artiste sont les fourmilières artificielles, qu’on peut ramener chez soi afin d’observer les insectes évoluer dans un micro-monde préfabriqué pour eux. Elle nous explique : « C’est comme un mini laboratoire d’observation des humain·es sur le monde des insectes. On a créé une boîte, comme un open-space des fourmis, pour les voir travailler. Ce qui m’intéresse le plus, c’est le jeu de regards d’une société sur une autre, entre lesquelles on a tant essayé de faire de liens. Mais c’est aussi une prison et un espace de contrôle. C’est assez cruel quand on y pense. »
La comparaison aurait-elle pu être plus juste, et moins romancée ? Vantées pour leur efficacité de travailleur·euses, comme dans la fable de La Fontaine, les fourmis sont des animaux productivistes, nés pour construire et agrandir sans jamais s’arrêter, dans une société de castes, où les ouvrières le resteront toute leur vie, et où la reine est condamnée à pondre sans repos. Les parfaits insectes libéraux ?
Flora Aussant questionne l’impact des technologies et du capitalisme sur le vivant : sur la nature, mais aussi sur nos corps, ramenés au rang de ressources inépuisables, dont on extrait jusqu’à la dernière goutte – de sueur, de sève.
Dans un diptyque, c’est un corps tout entier qui se contorsionne sur sa chaise de bureau. En évoquant une esthétique parfois clinique, empruntée au vocabulaire de la kinésithérapie et de la médecine du travail, l’artiste interroge le paradoxe du soin appliqué à notre société de la performance : l’injonction au care, le fait de prendre soin de soi à grand renfort de développement personnel, mais un soin béquille, pensé pour que l’on puisse continuer à nourrir l’effort permanent que l’on impose à nos corps, à nos têtes, un soin calibré pour que l’on soit toujours plus efficaces.
Les corps dont parle Flora Aussant ne se tordent plus sous les machines, mais derrière l’écran d’un ordinateur, ils ont mal au dos, aux cervicales – moulées dans de la cire, et entreposées dans l’espace de la galerie – alors on leur imagine des prothèses : autant d’exosquelettes pour continuer de produire et de croire en un rêve commun. Un rêve libéral de droit au bonheur, de réalisation de soi, un rêve où l’on est maître·sse de sa destinée et où l’on s’épanouit dans le travail… Un rêve très oppérationnel, qui défile 24/7 dans nos têtes.
 © Flora Aussant
© Flora Aussant
Au milieu de la galerie, une tête de lit lévite au-dessus d’une butte de terre, évoquant autant une pierre tombale qu’une fourmilière. Quelle place pour le sommeil, pour le repos, pour le loisir, dans un monde où l’on s’endort au chuchotement d’une application de méditation ?
Certaines photographies sont présentées dans un double cadre, séparées par une nervure dans laquelle circulent des billes de métal : on observe les deux images et les billes, coincées dans leur trajectoire, comme on regarderait les fourmis dans leurs boîtes. D’autres apparaissent en transparence sur du plexiglass, d’autres encore sont des transferts sur plâtre. Sur celles-ci s’étalent de larges éclaboussures, renvoyant à l’idée d’une société liquide conceptualisée par le philosophe Zygmunt Bauman, qui raconte le triomphe du consumérisme, où l’humain·e et ses affects sont des biens consommables parmi tant d’autres. « Je parle de liquidité sur une matière poreuse, issue d’une réaction de solidification. Et j’aime l’ambiguïté que le transfert apporte aux images, que ça altère les couleurs : il y a justement quelque chose qui échappe au contrôle » précise Flora Aussant.
 © Flora Aussant
© Flora Aussant
La question du contrôle est pourtant omniprésente, lae spectateur·rice continuellement mis·e dans une position de voyeur·euse. Avec des jeux d’échelle entre des pièces imposantes et d’autres plus petites, mais également à travers les judas installés sur deux diptyques, Flora Aussant nous invite à changer de prisme. Le regard qu’elle pose sur notre société du travail, de la consommation et de l’immédiateté est plus interloqué qu’effrayé, et le monde qu’elle nous décrit n’est jamais violent, comme si le système était trop intelligent pour s’avouer brutal. Au contraire, il est doux comme un tapis de mousse dans la forêt, et pour un peu nous aussi, on aurait envie d’enfiler un costard et de filer sur le droit chemin, sans trop se poser de questions.
Car les chemins qu’on emprunte avec tant de ferveur, sommes-nous celles et ceux qui les dessinons, ou bien ont-ils été tracés pour nous ? Nos désirs d’accomplissement nous appartiennent-ils vraiment ? Autant de questions que Digging for a home or a grave soulève et auxquelles l’artiste nous invite à réfléchir.
 © Flora Aussant
© Flora Aussant
 Image issue de la vidéo Ants Whisper présentée dans l’exposition
Image issue de la vidéo Ants Whisper présentée dans l’expositionFlora Aussant présente Digging for a home or a grave, du 23 février au 4 mars 2023 à la Galerie du Crous de Paris, au 11 rue des Beaux-arts, 75006 Paris. Ouvert du lundi au samedi de 11h à 19h.
Image à la une : © Flora Aussant
Relecture et édition : Anne-Charlotte Michaut
Cet article De la fourmilière à l’open-space : Flora Aussant à la Galerie du Crous provient de Manifesto XXI.

Alors que le magazine souffle cette année ses 25 bougies, nous vous proposons une excursion historique dans ses premières pages: direction juillet 1998!
L’article 360°, premier du nom est apparu en premier sur 360°.

Deux suspects, dont un mineur, ont été appréhendés et le plus âgé, 21 ans, a été jugé en comparution immédiate. Lors des perquisitions, des ordinateurs dérobés ont notamment été retrouvés à leur domicile.
L’article La Réunion : l’un des incendiaires du centre LGBT+ OriZon condamné à un an de prison ferme est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Aurélie Olivier: Quand le corps de ferme parle provient de Manifesto XXI.
Après avoir dirigé l’ouvrage collectif Lettres aux jeunes poétesses (L’Arche), Aurélie Olivier fait aujourd’hui entendre sa voix singulière dans Mon corps de ferme, publié aux Éditions du Commun. Elle y raconte son enfance dans une ferme d’abattage industriel en Bretagne et panse la violence du monde agricole par la délicatesse de sa langue poétique.Qu’est-ce qu’un corps de ferme ? Est-ce l’enceinte physique dans laquelle Aurélie Olivier a grandi 18 années durant ? Ou bien sont-ce sa chair et ses organes, marqués à vie par la ferme ? C’est en partie à ces questions que la poésie d’Aurélie Olivier tente de répondre. L’autrice égrène, tout au long de son récit, des jeux sur la polysémie et l’ambivalence des mots pour mieux rendre compte de la complexité de la vie agro-industrielle : « En 1976, 67 ans après les salariées / les paysannes on un congé maternité / 14 semaines pour les salariées / contre 14 jours pour les paysannes […] / A minima, l’élevage sera intensif »
À la fois récit politique et texte féministe intime, Mon corps de ferme s’attèle à rendre visible une réalité méprisée et ignorée pour faire enfin parler les silences omniprésents de son enfance. Le travail d’Aurélie Olivier ne semble pas guidé par la revanche, comme en témoigne son engagement dans l’association Littérature,etc ou le podcast Les Parleuses, qui met à l’honneur des textes méconnus. Au contraire, c’est bien la défense des mots comme canaux de dignité et d’émancipation qui semble au cœur de son écriture. Rencontre.
Manifesto XXI – Qu’est-ce qui vous a amené à prendre la plume et à écrire sur votre enfance dans une ferme industrielle en Bretagne ?
Aurélie Olivier : C’est la situation d’urgence de vie ou de mort que m’a fait affronter la découverte de mon mélanome (un cancer de la peau surreprésenté dans le milieu agricole, ndlr). Prendre conscience que, d’un seul coup, la vie peut s’arrêter et le sentir dans mon corps m’a ramené à un une question existentielle : qu’est-ce que j’ai envie de faire du temps qui m’est imparti ? Cependant, lorsque l’on vient d’un milieu comme le mien, la parole n’est pas une évidence et l’écriture l’est encore moins car elle laisse une trace. Cela signifie que l’on assume sa parole pour qu’elle devienne publique. Il y a très peu de modèles auxquels se référer dans cet acte de prise de parole. Un des symptômes d’un corps de ferme, c’est le silence. S’autoriser à écrire et à parler demande beaucoup plus de temps dans le milieu agricole que dans d’autres. Qui plus est en tant que femme. On a toujours l’impression d’être les premières à écrire alors qu’il y a toute une histoire littéraire qui nous précède mais qui a été invisibilisée et oubliée parce qu’elle n’a pas été transmise.
La poésie oblige à peser et penser chaque mot, à s’arrêter sur chaque terme. La poésie est une pratique du soin.
Aurélie Olivier
Ce silence, c’est par la poésie que vous le brisez. Pourquoi ?
La poésie oblige à peser et penser chaque mot, à s’arrêter sur chaque terme. La poésie est une pratique du soin. Par rapport au sujet que je traite, cela me semblait très important d’utiliser une forme qui fait bien entendre les mots et qui demande d’être très précise. La poésie permet une grande complexité notamment grâce au jeu avec l’ambivalence des mots, leurs doubles sens… La poésie est aussi un genre et une forme peu rentables, très sur-mesure, donc c’était une manière de ne surtout pas laisser ma pratique être contaminée par les logiques de l’industrie agro-alimentaire. La poésie est une pratique qui est à l’opposé : elle est en dehors de la logique de rentabilité, de la monoculture et de sa violence. En ce sens, elle est une réponse qui sublime l’expérience agro-alimentaire.
Le livre est le récit de votre enfance et de votre adolescence. Il y a de nombreux parallèles entre la manière dont votre corps change en même temps que le corps de ferme change, et cela jusqu’à brouiller leurs limites. Quelles relations y a-t-il entre votre corps, la ferme et l’agriculture ?
N’importe quel corps est influencé par le contexte qui l’entoure. Quand on grandit dans une ferme, il y a une confusion totale entre ce qui relève de la vie privée et de la vie professionnelle, la vie de la ferme. La ferme est derrière la maison, tout est mélangé. On ne peut pas grandir dans le capitalisme agro-alimentaire sans y être poreux. Par exemple, les mises aux normes régulières dans l’agriculture conventionnelle et le fait que le langage même de ce modèle économique fasse partie de notre quotidien a un impact direct sur celleux qui l’utilisent. Les mots agissent sur les gens et leur manière de penser et de se penser. Toute norme, comme par exemple l’hétéro-normativité, fait rentrer nos désirs dans des cases.
Il y a une sorte de paradoxe qui semble émerger dans votre récit : on ressent un sentiment d’enfermement dans un espace imaginé par les urbain·e·s comme un lieu ouvert…
La ferme n’est pas un espace ouvert. C’est un îlot de solitude et le regard social rend toute tentative d’occuper l’espace public très surveillée. Il y a peu de possibilités de déroger à la norme car il y a peu de lieux dans cette réalité : le collège, le supermarché, la ferme. Il n’y a pas de lieux où l’on peut exprimer une singularité car tous reproduisent des cadres normés assez violents. Ce sont des lieux avec peu de possibles et avec des horizons très courts.

Quel était donc votre rapport au monde en grandissant dans cet espace ?
On parlait très peu du monde extérieur. Je cherchais des discours qui pouvaient m’apprendre mon histoire. J’étais à l’affût de toutes les choses qui pouvaient m’expliquer d’où je venais. Par exemple, même si C’est mon choix est une émission de télévision catastrophique, pour moi enfant, c’était un endroit où l’on parlait du monde au delà de ma réalité limitée. Alors que la réalité de la ferme est concrète, il y avait en même temps une forme d’abstraction vis-à-vis des gens qui prennent les décisions. La chance que j’ai eue, c’est la découverte de la littérature au CDI du collège. C’est grâce à cela que j’ai commencé à me penser dans une réalité où le monde de mon enfance ne serait pas le monde dans son intégralité.
Comment retrouver la réalité de ce monde après être partie si longtemps ?
Je suis partie de la ferme dès que j’ai pu, car j’ai toujours détesté cet endroit, même quand j’étais enfant. Il y a tellement de silences autour de la vie dans la ferme qu’il y a quasiment deux suicides d’agriculteurices par jour en France. À partir de mes 16 ans, je suis allée dans un « bon lycée ». Je n’ai donc plus rencontré de personnes issues de ce monde, ou qui en étaient suffisamment sorties pour pouvoir y réfléchir et parler de ce qui s’y jouait. 18 ans après avoir quitté ce milieu, j’avais besoin de voir comment on parlait de cette réalité afin de m’assurer que je n’avais pas tout inventé. Il a donc fallu que j’aille chercher à la fois des sources qui étaient proches de la réalité dans laquelle j’ai grandi, comme les journaux régionaux (Le paysan breton, Ouest France…), mais aussi des choses plus savantes comme L’histoire de la Bretagne et des Bretons de Joël Cornette.
Quand j’étais petite, les vaches portaient des prénoms, aujourd’hui, elles portent des numéros. Le rapport au vivant a été anéanti, il est mort.
Aurélie Olivier
En effet, votre récit est ancré dans la triste réalité du monde agricole d’aujourd’hui : suicides, appauvrissement de la terre et des humain·e·s par le capitalisme… Comment le modèle agricole promu par l’Union Européenne perpétue-t-il les « horizons fermés » dont vous parlez ?
La violence et le silence du monde agricole ont leurs raisons car les gens sont forcés dans ce système. Par exemple, utiliser les subventions européennes pour l’agriculture paraît être le seul moyen accessible de payer des études aux enfants car il y a un désir logique de sortir de la misère et d’améliorer son sort. Toute autre option semble irréaliste parce que le monde agricole est prisonnier des logiques de mécanisation qui imposent des cadences toujours plus fortes. Et puis, il ne faut pas oublier que les agriculteurices actuel·les ont vu leurs ancêtres s’user à la tâche physiquement. Tout cela fait système et sa complexité ne pouvait être dicible que par la poésie.
Est-ce qu’il y a un avenir en dehors de ce modèle pour le monde agricole ?
Grâce à ce livre, je rencontre beaucoup de gens qui testent des choses et qui veulent un autre modèle. J’espère bien qu’une autre agriculture est possible !

Le livre parle aussi du rapport entre animaux et humain·e·s dans un contexte télévisuel qui promeut la viande à tout va. Dans Ce à quoi nous tenons, la théoricienne Émilie Hache parle de la séparation entre animaux et humain·e·s comme constitutive du capitalisme industriel. Quelle relation les agriculteur·ices entretiennent-iels avec les animaux dans un contexte où c’est leur abattage qui est la ressource principale de revenus ?
Cette relation humain·e-animal a évolué et changé à travers le temps. Quand j’étais petite, les vaches portaient des prénoms, aujourd’hui, elles portent des numéros. Le rapport au vivant a été anéanti, il est mort. Ce système tue les animaux mais il tue aussi les humain·e·s et un certain rapport au monde. Tout est ambivalence car les exploitant·e·s sont aussi les exploité·e·s. Le système capitaliste nécessite un éloignement constant face à ce que l’on fait. Il demande une déréalisation permanente. Mon texte s’inscrit dans une volonté de réintroduire de la réalité dans ce monde.
On pourrait facilement catégoriser votre livre dans cette grande mouvance des récits de transfuges de classe. Pourtant, votre texte va ailleurs car, bien que vous insistiez sur votre désir de sortir de la ferme, vous ne reproduisez pas l’écueil parfois commun du jugement a posteriori du milieu d’où vous venez.
Je préfère le mot de transclasse, d’après le travail de Chantal Jacquet, plutôt que le terme transfuge. Transfuge implique l’idée que la classe à laquelle j’appartiens aujourd’hui serait meilleure que celle d’où je viens et je n’en suis pas sûre. Je ne sais pas si j’ai voulu partir de la ferme ou si j’en ai été chassée d’ailleurs. Après, il y a une faille dans mon histoire parce que je suis née d’un déni de grossesse et cela a créé une brèche dans ma vie qui a aussi participé à me donner des possibilités de sorties. Mais lorsqu’on est sorti·e de son milieu, on se pose toujours la question : « Pourquoi moi et pas les autres ? ». Et cela, je ne sais pas vraiment y répondre.
Est-ce qu’on peut quitter son corps de ferme ?
Dès toute petite, j’étais en dehors de ce corps de ferme simplement parce que j’observais toujours les choses avec beaucoup d’attention. Et en même temps, on n’en sort jamais : le corps de ferme se ré-ouvre par moment mais se referme aussitôt. Tout cela est une lutte : le corps de ferme n’est jamais vraiment clos car l’enfance est constitutive de nos histoires, elle tatoue nos vies.
Quelle relation entretenez-vous avec la ferme aujourd’hui ?
C’est compliqué mais je n’en parle pas dans mon livre. Je ne voulais pas que mon livre laisse à penser que ce sont les agriculteurices qui sont responsables. Iels ne sont que les exécutant·e·s d’un système dont iels ne sont pas les penseur·euse·s. Et aujourd’hui, je suis sociologiquement plus proche des gens qui décident du système que des agriculteurices. J’ai plutôt envie d’accuser celleux qui ont les cartes en main. Ce texte est une tentative de comprendre d’où je viens et ma hantise était que l’on ressente du mépris de classe. Cela ne veut pas non plus dire que je suis fière de venir de ce milieu, ce n’est pas mon sujet. J’ai voulu essayer de comprendre comment les systèmes façonnent les gens. Et puis, la proximité entre le monde de la ferme et l’implantation des Éditions du Commun (à Rennes ndlr) m’a rassurée car je savais qu’on m’alerterait s’il y avait quelque chose de gênant ou de méprisant dans mon récit. Iels étaient garant·e·s du fait que je ne représente pas un portrait rayonnant de la transfuge de classe qui vient du milieu agricole. Publier dans cette maison c’était déjà pour moi une manière de commencer à rompre la distanciation et la séparation entre la ferme et les mots.
Comment Mon corps de ferme fait-il écho à votre travail avec Littérature, etc., la direction du livre Lettres aux jeunes poétesses, et plus globalement avec l’émergence de récits féministes, queers, radicaux qui proposent d’autres points de vue sur la réalité ?
Avec mon association Littérature, etc., le podcast «Les Parleuses» ou dans Mon corps de ferme, mon moteur est d’aller traquer le déni, aller voir ce que l’on ne veut pas voir, écouter ce qu’on n’écoute pas. Ce que je préfère, c’est donner de la visibilité à des textes qui en méritent plus mais qui ont été oubliés ou qui ont du mal à circuler. J’aime lire un texte écrit par une voix peu entendue, jeune, maladroite et qui n’aurait pas les codes. Je trouve ces voix plus intéressantes et créatives parce qu’elles sont inattendues. J’ai longtemps pensé que le sujet de la ferme n’intéressait personne mais je vois aujourd’hui qu’il y a une curiosité et un désir de savoir la réalité du système agricole. C’est un enjeu fondamental de savoir d’où vient ce que l’on mange. Si les fondamentaux sont bafoués comme ils le sont aujourd’hui, on peut toujours fermer les yeux mais cela dit quelque chose sur notre société.
Mon corps de ferme, 70 p, Éditions du Commun
Relecture et édition : Anne-Charlotte Michaut
A lire aussi : « L’année 2022 marquera-t-elle le comeback de la poésie ? »
Cet article Aurélie Olivier: Quand le corps de ferme parle provient de Manifesto XXI.

 Dans les couloirs du métro à Paris, impossible de rater en ce début d’année la double affiche de l’exposition de la Maison Européenne de la Photographie dédiée à Zanehe Muholi ...
Dans les couloirs du métro à Paris, impossible de rater en ce début d’année la double affiche de l’exposition de la Maison Européenne de la Photographie dédiée à Zanehe Muholi ... 
Un homme de 27 ans, sous l'emprise de cocaïne, a été appréhendé ce mardi 21 février, après l'agression d'un couple d'hommes, qu'il a injurié puis frappé, parce qu'ils se tenaient par la mais sur le quai du métro.
L’article Un couple gay, qui se tenait par la main, agressé dans le métro à Lyon est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

En décembre 2022, le Conseil fédéral a publié la première étude nationale sur l’état de santé et l’accès aux soins pour les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans*. Les résultats sont alarmants.
L’article Les personnes LGBT n’ont pas les mêmes chances en matière de santé est apparu en premier sur 360°.

Cet article Un moment figé dans le présent avec Sabrina Bellaouel provient de Manifesto XXI.
Depuis 2017, la chanteuse et productrice agite la scène francophone en testant, sans concessions, tout type de composition. Avec Al Hadr, la voix soul de Sabrina Bellaouel nous emporte une nouvelle fois dans un espace sincère et spirituel.En ce début mars, Sabrina Bellaouel se dévoile entièrement sa musique expérimentale, dans un ultime condensé de ces anciens travaux. Cette voix unique R&B/Soul se pose sur des productions électroniques toujours étonnantes et colorées, qui n’hésitent pas à être trafiquées et déstructurées pour servir le propos. Cette fois, trois langues qui lui sont chères sont fusionnées pour un ensemble harmonieux et personnel. La chanteuse et compositrice revient avec nous sur le temps présent et sa sérénité retrouvée dans son dernier projet, Al Hadr.
MANIFESTO XXI – C’est un honneur de pouvoir échanger avec toi et de présenter ton travail. Peux-tu te présenter pour celle·eux qui ne te connaitraient pas ?
Sabrina Bellaouel – Je m’appelle Sabrina Bellaouel, je suis chanteuse et productrice et je vis à Bagneux, dans le 92. Mon projet, c’est un album de treize morceaux qui sort le 3 mars chez InFiné et qui s’appelle Al Hadr. Ce titre signifie « le moment présent » et ça me représente entièrement. Le projet est à l’image de toute la palette de ma musique, en un ensemble. Je n’étais pas vraiment prête à tout ça. J’ai vécu une certaine transition dans ma vie. J’ai pris plus confiance en moi et j’ai assumé plus d’aspect de ma personnalité. J’ai pu explorer plein de choses musicalement et ça avait du sens de rassembler toutes ces pièces, comme on assemble des chutes de tissu. C’est comme ça que je vois mon album : des chutes que j’ai réunies et qui représentent ce que je suis et ce que j’ai envie de présenter. Il y a de quoi danser, des chants un peu spirituels et des invitées formidables.
La grosse différence avec mes anciens projets, c’est que je me suis plus ancrée dedans. Tu vois, moi, Sabrina Bellaouel, qui est là maintenant, j’ai arrêté de me projeter trop loin dans le futur et de me créer une personnalité artistique qui n’existe pas. Ou alors d’être trop nostalgique de ce que je faisais avant. J’étais un peu tiraillée, par rapport à ma discographie, entre ce que j’ai fait avant et les choses que je projette de faire dans le futur. J’ai un côté très expérimental et électronique que j’avais envie de tester et je ne trouvais jamais la jonction entre les deux. Du coup, je me suis ancrée, je me suis posée, j’ai tout mis ensemble et ça a finalement fait sens. C’est mon ADN.
 © Tom Kleinberg
© Tom Kleinberg
Al Hadr est un album trilingue (français, arabe et anglais). Tout y est subtilement géré, on passe d’une langue à une autre sans réellement s’en rendre compte. Tu avais fait ton projet illusions en 2017 uniquement en anglais, tu avais parfois fait des passages en français sur des single, mais un album entier où tout est mélangé, jamais encore. Comptais-tu associer ces 3 inspirations linguistiques ensemble depuis longtemps ?
Pour moi, le choix de la langue n’est pas du tout stratégique. C’est le morceau, la musique qui appelle une langue. Parce que la langue, c’est un rythme avant tout, et une couleur. Parfois le morceau se prête à du français, parfois à de l’anglais. Sur l’intro de l’album, par exemple, il y a des polyrythmies, des gnaouas [Musique confrérique soufie généralement associée à des paroles de caractères religieux, qui invoque les ancêtres et les esprits, NDLR] qui appellent forcément à la spiritualité et à la poésie de la langue arabe.
Autre exemple, le morceau « Jah », qui parle de Dieu. Il m’a semblé important de l’écrire en français parce qu’on parle très peu de Dieu en français. En tout cas, je ne choisis pas la langue au préalable. C’est la musique qui crée cet espace pour la langue. Ensuite, c’est tout un travail d’écriture mélodique, de sens. J’ai eu la chance de collaborer avec Bonnie Banane qui m’a aidé à écrire les morceaux en français. Pour le reste, c’est aussi l’endroit où je me trouve dans le monde qui m’inspire. Pour cet album particulièrement, j’ai passé beaucoup de temps à Londres, à Amsterdam et à La Haye. Tu écoutes des prods, arrangements et mélodies, les paroles viennent directement parce que tu as la langue dans le cerveau, c’est automatique.
Dès le premier titre, on est frappé par l’importance de l’autotune et par toutes sortes d’autres modifications de ta voix qui font apparition au cours du projet. On entend des voix aux tonalités aiguës, accélérées, saccadées sur le morceau « Trust », ou encore très graves sur « Rapture ». Des voix qui accompagnent des paroles aux penchants romantiques et érotiques, comme dans le morceau « Body », où ta voix nous est murmurée à l’oreille. On a vraiment l’impression que tu as pris la création de cet opus comme un jeu, est-ce le cas ?
Je me suis créé un espace avec cet album, un espace totalement libre. J’ai expérimenté des trucs seule et accompagnée. Plus c’était inconfortable et mieux c’était. Et c’est dans cet espace de liberté que se crée le miracle, pour moi. Je vais faire une mélodie que je n’aurais pas pu créer autre part ou dans des espaces plus clos. Là, il y a tellement de ponts, entre les différentes techniques de compositions, d’enregistrements, les jeux avec les langues, les personnes et les endroits… Au départ, quand j’ai commencé à en parler à Alexandre Cazac qui est le directeur de mon label, cet album était un labyrinthe, dans ma tête. En fait, il y avait pleins d’espaces de jeu et il fallait que tout rentre dans un seul projet. Sauf que pour moi, la musique n’a jamais été une chose qui a des limites. C’est un tissu qui est extensible à l’infini et je trouve ça stylé et miraculeux de pouvoir écouter cet album aujourd’hui et me dire que j’en suis arrivé là. Je me reconnais dans tout et ça me fait beaucoup de bien.
En plus des voix, tu t’orientes vers des détails proches du design sonore du domaine filmique. Ça a toujours été présent dans ton travail, mais plus encore aujourd’hui. Al Hadr s’est fait en collaboration avec le producteur Basile3 (également chez Infiné) et Monomite avec qui tu travailles depuis tes premières sorties. On y retrouve pleins de test sonores, des mélodies inversées, des échos déstabilisants, des bruits de cassettes, des ralentissements…
C’est un jeu qui me fait du bien, d’expérimenter. Je me suis sentie libre et j’ai atteint une sorte de lâcher prise que je n’avais pas forcément la possibilité d’atteindre avant, parce que je travaillais beaucoup avec les autres. Et sur cet album, les démos, je les ai créées. Une grosse partie des arrangements ont été faits en coproduction, mais j’ai vraiment suivi le processus de A à Z. C’est un poids qui a l’air énorme comme ça, parce que tout jaillit de toi, mais en même temps, il faut savoir lâcher prise là-dessus. J’espère avoir cet état d’esprit sur les prochains projets.
Malgré tous ces détails, Al Hadr est bien plus pop et accessible, jusqu’à la pochette qui inspire la sérénité, un accomplissement. En plus des multiples influences R&B, on retrouve de la soul et même de la folk. Comment perçois-tu ton évolution musicale ? Voulais-tu que ton message et ta création soient plus simples à comprendre ?
Franchement, j’ai lu dans des interviews ou des tweets des retours sur la complexité de ma musique. Mais ça ne m’a jamais touché au point de me dire que je devais changer mon processus ou rendre ma musique plus simple et abordable. Ça vient naturellement. Je suis beaucoup plus à l’aise avec ma personnalité et plus je suis à l’aise avec mon personnage de productrice, plus j’ai envie de dire des choses de manière abordable. C’est une bulle qui éclate et je laisse les gens y rentrer. La musique est faite pour être partagée et je crois que c’est comme ça que je fonctionne le mieux. En somme, je ressens que je suis plus en confiance et que le message délivré est plus simple.
 © Tom Kleinberg
© Tom Kleinberg
Tu nous parlais d’invitées tout à l’heure, il y en a deux, Bonnie Banane et Crystallmess. Peux-tu nous en dire plus sur ces collaborations, et sur la façon dont elles sont arrivées sur le projet ?
Bonnie Banane, c’est avant tout ma sœur et une artiste que j’admire beaucoup. Le morceau existait avant même que je ne signe chez InFiné. Bonnie Banane avait déjà posé sa voix dessus, mais je n’avais aucune idée de comment présenter ce morceau-là. Est-ce qu’il fallait que je le sorte en single, comme tous mes morceaux en français ? On s’est finalement dit, avec Alexandre Cazac, qu’il serait parfait dans l’album. C’était une évidence.
Et un jour, je suis tombée sur une story de Crystallmess, sur instagram. Elle psalmodiait. Je ne sais pas si elle serait d’accord avec ce terme-là, mais en tout cas, elle récitait un poème et je trouvais que c’était la quintessence du projet. C’est ce poème-là qu’elle récite sur le morceau « Kesh », qui est la pièce maîtresse de l’album. Ce n’est pas pour rien qu’il se trouve en plein milieu. Elle a tout expliqué et tout résumé avec ce poème. Il me donne des frissons chaque fois que je l’écoute.
Crystallmess sur le morceau « Kesh » tient un discours d’amour pour soi-même et d’écoute nécessaire. Il s’agit d’une douce interlude, où la voix se mêle à une structure musicale ambient très épurée. Cette voix rappelant une concentration sur le temps présent et le besoin de reconstruction. Quelle est ta relation à l’ambient dans ton travail et l’harmonie qui peut s’en dégager ?
L’ambient, c’est la musique qui n’a pas besoin de mots, c’est toutes les émotions. On est sur un bateau et on se laisse complètement emporter, on se laisse dériver. Ça laisse la possibilité d’un lâcher prise aussi bien physique que mental. J’en écoute pendant des heures, j’adore la musique minimale. C’est une forme de méditation pour moi. Je peux improviser dessus, faire mes exercices de voix. C’est un tapis magnifique sur lequel je peux me reposer tranquillement. J’ai découvert tout ça via Steve Reich. C’est un peu le père de la musique classique et contemporaine, et c’est lui qui m’a ouvert les portes de ce monde. J’ai trouvé ça stylé de pouvoir créer une ambiance. Il n’y a pas de limite.
En plus de l’ambient, on retrouve sur Al Hadr des ambiances plus house. Des rythmiques qu’on entendait déjà en 2020 sur ton EP We Don’t Need to Be Enemies, avec les remix de ton morceau « Arab Liquor » ou encore les sons avec Marina Trench. Ta voix soul se colle parfaitement au mélange. On la retrouve sur « Éclipse », un morceau plus club. Dans quel contexte ce genre de musique s’est-elle incorporée dans ta composition ?
J’ai passé pas mal de temps en club, comme tout le monde et j’avais envie de créer des ambiances sonores qui s’en rapprochaient. Je changeais parfois les BPM, ça faisais du bien. Et puis, j’en avais marre d’écrire des chansons tristes, parce que je suis heureuse dans ma vie et j’avais envie de créer de la musique qui reflète cet état d’esprit, qui pousse à danser, à célébrer, perdre le contrôle, transpirer. Je ne sais pas si c’est de la musique Club, mais en tout cas, c’en est influencé. C’est encore un pont que j’ai envie de créer.
Par exemple, sur le morceau « Eclipse », j’ai samplé une chanteuse de Raï [Genre musical et littéraire d’Algérie, chants populaires souvent improvisés et associés aux courants musicaux connus NDLR] qui s’appelle Cheba Sabah, une chanteuse algérienne incroyable, que je suis depuis des années. Ça n’était pas forcément un choix évidement, mais ça m’a paru audacieux et innovant de mêler le Raï à de la house, et je trouve que ça sonne bien. Et en plus, je rends hommage à la culture Raï et à la culture club en même temps. Je me suis vraiment fais plaisir, c’est le morceau qui me donne le plus le sourire. Il est sorti il y a quelques jours et il a trouvé une résonance auprès de la communauté algérienne qui m’a trop fait plaisir, parce qu’on n’en a pas l’habitude. J’ai grandi avec la culture du sample, donc transformer d’une musique existante en une nouvelle forme de Raï mêlée à de la house qui est bien universelle et indémodable, c’était trop bien !
 © Tom Kleinberg
© Tom Kleinberg
Tu es proche d’artistes qui chantent en anglais en France, et d’artistes plus proches de la scène rap, tu as collaboré avec Gracy Hopkins, Jimmy Whoo ou encore Ichon. Avec qui souhaiterais-tu t’associer aujourd’hui ?
Il y a un gars qui ne fait plus de sons et ça m’énerve. C’est un chanteur qui s’appelle Vibe, il était signé dans une grande maison de disques française. C’était à l’apogée du R&B français dans les années 2000. Ce serait trop cool de pouvoir faire quelque chose avec lui, s’il reprenait. Et en vérité, c’est un peu énorme, mais j’aimerais beaucoup travailler avec A$AP ROCKY. J’adore le groove global de ses sons et le côté un peu électronique, ses jeux de guitare, d’écho et d’autotune. Et surtout sa poésie : il décrit les choses telles qu’elles sont. Il est en accord avec son personnage d’amoureux et j’adore ça. Il est balance comme moi, ça résonne dans son message. C’est que du love, il est fier de lui, il est fier de sa go et il en parle naturellement. Ça inspire à faire des choses positives. C’est ce que j’ai essayé de faire sur ce dernier projet. J’ai tenté de retirer le maximum de couches de conventions, d’être vraiment authentique et de présenter mes valeurs. Il n’y a pas de conventions, pas de cadre. Il y a de la couleur, beaucoup de joie et beaucoup de spiritualité.
Dans le morceau « Shop », tu parles également d’énergies et de fréquences. Toujours avec ces voix proches, tel un secret, qui se retrouvent à maintes reprises dans l’album. Est-ce que cette voix agit comme un message pour rassurer ? Tu parles très aisément de ta foi dans ta musique. Peux-tu nous raconter le lien que tu tisses entre ta croyance et ta musique ? Le morceau « Jah » dont tu parlais tout à l’heure, qui est en français, parle de ta croyance, à l’image d’un voyage en voiture pour raconter une relation complexe, et la libération de savoir de te satisfaire seule.
ça a été une longue quête dans ma vie pour savoir ce que ça représentait pour moi. Je suis musulmane et née d’une famille musulmane pratiquante. La musique a toujours été un exutoire, l’endroit où je peux exprimer ma conception de Dieu, ma conception de l’équilibre que ça m’apporte. C’est une boussole pour moi, comme une lune, une étoile que je suis. C’est une protection et ça me permet d’être unie avec moi-même et les autres. C’est vraiment un équilibre et une paix intérieure qui, je pense, s’est beaucoup exprimée entre les lignes sur cet album-là, par les voix, ce que dégagent les voix. Je viens du gospel, aussi.
Je crois que l’album est fédérateur parce que ce sont le souffle et l’énergie que j’y mets qui sont importants. Les morceaux peuvent être house, rock ou folk, peu importe. Pour moi, ce souffle est inspiré par mon étoile : c’est Dieu et je suis fière. J’éprouve beaucoup de gratitude aujourd’hui, pour avoir enfin terminé ce projet. Je me sens bien et c’est pour cette raison que ça sonne comme ça, qu’il y a très peu de musiques tristes. La musique, ça influence beaucoup l’humeur et je voulais faire quelque chose d’inspirant, que ça donne à celleux qui l’écoutent l’envie de dessiner, par exemple, ou d’aller marcher seul·e. Il n’y a que des mantras qui me font avancer.
Dans une nouvelle direction artistique, Sabrina Bellaouel place son besoin de renouveau et sa sérénité dans des mélodies qui ne se trouvent nulle part ailleurs. Al Hadr est à retrouver dès le 3 mars chez Infiné.
L’artiste est à retrouver le 13 avril au Festival Mythos à Rennes, le 20 avril au Printemps de Bourges, le 5 mai lors des Nuits Botaniques à Bruxelles, le 7 juin au Kantine Am Berghain à Berlin et enfin au Sonar le 15 juin à Barcelone.
Relecture et édition : Léa Simonnet
Cet article Un moment figé dans le présent avec Sabrina Bellaouel provient de Manifesto XXI.

Cet article Le véritable punk est noir : retour sur un whitewashing provient de Manifesto XXI.
Le punk puise ses origines et ses influences dans les productions et cultures noires, latin·x et indigènes. Mais le mouvement a été si whitewashé qu’aujourd’hui, les scènes punk sont devenues majoritairement blanches et les personnes noires qui y adhèrent se sentent parfois illégitimes, ou sont discriminées et volontairement effacées. Pourtant, qui de plus anti-système et de plus punk que les personnes noires ?Tapez le mot « punk » dans un moteur de recherche, et vous tomberez systématiquement sur des groupes de personnes blanches, principalement des hommes cis, aux crêtes fluorescentes et vestes en cuir cloutées. Il vous faudra scroller bien plus bas, jusqu’à la crampe, pour trouver une image de punks racisé·es, et encore plus loin pour qu’une personne noire apparaisse dans un costume caricatural dédié à Halloween. Un comble, quand on sait par quoi, et surtout par qui, le mouvement punk a été inspiré…
Dans les écouteurs, le punk, c’est de la guitare et une batterie qui tambourinent fort et très vite, puis une voix qui perce le tout avec des paroles politiques et controversées. Dans la penderie, l’esthétique dite punk s’oppose radicalement à celle du mouvement hippie des années 70. Le moche et le « vulgaire » sont glorifiés, les imprimés criards remplacent les pâquerettes et les rubans, et les t-shirts déchirés aux slogans provocateurs sont tenus à bout de bras par des épingles à nourrice. L’histoire de la musique punk, quant à elle, se limite aux yeux du grand public au mouvement anarchiste né de la classe ouvrière de la jeunesse anglaise et blanche des années 70. Encore aujourd’hui, on associe essentiellement le punk à des groupes comme le quatuor Sex Pistols, à leur dégaine provocatrice et leur incontournable « God Save the Queen ».
Mais le punk, c’est bien plus que ça. Et surtout, le punk est noir.
Le punk, c’est aussi l’aspiration à l’indépendance. Il n’y a pas plus punk qu’une personne noire et son existence ou sa survie.
Adama Anotho, photographe
 © Pure Hell
Punk avant le punk
© Pure Hell
Punk avant le punk
« Si vous remontez dans l’histoire, il ne faut pas longtemps pour remonter la lignée du punk et y trouver une descendance directe de la classe ouvrière noire » nous rappelle Seth, multi-instrumentiste américain. Le musicien connaît bien son sujet. Après avoir joué dans de nombreux groupes punk, garage et hardcore au cours des dix-huit dernières années (Useless Eaters, Clock Of Time, ÖPNV, Couteau Latex, Exit Group, Glaas, Idiota Civilizzato, Life Trap, POW!, Vile Nation), il a récemment lancé un nouveau projet entièrement électronique, Blaq Hammer, qui n’en reste pas moins très punk.
L’artiste de Memphis m’offre d’ailleurs un bref résumé des origines du mouvement. Le rock tel qu’on le connaît aujourd’hui trouve la plupart de ses origines dans le blues. Inventé par les Afro-Américains, le blues lui-même descend des chants entonnés par les esclaves dans les plantations du Deep South américain. Les premiers groupes de punk, Death originaire de Détroit ou encore Pure Hell de Philadelphie, étaient composés de membres noirs qui cherchaient à exprimer leur condition à travers une version plus crue du rock de l’époque.
 © Punk Before Punk Existed : A Band Called Death
© Punk Before Punk Existed : A Band Called Death
Le documentaire Punk Before Punk Existed : A Band Called Death, dédié au parcours rocambolesque du groupe Death, le dit sans détour : Death était punk deux ans avant que le punk ne voit le jour. Pourtant, rien ne le laissait présager. Avant de changer le game avec leur emblématique « Politicians In My Eyes », un titre mélodique et engagé, les frères Bobby, David et Dannis Hackney ont d’abord joué du funk sous le nom de Rock Fire Funk Express. Leur style plus agressif et visionnaire viendra un peu plus tard, après le décès soudain de leur père et la découverte des groupes The Who et The Stooges. En 1975, le producteur Clive Davis de la maison de disques Columbia les repère et leur propose une avance pour qu’ils enregistrent un album à condition que le groupe change de nom. Rebelles dans l’âme, les musiciens refusent en bloc : la maison de disques se rétracte et le groupe se sépare deux ans plus tard.
Quant à Pure Hell, ce groupe précurseur du hardcore composé de quatre ados énervés, Kenny « Stinker » Gordon, Lenny « Steel » Boles, Preston « Chip Wreck » Morris et Michael « Spider » Sanders, il a proposé un rock plus cadencé et provocateur dès les années 70. Une audace qui leur valu, des années plus tard, l’étiquette du premier groupe punk entièrement noir et une reconnaissance relative pour leur unique titre « These Boots Are Made for Walking ». Le guitariste Boles confia même : « C’est nous qui avons payé le prix fort pour ça, nous avons enfoncé les portes. Nous étions véritablement les premiers. Et nous n’en avons toujours pas reçu le mérite. »
Voir cette publication sur Instagram
Malgré leur influence, ces pionnier·es n’ont jamais eu le succès qu’iels méritaient, l’industrie cherchant à cantonner les personnes noires au disco ou à des musiques dites plus dansantes. Le compte Instagram BIPOC_Punk [l’acronyme signifie Black, Indigenous and People of Color, ndlr] vise aujourd’hui à mettre en lumière ces artistes noir·es, indigènes et racisé·es invisibilisé·es de la scène punk, à l’image de la chanteuse grunge afro-américaine Tina Marie Bell, le chanteur afro-queer Lionel White du groupe Snuky Tate ou encore des groupes contemporains comme Big Joanie, un trio de féministes punk et noires. Le créateur de la page insta, le philippino-américain Ray Lacorte, retrace les raisons de cet effacement : « De nombreux groupes pionniers tels que Death et Pure Hell qui comptent exclusivement des membres afro-américains, et des groupes latino-américains de l’est de Los Angeles, comme The Brat, Los Illegals et The Stains, n’ont pas bénéficié d’une audience nationale ni d’une reconnaissance pour leur rôle dans le lancement du punk aux États-Unis. Si de nombreux facteurs peuvent conduire à la montée en popularité d’un groupe, la distribution de la musique, ainsi que l’exposition dans les médias jouent un rôle important dans la viabilité commerciale et la sensibilisation des consommateur·ices. Ces facteurs, en particulier aux États-Unis, faisaient cruellement défaut. » Tout s’explique.
Et les femmes dans tout ça ? Bien avant la version féministe du punk rock et du rock alternatif popularisé par les Riot Grrrl des années 90, des femmes noires comme la batteuse Karla Maddog et la chanteuse Betty Davis ont participé à enrichir la sous-culture punk des années 70 aux années 90. « Je me souviens de figures comme Skunk Anansie », se rappelle la photographe franco-gabonaise Adama Anotho, la plus punk de mes ami·es, dont le travail s’articule autour des identités marginalisées et de leur archivage. « Voir une femme noire et foncée à la tête d’un groupe comme ça, dans mon cerveau d’ado, c’était l’explosion et aussi une confirmation que j’étais à ma place. Cela m’a confortée dans l’idée que j’avais le droit d’être qui j’étais, même si je n’en avais pas trop douté car ma propre mère encourageait la manière dont je choisissais de m’exprimer. Les remarques du reste du monde avaient peu de poids. » N’omettons pas non plus le groupe X-Ray Spex, groupe punk-rock d’inspiration jazz dont la chanteuse Poly Styrene était noire, qui a produit le tube féministe « Oh Bondage Up Yours! » de leur unique album Germ Free Adolescents, devenu une chanson emblématique de l’époque.
Écarteurs, piercings, scarifications…Il y a une certaine ignorance, une aliénation issue de la suprématie blanche et de la colonisation, qui font qu’on ne connaît pas bien nos propres histoires. Finalement, les personnes noires sont marginalisées dans leurs propres codes.
Adama Anotho, photographe
Pour Seth, c’est clair, le punk a été récupéré : « Les punks s’approprient à nouveau une image de classe inférieure comme une forme de rébellion ». Selon lui, cela aurait déjà été le cas pour le beat, un genre musical des années 60 mêlant le pop et le rock, dont les jeunes blancs privilégiés de la classe moyenne à moyenne supérieure des banlieues américaines se sont saisis en imitant le mode de vie des musiciens de jazz afro-américains.
Pour Adama Anotho, les codes du punk sont tirés des arts noirs et ne sont jamais, ou rarement, crédités. « On trouve des parallèles dans certaines cultures africaines. On voit par exemple beaucoup de modifications corporelles dans la scène punk d’aujourd’hui, avec des écarteurs, des piercings, des tatouages et scarifications. Ce sont des pratiques venues du continent africain avec une signification sociale ou un langage spirituel. Moi, par exemple, j’ai de nombreuses scarifications sur le corps qui ne sont ni esthétiques, ni le fruit d’un mal-être, et qui ont été faites dans un contexte culturel de deuil. » Les cultures afro-descendantes ne sont pas les seules à avoir été effacées. La crête dite « iroquoise » popularisée en Occident par le mouvement punk moderne est un style de coiffure qui copie ouvertement celui des Mohicans et des Mohawks, des peuples indigènes d’Amérique.
 © Pure Hell
© Pure Hell
Pour Safra, du groupe BLK VAPOR, le whitewashing du punk est « carrément du blackface ». La chanteuse de Baltimore performe du noise rock expérimental aux côtés de trois autres membres afro-descendant·es – Proxy, Kirby et Melody. Selon elle, les punks blanc·hes imitent la façon dont les Noir·es et les Indigènes s’expriment pour se rebeller contre la société. « Iels utilisent nos pratiques culturelles comme un moyen de s’éloigner de leur blanchité. Leurs actes de rébellion sont considérés comme acceptables, mais il n’y a pas de punk si la société l’accepte. Iels n’ont donc jamais été punk à mes yeux. »
Pour autant, Adama Anotho tient à nuancer : « L’histoire du punk est très riche, il y a aussi une partie liée aux États-Unis et une autre liée au Royaume-Uni et leur empire colonial. Le punk britannique est lié à l’histoire du reggae, car la classe ouvrière blanche britannique et les personnes issues de l’immigration caribéenne se sont mutuellement influencé·es. Il y avait des personnes noires impliquées dans ces milieux et beaucoup de mélanges, au-delà de l’appropriation culturelle par les blanc·hes. »
Les gens de la diaspora africaine ont une vibration d’âme qui ne peut jamais être détruite, colonisée, apprivoisée ou supprimée. L’afro-punk est un autre exutoire de cette même vibration.
Seth, Blaq Hammer
Personnellement, j’ai mis longtemps à me considérer comme punk. Plus jeune, lorsque j’étais au collège, j’adoptais le style « emo », j’écoutais du punk rock, du blues ou encore du pop rock, et j’essuyais les moqueries et le racisme qui allaient avec. Trop noir·e pour adopter un tel style et pour écouter de telles musiques, apparemment. Les stéréotypes et le bagage culturel qui nous dictent d’écouter certains styles musicaux ou de coller à une certaine esthétique en tant que personne noire m’ont longtemps rendu·e honteux·se de mes goûts.
Ça a également été le cas pour Adama Anotho, qui, en tant que personne noire écoutant des musiques alternatives, a souvent été taxée de « copieuse de personnes blanches ». « La plupart des personnes noires ignorent que ces sous-cultures tirent leurs origines de nos codes, ajoute-t-elle. Certaines d’entre elles m’ont déjà dit que ces musiques étaient celles du diable, par exemple. Il y a une certaine ignorance, une aliénation issue de la suprématie blanche et de la colonisation, qui font qu’on ne connaît pas bien nos propres histoires. Finalement, les personnes noires ne peuvent même plus profiter du fruit de leur propre création, iels sont marginalisé·es dans leurs propres codes. »
Voir cette publication sur Instagram
Si les scènes punk sont devenues majoritairement blanches aujourd’hui, c’est aussi à cause de ces stéréotypes racistes et des agressions subies par les personnes noires durant les shows. « Je vais toujours en concert accompagnée, je n’y suis jamais allée le cœur léger ou dans l’insouciance, poursuit Adama Anotho. J’ai déjà été agressée à des concerts. Il y a des franges radicales et suprémacistes, ce sont des éléments perturbateurs dont je peux être la cible, même si je pense que la majorité des personnes de la scène punk me défendraient. »
Seth non plus ne s’est pas toujours senti en sécurité ou valide dans ces espaces, et particulièrement en Europe. Le musicien, qui a joué dans de nombreux groupes de punk, de garage et de hardcore à Toronto, Berlin, San Francisco, en Europe et en Australie, note toutefois une différence selon les zones géographiques : « Je crois qu’il y a un espace pour n’importe qui, tant que chacun·e crée le sien. Mais cela semble plus difficile dans la scène punk en Europe parce qu’il y a moins de personnes racisées représentées dans ces espaces. Et quand iels le sont, iels doivent toujours briser le plafond de verre sexiste et raciste tacite qui existe. »
Non seulement le punk est devenu blanc, mais il a, en grande partie, été vidé de son sens, se réduisant trop souvent à une esthétique pseudo-rebelle marketée par de grandes chaînes de prêt-à-porter. Quelle ironie. Selon Safra de BLK VAPOR, dans sa forme originale, le punk était un moyen de se révolter contre les constructions sociales du monde occidental. Ce qui, certes, peut être accompli à travers l’apparence, mais « ce n’est pas son aspect le plus puissant ». L’artiste explique : « Personnellement, je ne trouve pas que le punk soit une esthétique, il n’y a pas vraiment de look punk, il s’exprime par rapport à l’identité de chacun·e. Certain·es d’entre nous qui ne sont pas directement affilié·es à la scène musicale punk peuvent quand même être considéré·es comme punk parce qu’iels sont des parias de la société et qu’iels se rebellent contre le système. Le punk va aussi bien au-delà de la musique. Il est profondément politique. »
Une réappropriation afro-punkÊtre punk, c’est rester souverain·e dans sa négritude et dans son indigénéité, être capable de créer quelque chose à partir de rien.
Safra, BLK VAPOR
« Le punk, pour moi, c’est aussi l’aspiration à l’indépendance. C’est pour ça que pour moi, il n’y a pas plus punk qu’une personne noire et son existence ou sa survie », continue Adama Anotho. C’est justement cette culture de la rébellion, de l’indépendance et de la créativité qui fait du punk un mouvement éminemment noir. « C’est un moyen d’exprimer librement ses sentiments ou émotions négatives à travers des formes d’expression intenses et directes, avec peu ou pas de ressources ; de créer quelque chose de positif avec absolument rien », détaille Seth.
Voir cette publication sur Instagram
Et qui dit esprit de rébellion, dit réaction face à l’oppression. En réponse à l’effacement et à la discrimination auxquels les punks noir·es ont été confronté·es, l’afro-punk est né. Les afro-punks ont ainsi créé leurs propres festivals, leurs labels, mais aussi leurs groupes de musique autour des personnes afro-descendantes. Tout a commencé dès les années 70. En Grande-Bretagne, en réponse au racisme et à l’effacement subi par les Noir·es dans le rock et plus précisément dans le punk, le mouvement Rock Against Racism (RAR) a été créé. RAR, c’était des centaines de festivals et de concerts qui portaient des messages antiracistes. Plus tard, en 2003, James Spooner a sorti un documentaire phare intitulé Afro-Punk, mettant en lumière les Afro-Américain·es punk qui ne se sentaient pas à leur place ou qui étaient invisibilisé·es au sein de la scène. Après le succès de ce film, s’en sont suivis un site web, un forum et un festival du même nom. Aujourd’hui, le festival Afropunk a élargi son panel de styles musicaux, ne se limitant plus au punk, mais faisant la part belle à de multiples productions afro-centrées. Dans les fosses, face aux scènes, vestes en cuir et bas résilles côtoient peintures faciales inspirées d’ethnies africaines et afros colorées.
Seth a découvert le mouvement afro-punk très jeune sur internet. « Les gens de la diaspora africaine ont une vibration d’âme qui ne peut jamais être détruite, colonisée, apprivoisée ou supprimée par les pouvoirs en place, peu importe à quel point les gens essaient de les oppresser ou de les imiter. Le punk, ou plus spécifiquement l’afro-punk, est, je crois, simplement un autre exutoire de cette même vibration », confie-t-il.
Voir cette publication sur InstagramUne publication partagée par PUNK BLACK | Alt POC Network (@punk.black)
De nombreuses plateformes ont également vu le jour pour créer des espaces de célébration et de visibilité pour les punks noir·es. L’occasion de se réapproprier l’histoire du punk. Punk Black en est un exemple. Cette plateforme offre un espace virtuel aux créatif·ves noir·es « pour explorer leurs penchants musicaux, leur esprit nerd et leur expression artistique dans un endroit sûr, pour ell·eux et par ell·eux ». Pour Ray Lacorte, à l’origine de BIPOC_Punk, la création d’une telle plateforme était avant tout une réaction au manque de reconnaissance et donc de représentation : « Dans chaque post, pour chaque profil, j’aime fournir l’origine ethnique de l’artiste, la discographie de ses groupes passés et actuels, ainsi qu’un bref compte-rendu de sa biographie, de ses labels et de ses genres musicaux. Leur dénominateur commun, c’est leur lutte personnelle, à des degrés divers, contre la discrimination sociétale liée au fait d’être BIPOC ; souvent, le punk leur a apporté l’inclusion qu’iels souhaitaient et leur a permis d’être ell·eux-mêmes. »
C’est à travers ces mêmes lunettes que le groupe BLK VAPOR voit le punk. Les musiciennes originaires de Baltimore sont, pour la plupart, activistes et se sont d’ailleurs initialement réunies dans le but d’inspirer les personnes sous-représentées dans l’art. Safra conclut : « Être punk, c’est rester souverain·e dans sa négritude et dans son indigénéité, être capable de créer quelque chose à partir de rien, ce sont les sociétés matrifocales ou encore le fait d’être capable de se défendre et de défendre les autres ! » Alors, vive le punk.
 © BLK VAPOR
© BLK VAPOR
Relecture et édition : Sarah Diep et Apolline Bazin
Cet article Le véritable punk est noir : retour sur un whitewashing provient de Manifesto XXI.

Dans un rapport de 135 pages, documenté par des témoignages de victimes, Human Rights Watch appelle les géants d'internet à protéger les personnes LGBT+ face aux « traques en ligne » des forces de sécurité dans plusieurs pays arabes.
L’article Traques en ligne : HRW appelle les géants d’internet à protéger les personnes LGBT+ est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.


– Vous vous intéressez à l’actualité LGBTIQ+ romande, nationale et internationale? – Vous suivez les
L’article 360° recherche: Journalistes indépendant·e·x·s est apparu en premier sur 360°.

Rouge aux joues, sourire de premier de la classe: voilà l’image que renvoyait Albert Rösti
L’article Rösti et la patate chaude LGBTIQ+ est apparu en premier sur 360°.

Le Procureur général a fait appel du jugement rendu le 16 décembre 2022 par le Tribunal de police de Lausanne, estimant que les faits reprochés à M. Soral, outre la diffamation, sont bien constitutifs d’infraction de discrimination et incitation à la haine.
L’article Après sa condamnation pour diffamation, Alain Soral à nouveau devant la justice suisse pour homophobie est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Le Centre LGBT+, situé à Saint-Denis, avait déjà été cambriolé en novembre dernier. Une plainte sera déposée.
L’article La Réunion : Le local de l’association LGBT+ OriZon à nouveau vandalisé est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Sapphosutra : « On a créé ce qui nous a manqué, une constellation saphique » provient de Manifesto XXI.
En 2019, Lou et Léontin cherchent un kamasutra lesbien afin d’étoffer les imaginaires érotiques qu’iels expérimentent au sein de leur relation. Façe à la pauvreté des représentations s’offrant à iels, le couple décide de pallier à ce manque via le compte Instagram Sapphosutra. Début février 2023, iels ont publié Kamasutra Queer, Manifeste érotique saphique aux éditions Les insolentes. Dans l’ouvrage iels l’affirment : « un jour, nos amours cesseront d’êtres politiques et il n’en restera que la poésie, cette dernière rendra toute la place ».Lou est artiste et illustratrice, Léontin est artiste-auteur, depuis trois ans et demi iels s’efforcent de visibiliser les amours et sexualités lesbiennes, bi, pan et queers. Aujourd’hui le compte Instagram de Sapphosutra rassemble une communauté de plus de 50 000 personnes et la soirée de lancement de leur livre a réuni des centaines de personnes venues spécialement de la France entière. Nous les avons rencontré·es pour parler plaisir, corps et communautés.
Manifesto XXI – Tout d’abord, est-ce que vous pouvez nous raconter comment votre histoire a commencé ?
Léontin : J’ai rencontré Lou à 20 ans en arrivant sur Paris, on terminait nos études d’art dans la même université. On n’était pas dans la même promo, mais Lou s’est beaucoup incrustée dans mes cours sans que je comprenne pourquoi, jusqu’à ce que je saisisse qu’elle était intéressée par moi… On a 25 ans, ça fait donc cinq ans qu’on est ensemble. J’ai fait mon coming out vers seize ans, avant Lou j’avais déjà eu quelques amourettes, mais je n’avais jamais eu des relations aussi longues.
Lou : Pour ma part je savais que j’étais bi depuis plusieurs années, mais avant Léontin je n’avais eu que des longues relations avec des hommes. D’ailleurs petite parenthèse, aujourd’hui je me définis comme lesbienne bien que je suis persuadée que si le patriarcat n’existait pas, je serais bi/pan. Cependant je ne supporte plus l’idée de partager mon intimité avec un homme cis, c’est vraiment viscéral et je n’arrive plus du tout à développer de la tendresse à leur égard. Je peux encore avoir des microdésirs, mais ils ne passent pas l’épreuve d’une discussion de quelques phrases, ou même la simple observation de leur attitude. Je me suis longtemps inscrite dans une identité bi, mais aujourd’hui je me sens plus à l’aise avec le terme lesbienne, car cette identité correspond à ce que sont mes désirs et mes aspirations personnelles. Bref, toujours est-il que lorsqu’on s’est rencontré avec Léo, il a cru que j’étais hétéro !
Léontin : À l’époque, je pense que j’avais encore beaucoup de clichés en tête, surtout sur tout ce qui s’apparente aux codes féminins. Lorsque j’ai connu Lou, elle avait les cheveux longs, elle était souvent maquillée avec du rouge à lèvres et inconsciemment, je l’associais à des codes hétéronormés. Cela s’explique : plus jeune, l’attitude que j’avais pour me définir et me construire en tant que lesbienne, c’était de casser les codes de la féminité et de performer une autre représentation, à savoir ce que j’imaginais être « la lesbienne ». Lou n’étant pas dans cette représentation biaisée, je l’ai assimilé à l’hétérosexualité. J’ai aussi grandi dans un milieu rural et à cette époque je n’avais jamais rencontré de personnes qui s’assumaient ouvertement bis ou lesbiennes avec l’apparence de Lou. Et depuis c’est trop cool, j’ai largement déconstruit tout ça. Il y a plein de manières d’être lesbienne et il ne faut pas se cantonner à deux clichés, notre diversité est précieuse.
À cette époque on a 20 ans, on vient d’arriver à Paris et on n’a pas d’entourage queer.
Léontin
Et comment l’idée d’un projet commun est née ?
Lou : J’ai tapé dans la barre de recherche Google « kamasutra lesbien », un peu bêtement. En fait c’est quelque chose que j’avais l’habitude de faire dans mes histoires hétéros et comme c’était ma première relation lesbienne j’ai fait la même chose. Et la merde, je me rends compte qu’il n’y a rien ! J’ai juste trouvé un article avec cinq dessins alors qu’un papier similaire du côté des hétéros, c’est un carrousel de minimum cent positions. En plus c’était des propositions complètement irréalistes. Par exemple, une des propositions phares c’était deux femmes très éloignées qui du bout des mains se contentent de se pincer les tétons. Ça, c’était l’une des cinq positions phares ! Enfin, ces maigres ressources montraient des « femmes statues », sensuelles, toujours minces, blanches et prudes. C’était assez édifiant, surtout que j’étais en mesure de comparer avec la profusion de ressources hétéros auxquelles j’avais eu accès par le passé. Lorsque j’ai partagé ce constat à Léo, il m’a dit : « Et bien toi tu es illustratrice donc on va le faire nous-même ce kamasutra ».
Léontin : À ce moment-là on devait régulièrement faire des projets artistiques pour notre école d’art, donc ça faisait sens de réaliser ce projet ensemble. À cette époque on a 20 ans, on vient d’arriver à Paris et on n’a pas d’entourage queer.
Lou : De mon côté j’étais en master d’esthétique et philosophie de l’art. Je m’intéressais énormément, et c’est toujours le cas, aux univers qui sont vus comme populaires, laids ou dégradants, selon les critères esthétiques dominants. Je me passionne pour l’esthétique des blogs en ligne, des cams girls, des blogueuses et Instagrameuses… Donc d’un point de vue artistique, ça me plaisait de faire ce projet sur Instagram.
Léontin : De là on s’est fait des petits points travail et on a démarré en deux semaines.
Lou : Pour Léo l’objectif, c’était 5000 abonnés, je lui ai dit : tu es fou ! Le mien c’était de réussir à faire un petit peu de trésorerie pour faire des stickers, c’était mon goal ultime.
On avait que nos discussions pour créer des imaginaires et on savait que c’était limité.
Léontin
Donc en un mois, vous avez monté Sapphosutra et vous étiez super jeunes quand vous l’avez lancé, j’imagine que vous n’aviez pas forcément des années de travail sur la sexualité. Comment ça s’est passé ? Vous avez appris sur le tas ?
Léontin : On a complètement appris sur le tas. On insistait d’ailleurs sur le fait qu’on n’était pas spécialistes de la sexualité ni sexologues. On a beaucoup grandi grâce à ça et c’est pour cette raison qu’on a lancé un projet qui dès le départ était collaboratif.
Lou : Le côté participatif a tout de suite fonctionné. Très vite, on a eu des témoignages et des récits assez divers. Dès le premier mois, on avait un témoignage d’un couple avec une femme trans, ce qui était très chouette, car j’ai pu rapidement dessiner des corps saphiques différents du mien.
Léontin : Avoir des retours d’autres personnes c’était précieux pour nous qui n’avions pas de queers dans notre entourage et peu de représentations. Finalement on ne connaissait que ce qu’on expérimentait avec Lou, on avait que nos discussions pour créer des imaginaires et on savait que c’était limité. Petit à petit, on a rencontré des gens, les choses se sont étoffées et les gens nous ont confié leurs témoignages. On a très vite progressé, on a commencé à lire plein de contenus sexo, à emmagasiner énormément d’informations, et au fur à mesure on a pu se permettre de faire de plus en plus de pédagogie sur des sujets où il y avait de la demande. Au fil du temps on est devenu effectivement expert•es dans ces domaines.
Lou : Pour ma part j’ai une sexualité active depuis que j’ai quatorze ans et ça m’a toujours beaucoup intéressée. J’avais déjà monté des expos lors de ma licence sur des sujets liés aux sexualités, donc j’avais des connaissances, mais elles étaient moins approfondies sur le côté queer.
J’ai noté qu’il y a eu une grande évolution sur votre compte dans les termes que vous employez pour définir les sexualités représentées. Au début vous écriviez dans vos publications « femmes » avec un x, c’est-à-dire « fxmmes » et maintenant vous parlez de sexualités queers et saphiques. Comment et pourquoi avez-vous changé d’expressions ?
Lou : On a simplement demandé aux gens. C’est un peu le même constat que lorsqu’on a commencé le compte, on savait qu’on n’avait pas encore toutes les connaissances, on ne maîtrisait pas tout le vocabulaire et surtout, on s’était tout de suite aperçu qu’il n’y avait pas un mot parfait. Et ça, ça nous a posé beaucoup de soucis. À l’époque je m’estimais bi donc « lesbienne » me dérangeait tout comme l’expression « sexualité entre femmes » car on avait des témoignages d’hommes trans et de personnes non binaires.
Léontin : Bref, on a eu envie de n’exclure personne et à la fois il n’y avait pas de mot idéal, donc on écoutait les gens. A un moment donné, il y a le mot femme avec un x qui nous a été conseillé par des femmes trans pour parler des hommes trans qui se considèrent lesbiens et des personnes non binaires. Donc on a fait OK, pourquoi pas, utilisons « fxmmes », mais ça nous a fait bizarre.
Lou : En fait, en story sur Sapphosutra on avait fait voter les gens sur le choix du terme et c’est lui qui avait été retenu. Dans un deuxième temps, ce terme a été contesté et on nous a reproché de l’employer. De toute façon, il ne nous convenait pas vraiment, parce qu’il était trop marqué « femme ». On a longuement erré dans le vocabulaire, on a testé plein de choses. On a fini par arriver à « saphique » parce que c’est le mot avec lequel on est le plus à l’aise et aussi car il est très peu incarné en France. Il y a encore plein de gens qui ne le connaissent pas, ça nous permet de l’investir et de l’utiliser comme nous on l’entend.
Chaque découverte de vieux textes lesbiens me donnait des papillons dans le ventre, alors on s’est dit qu’on allait rassembler ces papillons.
Lou
Avez-vous rencontré des difficultés pour publier du contenu sexo sur la plateforme Instagram ?
Lou : Ben ouais, sur Sapphosutra on est tout le temps shadow ban, c’est-à-dire que lorsqu’on tape notre pseudo dans la barre de recherches d’Instagram on ne nous trouve pas. Maintenant on ne peut plus du tout publier de dessins de positions de notre kamasutra sur cette plateforme. Ce sont des suppressions illico même si l’on fait attention à ne pas montrer de parties « intimes ».
D’où le besoin d’archiver votre travail dans un livre ?
Léontin : Oui, le fait de sortir un livre, c’est l’acter dans le temps. Ça nous fait du bien de se dire OK, le travail il est là, il ne bougera pas.

Et pourquoi ce choix de faire un livre érotique sous forme d’anthologie donc qui compile des textes saphiques et queers en plus des parties sexos ?
Lou : Le milieu de l’édition nous encourageait à nous arrêter à la pédagogie sexto, à faire un livre se rapprochant du best-seller « Jouissance club » de Jüne Pla. Cependant nous avions envi·es de rester dans la constance de notre projet qui a toujours été collaboratif. Nous voulions continuer à visibiliser des récits, des imaginaires et des initiatives queers qui ne se limitent pas aux nôtres.
Léontin : On a aussi fait comme chaque fois, c’est-à-dire se poser en se demandant ce que nous on aurait aimé avoir et lire. On a essayé de créer l’objet qu’on voudrait sur notre table de chevet.
Lou : J’ajoute qu’à ce moment-là, j’allais régulièrement aux archives lesbiennes car une de mes amies y travaillait. Avec ces visites, j’ai pris conscience que j’avais des ancêtres que je ne connaissais pas, qui étaient mes prédécesseurices queers. Ça m’a touché•e de réaliser qu’on n’a pas de représentations de grands-parents et des lointaines générations LGBTQIA+. On voulait créer un objet qui s’inscrive dans cette continuité historique dont on nous a privé•es. Chaque découverte de vieux textes lesbiens me donnait des papillons dans le ventre, alors on s’est dit qu’on allait rassembler ces papillons.
Léontin : On s’est heurté·es à pas mal de contraintes, notamment liées aux droits d’auteurices ou à l’effacement de nos récits. Ce n’était pas évident de déterrer des textes érotiques écrits par des concerné•es, mais à force de recherches on trouve. Par exemple, Lou a enquêté plusieurs semaines sur la trace de douze épopées en arabe, rédigées au Moyen- Âge. Il s’agissait de 12 histoires de couples de lesbiennes en mode l’Iliade et l’Odyssée version saphique ! Malheureusement, si les historien•nes attestent de la véracité de cette pièce historique, les textes ont été détruits. Cependant on a quand même trouvé et incorporé deux textes datant du Moyen-Âge ! L’idée c’était de recoller et d’assembler des morceaux de culture saphique au sein de notre ouvrage.
J’ai l’impression que ça a toujours été votre but, dans tout ce que vous avez entrepris, de fédérer, de rassembler les personnes queers et de recoller les morceaux.
Lou : On a sans cesse eu cette volonté de faire ce qu’il nous a manqué pour apporter notre pierre à l’édifice et avancer. On essaye de ne pas oublier ce qu’on aurait aimé avoir plus jeunes. Concernant le lien social, ça nous tient à cœur de faire en sorte que les individus se rencontrent et échangent. On organise souvent des rencontres et des évènements. On a réussi à créer une constellation saphique ! Je me souviens qu’en arrivant à Paris j’étais perdue, tout me semblait trop grand et trop intimidant. Que faire ? Où aller ? Comment connaître des gens ? Est-ce que je dois être pointue en musique techno et avoir un style au top pour m’intégrer ? Bien sûr, il y a une part de projection sur ce qu’on imagine être la communauté féministe et queer parisienne, mais toujours est-il que cette appréhension existe et qu’on a essayé à notre échelle, de la désamorcer.
Léontin : C’est vrai que cette crainte est présente et encore plus en milieu rural. Venant d’un monde populaire et de la campagne profonde, j’ai souvent des potes qui me disent « la sphère parisienne queer me fait peur, c’est trop élitiste, je vais m’en faire exclure direct, je ne sais pas les termes corrects à employer et je ne connais pas les codes ». Naviguant entre ces deux milieux, je fais de mon mieux pour penser large en essayant de m’adresser aux individus LGBTQIA+ dans leurs pluralités.
Comment voyez-vous l’avenir de Sapphosutra ?
Lou : On a d’autres projets littéraires sur le feu et on va étendre encore plus les champs du projet avec d’autres formats pour continuer de visibiliser nos amours !

Kamasutra queer, Manifeste érotique saphique est à retrouver dès à présent en librairie.
Image à la une : photo de ©lizamiri
Relecture et édition : Apolline Bazin
Cet article Sapphosutra : « On a créé ce qui nous a manqué, une constellation saphique » provient de Manifesto XXI.

 Jeudi dernier, j’ai été infidèle. J’ai pourtant passé mes meilleures viewings parties de Drag Race en compagnie de Kam Hugh, l’année dernière. Mais la prochaine qu’elle allait animer, à l’étage ...
Jeudi dernier, j’ai été infidèle. J’ai pourtant passé mes meilleures viewings parties de Drag Race en compagnie de Kam Hugh, l’année dernière. Mais la prochaine qu’elle allait animer, à l’étage ... 
En dépit des victoires législatives, l'année 2022 explose tous les records des violences LGBT+phobes enregistrées depuis 12 ans, en nombre et gravité, en Europe et en Asie centrale, s'inquiète l'ONG ILGA-Europe dans son 12e rapport annuel, paru ce lundi 20 février.
L’article 2022, l’année la plus violente pour les personnes LGBTI en plus d’une décennie est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.



Que l'on soit lesbienne, gai, queer ou hétéro n'y change rien: à Berlin, l'AMÛÛÛR, c'est une licorne. Et elle ne gambade pas sur les applis de rencontre. Les innombrables conversations que j'ai pu avoir avec des Berlinois·e·x·s sur le sujet s'achèvent toujours sur le même triste constat: il n'y a rien de plus merdique que le dating à Berlin.
L’article À Berlin, l’amour est une licorne est apparu en premier sur 360°.

Au moment où des pays durcissent leur législation anti-LGBT+, Mgr Giraud, archevêque de Sens & Auxerre, revient sur les propos du Pape, engageant l’Église dans l’abrogation des réglementations discriminatoires.
L’article Mgr Giraud : « Comme toute forme de haine, l’homophobie détruit et sème le mal ! » est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

On estime que, dans l'Union européenne, 2% des personnes LGBTI ont subi de telles pratiques et 5% se sont vu proposer une conversion, mais les chiffres réels pourraient être bien plus élevés.
L’article Le Conseil de l’Europe exhorte les Etats membres à mettre fin aux « thérapies de conversion », toujours répandues est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Les députés espagnols ont définitivement adopté la loi dite « transgenre », permettant aux personnes qui le souhaitent de faire changer leur genre sur leurs papiers d'identité via une simple déclaration administrative dès l'âge de 16 ans.
L’article L’Espagne adopte une loi autorisant le libre changement de genre dès l’âge de 16 ans est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Fatima Ouassak : « La piraterie, c’est prendre la mer et se libérer des humiliations » provient de Manifesto XXI.
Fatima Ouassak repart à l’abordage avec un nouvel essai intitulé Pour une écologie pirate. Et nous serons libres, aux éditions La Découverte. Un texte saisissant, qui se lit d’un souffle, et nous transporte à la rencontre des idées révolutionnaires de l’auteure, en passant par le conte d’un dragon capitaliste et les discussions entre un père et sa fille. Rencontre avec une voix essentielle de la pensée politique contemporaine.Pour une écologie pirate est le deuxième tome d’une trilogie commencée avec La Puissance des mères (éd. La Découverte). Fatima Ouassak y propose de nouveaux outils pour organiser la libération des habitant·es des quartiers populaires face à un système colonial-capitaliste. Au fil des pages, elle décrit le réel de la sous-humanisation des quartiers populaires et la soif de liberté qui anime ses habitant·es. Une soif qui donne envie d’abattre les murs, de brûler les obstacles, de prendre la mer et de se libérer. Fatima Ouassak, à la fois politologue, militante, femme, mère, dessine dans cet ouvrage les contours d’un projet écologiste puissant qui peut enfin s’adresser à la jeunesse et aux quartiers populaires. Nous l’avons rencontrée à Verdragon, la première maison d’écologie populaire qu’elle a co-fondée, à Bagnolet.
Manifesto XXI – Dans Pour une écologie pirate, vous articulez un projet écologiste qui intégrerait réellement les habitant·es des quartiers populaires. Pour vous, quel est le pouvoir de l’écologie ?
Fatima Ouassak : L’écologie est pour moi un outil de libération. J’essaie d’expliquer dans ce livre que l’on peut aspirer à la liberté, quand bien même on serait pauvre, de quartiers populaires, non-blanc·he. J’ai écrit cet essai en partie en réaction à ce qu’il s’est passé pendant la crise sanitaire, lors de laquelle la question des libertés ne s’est posée dans le débat public que pour les classes moyennes supérieures. Dans les quartiers populaires, en revanche, on a évoqué uniquement des questions de survie et d’alimentation alors qu’on peut aussi mourir d’un manque de liberté.
Cette absence de questionnement quant à notre liberté est, selon moi, une manière de nous sous-humaniser et de nous ramener à notre utilité, celle de n’être qu’une force de travail notamment, comme je le développe dans l’ouvrage.
Si le symbole de la piraterie est autant aimé dans les quartiers populaires, c’est parce qu’il traduit notre aspiration à la liberté.
Fatima Ouassak
Vous qualifiez ce projet écologiste de « pirate », en faisant notamment référence directement aux personnages du manga One Piece. Pourquoi invoquer cet imaginaire de la piraterie ?
Cela part d’une sensibilité personnelle. J’ai une passion pour l’univers des dragons et des mangas dans lesquels je vois quelque chose de l’ordre de la piraterie. Ensuite, l’hypothèse que je fais est que si le symbole de la piraterie est autant aimé dans les quartiers populaires, c’est parce qu’il traduit notre aspiration à la liberté. Le côté pirate représente donc cette envie de tout casser ! Cette soif de liberté qui se traduit par du feu quand on n’en peut plus. La piraterie, c’est aussi la remise en question de l’État-nation, de l’ordre établi et du système colonial-capitaliste comme je le nomme. La piraterie, c’est prendre la mer et se libérer des humiliations que l’on vit.
On ne peut pas comprendre ce feu qui pousse à vouloir brûler des voitures si on ne comprend pas le contrôle permanent que l’on vit. En tant qu’habitante des quartiers populaires mais aussi militante antiraciste et musulmane, je me sens sous contrôle. Ce sentiment de contrôle, nous le ressentons de manière générale lorsqu’on vit dans un quartier populaire. Nous ne sommes pas libres. Nous vivons dans des espaces bétonnés, exigus, remplis de murs construits entre nous et les quartiers pavillonnaires.
Ce projet d’écologie pirate est une réponse aux projets écologistes majoritaires portés par les partis de gauche et écologistes. Pourquoi les habitant·es des quartiers populaires, que vous appelez les « sans-terres », ne participent pas à ce modèle écologiste majoritaire ?
Tout d’abord, parce que c’est un projet qui n’a pas été pensé du point de vue des quartiers populaires et pour les quartiers populaires. L’écologie est un outil de libération, comme je le disais, et donc de pouvoir. Se réclamer de l’écologie aujourd’hui permet d’avoir le pouvoir de changer les choses et de décider de sujets très concrets comme l’aménagement urbain, la mobilité, l’alimentation, etc.
L’écologie est également une distinction qui permet de montrer que l’on mange sainement ou que l’on est responsable vis-à-vis de l’environnement.
Ce pouvoir, on en a dépossédé les populations des quartiers populaires, comme s’il y avait un accaparement de l’écologie par une classe dominante. Cet accaparement entrave l’accès aux enjeux écologiques par les classes populaires de manière générale. C’est un comble quand on sait que ce sont ces classes populaires précisément qui polluent le moins et qui subissent le plus les conséquences du désastre écologique.
En effet, vous décrivez dans le livre que l’absence de pouvoir de négociation des habitant·es des quartiers populaires permet d’éviter la remise en question de certains sujets comme la gentrification ?
Oui, en effet. Avoir du pouvoir politique et une voix qui compte dans le débat public donne la possibilité de décider de son sort. Cela se traduirait par exemple par une opposition et une remise en question de la gentrification, qui est un drame social et humain pour les habitant·es des quartiers populaires.
La gentrification, c’est l’opportunité pour les classes moyennes supérieures de s’approprier la terre des populations descendantes de l’immigration post-coloniale installées là. Ce « là », ce sont les quartiers populaires. Ce processus de gentrification participe au désancrage des quartiers populaires qui consiste à dire aux personnes qui y vivent : « vous n’êtes pas ici chez vous, cette terre n’est pas la vôtre ».
La terre est quelque chose de puissant et de nécessaire. Être « sans-terre », c’est être un « sans-pouvoir », donc il vous manquera toujours quelque chose.
Fatima Ouassak
Pourquoi utiliser le mot « terre » dans cette réflexion ?
Je l’utilise pour exprimer que les habitant·es des quartiers populaires ne se sentent pas autorisé·es à vivre là où iels vivent. Leur espace est quadrillé, contrôlé par la police en permanence et modifié sans consentement par le processus de gentrification.
Votre livre propose ainsi une réflexion et des outils pour ancrer les habitant·es des quartiers populaires afin qu’iels ne demeurent pas des « sans-terres », pouvez-vous nous donner un exemple ?
Cela commence par dire à nos enfants « vous êtes ici chez vous ». Par « chez vous », je fais référence justement à cette terre, où iels vivent déjà. La terre est quelque chose de puissant et de nécessaire. Être « sans-terre », c’est être un « sans-pouvoir », donc il vous manquera toujours quelque chose.
Je veux dire à tous·tes les enfants des quartiers populaires que dès lors que vous vous sentirez chez vous, vous protégerez la terre qui est la vôtre. Il ne s’agit pas de propriété privée – la terre n’appartient à personne – ni d’appartenance à la nation au sens de l’État-nation ; parce qu’en tant que militante, anticapitaliste notamment, mais aussi anticoloniale, je rejette totalement l’idée de l’État-nation. Il s’agit plutôt du sentiment d’être concerné·es et redevables. C’est pour cela que je parle dans le livre des nombreuses personnes qui ne souhaitent pas être enterrées ici. Cela veut dire beaucoup…
Vous parlez également de la liberté d’accueillir…
Je revendique en effet le droit pour chacun·e d’accueillir nos familles, nos ami·es, qui vivent dans nos pays d’origine car cette liberté de circuler, qui existe pour le moment à sens unique, a créé de l’inégalité au sein des familles. C’est un traumatisme dont on ne parle jamais. Je pense que cela a même créé un rapport de classe, voire de race, entre nous et nos familles.
Je considère que l’on ne se sentira chez nous qu’à partir du moment où l’on pourra se dire : « Si je veux inviter mon grand-père, ma tante… j’ai le droit ». Le fait que ce droit soit soumis à condition par des demandes de visas difficiles d’accès et variables participe au désancrage dont je parlais avant.
Pourquoi un projet écologiste commun et fort politiquement est-il urgent ?
Aujourd’hui, il y a un processus de gentrification en marche ainsi qu’un État de plus en plus répressif ; avec un quadrillage policier dans les quartiers populaires et des contrôles racistes (pour lesquels la France a d’ailleurs été condamnée). Ces dispositifs, qui n’ont pourtant pas été implantés par des gouvernements d’extrême-droite, nous menacent déjà dans les quartiers populaires. Ils menacent déjà notre espace vital. J’utilise cette expression à dessein, même si je sais à quoi cela renvoie historiquement. Si l’extrême-droite arrive au pouvoir – ce qui est tout à fait envisageable –, elle n’aura qu’à se servir des dispositifs déjà en place.
Ce livre est aussi un appel à se parler – entre classes populaires, classes moyennes supérieures ; entre quartiers populaires, quartiers pavillonnaires. Nous devons conscientiser tous ces processus maintenant. On ne peut pas être en bloc les un·es contre les autres et blâmer les individu·es, car les dispositifs sont complexes. Mais il faut urgemment se parler pour faire face et voir dans quelle mesure on partage les terres finalement.
En tout cas, nous, dans les quartiers populaires, ne voulons plus être réduit·es à notre coût ou à notre utilité.
Dans cet essai, vous défendez vos positions antiracistes et votre vision de l’internationalisme également. Ainsi vous militez pour la liberté de circuler sans condition comme élément central de ce projet écologiste.
Absolument, et cela devrait être l’argument de la gauche. L’argument écologiste que l’on doit opposer à la vision écologique de l’extrême-droite (renvoyer les étrangers chez eux, aider les pays qui vivent des catastrophes mais ne pas les accueillir, etc.) est, selon moi, la liberté de circuler pour toutes et tous sans conditions.
D’une part, parce que le désastre climatique a déjà lieu ; certaines catastrophes sont irréversibles. La liberté de circuler constitue une réponse politique afin d’offrir une possibilité de se mettre à l’abri. D’autre part, parce que l’inexistence de cette libre circulation représente une injustice entre l’Europe et les Suds en général. Cette liberté de circuler est un projet politique déjà défendu par les organisations anticapitalistes par exemple. J’ajoute que nous devons, avec les militant·es écologistes, féministes, antiracistes, se mettre derrière une même ligne de front.
Vous disiez « il est urgent de se parler ». Où peut-on se parler ? Verdragon, la maison d’écologie populaire que vous avez créée à Bagnolet avec le Front de mères, est-elle justement un espace pour créer cet avenir commun ?
Verdragon est un lieu pour les quartiers populaires où l’écologie est traitée de notre point de vue. C’est un lieu où j’ai la chance de pouvoir mettre en pratique les outils que je développe dans mes livres en tant que militante. Un des objectifs stratégiques est évidemment d’avoir un lieu où se parler et créer des alliances. La convergence des luttes n’est pas une mince affaire, mais il est urgent de se parler et de convaincre !
Avec cette fierté et ce sentiment d’appartenance, nos enfants grandissent en marchant droit. C’est déjà une victoire incroyable !
Fatima Ouassak
Quels sont les plus grands obstacles à la réalisation de ce projet politique ?
Honnêtement, en tant que militante dans les quartiers populaires, je n’en vois pas beaucoup. Tout simplement parce que nos demandes sont souvent la base de la base ! Avec le Front de mères, lorsqu’on se bat pour avoir des ascenseurs qui marchent ou que l’on milite pour une alternative végétarienne dans les écoles, on gagne, car ce sont des demandes basiques, essentielles. C’est éreintant d’essuyer les attaques racistes et les tentatives de décrédibilisation comme on l’a vécu lors de l’ouverture de Verdragon, mais nous gagnons lorsque nous nous mobilisons.
D’autant plus que nous nous battons pour nos enfants. Nous voulons leur redonner confiance en ell·eux car c’est un problème majeur que l’on constate dans les quartiers populaires. Nos enfants n’ont pas confiance en ell·eux depuis qu’iels sont tout petit·es. Ce sont ces victoires pour une vie digne et pour la liberté qui leur montrent qu’iels valent quelque chose et qu’iels peuvent avoir confiance en ell·eux.
Je dis cela pour dire aux personnes qui lisent et qui sont issues de l’immigration post-coloniale, qui sont de classes populaires, qui sont pauvres : « si vous transmettez la détermination ainsi que le sentiment d’appartenance à notre terre, ici, eh bien cela crée quelque chose ». Nous pouvons en témoigner avec les camarades. Avec cette fierté et ce sentiment d’appartenance, nos enfants grandissent en marchant droit. C’est déjà une victoire incroyable !
L’enfant est en effet au cœur de votre réflexion. C’est aussi pour cela que vous accompagnez l’ouvrage d’un conte ?
Oui, les enfants sont au centre parce que je considère que ce sont des sujets politiques et qu’il faut travailler à leur émancipation. J’aime raconter des histoires à mes enfants et aux enfants de Verdragon aussi. J’ai repris certains des personnages pour en faire un conte. C’était également une façon d’aérer le récit. J’aime l’idée d’être sur plusieurs registres pour exprimer une idée comme on le voit chez les écoféministes par exemple.
Les enfants comprennent très bien et très vite des sujets importants et sérieux comme les rapports de production, l’exploitation du travail, le système raciste, etc. Nous devrions avoir des débats avec ell·eux. Demandons-leur comment iels voient les choses. Les enfants de classes populaires ne voient pas le monde de la même manière que les enfants de classes supérieures. Il me semble important de comprendre la diversité de leur perception.
Il est temps pour nous, dans les quartiers populaires, de nous organiser en autonomie et d’être en rupture avec la gauche telle qu’elle existe.
Fatima Ouassak
Dans la conclusion du livre, vous dites : « L’irréversibilité du désastre climatique conjuguée à la menace fasciste oblige à faire sécession. » Comment « faire sécession » ?
Je parle effectivement de « faire sécession » face à la menace de l’extrême-droite, ce thème fera l’objet du troisième volet de la trilogie. Concrètement, cela veut dire s’organiser et se défendre. Il s’agit de montrer que l’on n’accepte pas d’être gouverné·es par des suprémacistes blancs et que l’on est déterminé·es à ce que nos enfants puissent vivre dans un espace où iels sont libres.
Si l’extrême-droite prend réellement le pouvoir, manifester ne sera pas suffisant. Nous avons le droit de refuser d’être dirigé·es par l’extrême-droite. C’est même un droit fondamental pour moi. Je ne veux pas que ceux et celles qui prennent des décisions concernant le sort de mes enfants soient des suprémacistes blancs. Je ne suis pas la seule !
L’autre aspect de « faire sécession », c’est vis-à-vis du champ politique de manière générale et de la gauche notamment. Il est temps pour nous, dans les quartiers populaires, de nous organiser en autonomie et d’être en rupture avec la gauche telle qu’elle existe.
Pour une écologie pirate. Et nous serons libres, aux éditions La Découverte. Sortie le 9 février 2023, 272 pages, 16€
Image à la Une : © Charlotte Krebs
Cet article Fatima Ouassak : « La piraterie, c’est prendre la mer et se libérer des humiliations » provient de Manifesto XXI.

Cinq personnes, dont deux mineurs, ont été déférées au parquet de Châlons-en-Champagne, soupçonnés d’avoir participé à l’agression de deux hommes homosexuels, piégés via un site de rencontres.
L’article Guet-apens homophobe à Épernay : cinq suspects en garde à vue est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

En mai 2012, le corps mutilé d’Ihsane Jarfi était retrouvé dans un champ près de Liège. L'enquête a conclu à un crime homophobe, retracé par le réalisateur Belge Nabil Ben Yadir dans son film « Animals ».
L’article « Animals » de Nabil Ben Yadir, inspiré d’un crime homophobe est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Chaque mois, Payot Libraire nous propose une sélection littéraire queer. Au programme pour ce numéro, trois coups de cœur à dévorer en février.
L’article La sélection livres queer de février est apparu en premier sur 360°.

Cet article « Ce n’est pas une exposition sur le sida » : rencontre avec Élisabeth Lebovici et François Piron provient de Manifesto XXI.
À partir du 17 février, et jusqu’au 14 mai, le Palais de Tokyo présente Exposé·es, une exposition conçue à partir de Ce que le sida m’a fait. Art et activisme à la fin du XXe siècle (2017), un ouvrage écrit par l’historienne et critique d’art Élisabeth Lebovici. Elle rassemble des œuvres très diverses qui, toutes, « opèrent depuis le champ des affects et des expériences vécues », selon les termes de François Piron, commissaire de l’exposition.Pensée comme une extrapolation depuis le livre, l’exposition est volontairement subjective et ouverte. Elle n’est ni discursive, ni linéaire, encore moins commémorative. François Piron et Élisabeth Lebovici, qui endosse le rôle de conseillère scientifique, insistent : ce n’est pas une exposition sur le sida. Le sida est ici une « grille de lecture pour reconsidérer un grand nombre de pratiques artistiques exposées à l’épidémie ». Ainsi, les objets et œuvres présentées sont d’une grande hétérogénéité, et beaucoup ont été produites pour l’occasion.
Avec comme maîtres-mots la reconsidération et la réactualisation, les œuvres historiques sont appréhendées depuis une perspective actuelle, revisitées par les artistes elleux-mêmes ou par d’autres. Aux côtés de figures aujourd’hui canonisées par le monde de l’art (Felix Gonzalez-Torres, Derek Jarman, Nan Goldin…) sont présenté·e·s des artistes qui ont évolué aux marges de ce milieu (Lionel Soukaz, yann beauvais…), d’autres plus jeunes (Benoît Piéron, Jesse Darling…), tandis que des pratiques activistes et/ou collectives (Bambanani Women’s Group, Les Ami·e·s du Patchwork des noms, Black Audio Film Collective…) sont placées sur un pied d’égalité. Volontairement équivoque, voire « hésitante », l’exposition se visite librement, à la découverte de propositions qui sont autant de manières d’appréhender l’expérience et l’héritage de l’épidémie de sida.
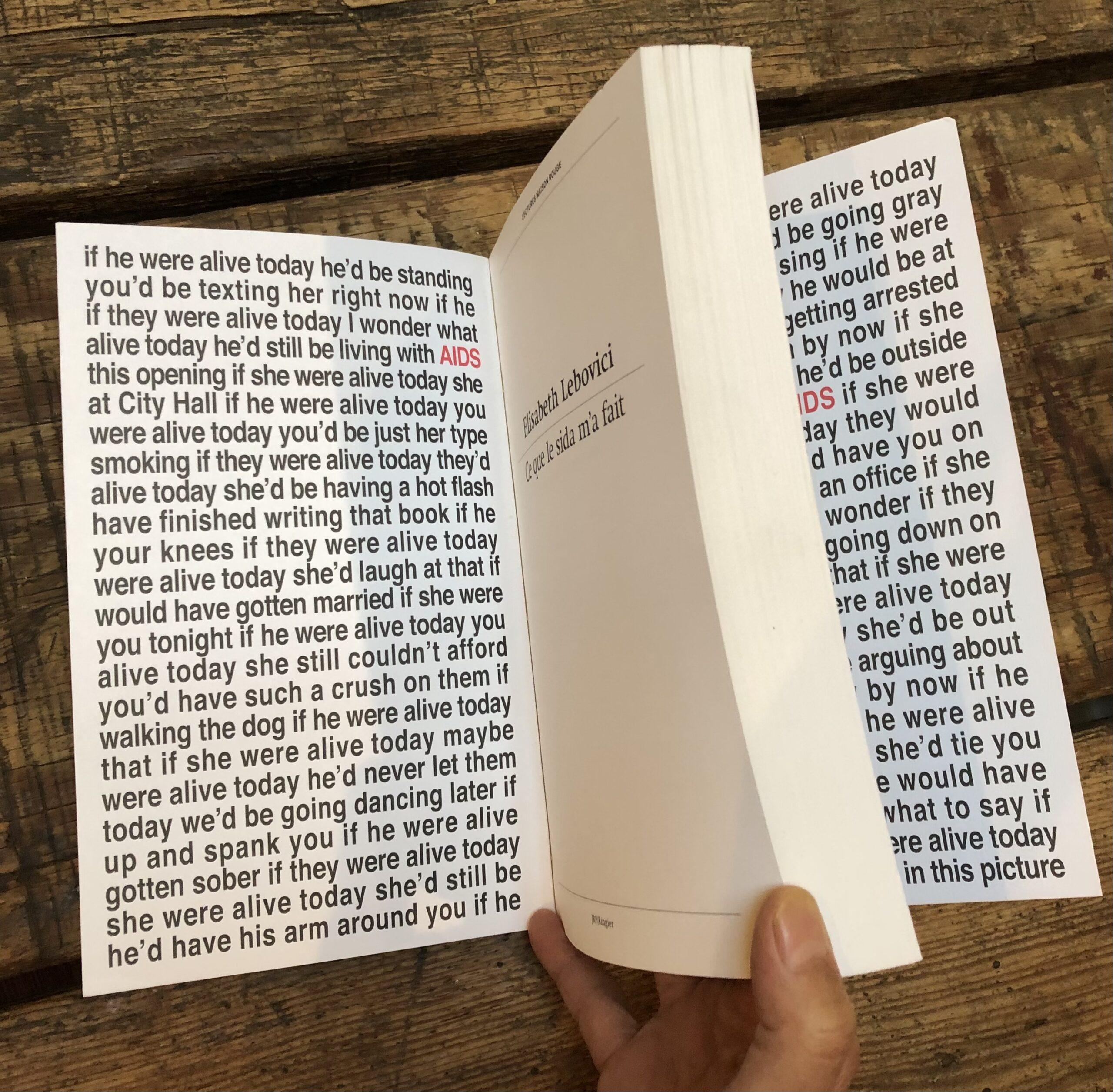 fierce pussy, For The Record, 2017, pour les rabats de couverture du livre d’Elisabeth Lebovici, Ce que le sida m’a fait–Art et activisme à la fin du XXe siècle. Photo : Nancy Brooks Brody
fierce pussy, For The Record, 2017, pour les rabats de couverture du livre d’Elisabeth Lebovici, Ce que le sida m’a fait–Art et activisme à la fin du XXe siècle. Photo : Nancy Brooks Brody
Manifesto XXI – Pouvez-vous nous parler de la genèse de ce projet et de la manière dont vous avez travaillé pour créer une exposition à partir d’un ouvrage ?
François Piron : J’ai proposé à Élisabeth une idée spéculative, qui était de savoir s’il serait intéressant de faire une exposition à partir de son livre. Elle m’a répondu un « oui » de confiance, tout en précisant d’emblée qu’elle ne voulait pas adapter son propre livre. Nous avons travaillé très quotidiennement ensemble, sur des questions de méthodologie, d’économie, des questions politiques également. Par exemple, on s’est rapidement accordé·e·s sur la volonté de ne pas faire une exposition patrimoniale. Il était plus important pour nous de faire une exposition qui extrapole à partir du livre plutôt que de lui rester complètement fidèle, si tant est que cela soit possible. Je souhaitais travailler directement avec les artistes, et consacrer une part importante de l’économie de l’exposition à la production de nouvelles pièces. Le mot-clé, qui a guidé tous nos choix, est « reconsidérer ». Ainsi, on a demandé aux artistes dont le travail s’étend depuis plusieurs décennies de refaire, reprendre, réactualiser, re-questionner des œuvres déjà réalisées, tandis que pour les plus jeunes, il s’agissait de produire des pièces qui évoquent, appellent ou invoquent d’autres artistes du passé – comme Henrik Olesen avec Paul Thek, Moyra Davey avec Hervé Guibert, Jesse Darling avec Felix Gonzalez-Torres…
Élisabeth, comment avez-vous réagi à cette demande, et comment s’est déroulé votre travail de « conseillère scientifique » ?
Élisabeth Lebovici : J’ai d’abord été émue et assez fière que François veuille traduire la résonance que ce livre avait eu pour lui par un projet d’exposition. Lorsqu’il m’a dit que ce qui l’intéressait, c’était surtout la méthode que j’avais mise en place, ça m’a beaucoup plu. Ça voulait dire qu’on partageait la volonté de ne pas reprendre littéralement les organisations visuelles que j’avais déjà mises en scène dans les chapitres de mon livre. De toute manière, cela aurait été impossible à faire. Le Palais de Tokyo n’est pas le lieu pour une exposition patrimoniale, c’est, théoriquement, un espace d’expérimentation.
 Zoe Leonard installe Untitled (1992) à la Neue Galerie, Cassel, documenta 9, 1992. Photo : Dieter Schwerdtle Courtesy documenta-Archiv
Zoe Leonard installe Untitled (1992) à la Neue Galerie, Cassel, documenta 9, 1992. Photo : Dieter Schwerdtle Courtesy documenta-Archiv
Mon travail a donc été de me défaire de mon livre, pour me placer dans l’ici et maintenant, et avec François. Pourtant, plus le travail avance, plus je me rends compte qu’il y a tout de même beaucoup de liens avec le livre. On retrouve des artistes dont je parle, mais abordé·e·s d’une autre manière, et avec des pièces différentes de celles produites à l’époque. Je pense précisément au cas de Lionel Soukaz et Stéphane Gérard, qui reviennent au Journal Annales, dont je parle dans mon livre et qui était aussi présent dans l’exposition du Mucem, dans un montage produit pour l’occasion. Pour Exposé·es, ils ont réalisé une nouvelle version encore, avec un autre type de production et un angle différent. On voit comment les artistes se remettent à l’ouvrage en situant leur discours et leurs savoirs à un autre endroit. Comme l’a dit François, l’idée de reconsidérer, de revoir, d’aller ailleurs, est fondamentale dans l’exposition. Des artistes plus jeunes, quant à elleux, retracent ce que telle ou telle production artistique leur a fait et essayent de l’actualiser en se saisissant de cet héritage.
FP : Iels se situent dans des lignées, dans des affinités électives. C’est une manière de construire l’histoire.
On retrouve dans toute l’exposition une « amitié » entre art et activisme à différents degrés.
Élisabeth Lebovici
EL : Oui, et ça donne par ailleurs une toute autre idée de l’activité artistique, lorsqu’on voit qu’un certain nombre d’artistes ont ouvert leur travail à la possibilité pour d’autres personnes de s’en saisir, s’y inscrire, s’y reconnaître et construire une forme de communauté. Je pense ici au portrait de Julie Ault par Felix Gonzalez-Torres, qui en offre un vibrant exemple. Chez Felix Gonzalez-Torres, un portrait, c’est un alignement, non chronologique, de mots et de dates déterminantes pour la personne ainsi représentée ; un portrait toujours inachevé, puisqu’à chaque présentation, cette représentation peut se transformer, changer le cours de ces événements remarquables de la vie, de l’histoire, du monde dans lesquels vit cette personne. Pour Exposé·es, on a demandé à Isabelle Sentis, une figure de l’activisme anti-sida, performeuse et art-thérapeute d’actualiser le portrait de Julie Ault. Elle a réuni un groupe de personnes vivant avec le VIH/sida qui, ensemble et chacun·e, ont ajouté leurs mots et leurs dates. C’est une grande joie pour moi de voir ces mots français au sein des éléments en anglais du portrait de Julie Ault, en amitié avec Felix Gonzalez-Torres.
 Derek Jarman, BLOOD COUNT, 1990, huile et techniques mixtes sur toile, 25,4 x 35,88 x 5.08 cm. Courtesy Amanda Wilkinson, London and Keith Collins Will Trust
Derek Jarman, BLOOD COUNT, 1990, huile et techniques mixtes sur toile, 25,4 x 35,88 x 5.08 cm. Courtesy Amanda Wilkinson, London and Keith Collins Will Trust
Comment passer d’une histoire à la première personne, à une exposition, endossée par une institution ? L’idée était d’essayer d’articuler un espace sensible, d’affects et d’émotions, et un espace collectif, partageable.
François Piron
C’est aussi une approche qui permet de présenter des grandes figures, très connu·e·s, tout en restant ancré·e·s dans le présent.
FP : Certain·e·s artistes, aujourd’hui canonisé·e·s par le monde de l’art contemporain, étaient très important·e·s pour nous. Ce qui était intéressant à propos de Felix Gonzalez-Torres était de relire ses protocoles, qui autorisent à qui en prend la responsabilité de modifier les paramètres de son œuvre. C’est précisément ce qu’il désirait, parce que les occurrences doivent changer, car elles sont aussi la contingence du temps, de l’espace, de la situation géographique – et donc sociétales, politiques, etc. C’est aussi ce qui légitime la présentation de son œuvre. En procédant ainsi, nous avons voulu rester aussi proches que possible de l’esprit de l’artiste.
C’est le même rapport qu’avec le livre d’Élisabeth : essayer d’être proches de l’esprit mais pas nécessairement de la lettre. Le challenge était peut-être là, à savoir : comment passer d’un pronom personnel, d’une histoire qui s’énonce à la première personne, à une exposition, endossée par une institution ? Il n’y a plus de « je » qui puisse vraiment s’exprimer, mais l’idée était d’essayer d’articuler un espace sensible, d’affects et d’émotions, et un espace collectif, partageable.
Ce n’est pas une exposition qui retrace une histoire, mais une exposition qui, sans guidage excessif, rassemble de manière affinitaire des pratiques artistiques, en respectant avant tout la polysémie des œuvres et leur ambiguïté. Elle rassemble une grande diversité de choses – différentes zones géographiques, cultures, époques et univers. Le sous-titre du livre d’Élisabeth, « art et activisme », ouvre un paradigme à l’intérieur duquel j’ai cherché à déplier toutes les nuances. Dans l’exposition, il y a des personnes qui s’expriment en activistes avant tout, et d’autres qui n’ont pas été inclus·es dans des luttes.
 Bambanani Women’s Group, Body Map (Nondumiso), 2002, technique mixte sur papier, 110 x 200 cm. Courtesy AIDS and Society Research Unit (University of Cape Town) et Bambanani Women’s Group
Bambanani Women’s Group, Body Map (Nondumiso), 2002, technique mixte sur papier, 110 x 200 cm. Courtesy AIDS and Society Research Unit (University of Cape Town) et Bambanani Women’s Group
 Pascal Lièvre, Six portraits à la bougie (des archives pour le futur), 1996 (détail), peinture, collage de coupures de journaux, emballages de médicaments, pages de livre et cire, 120 x 160 cm. Photo : Pascal Lièvre. © ADAGP, Paris, 2023
Pascal Lièvre, Six portraits à la bougie (des archives pour le futur), 1996 (détail), peinture, collage de coupures de journaux, emballages de médicaments, pages de livre et cire, 120 x 160 cm. Photo : Pascal Lièvre. © ADAGP, Paris, 2023
EL : Un bon exemple de cela est la version du travail du collectif fierce pussy que nous présentons : un projet d’exposition porté par le commissaire Jo-ey Tang, dont plusieurs chapitres ont déjà été élaborés aux États-Unis et qui arrive et s’arrête ici. Les quatre personnes lesbiennes qui composent aujourd’hui ce collectif formé en 1991 font cohabiter dans ce projet leur pratique activiste commune et leurs pratiques artistiques singulières. Cette « amitié » entre art et activisme est ici explicite, mais on la retrouve dans toute l’exposition à différents degrés.
Dans le titre de l’exposition, il y a l’inclusif, mais aussi le pluriel.
François Piron
FP : Oui, l’amitié est une autre question fondamentale de l’exposition. Plutôt que de montrer des figures individuelles, nous montrons des réseaux, des affinités, des amitiés. C’est fascinant, ce sont des relations, à la fois affectives et politiques, de désidentification d’une certaine manière. Par exemple, on approche David Wojnarowicz à travers son amitié avec Marion Scemama, et on va retrouver dans l’exposition presque toutes les modalités possibles de leur collaboration : Marion qui photographie ou filme David, David qui dédie des œuvres à Marion, des choses qu’iels signent ensemble… Cela permet aussi de mettre au jour une certaine manière de construire l’histoire de l’art : ce sont des réseaux, et non des personnes isolées, qui s’érigent et se canonisent. Dans le titre de l’exposition, il y a l’inclusif, mais aussi le pluriel.
EL : À l’époque, il y avait à la fois une très forte revendication du « je », nécessaire pour se situer comme personne vivant avec le VIH et comme sujet politique, et la nécessité d’un travail collectif dans le processus de production. Je pense à Philippe Thomas par exemple, qui s’est dépossédé de son propre nom en tant qu’auteur pour faire que d’autres « fassent » aussi le travail ; et, en endossant cette fonction d’auteur, pour que ces personnes, personnellement et collectivement, lui permettent de continuer à agir dans le monde des vivant·e·s. Avec ces artistes, la pensée n’est jamais univoque, il y a toujours une tension, une contradiction. J’espère que cette dynamique sera visible.
C’est une exposition vibrante, parce qu’elle est pleine de doutes, elle part un peu dans tous les sens.
Élisabeth Lebovici
Cette exposition rassemble une grande diversité de pratiques, de formes et de contextes. Vous avez souhaité la garder ouverte et ne pas porter de discours. Comment cela s’est passé ?
FP : Les contours de l’exposition sont ambigus, parce qu’il ne s’agissait pas d’ordonnancer, de catégoriser et d’avoir un discours institutionnel couvrant. Pour manifester que nous sommes dans le présent, et toujours dans le présent de l’épidémie, il fallait accepter une part de désordre et de débordement. Nous sommes également dans un paysage culturel et institutionnel qui se gentrifie et qui gentrifie les esprits, pour paraphraser Sarah Schulman. Pour s’en départir, nous avons choisi de faire valoir les sentiments plutôt que les discours, de montrer comment des artistes ont travaillé par nécessité, urgence, avec le manque, la colère, parfois l’humour aussi… La gageure est de faire une exposition à la fois intime et publique, dans un espace comme le Palais de Tokyo qui n’a rien d’intime.
 Georges Tony Stoll, Gramercy Park Hotel, 1999, photographies argentiques, tirages RA-4 couleur satiné prestige, 120 x 80 cm (chacune). Courtesy Galerie Poggi (Paris) © Georges Tony Stoll
Georges Tony Stoll, Gramercy Park Hotel, 1999, photographies argentiques, tirages RA-4 couleur satiné prestige, 120 x 80 cm (chacune). Courtesy Galerie Poggi (Paris) © Georges Tony Stoll
EL : Nous sommes des personnes de doute, on ne va pas asséner un savoir qu’on n’a pas. On a essayé de ne pas avoir de position surplombante, et c’est très difficile ! Il y a quelque chose de ma personne qui est très bien reflété dans l’exposition, c’est l’hésitation permanente. C’est une exposition vibrante, parce qu’elle est pleine de doutes, elle part un peu dans tous les sens.
FP : Le noyau de l’exposition est le livre, comme un prétexte ou un pivot, qui dégage un prisme de questions. On n’a pas choisi un angle d’attaque, mais, au contraire, de continuer à tourner autour de ce pivot et d’en refléter le maximum d’aspects. Donc, effectivement, c’est assez foisonnant, désordonné, et certainement assez hésitant. Notre méthode a été de garder l’hésitation aussi longtemps que possible, et être au maximum synchrones avec les artistes qui produisent pour cette exposition. Travailler avec de l’inconnu m’a semblé indispensable.
 Lili Reynaud-Dewar, My Epidemic (Teaching Bjarne Melgaard’s Class), 2015, 31 rideaux, peinture, dimensions variables. Vue d’installation, Audain Gallery (Vancouver), 2015 Coll. Centre national des arts plastiques, Inv. FNAC 2021-0531 Photos : Blaine Campbell © ADAGP, Paris, 2023
Lili Reynaud-Dewar, My Epidemic (Teaching Bjarne Melgaard’s Class), 2015, 31 rideaux, peinture, dimensions variables. Vue d’installation, Audain Gallery (Vancouver), 2015 Coll. Centre national des arts plastiques, Inv. FNAC 2021-0531 Photos : Blaine Campbell © ADAGP, Paris, 2023
Quelle est votre ambition avec cette exposition, quels publics souhaitez-vous toucher ?
FP : Je fais les choses tant que j’ai l’espoir qu’elles peuvent constituer un encouragement pour d’autres personnes. La transmission est centrale, et je crois que l’exposition s’inscrit dans un moment où une jeune génération d’artistes a une croyance renouvelée dans les effets de l’art. On n’est plus dans le postmodernisme ironique. L’art est situé, il se fait par nécessité, et peut produire des choses – de l’information, une prise de conscience, peut-être une catharsis émotionnelle, et, éventuellement, avoir une vertu thérapeutique…
EL : Beaucoup d’étudiant·e·s ou de jeunes artistes sont concerné·e·s par l’activisme, j’entends des conversations dans lesquelles je me retrouve complètement. C’est incroyable de voir à quel point, depuis quelques années, iels sont présent·e·s pendant les manifestations : ART EN GRÈVE, ART EN GOUINE, #NousToutes, #inverti·e·s, ces performances qu’on voit dans les cortèges… Cette vibration, j’espère que l’exposition se meut avec elle, de façon synchrone, ou est en conversation avec ce qui se passe.
L’horizon de cette exposition est plutôt celui des affects, de « ce que le sida m’a fait », c’est-à-dire, de ce qu’il a fait faire à certain·e·s artistes qui s’y sont exposé·e·s.
Élisabeth Lebovici
Aujourd’hui, les personnes migrantes, les personnes trans, les travailleur·se·s du sexe sont parmi les communautés les plus touchées par l’épidémie. Elles ne sont quasiment pas représentées dans l’exposition et la publication. Est-ce un impensé ? Comment expliquez-vous cela ?
EL : Encore une fois, François a choisi de partir de mon livre, qui n’est pas un état des lieux, ni un historique de l’épidémie du VIH/sida. Ce n’est pas son terrain d’enquête. L’horizon de cette exposition est plutôt celui des affects, de « ce que le sida m’a fait », c’est-à-dire, de ce qu’il a fait faire à certain·e·s artistes qui s’y sont exposé·e·s. Je suis très sensible à la belle expression, forgée par Raymond Williams (l’un des précurseurs des études culturelles) de « structure de sentiment ». Elle est très utilisée par toutes formes de dissidence sexuelle, pour déplacer les enjeux de l’identité et de la représentativité des corps au-delà ou en dehors des assignations de l’hétéronormativité reproductive.
FP : Une exposition s’inscrit dans un continuum, d’un point de vue institutionnel. Elle va être suivie par un autre projet, porté par d’autres curateur·rice·s, où la question de la présence d’autres corps et d’autres militances va être centrale. J’étais sûrement moins apte que d’autres à poser certaines questions, je ne prétends pas tout rassembler, et je dois aussi affirmer la partialité et la restriction d’un certain champ d’action.
 Henrik Olesen, Milk 4, 2020, résine époxy, 23 x 7 x 7 cm. Courtesy de l’artiste et Galerie Buchholz (Berlin, Cologne, New York)
Henrik Olesen, Milk 4, 2020, résine époxy, 23 x 7 x 7 cm. Courtesy de l’artiste et Galerie Buchholz (Berlin, Cologne, New York)
EL : Par ailleurs, certain·e·s artistes de l’exposition ont intégré ce social qui se modifie constamment. Je pense à fierce pussy, qui dans leur grand « registre » des faits et des gestes quotidiens que feraient les personnes qui « vivraient encore avec le sida », se demandent aussi bien « quel pronom iels choisiraient » par exemple.
FP : Cette idée de reprise implique aussi de traiter d’une certaine temporalité, ce qui explique également qu’il n’y ait pas non plus d’artistes très jeunes dans l’exposition. On n’a pas tout couvert et nous ne prétendons pas être exhaustif·ve·s ni représenter toutes les communautés, toutes les générations, tous les continents…
Avec la publication, on a l’impression d’un énorme fanzine, sans rubriques ni sommaire, fougueux et échevelé.
Élisabeth Lebovici
J’aimerais parler de la publication qui accompagne l’exposition, dans laquelle de nombreuses voix, qui participent ou non à l’exposition, sont rassemblées, sous une grande pluralité de formes textuelles. L’avez-vous pensée comme un prolongement du projet ?
FP : La publication est un accompagnement de l’exposition. Le livre est par essence l’endroit du discours, donc on y dit beaucoup de choses qui sont laissées plus ouvertes, ou simplement suggérées dans l’exposition. Nous avons travaillé avec la graphiste Roxanne Maillet, qui ne vient pas du tout du monde de la publication institutionnelle mais plutôt de l’activisme, et est connue pour fabriquer des objets communautaires et joyeux – des fanzines, des t-shirts… Elle a mis un joyeux désordre dans l’esthétique du livre, qui a été une grande libération.
EL : … Et elle a joué avec des pratiques typographiques inclusives et non binaires, qui ont envahi la forme traditionnelle du « catalogue d’exposition ».
FP : Cette publication n’est pas académique. Tout est mis à plat – les récits à la première personne et les paroles plus théoriques –, et tout le monde est au même niveau – artistes, théoricien·ne·s, activistes… C’est un long fil continu d’affinités, et on a travaillé de manière empirique et progressive.
EL : L’hétérogénéité des discours, qui entraîne une lecture où on « saute » d’un ton ou d’un mode de narration à un autre, m’a évidemment fait penser a contrario au lissage pratiqué dans certains magazines, habitués à n’émettre qu’un seul son continu. Là, on a l’impression d’un énorme fanzine, sans rubriques ni sommaire, fougueux et échevelé.
Exposé·es, du 17 février au 14 mai 2023, Palais de Tokyo, Paris. Commissaire : François Piron, conseillère scientifique : Élisabeth Lebovici, assistant curatorial : Clément Raveu, assistante d’exposition : Rose Vidal.
L’exposition se prolonge du 9 mars au 13 mai 2023 au CN D, Pantin, et avec une publication associée, une coédition Palais de Tokyo et Fonds Mercator.
Image à la une : Régis Samba-Kounzi, Sans titre # Jacqueline, travailleuse du sexe, vit et travaille à Bonadibong, le plus vieux quartier de prostitution de la ville, Douala, Cameroun, 2017, photographie couleur © Régis Samba-Kounzi
Relecture : Benjamin Delaveau et Soizic Pineau
Cet article « Ce n’est pas une exposition sur le sida » : rencontre avec Élisabeth Lebovici et François Piron provient de Manifesto XXI.

Bien connue pour ses positions TERF, Dora Moutot, blogueuse et influenceuse française, multiplie depuis des mois ses attaques contre les personnes transgenres sur les réseaux sociaux. STOP Homophobie et Mousse déposent plainte ce mercredi 15 février pour injures et appel à la haine transphobes, aux côtés de la maire de Tilloy-lez-Marchiennes, Marie Cau, et du journaliste Hanneli Escurier.
L’article Plainte contre la blogueuse Dora Moutot pour propos transphobes est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Nous avons reçu du Collectif archives LGBTQI une demande de droit de réponse au titre de l'article 6-IV de la Loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. En voici le texte.

Cet article L’écoféminisme peut-il sauver l’industrie musicale ? provient de Manifesto XXI.
La nouvelle étude du Centre national de la musique sur la présence des femmes dans la filière affiche des chiffres affligeants. Pour comprendre réfléchir à des solutions, les Assises de l’égalité femmes-hommes dans la musique ont réuni jeudi dernier à Marseille tout un panel de professionnel·les autour de tables rondes et d’ateliers. Retour sur la discussion « Égalité, écologie et musique : aller vers un modèle plus vertueux ».La première chose que les questions écologiques et féministes ont en commun, c’est le constat qu’il y a urgence, et la sensation que les choses n’avancent pas assez vite » commence Margaux Demeersseman, responsable du pôle Veille, innovation et prospectives au CNM et modératrice de la table ronde. Il est 14h45 ce jeudi 9 février au conservatoire Pierre Barbizet à Marseille : Flèche Love, compositrice et interprète, Véronique Fermé, responsable développement, animations et formations au Collectif des festivals éco-responsables et solidaires en région Sud (COFEES), et Gwendolenn Sharp, fondatrice et coordinatrice de The Green Room, se lancent dans un état des lieux de la filière autour de la notion d’écoféminisme, un courant de pensée qui trouve au patriarcat et à l’exploitation de la nature par l’humain, des similitudes et des fondements communs, notamment théorisé dans les œuvres de la militante et autrice Starhawk.
Charge mentale et transfert d’impact
Premier constat évident pour les trois invitées : dans la filière musicale, les enjeux écologiques sont majoritairement abordés et gérés par les femmes. « Cette mission-là ne fait régulièrement pas partie de leur fiche de poste et ne donne pas lieu à une valorisation financière. Cela ajoute à la charge mentale que portent les femmes » soulève Gwendolenn Sharp, qui travaille avec de nombreux festivals depuis plusieurs années. « La majorité d’entre elles ont déjà des réflexes éco-responsables, ne prennent plus l’avion, font pas mal d’actions concrètes… Mais elles n’en parlent pas, elles ont plus de mal à s’exprimer sur le sujet que les hommes. C’est déjà suffisamment dur d’être une femme dans ce milieu, alors elles disent ne pas vouloir tendre le bâton pour se faire battre. »
Voir cette publication sur Instagram
On n’a plus le temps. Sinon, on va toustes disparaître.
Véronique Fermé
Il semble y avoir ici un enjeu de communication frappant : ceux qui en font le moins sont ceux qui en parlent le plus. Les questions écologiques et les femmes paraissent donc liées dans l’invisibilisation : à la fois non valorisées socialement et économiquement, minimisées face à l’urgence de la situation et manquant de temps pour mener à bien les réflexions nécessaires à l’adaptation de l’industrie. Pourtant, la lutte contre le réchauffement climatique est intrinsèquement liée au combat contre les violences sexistes et sexuelles. Une étude intitulée « Événements extrêmes et violence fondée sur le genre : une revue systématique à méthodes mixtes », menée par l’université de Cambridge en 2022 et publiée dans la revue scientifique et médicale de référence The Lancet, démontre ainsi des liens systémiques entre catastrophes naturelles et hausse des violences sexistes et sexuelles. Une urgence encore largement inaudible pour l’industrie musicale.
Et finalement, cet engagement déséquilibré participe à creuser encore les inégalités entre les femmes et les hommes. On parle alors de transferts d’impact. « Il faut veiller à ce que les mesures environnementales prises, à différentes échelles, n’impactent pas de manière plus grande des franges de population qui rencontrent déjà des problématiques d’accès à cette culture », prévient Gwendolenn Sharp. Car certaines convictions peuvent se heurter à des questions pratiques, tout aussi vitales. « Je peux tenter de ne plus prendre l’avion du tout, mais si je veux aller jouer au Canada, je fais comment ? Si je ne prends plus l’avion, je ne travaille plus ! » regrette Flèche Love, avant d’ajouter que souvent, les alternatives éco-responsables sont aussi excessivement chères. S’engager écologiquement peut revenir à une grosse perte d’argent, voire à l’exclusion d’une scène où les femmes artistes sont déjà sous-représentées.
Changer les comportements collectifs
Alors pour qu’une mesure ne se transforme pas en tas d’embûches pour les catégories sociales qui subissent déjà le plus, elle doit être pensée largement, imbriquée dans un tout. « Il existe des actions concrètes et utiles, mais est-ce que cela suffit face à l’urgence ? » s’interroge Véronique Fermé. Installer des poubelles sur les lieux de festivals, communiquer sur le tri, faire venir les artistes en train, proposer des caterings végétariens… c’est bien, mais pas suffisant. « Pour l’écologie comme pour le féminisme, il ne suffit pas d’appliquer une liste de bons comportements. Il faut repenser toutes nos manières de faire, en profondeur. » Pour Flèche Love, il faut commencer par replacer la musique au centre des réflexions, et s’éloigner d’une industrie qui engendre de la sur-consommation. Plutôt que de suivre un modèle ultra-polluant générant des singles à tour de bras, elle s’entoure d’une équipe « d’artisanes » de la musique. Prendre le temps de créer, replacer la musique au centre des réflexions, au centre du projet, c’est déjà réduire son empreinte écologique.
Mais comment agir à plus grande échelle ? Gwendolenn Sharp et Flèche Love soulignent la nécessité de l’intersectionnalité des luttes. L’écoféminisme apparaît comme une base de travail indispensable pour repenser nos usages. Mais pour générer de telles remises en question et un changement global des mentalités, il faut du temps. De parole et de réflexion. Aujourd’hui, les questions écologiques sont encore souvent abordées à demi-mot, souvent par intérêt, pour obtenir une subvention ou par peur d’une punition fiscale. En plus de décharger les femmes de cette charge mentale, les temps de discussions permettent d’entamer un changement des comportements collectifs et donc plus efficace. Il faut nommer les responsabilités et remettre de l’ordre dans les listes de priorités. « On n’a plus le temps. Sinon, on va toustes disparaître », assène Véronique Fermé.
Soucieuses de terminer cette conversation sur un ton plus positif, c’est avec un joyeux espoir que ces trois professionnelles finissent par saluer les changements de comportements qui s’observent chez la plus jeune génération. « Iels laissent passer beaucoup moins de choses, que ce soit sur des questions de féminisme ou d’écologie. Mon rôle, maintenant, va être de leur faciliter la tâche et ensuite, peut-être laisser la place, leur donner cet espace pour parler de tout ça, dont iels parlent mieux que nous, qui sommes résignées » conclut Gwendolenn Sharp, avant que Flèche Love ne nous rappelle que « c’est bien de montrer du doigt ce qui ne va pas, mais il faut parfois se donner une petite tape sur l’épaule et se dire : regarde, on a déjà accompli tout ça ! »
Relecture et édition : Sarah Diep
Image mise en avant : © Chloé Ferrand
Cet article L’écoféminisme peut-il sauver l’industrie musicale ? provient de Manifesto XXI.



Cet article Lesbien·nes au coin du feu, Ep 1: Mon pays sera toi provient de Manifesto XXI.
Bienvenue dans Lesbien·nes au coin du feu. Ici, on tend le micro à des femmes et personnes lesbiennes, bies ou pans, seules ou à plusieurs, pour qu’elles nous racontent un souvenir heureux de leur vie amoureuse. Histoires d’amour en cours ou passées, rencontres d’une nuit ou amourettes de vacances… Nous voulons diffuser des histoires lesbiennes pour donner le sourire, émouvoir et faire rêver.Voici la retranscription écrite de notre premier épisode, dans lequel Alex et Lu ont accepté de nous raconter leur histoire.
Alex et Lu se rencontrent à l’université en Argentine. Alex tente directement d’aborder Lu, qui, barrière de la langue et lesbianisme obligent, ne comprend pas ses signaux. Un an plus tard, Alex se décide finalement à lui proposer une bière. Mais Lu est déjà rentrée en France.

Écouter sur Apple Podcast, Spotify et Deezer
Lu : On est en Août 2017, je viens juste d’arriver à La Plata en Argentine pour un échange universitaire. C’est la première fois que je pars vivre dans un pays hispanophone, je parle quasiment pas espagnol et j’arrive une semaine avant le début de mes cours à la fac. Donc j’arrive à la fac en connaissant personne, et je croise par hasard deux meufs qui me proposent d’aller, à la fin de la semaine, à une réunion pour préparer un voyage pour des rencontres féministes qui ont lieu un peu plus tard en novembre.
Comme j’ai pas grand chose à faire et que je connais personne je me dis que c’est l’occasion, et j’y vais en imaginant que c’est une grosse réunion avec plein de gens, et que je vais juste pouvoir y aller pour écouter ce qu’il se passe. Sauf que le vendredi, j’arrive à la réunion, et je me rends compte qu’on est six ou sept et qu’il va falloir quand même que je participe un petit peu. Je suis assez stressée, je comprends rien, du coup je décide de juste plus au moins répéter ce que dit la personne à côté de moi quand on me demande mon avis, et j’essaye de partir assez vite pour pas être trop mal à l’aise.
Alex : Du coup, Moi j’arrive dans cette réunion avec une de mes meilleures copines. On avait trop envie d’y aller car c’est une rencontre plurinationale de lesbiennes, trans, pédé et de personnes non binaires. C’est une rencontre féministe de ouf en Argentine. On arrive dans une salle où il y avait effectivement pas trop de monde, et la première personne que je repère c’est une blonde très belle. Donc j’arrive, je m’assois à côté d’elle, et à un moment donné on commence à faire une présentation. Ils posaient une question très gênante mais rigolote, il fallait dire quelle était notre partie érogène la moins courante. J’ai pensé au fait que quand je fume de la weed, j’aime beaucoup toucher les mains. Du coup j’ai dit les mains, et la blonde à côté de moi a dit « les mains » aussi, donc j’étais comme : « Ok trop bien, je la kiffe. »
Après cette réunion, on commence à se croiser dans la fac, et moi j’essaye de voir comment établir un contact. À ce moment, c’est le début du semestre et je commence un cours de théories féministes. Et là je vois que cette meuf est dans le cours, du coup je lui souriais, nana… Et un jour, à la fin du cours, elle est entrain de sortir de la salle, j’arrive vers elle et je lui dis « Bon, salut, ça va, ça se passe bien, tu t’appelles comment ? » Et j’avais deux copines juste derrière moi, et une d’elles qui demande à l’autre « c’est qui cette meuf ? » et elle répond assez fort « c’est la meuf qu’Alex elle kiffe. » Moi j’étais trop gênée, Lucie elle a fait comme « haha », et elle est partie tout de suite, j’ai eu trop la honte.
Lu : Moi après la réunion, je fais un petit peu ma vie à la fac, je commence à prendre mes marques, à comprendre un peu mieux la langue et à connaître les gens. Je prends un cours de théories féministes où il y a beaucoup de monde, et dans ce cours je croise une des personnes qui était à la réunion. Je la reconnais, on s’était jamais vraiment parlé mais on s’était déjà recroisées à la fac. Je lui dis bonjour, et au moment où on allait échanger quelques mots, j’entends qu’elle est avec d’autres amies et qu’elle commence à rigoler beaucoup toutes les 3. Moi j’étais assez gênée, je comprenais toujours pas très bien ce qu’il se passait en espagnol, et j’avais l’impression peut-être que j’avais dit un truc pas correctement donc je suis vite partie. Après on s’est un peu recroisées mais j’avais l’impression, je sais pas, qu’elle se moquait un peu de moi. Donc on se disait bonjour de loin et voilà. J’essayais pas du tout d’entrer en contact.
Alex : Après ça, moi j’ai un peu laissé tomber l’affaire. D’ailleurs à ce moment-là j’étais vers la fin d’une relation avec une autre personne, avec qui on s’était dit que c’était ok de voir d’autres gens, mais j’avais pas l’énergie, j’étais un peu fatiguée émotionnellement. J’avais cherché le Facebook de Lucie quand même pour la stalker, et je l’avais ajoutée, mais j’avais laissé tomber l’affaire.
Un an plus tard, je me rappelle de l’existence de cette meuf, et je me dis : « Allez je vais lui écrire, je vais lui proposer d’aller boire un verre. » Donc je lui envoie un message, et elle me répond : « Non mais je peux pas aller boire un verre, je suis à Paris, je suis rentrée en France ». J’étais trop deg, mais bon c’était comme ça, et j’ai continué ma life.
Six mois plus tard, en mai 2019, j’étais avec des ami·es en train d’attendre dans la queue d’un concert de Chocolate Remix (C’est du reggaeton lesbien, allez écouter), et là je regarde à ma gauche, et je vois Lucie qui arrive. Je la vois en train de marcher et je me dis « Waw. » J’étais avec une copine, celle qui avait rigolé et un peu gâché l’affaire à la sortie de ce cours de théories féministes, donc là je lui ai dit : « Non attends, tu vas rien faire cette fois, là c’est moi qui gère. » Donc on a commencé à se parler avec Lucie, et dans ce concert j’ai vraiment tout donné, je me suis dit : « Allez, c’est mon moment là. »
Lu : Quand Alex m’a écrit après mon retour en France, j’avais compris que potentiellement il pouvait se passer quelque chose entre nous. Mais c’était longtemps avant et on se connaissait pas du tout, donc j’étais pas sûre. Quelques mois après mon retour, je décide de repartir à La Plata, toujours plus ou moins dans le cadre de l’université, mais aussi pour continuer à connaître les gens que j’avais rencontrés, à développer les relations que j’avais commencé à construire là-bas.
Après le concert j’étais très contente de l’avoir croisée, on s’était bien parlé, et assez rapidement on s’est revues. Deux jours après on a été à une manif ensemble, on a été boire des verres, je l’avais invitée à l’anniversaire d’une pote à moi, on a fait un repas chez des amies à elle… Bref très vite on a commencé à apprendre à se connaître, à se voir pas mal. En fait, en une semaine, on s’est vues quasiment tous les jours. Et on s’écrivait beaucoup.
Alex: Je sais pas d’où viennent les désirs, ni pourquoi je me suis sentie si attirée par Lucie, mais je voulais construire un type de relation avec elle, sans savoir qu’est-ce que je voulais exactement. Mais pour moi draguer c’est pas si simple. J’avais plusieurs choses à gérer avec cette situation. D’abord, il fallait savoir si Lucie était gouine, et si elle était dispo quoi. Aussi, il fallait communiquer discrètement et pas bizarrement, pour lui montrer que j’étais intéressée par elle. Du coup, je l’ai invitée dans des manif, parce qu’à ce moment je militais dans la campagne pour la légalisation de l’avortement et j’avais pas d’autres idées d’activités à proposer. Je commençais à la connaître et à me rendre compte que cette meuf n’était pas seulement magnifique sinon aussi très intelligente, critique et drôle… Je la kiffais quoi.
Lu : D’autant plus qu’à la fin de cette semaine-là, j’allais partir dix jours en voyage avec des ami·es à Mendoza, une autre ville d’Argentine. Donc j’avais un peu envie de voir ce qu’il pouvait se passer avant mon départ.
Finalement, quand je pars à Mendoza, il s’est toujours rien passé de très concret, mais pendant tout le voyage on s’écrit énormément, tous les jours. Moi qui n’ai pas trop l’habitude de faire ça, je suis tout le temps sur mon téléphone en train d’écrire à Alex, de lui raconter ce que je fais, de lui envoyer des photos. Assez bizarrement, notre relation se développe pas mal par écrit, via Whatsapp. Et pendant ces dix jours, elle m’avait raconté ses galères dans son appart. Elle avait plus de gaz, du coup je lui ai dit que chez moi j’avais une petite plaque électrique d’appoint, que j’allais lui apporter le jour de mon retour, et que j’allais lui cuisiner un truc que je venais d’apprendre à cuisiner : une soupe de cacahuètes. J’étais assez contente de rentrer de ce voyage et le soir même je suis passée chez moi, j’ai pris une douche, la plaque électrique, et je suis allée chez elle pour cuisiner cette soupe de cacahuète.
On s’était dit que ce qui était bien aussi les dimanche, c’était de regarder des films qu’on avait fait semblant d’avoir vu toute notre vie, et un de ces films pour nous c’était Fight Club. Donc ce soir-là on décide de regarder Fight Club, mais bon on voit à peu près 30 secondes du film. Assez rapidement on s’est rapprochées physiquement, ça a d’abord commencé par des caresses, on faisait semblant de regarder le film mais il y avait beaucoup de tensions. Et j’ai fini par me retourner pour l’embrasser, et on a passé la nuit ensemble.
Alex : En fait, on a passé trois jours ensemble. On s’est donné tous les bisous et caresses qu’on s’était pas donné pendant les deux semaines passées. Il faut clarifier qu’on ne s’avait pas pécho ou touché avant. En fait, j’aime beaucoup la tension et je suis ok avec ça. J’aime bien éviter de toucher les gens quand j’ai beaucoup trop envie de le faire, ça me fait trop plaisir d’attendre l’explosion de sensations physiques, quand tu sens que tu peux plus.
Et là, j’ai littéralement disparu de la circulation pendant trois jours. Je suis restée dans la chambre d’Alex trois jours non-stop. Et il faut savoir que pendant le voyage à Mendoza j’avais cassé mon téléphone, donc quand je suis repassée chez moi chercher des affaires après trois jours chez Alex, j’ai ouvert mon ordi et j’ai découvert que j’avais plein de messages de gens qui étaient très inquiets de savoir où j’étais passée. Dont une de mes tutrices de mémoire, qui était la directrice d’un centre de recherche de notre université à La Plata, et à qui j’avais eu quand même un peu honte d’avouer que j’avais pas du tout été enlevée, mais que j’étais juste chez quelqu’un que j’avais rencontré.
Alex : Il faut dire aussi que pendant ces 3 jours, l’unique chose qu’on a mangé c’était la soupe de cacahuètes. Et à la fin de ces 3 jours, je regarde Lucie et je lui demande quel type de relation elle aimerait construire avec moi. Parce que depuis des années, je relationnais avec les gens mais j’avais pas du tout envie de construire des relations de couple. J’ai pas proposé à Lucie de se mettre en couple, mais je lui ai dit que si elle le voulait, moi j’étais ok. Du coup on a eu cette petite conversation où on était d’accord toutes les deux pour continuer à être ensemble et voir ce qui allait se passer.
En fait, Lucie avait prévu de partir d’Argentine à la fin de l’année, et on a commencé à construire notre lien en sachant qu’on allait se séparer, et en même temps c’était très intense. De ma part, je voulais juste tout prendre de ces moments, parce que c’était très explicite qu’on avait un CDD, alors je sentais qu’il fallait en profiter chaque instant.
Lucie : Il y a un mois qui passe, à la fin duquel, avec ma coloc de l’époque, on décide de lâcher notre appart, pour différentes raisons. À ce moment-là, je fais un peu le point sur le mois qui vient de passer, je me rends compte que j’ai dormi chez moi qu’une seule fois, et tout le reste chez Alex. Du coup je me dis que ça va effectivement pas changer grand-chose si je lâche mon appart. Je décide de reprendre mes affaires tranquillement et de les amener chez Alex, dans le but de chercher un autre appart, je me laisse jusqu’à la fin du mois suivant. Je galère, j’ai pas mal d’histoires un peu extravagantes avec des proprios, des apparts, des colocs qui s’avèrent complètement pourries, et à la fin de ce mois-là et de beaucoup de tergiversations, on se demande si on doit pas tout simplement s’avouer qu’on vit quand même déjà ensemble, même si c’est très bizarre vu qu’on s’est rencontrées deux mois plus tôt. Et vu que j’allais repartir maximum en décembre de la même année, on s’est rendues compte qu’on avait pas du tout envie que je quitte cet appart là, donc on a décidé d’officialiser que j’allais habiter dans l’appartement qu’Alex avait avec son frère à La Plata.
Alex : On fait notre coming out de vivre ensemble, on passe tout notre temps ensemble, et ça se passe trop trop bien. On commence à déborder notre affection et notre vulnérabilité, et on se sentait très bien comme ça, c’était le début de notre tendresse, et on avait très envie de gérer ça.
À un moment donné, Lucie avait prévu un voyage au Nord de l’Argentine pendant une semaine avec des potes. Pendant qu’elle était là-bas, j’ai pu prendre du recul sur ce qu’il s’était passé, et j’ai commencé à angoisser beaucoup en réalisant que la meuf avec qui je vivais depuis quelques mois, allait effectivement partir à la fin de l’année. Je me rends compte que ça ne va pas du tout, j’ai pas envie d’accepter ça. Je commence à pleurer avec mes copines et dire : « Oui je suis en couple libre, je veux que Lucie soit un être libre, mais je suis trop triste, j’ai juste envie d’être avec elle pour un temps plus indéfini, ça va être trop triste quand elle partira, là elle est partie une semaine et je sais pas quoi faire. » J’écris à Lucie, je lui dis : « Bon cette semaine est un peu intense pour moi, je vois qu’il faut qu’on parle de notre relation ». Et basiquement, je voulais lui dire que j’avais envie de trouver une manière de continuer avec elle, même si elle partait.
Quand Lucie arrive une semaine plus tard, on commence à pleurer toutes les deux et on s’avoue qu’on n’a pas du tout envie de se séparer à la fin d’année. Alors on se dit : « Qu’est-ce qu’on fait ? »
Moi à ce moment-là, j’en ai un peu marre de vivre en Argentine parce que j’y suis depuis déjà cinq ans, et je réfléchis à partir en Uruguay. Mais Lucie, elle voulait rentrer en France. Donc moi je me suis dit : « Allez, pourquoi pas. Je vais aller en France, je vais apprendre le français, allez, on y va, on fait ça. »
Lu : On est fin novembre 2019, le moment est venu pour moi de quitter l’Argentine. À cette période c’est les vacances d’été en Argentine, et avant mon départ, on décide avec Alex de se prendre un mois ensemble en Colombie. Pour aller passer du temps chez sa famille, voir des amies colombiennes, et aussi pour avoir une transition entre tout ce qu’on avait vécu en Argentine et tout ce qui allait se passer en France, mais qui était encore très très flou, parce qu’il fallait organiser plein de choses administratives avant qu’elle puisse venir me rejoindre.
On part là-bas dans un contexte un petit peu tendu étant donné qu’Alex avait avoué à sa mère juste avant qu’elle était avec une fille, et en l’occurrence avec moi. Sa mère est très religieuse, donc on était pas bien sûres de comment elle allait le prendre. Et je sais pas si on peut dire qu’elle l’a bien pris, puisqu’elle lui a répondu que si je venais chez elle, « Elle ne me taperait pas ». Donc j’étais à la fois contente de le savoir et à la fois un peu inquiète qu’elle ait besoin de le clarifier. Mais bon on arrive là-bas, je rencontre sa mère, on bouge un petit peu autour mais on est surtout chez elle. C’est un mois assez difficile déjà parce que sa mère ne veut absolument pas nous laisser dormir ensemble, donc on dort pas ensemble, ou alors en cachette ou chez d’autres gens, alors que c’est le dernier mois qu’on a ensemble avant de ne plus se voir pour une période indéfinie.
Au moment où je rentre en France, le plan c’est qu’Alex demande un visa étudiant et qu’elle vienne ici pour ses études. Mais quand on se penche sur ces démarches-là, on se rend très vite compte que c’est extrêmement compliqué et cher de faire ce type de visa.
Alex : Il faut préciser que j’étais une personne migrante en Argentine et j’avais déjà pas trop d’argent, j’étais pas dans les meilleures conditions. Les personnes qui viennent de pays pauvres pour aller en France, c’est celles qui ont le privilège d’être riches. Moi je ne suis pas riche, et j’ai constaté ça quand on a commencé à regarder combien coûtait le visa, les billets, et comment ça pouvait se faire pour venir étudier ou travailler ici. J’étais un peu angoissée car on s’est rendues compte que c’était pas du tout dans notre budget.
Mais on a découvert en faisant des recherches, que quand tu es mariée avec une personne française, ils te donnent un visa presque gratuitement, pour 200 euros. Et c’était l’option la moins chère. Donc on s’est dit : « Allez, on fait ça, on va se marier. »
Lu : On décide ça en janvier 2020. Moi je vivais à Strasbourg, et il fallait déposer à la mairie de Strasbourg un dossier de mariage, dossier de mariage avec une personne étrangère qui n’était pas présente. Il fallait que je réunisse tous les papiers dont plusieurs originaux, en sachant qu’Alex habitait en Argentine tout en étant colombienne. Donc on essayait de faire communiquer les administrations française, colombienne et argentine en même temps. C’était extrêmement complexe, notamment pour faire parvenir des originaux en France depuis la Colombie en passant par l’Argentine, bref on était déjà presque au bord du burn out administratif au moment où on a finalement réussi à déposer tous les papiers à la mairie. Pour déposer le dossier il fallait déjà avoir acheté un billet d’avion pour avoir des dates précises, donc il fallait que tout ça arrive avant l’arrivée d’Alex en France, qui était prévue le 21 mars 2020.
Donc on pensait vraiment être au bout de nos peines administratives, et là…Fermeture des frontières, confinement général, pandémie mondiale.
Alex : Apocalypse… À ce moment-là, c’était le désespoir. On a beaucoup pleuré parce qu’on s’était séparées en janvier et on pensait se revoir en mars. Le confinement était indéfini, très angoissant, on savait pas ce qui allait se passer. Donc pendant des mois, on a continué de vivre notre relation à notre manière, on s’est fait des appels vidéos tous les jours, Lucie a commencé à me donner des cours de français. Parce que moi l’unique chose que je savais dire avant en français c’était « Bonjour la Tour Eiffel ». On fait des date, des fois on faisait du sex cam, on parlait beaucoup. Ça m’a beaucoup étonnée parce que pendant ces mois de confinement, on a vachement développé notre relation.
Lu : Les mois passent, la fin du confinement arrive en France mais en Argentine pas du tout. D’ailleurs le moment où l’Argentine a été déconfinée, c’était le confinement le plus long du monde. Et de toute façon, les frontières françaises étaient toujours fermées. Ma routine matinale c’était de taper « Actualités ouverture frontières » dans Google.
L’été arrive, moi je recommence à faire ma vie, je prends un boulot. On sait pas trop quand on va pouvoir reprogrammer le vol qui est toujours en attente, on est un peu désespérées. On lâche pas du tout l’affaire mais on sait pas ce qu’on va faire, on est juste là entrain d’attendre. Jusqu’à ce qu’un jour, un peu par hasard, Alex lise dans un journal national argentin, un article sur un couple bi-national, une française et une argentine, qui étaient dans la même situation que nous. Coincées chacune dans leur pays, sans possibilité pour la personne argentine de rejoindre la personne française. Et l’article raconte comment elles ont réussi finalement à se retrouver et à faire les démarches administratives qui ont permis à la personne argentine de passer la frontière et de venir en France pour se marier. Donc exactement notre cas. Sauf que nous, on avait pas encore réussi à résoudre l’affaire.
Alex : Cet article était pas très safe pour les meufs parce qu’il y mentionnait clairement leurs noms dessus, mais du coup j’ai pu trouver une d’elles sur Facebook, et je l’ai contactée. Elle s’appelle Clem, et j’espère qu’elle va bien. Elle m’a tout expliqué, et elle m’a raconté : « Du coup j’ai écrit au consulat, on était pas mariées mais j’ai réussi à prouver qu’on était ensemble grâce au bail de notre maison, et j’ai pu prendre l’avion avec ce bail ».
Avec Lucie, on s’est dit « On fait ça, allez ». On a falsifié un bail, parce qu’on avait vécu ensemble mais on n’avait rien pour le prouver. Donc avec ce bail falsifié, je m’embarque dans un vol presque 15 jours plus tard, avec 15 millions de papiers qu’on avait réunis.
Moi j’avais très peur, j’attendais que quelqu’un vienne me voir pour me dire que je pouvais pas passer, et finalement je passe la frontière. J’arrive à l’aéroport en France, je parlais pas français, je comprenais rien, et à un moment je suis en train d’avancer et je vois Lucie, et c’était.. Trop bien. J’arrivais pas à croire à ce moment aussi attendu. Et j’ai dit à Lucie : « Attends, j’ai pas mon tampon de passeport. » Du coup on a dû retourner à la police pour leur demander de tamponner mon passeport. C’était très important, parce qu’il fallait que je re-rentre en Argentine après pour demander un visa, avant de revenir définitivement en France.
Lu : Donc on se retrouve à l’aéroport, un peu abasourdies. On rentre à l’appartement à Strasbourg avec Alex le jour même, on est très contentes d’être ensemble mais en même temps on lâche rien parce qu’il faut aller valider le dossier de mariage à la mairie pour avoir une date avant son billet retour. On y va, on obtient une date le 25 septembre 2020.
Et entre deux confinements, on se marie.
Là on comprend pas trop ce qu’il se passe, parce que nous à la base le mariage c’est un truc qu’on fait… Pour pouvoir être ensemble bien sûr, mais en fait on est passées du plan du Visa Étudiant à ça sans trop se poser de questions. Et là il y a toute ma famille qui vient à Strasbourg très bien habillée, nos ami·es font des conversations secrètes pour nous organiser des surprises de mariage… On se fait embarquer dans un truc sans se rendre compte du poids social que cette fête a. À ce moment pour nous le mariage c’est une grosse bataille administrative qu’on est entrain de gagner après de longs mois, mais on se rend vite compte que c’est aussi symboliquement quelque chose qui malgré tout compte pour les gens… Et donc pour nous aussi, vu qu’on est avec tous ces gens à ce moment-là.
On se marie à la mairie de Strasbourg le 25 septembre 2020 à 9h du matin, puis on enchaîne sur une énorme fête dans notre appart avec toute ma famille, tous mes ami·es, parce qu’Alex connaissait pas encore grand monde en France. Et on est là, une soixantaine de personnes entre les deux confinements, en train de danser pour fêter cette bataille administrative.
Alex : Moi j’étais un peu angoissée, parce qu’on sentait qu’il y avait beaucoup de symbolique pour tout le monde, et je me retrouve avec des gens qui me félicitent pour mon mariage, j’étais comme : « Non, ne me félicite pas, je suis pas contente de me marier, je suis contente d’être avec Lucie et de pouvoir vaincre l’administration ».
C’est drôle parce que quand Lucie et moi on s’est rencontrées on disait : « Ha ouais, nique le mariage, les gens qui se marient c’est nul. » Et là ce soir-là, on était en train de danser sur du reggaeton et c’était too much, c’était un vrai mariage. On est sorties de la mairie, il y avait des gens qui nous jetaient des coquillettes de pâtes à la tête, c’était un peu angoissant.
Lu : Après ça, Alex repart en Argentine pour demander son visa, on a un peu peur parce qu’on se dit : « Qu’est-ce qui va encore nous arriver ? » Et évidemment, il nous arrive encore quelques rebondissements administratifs qu’on vous épargne. Elle finit par obtenir son titre de séjour assez rapidement, et trois semaines après elle revient s’installer à Strasbourg dans la coloc où je vivais, jusqu’au mois de juin de l’année suivante, juin 2021.
Entre-temps, en avril, on va voir des ami·es à moi à Marseille pour un week-end. Quand on habitait en Argentine, j’avais dit à Alex que si elle venait vivre en France, on pourrait trouver une ville avec un climat un peu moins violent que celui de Strasbourg. Et je lui avais parlé de Marseille, je lui avais montré des photos, elle avait beaucoup aimé. Pendant ce week-end là à Marseille, on découvre la ville, nos ami·es essayent de nous convaincre de venir y habiter. Nous on sait pas trop, on hésite, et finalement quelques mois plus tard, en Août, on emménage à Marseille, où on vit aujourd’hui.
Alex : Mon projet c’était reprendre la fac, du coup je m’inscris à l’université à Marseille. Lucie trouve un boulot ici, puis moi aussi après, et on commence à vivre nos vies dans cette ville.
Lu : On a même adopté un chat qui s’appelle Gina María. Aujourd’hui, ça fait trois ans déjà qu’on est ensemble, et on essaye de continuer de construire notre relation, une relation qui soit la plus saine possible, qui nous fasse le plus de bien.
Alex : On lâche pas depuis le début de l’affaire d’essayer de construire une relation de couple qui soit aussi politique, en sachant qu’il y a des choses qu’on a pas forcément envie de mettre en place, comme la monogamie, ou certains modèles heterosexuels qu’on ne veut pas reproduire. C’est pas toujours très facile de sortir de ça, mais on essaye tout le temps d’évoluer vers des choses qui nous font du bien.
Lu : On voulait raconter notre rencontre parce qu’on considère qu’on est toujours entrain de se rencontrer. On continue de se découvrir nous-même et l’autre un peu tout le temps. Moi avant de rencontrer Alex, j’avais jamais été dans une relation comme celle-là, comme on peut appeler une relation de couple assez longue dans laquelle je me projette sur différentes choses à moyen et long terme. J’ai l’impression que ça m’a apporté beaucoup de sérénité et de confiance dans les choses que j’ai envie d’imaginer, de continuer de construire. C’est très agréable de savoir que je peux compter sur quelqu’un et que quelqu’un peut compter sur moi. Ça me donne beaucoup de confiance.
Alex : J’aime beaucoup regarder comment notre relation évolue dans le temps, comment ça change et comment ça s’adapte à nous, à notre manière de vivre. Comment on fait des choses pour continuer d’être ensemble, et ça fait du bien. Le fait d’être avec Lucie c’est un choix que j’aime bien parce qu’on vit beaucoup de choses ensemble et on partage notre quotidien et notre intimité ensemble. Mais je sens aussi que ma relation avec elle m’apporte des choses avec les autres personnes. Je sens que c’est un peu tout lié. Quand je suis avec d’autres personnes je sens que ça nourrit un peu la relation que j’ai avec Lucie, et vice versa. C’est une chose qui me fait trop du bien. Moi j’ai envie de rester là-dessus.
Vous venez de lire le 1er témoignage de Lesbien·nes au coin du feu, un podcast Manifesto XXI signé Athina Gendry. Merci à Alex et Lu de nous avoir partagé leur histoire. Cet épisode a été monté par Louise Despret, Jeanne Chaucheyras a assuré la réalisation, le sound design et la musique originale. Il a été produit par Soizic Pineau, avec Apolline Bazin à la distribution et promotion, et Coco Spina à la direction éditoriale. L’identité visuelle et la direction artistique de ce podcast ont été imaginées par Dana Galindo. Léane Delanchy anime le compte Instagram @lesbaucoindufeu et a réalisé l’illustration de cet épisode, d’après une idée d’Alex.
Merci au média Hétéroclite ainsi qu’à ACAST pour la diffusion du podcast. On vous retrouve bientôt pour un nouveau témoignage. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n’hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous.
Si vous souhaitez vous aussi raconter une belle histoire au micro de Lesbiennes au coin du feu, vous pouvez nous la partager à l’adresse mail suivante : lesbiennesaucoindufeu@gmail.com
Cet article Lesbien·nes au coin du feu, Ep 1: Mon pays sera toi provient de Manifesto XXI.

Le corps d'une jeune fille de 16 ans, Brianna Ghey, a été retrouvé poignardé dans un parc au nord-ouest de l'Angleterre. Deux jeunes suspects ont été arrêtés.
L’article Deux suspects de 15 ans en garde à vue après le meurtre d’une adolescente transgenre au Royaume-Uni est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

La rencontre de première division de district entre Limeuil et le Périgueux Foot a été arrêtée ce samedi 11 février, après des propos menaçants et injures homophobes plusieurs fois réitérées par des supporters, en dépit des avertissements de l'arbitre visé.
L’article Interruption d’un match de football en Dordogne après des « propos homophobes répétés » est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Le milieu de terrain de l’équipe nationale tchèque, Jakub Jankto, 27 ans, qui évolue actuellement au Sparta Prague, a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux évoquant son homosexualité, « qu'il ne veut plus avoir à cacher ».
L’article « Je suis homosexuel et je ne veux plus me cacher » : le joueur de football international tchèque Jakub Jankto fait son coming out est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.



Dans La femme de Tchaïkovski, Kirill Serebrennikov évoque la vie du célèbre compositeur à travers le regard de sa femme, qu’il a épousée pour cacher son homosexualité et son existence dissolue.
L’article De l’amour obsessionnel à la folie est apparu en premier sur 360°.

A défaut d’un mariage religieux, l’Eglise d’Angleterre va néanmoins permettre aux prêtres de bénir les couples de personnes de même sexe, suscitant de nouveaux remous au sein du culte anglican.
L’article A défaut d’un mariage religieux, l’Eglise d’Angleterre se résout à une bénédiction des couples homosexuels est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Après le suicide de Lucas, adolescent de 13 ans harcelé au collège en raison de son homosexualité, le ministre de l’Éducation Pap Ndiaye a annoncé vouloir mettre en place plusieurs mesures, que beaucoup d'acteurs impliqués jugent insuffisantes.
L’article Harcèlement scolaire : Beaucoup d’efforts pourraient être faits « pour rendre l’école plus inclusive » est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

 Le 28 janvier, La Machine du Moulin Rouge accueillait la Wet For Me pour une nuit blanche inoubliable. Avec les DJ sets du collectif La Tchoin à la Chaufferie, et ...
Le 28 janvier, La Machine du Moulin Rouge accueillait la Wet For Me pour une nuit blanche inoubliable. Avec les DJ sets du collectif La Tchoin à la Chaufferie, et ... 
Cet article « On est un mouvement social » : état des luttes trans avec Ali Aguado et Karine Espineira provient de Manifesto XXI.
Alors que la visibilité des transidentités s’améliore un peu, les attaques d’extrême-droite se multiplient et la silenciation du mouvement politique trans persiste. D’ailleurs, ce mouvement, qu’est-ce que c’est ? Réponses de la sociologue des médias Karine Espineira et du militant, directeur d’établissements médicaux-sociaux, Ali Aguado dans cet entretien fleuve.Depuis quelques mois, les attaques contre les droits et la dignité des personnes trans se multiplient, notamment dans les médias. Après la polémique autour de l’affiche du planning familial représentant une personne transmasculine enceint, les épisodes transphobes s’enchaînent, les réactionnaires s’emparant de la « question trans » comme d’un nouvel os à ronger.
Dans cette époque de toutes les contradictions, le mouvement trans est sur une ligne de crête. Aujourd’hui, quand on tape « droit des personnes trans en France », le premier résultat est une fiche issue d’un ministère sur le respect de nos droits. Quant à nos premières représentations d’un homme trans qui se rase, elles nous proviennent d’une marque de rasoirs s’évertuant à paraître à la page. C’est une époque où les termes inclusion et pink washing sont dans toutes les bouches, sans nécessairement comprendre qu’ils sont les revers d’une même pièce : le néolibéralisme et la monétisation de nos identités. Une époque qui produit de la confusion, ce qui rend d’autant plus urgent les discussions de fond sur nos stratégies politiques et nos luttes. Revenir sur l’histoire non pour glorifier des groupes et des personnes qui travaillent à l’émancipation collective, mais pour comprendre notre situation actuelle et faire circuler la boîte à outils et stratégies transféministes fabriquée par d’autres.
Malgré la visibilisation plus importante des sujets trans, l’invisibilisation et la silenciation des personnes et du mouvement politique trans restent majeures. D’ailleurs, ce mouvement, qu’est-ce que c’est ? Karine Espineira et Ali Aguado, deux guerrillera/o qui en sont issu·e·s, ont aussi investi les terrains médiatiques comme champs de bataille.
Trajectoires de militant·es transféministesLes médiatisations trans ont tendance à représenter les luttes trans comme quelque chose de perpétuellement nouveau. Or vos deux parcours de militant·es transféministes s’inscrivent dans le temps long. Pouvez-vous revenir sur l’histoire de votre militantisme transféministe ?
Karine : Mon militantisme n’est pas une histoire linéaire, tout a commencé quand je suis arrivée en France après le coup d’État au Chili. Il y avait une forme de racisme, on était des objets exotiques. Le fait d’avoir grandi dans une cité m’a aussi éveillé aux inégalités sociales. Adolescente, j’étais une gauchiste comme c’est pas permis. Quand j’ai fait ma transition au milieu des années 90, j’ai vu comment étaient traitées les personnes trans en France, et je trouvais ça tout aussi dégueulasse que toutes les autres formes d’injustices. Je suis arrivé à Paris dans une association qui s’appelait l’ASB [Association du syndrome de Benjamin]. Je ne pouvais pas juste me servir, faire ma petite transition pépère et puis repartir ; je devais m’engager. J’étais révoltée par les protocoles hospitaliers, par cette transphobie et cette ignorance. Cela a débouché sur le constat que tout était fait, autant par la médiatisation que par le protocole, pour construire un certain type d’homme et de femme. Moi et d’autres, on a refusé de valider le système sexe-genre, et on a commencé à faire usage du préfixe trans, tout en étant lié·es aux luttes féministes. Car les luttes trans doivent être nécessairement féministes. On était influencé·es par les études trans et transféministes américaines (Sandy Stone, 1991) et une association, Transexual Menace, fondée en 1994 par Denise Norris et Riki Wilchins.
Ali : J’ai commencé à militer avant mon coming-out trans, dans les réseaux féministes. Je viens d’une classe sociale défavorisée et je suis le premier de ma famille à être allé au-delà du collège. J’avais donc une forte conscience des rapports de pouvoir et de classe, notamment sur la question de l’accès à la santé, parce que dans ma famille, les gens travaillant jeunes, mourraient jeunes ou avaient des maladies. Je me suis donc inscrit dans un militantisme sur les rapports de classe, plutôt dans une logique anarcho-punk (aujourd’hui ce serait anarcho-queer), avec des expérimentations d’auto-gestion, de vie collective, en non-mixité femmes et lesbiennes. Déjà, je voyais que quelque chose clochait par rapport à l’identité lesbienne, pour moi, mais il y avait très peu de représentations trans. Quand j’ai eu accès à une culture trans, et Karine en fait partie, cela a réveillé une réponse que le féminisme ne m’apportait pas complètement. La question du genre est centrale. Les queer et trans studies émergeaient seulement. L’ASB ne faisait pas du tout écho, dans son militantisme, à ce que je recherchais en terme d’émancipation, parce que cela s’inscrivait dans une génération de trans qui n’avaient pas le même espace de visibilité ni l’accès aux savoirs féministes que l’on avait dans les années 2000. En tant que mecs trans, on était assez mis de côté par l’ASB. Avec les allié·es, Karine, Maud-Yeuse, et d’autres militant·es de l’ASB plus en marge, on a créé un mouvement transféministe. Par la suite, je me suis rapproché d’OUTrans, où j’ai monté et coordonné le volet de formation aux soignant·es et aux associations LGBT, avec l’entrée VIH. Et j’ai coordonné la première campagne d’incitation au dépistage du VIH à destination des personnes trans. J’ai aussi milité dans d’autres associations comme Espace Santé Trans à sa création, ou des associations d’autodéfense féministes.
Voir cette publication sur InstagramUne publication partagée par Association OUTrans (@association.outrans)
Karine Espineira, tu es chercheuse, sociologue des médias, donc une personnalité scientifique, comment articules-tu cette dimension scientifique avec ton militantisme ? En France, en particulier, les communautés scientifiques semblent avoir du mal à intégrer le principe de connaissance située. Il y a aussi le sacro-saint principe de neutralité, qui est visiblement un attribut privilégié des hommes cis blancs.
Karine : J’avais commencé un parcours universitaire que j’ai arrêté au moment de ma transition, car je ne me voyais pas faire ma transition en restant à l’université. J’ai repris à 40 ans, parce que c’était une façon d’investir la scène des savoirs. Il y avait beaucoup de choses écrites sur les trans, mais rien d’écrit par les trans, contrairement à ce qu’on voyait aux États-Unis. J’ai choisi de faire ma thèse en étant out, comme une forme de défense théorique, pour qu’on ne vienne pas me le reprocher ensuite. En même temps, je me suis mise en difficulté. Je me suis sentie très seule. La connaissance située, c’est un outil dont je me suis servi, et qui raconte aussi comment les féministes ont réussi à rentrer dans l’université. Il m’a permis de blinder ma thèse et m’a finalement mené à une sorte de coming-out théorique. Maintenant, je continue à organiser des choses mais je suis en recul. Je ne candidate plus car l’Université m’a clairement fait comprendre que je n’étais pas bienvenue.
On est des militant·es trans parce que l’on fait partie d’un mouvement social qui tire son essence de différents champs et qui se réunit pour produire des outils de plaidoyer.
Ali Aguado
Pourquoi l’université est-il un espace essentiel à investir ?
Karine : Être à l’Université n’est pas antagoniste avec le militantisme. Imaginons que je fasse de la recherche sur le climat ; si en même temps, je suis militant·e écologiste, cela n’invalide pas ma recherche. J’ai le droit d’être concerné·e par la cause environnementale en même temps que chercheur·se. C’est pareil sur les questions trans. À un moment, j’ai commencé à recevoir des commentaires négatifs de la part de camarades trans, comme si j’étais une ennemie de classe et que j’avais trahi ma militance. Alors que pour moi, c’est un autre champ de lutte, il faut aussi que l’on produise nos propres savoirs et contre-discours. C’est trop facile de cracher sur l’Université. L’Université m’a beaucoup violentée, mais je ne regrette pas d’y être allée. Par ailleurs, ce sont les savoirs militants qui ont nourri les savoirs universitaires portés par des personnes trans au sein de l’Université, comme dans mon cas. Un certain nombre d’entre elles·eux retournent sur le champ militant, c’est donc un dialogue permanent.
Mais qu’est-ce que tu réponds à des gens qui argumentent que, structurellement, l’Université n’est pas le bon endroit pour produire des savoirs transféministes, mais qu’il faut le faire en dehors ?
Karine : D’un côté, il y a ce recyclage néolibéral des savoirs produits à l’Université, qui sont ensuite portés non par les concerné·es, mais par d’autres. On voit arriver des études dans lesquelles on met « transidentité » avec un peu n’importe quoi, comme si on allait vendre un bon sujet. Mais je pense que d’avoir essayé de porter les études trans à l’Université est aussi une façon de mettre le pied dans la porte et de dire aux universitaires « ohé, y’a autre chose dehors ». C’est pour ça que, dans le colloque que j’ai organisé en Octobre, j’ai souhaité qu’il y ait aussi des militant·es et des artistes, et montrer que tout cela peut cohabiter et dessiner une nouvelle carte des cultures et savoirs trans. Mais les études trans, c’est une guérilla.
Ali : Le militantisme est transversal et s’incarne sous différentes formes. Pour moi, une personne trans à l’Université, c’est une affaire de militantisme et d’outillage d’une boîte à outils, sur le terrain du champ de nos luttes, pour faire du plaidoyer, de l’auto-support, de l’entraide. Ce que j’ai finalement incarné et organisé dans le champ du médico-social ou en visibilisant ma grossesse, cela produit aussi du savoir. On ne peut pas compartimenter et encore moins hiérarchiser. Il y a des moments, des espaces que l’on prend, mais autant la manif en rue que le plaidoyer auprès des pouvoirs publics sont du militantisme. Tout cela crée et visibilise un mouvement social. On est des militant·es trans parce que l’on fait partie d’un mouvement social qui tire son essence de différents champs et qui se réunit pour produire des outils de plaidoyer. Ce qui rend visible, sous différents aspects, les transidentités dans l’espace public.
Voir cette publication sur InstagramUne publication partagée par Association OUTrans (@association.outrans)
Dans une certaine mesure, ma prochaine question peut se poser à tous·tes les deux, puisqu’être transféministe implique que son corps soit mis dans la bataille. Ali en particulier, tu as milité et tu as eu le courage de médiatiser ta grossesse avec notamment un magnifique reportage dans Les pieds sur terre. Je suppose que cela occasionne une vulnérabilité particulière. Comment, pourquoi, avec qui fais-tu ces choix-là ? Peux-tu revenir sur l’histoire de ta parentalité ?
Ali : Je fais ces choix avec mon épousé, qui est co-parent avec moi. Une des premières raisons tient à mon rapport très douloureux à la parentalité. J’ai conçu un enfant par PMA avec une femme cis, qui savait que j’étais trans. Quand on s’est séparé·es, elle a refusé de reconnaître notre lien de filiation juridiquement, mais aussi affectivement, entre notre enfant et moi. À l’époque, le changement d’état civil se faisait avec stérilisation obligatoire, je n’avais donc pas changé d’état civil. En conséquence, nous n’étions pas marié·es, puisque c’était avant la loi pour le mariage des couples de même sexe d’état civil. C’est une histoire douloureuse et traumatisante, mais à travers laquelle j’ai beaucoup appris sur la transidentité en amour. C’est-à-dire comment notre transidentité peut être utilisée dans les arcanes institutionnels et les juridictions des affaires familiales contre nous, comment lorsque les affects se distordent, la justice peut être utilisée contre ce que nous sommes, ce que nous incarnons. En particulier quand on incarne une transidentité féministe, avec un refus de la stérilisation obligatoire et contre la psychiatrie. D’ailleurs, j’estime que l’État nous doit réparation de ces stérilisations et la reconnaissance de nos filiations. Cela doit s’ancrer dans le droit. Autre exemple, une personne trans marié·e dans un couple hétérosexuel à l’état civil devait divorcer de sa·son compagne·on pour pouvoir transitionner. Tout cela a produit une sorte de misère affective et de trauma collectif sur nos amours et sur nos corps, et produit des effets sur la possibilité d’imaginer ou pas (et sous quelles formes) la construction de nouvelles familles transparentales.
Du coup, quand notre enfant est né, avec notre compagnon, nous étions très outillés par cette expérience et par notre engagement et nos expériences militantes. Il y avait un enjeu essentiel dans la reconnaissance juridique au bon endroit de ma parentalité, mais aussi de la sienne. Il était aussi important de montrer à la communauté qu’une histoire trans de parentalité peut bien se passer, quand des allié·e·s ont à cœur de montrer une solidarité dans les actes. Cela n’a pas été une mince affaire, puisqu’il fallait préparer tout cela des mois en amont, tout en traversant une grossesse en tant que personne trans (sur le plan juridique, médical, mais aussi social).
Il y a eu une longue discussion avec des magistrats avant la naissance de notre enfant, donc eux prenaient le risque de protéger notre famille, en reconnaissant notre parentalité au masculin, sans mention de ma transidentité, ce qui était pour nous révolutionnaire. Aborder un tel sujet en marge dans Les pieds sur terre constituait aussi un risque pour Clémence Allezard [journaliste qui a réalisé le sujet, ndlr]. Finalement, cet épisode est devenu l’un des numéros 1 pendant une longue période, et cela eut un effet boule de neige sur d’autres médiatisations, que l’on a stratégiquement sélectionné.
Maintenant, les médias mainstream ont peut-être compris que je suis politisé et en mesure de défendre la parentalité qui ne s’inscrit pas juste dans une histoire individuelle. C’est l’histoire d’un mouvement, que je prends le risque d’incarner publiquement pour que d’autres puissent le faire par la suite, pour faire bouger les lignes. On a donc refusé l’angle du témoignage individuel pour politiser ce que signifie être une personne transmasculine qui porte un enfant et accouche en étant reconnu comme parent au masculin. On a aussi fait attention, pour nous et pour la communauté, de demander une formulation de l’acte pour qu’il puisse être utilisé par des parents cisgenres de même sexe d’État civil, afin que tous les queers puissent s’en emparer. On ne parle pas de paternité, on parle de parentalité. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je suis un parent avant d’être une mère ou un père, dans tout ce que cela soulève de concepts, d’attendus dans le positionnement. C’est important pour moi, et c’est écrit dans l’acte de naissance de notre enfant, il n’est pas écrit « père de », ni pour l’un ni pour l’autre.
Justement, qu’est-ce que c’est que faire famille, pour vous ?
Karine : Pour moi, famille est synonyme d’abandon. Ma famille m’a abandonnée, parce qu’ils n’ont pas voulu travailler, réfléchir, et ont préféré se réfugier dans la peur et les stéréotypes. Pour moi, la famille est recomposée et choisie, parce qu’on a des destins qui sont liés. La transidentité, par exemple, c’est un destin qui nous lie, une expérience de vie qu’on partage.
Ali : Les communautés féministes, notamment les gouines, mais aussi les pédés, nous ont appris qu’on peut faire famille sans enfant, qu’on peut faire famille dans une communauté d’intérêts, de proximité ou de trajectoire. Ce n’est pas l’enfant qui fait famille. Tout cela, ce sont des façons de faire famille qui sortent du cadre hétéronormé. Pour moi, c’est toujours compliqué de prendre la parole sur le sujet parentalité et famille, puisqu’à mon sens la famille ne s’inscrit pas seulement dans la conception ou l’éducation d’un enfant, en particulier biologique. Donc la question des parentalités trans peut aussi être un écueil. Tant mieux si ça se banalise, mais pour moi ce n’est pas le seul synonyme de « faire famille ».
Étudier et confronter les médiasPrendre la parole dans les médias, c’est surtout responsabilisant vis-à-vis de la communauté, car on n’engage pas que soi-même, même si l’on y va pour parler de sa propre expérience. On ne contrôle pas le processus de généralisation du public.
Karine Espineira
Vous avez tou·tes les deux eu l’expérience de médias mainstream. Généralement, la médiatisation des personnes trans et du mouvement trans navigue entre visibilisation déformée, stigmatisante, et invisibilisation en tant que telle. Du coup, quelles sont les stratégies vis-à-vis de ces médias et de leurs sollicitations ?
Ali : J’ai refusé plusieurs fois, par exemple Hanouna ou Morandini, pourtant j’ai accepté BFM ou le Quotidien. Il y a des raisons politiques à cela. Il y a aussi la question du format, qui est importante dans l’espace de reformulation des questions. Étonnamment, le direct est plus simple à gérer, car il n’y a pas la déception du coupage et du remontage. Même si c’est un exercice compliqué, car je ne suis pas formé à prendre la parole publiquement, et que notre parole nous échappe. À chaque fois qu’on nous sollicite, on pense à l’enjeu d’assurer notre sécurité. Si une question n’est pas la bonne, je me barre, parce que je n’ai rien à gagner et c’est beaucoup de mise en danger de moi, mais aussi de toute la communauté trans. Avec mon compagnon, on a défini un cadre précis et il n’y a aucune réponse que je donne sans en avoir discuté avec lui. Ce cadre, je l’ai posé aux médias qui m’ont contacté, et à chaque fois cela a été respecté.
Il y a des questions qui relevaient systématiquement de l’autobiographie, et mon enjeu est de réagir intellectuellement face à cela. De réagir aussi émotionnellement, parce que dans nos parcours trans, il y a un activisme des affects, et une vraie question à se poser sur les émotions, particulièrement dans la prise de parole publique et le risque de la mise à nu·e. C’est surtout l’après, auquel je n’étais pas préparé, dans les espaces mainstream, mais aussi dans la communauté queer. Je n’avais pas conscience de la force que cette prise de parole a produite dans notre communauté, je n’en attendais rien d’autre qu’une transformation de nos questions. Je suis parfois gêné du statut que cette prise de parole me donne.
Karine : J’ai toujours fui les espaces médiatiques mainstream. Ce n’est qu’en 2012, quand ma directrice de thèse m’a poussée à accepter une proposition de Serge Moati, pour que je puisse voir les médias depuis l’intérieur. J’en garde un souvenir affreux, j’avais peur d’avoir porté tort à ma communauté. Prendre la parole dans les médias, c’est surtout responsabilisant vis-à-vis de la communauté, car on n’engage pas que soi-même, même si l’on y va pour parler de sa propre expérience. On ne contrôle pas le processus de généralisation du public. [Ali : tellement…].
Une de nos grandes préoccupations a toujours été d’aller au-delà des questions trans, ne pas s’enferrer, parce qu’elles entrecroisent beaucoup d’autres questions et réciproquement.
Karine Espineira
Une autre stratégie médiatique, qui ne s’oppose pas nécessairement à l’occupation de médias mainstream, est celle de créer de nos propres canaux autonomes, à l’instar de XY média ou de l’Observatoire des transidentités que vous avez créé en 2010 avec Maud-Yeuse Thomas et qui a fermé il y a deux ans. Karine Espineira, souhaitez-vous revenir sur cette expérience ?
Karine : Avec Maud-Yeuse, cela faisait longtemps que l’on s’exprimait et portrait des contre-discours et représentations, notamment en réalisant des petits films au sein de l’association Sans contrefaçon. Mais on avait la frustration de ne pas avoir un espace à la fois académique et militant. Donc dans l’Observatoire, l’idée était de publier aussi bien des textes militants que des textes universitaires, et surtout de rompre les hiérarchies entre les deux. Par ailleurs, une de nos grandes préoccupations a toujours été d’aller au-delà des questions trans, ne pas s’enferrer, parce qu’elles entrecroisent beaucoup d’autres questions et réciproquement. On a doublé le site internet d’une publication papier, car symboliquement le livre reste encore très fort, notamment pour investir les bibliothèques. Après, il y avait toujours le problème de prendre la parole et surtout de parler depuis notre point de vue. Quand on voit arriver un média comme XY média, c’est juste énorme, parce qu’un regard extérieur, un cis-gaze, aussi bienveillant soit-il, ne vaudra jamais nos regards et nos voix, et ne sera jamais aussi authentique que ce que l’on produit depuis notre point de vue, avec nos savoirs et notre culture. On a aussi besoin, dans nos sociabilités, de pouvoir se partager des choses qui nous parlent. Les regards extérieurs nous exotisent et sont loin de nos réalités et préoccupations quotidiennes.
Pourquoi est-ce que l’Observatoire a fermé, il y a deux ans ?
Karine : Les choses se sont dégradées à l’Observatoire, à cause de relations de pouvoir, car les gens avaient plus tendance à considérer notre collègue sociologue, un homme cisgenre, comme interlocuteur légitime, et cela nous dévalorisait Maud et moi. On sentait qu’on se faisait déposséder. On a continué à deux, ce qui nous a libéré de tensions, mais cela nous a aussi coupé de ressources, tout d’un coup nous étions moins crédibles. Il y a toujours cette propension à répondre plus rapidement à l’homme, sociologue, cisgenre. Comme cela tournait moins bien, on a préféré arrêter. Mais on l’a gardé en archives, l’association de Marseille Genre des luttes le maintient, c’est consultable. Beaucoup d’étudiant·es s’y réfèrent encore, donc ces savoirs perdurent.
Dernièrement, il y a une multiplication des épisodes médiatiques transphobes, autour de l’affiche du planning familial, le piège dont Karine Espineira a fait les frais par une fausse journaliste d’extrême-droite, et puis la transphobie banalisée dans beaucoup de chaînes et de médias. C’est comme si les « questions trans » avaient forcé leur entrée dans les espaces médiatiques mainstream, mais que les personnes trans étaient toujours perpétuellement absentes ou mal traitées. Karine Espineira, avec maintenant un peu de recul, quel bilan tirez-vous de cette mésaventure journalistique ?
Karine : J’acceptais d’autant plus facilement les demandes que les rhétoriques anti trans sont fortes. Je me dis que dans tout ce brouhaha et cette violence, on est peu à pouvoir prendre la parole et à dé-dramatiser la situation. Dans ce documentaire, où j’ai été contactée par une journaliste avec un faux projet, j’avoue que dans tous ces écrits elle maîtrisait bien notre culture. Ensuite, je me suis retrouvée dans un teaser programmé à la soirée Omerta où se retrouve toute l’extrême-droite française. Ça refroidit… Je me sens plus en insécurité aujourd’hui qu’en 1995, et ça me questionne beaucoup. Cette affaire aurait pu avoir des répercussions horribles. Je vis dans un petit bourg où on a deux voisins racistes, homophobes, s’ils découvrent un truc comme ça, ma vie peut devenir un cauchemar.
Quelles stratégies pour naviguer entre la réappropriation néolibérale et le climat réactionnaire ?Le “groupe trans”, c’est un peu le dernier arrivé sur le marché de l’égalité des droits. Ces gens veulent rembobiner le truc, donc ça commence par nous, mais nous ne sommes qu’un des pans.
Karine Espineira
Quels liens faites-vous entre transphobie et climat d’extrême-droite ?
Karine : On est en train de voir les vrais premiers effets des coalitions réactionnaires qui se construisent depuis plus de dix ans. Pour ces coalitions, la question trans est la porte d’entrée vers une certaine vision de la société. Ils parlent de filiation, de procréation, d’identité nationale, de théorie de genre. Le “groupe trans”, c’est un peu le dernier arrivé sur le marché de l’égalité des droits. Ces gens veulent rembobiner le truc, donc ça commence par nous, mais nous ne sommes qu’un des pans.
Ces droits, on ne nous les a pas donnés, on a lutté, on est allé les chercher, et on ne se laissera pas les enlever. C’est ça qui fait qu’on est un mouvement social, un mouvement transversal, avec nos adelphes TDS, migrant·es, malades chroniques. On est un tout.
Ali Aguado
Ali : Le fait que des personnalités politiques prennent notre sujet comme un sujet à traiter, à éradiquer, est une agression en soi. Mais ce n’est pas qu’à l’extrême-droite que cela se passe. La gauche a participé aussi à ouvrir cette fenêtre d’Overton qui permet la banalisation d’une transphobie crasse dans l’espace public. Les gouvernements socialistes n’ont rien fait pour défendre la communauté LGBT dans son ensemble. Si la gauche avait été moins nuancée sur les réponses apportées à la Manif pour tous, cela n’aurait pas laissé autant de possibilités à l’extrême-droite de s’exprimer aussi banalement sur la valeur de nos vies. Mais ce n’est pas que l’extrême-droite. La transphobie apparaît beaucoup plus aujourd’hui car on est visibles. On est à ce point où, à force d’avoir tellement milité et travaillé dur à notre visibilité, on est là et la société ne peut plus fermer les yeux. On a pris les espaces au travail, à l’université, à la banque comme dans le médico-social, dans l’espace médiatique, dans les séries, dans la musique, etc. On ne peut plus nous ignorer ni ce que l’on a traversé toutes ces années pour avoir accès aux peu de droits que l’on a aujourd’hui.
Évidemment, la droite brandit la transidentité comme un chiffon rouge, parce qu’on est une menace pour l’ordre établi. Mais c’est vrai, on n’a pas à s’en cacher, et encore heureux ! On vient bousculer les normes. C’est certainement pas sans l’émergence des questions de genre et de nos transitions incarnées publiquement que l’abécédaire de l’égalité s’est fait, par exemple. On est là en sous-marin depuis des années, nos allié·es féministes s’en sont emparé, on a travaillé avec iels, et aujourd’hui c’est une menace, parce que cela s’incarne aussi dans le droit. Ces droits, on ne nous les a pas donnés, on a lutté, on est allé les chercher, et on ne se laissera pas les enlever. C’est ça qui fait qu’on est un mouvement social, un mouvement transversal, avec nos adelphes TDS, migrant·es, malades chroniques. On est un tout.
Karine : Voilà, c’est ça le programme, c’est notre programme transféministe. On propose une société différente. Lutter contre toutes ces discriminations, c’est aussi un programme politique, une volonté.
Le climat fasciste m’effraie, et particulièrement en tant que personne trans, quand on sait que nos parcours impliquent souvent des formes de fichage médicaux ou administratifs et aussi que les premier·es impacté·es sont les personnes trans migrantes et racisées. Comment se défendre en tant que trans contre le backlash réactionnaire ?
Ali : OUTrans a participé à marquer un tournant dans la façon de politiser nos inquiétudes en tant que communauté, et sur la fierté et l’empowerment par les outils féministes (Le GAT en avait posé les jalons avec Act Up). On avait produit un objet, une fausse carte d’identité où on devait cocher un certain nombre de cases identitaires, pour dire que nos états civils ne se réduisent pas à nos transidentités et concernent tout le monde. L’objectif était de montrer que les questions trans, c’est du bottom-up. On part des classes les plus minorisées qui peuvent avoir un pouvoir de transformation de toutes les autres. Sur le dos de la carte d’identité était écrit : « Ne me dites pas qui je suis et ne me demandez pas de rester le même : c’est une morale d’état civil ; elle régit nos papiers », qui est une citation de Michel Foucault. L’objectif, selon moi, c’est l’abolition de la mention de sexe à l’état civil. Mais d’ici là, chacun négocie sa stratégie en fonction de sa trajectoire. Personnellement, reculer le changement d’état civil me permettait de trouver mon espace de résistance. Mais pour d’autres personnes trans, c’est très important d’avoir ce droit à l’oubli, à disparaître, etc.
Toute cette génération qui veut s’intégrer, nous crache à la gueule en quelque sorte, alors qu’elle bénéficie du travail militant. Elle tient ce discours de l’intégration-désintégration, et ça me rend furax. Moi, j’ai pas envie de m’intégrer dans cette société telle qu’elle est, surtout pas.
Karine Espineira
J’ai aussi l’impression que la médiatisation de certaines personnalités trans s’inscrit dans un programme de normalisation libérale. Je pense à la première maire trans de France, Marie Cau, qui a eu une certaine visibilité médiatique et qui se décrit comme « non militante » et comme « symbole d’une normalité possible ». Elle est politiquement libérale. Reprenez-vous à votre compte le concept de « néolibéralisme trans » ? Si oui, quelle réalité décrit-il ?
Karine : Des personnalités comme Marie Cau, j’en ai croisé plein. Ce sont des personnes qui veulent se faire accepter à tout prix, et pour cela tiennent le discours de la norme, de la majorité. J’ai vu des adelphes tenir parfois des discours horribles. Il s’agit de devenir plus normal·e que la normale. Quel est l’intérêt de parler face à un public composé de membres de Génération identitaire, Livre Noir, Reconquêtes, des médias comme CNews, Valeurs Actuelles, etc. ? J’étais assez en colère, car toute la presse a récupéré les propos de Marie Cau sur les « militants extrémistes », alors que ce sont grâce à des gens comme nous que Marie Cau, et d’autres, ont eu des droits, qui sont extrêmement récents. Toute cette génération qui veut s’intégrer, nous crache à la gueule en quelque sorte, alors qu’elle bénéficie du travail militant. Elle tient ce discours de l’intégration-désintégration, et ça me rend furax. Moi, j’ai pas envie de m’intégrer dans cette société telle qu’elle est, surtout pas. Le paradoxe, c’est que ces personnes font de la militance contre les militant·es, et parfois on a aussi le sentiment qu’elles monétisent leur transition.
Ali : J’aurais un discours un peu plus nuancé. J’ai le même principe que Karine, celui de ne jamais taper publiquement sur les membres de notre communauté. Il y a des choses que l’on doit discuter et régler entre nous. Après, quand la communication est rompue, c’est plus compliqué. Mais le fait que Marie Cau soit la première mairesse de France trans et qu’elle défende un universalisme républicain, c’est aussi la force de notre communauté, qui est plurielle. On n’est pas tous et toutes d’accord. Il y a des gens de droite dans la communauté LGBT, il y a le FLAG. Le programme de Marie Cau sur les questions de migration est affreux, mais c’est le pendant d’être visible et de connaître ou pas son histoire. Elle incarne un peu toute notre discussion. De qui on parle, de quoi on parle, quand on parle de militantisme ? Est-ce qu’on parle des réseaux sociaux, de l’incarnation au quotidien, de l’organisation au travail pour l’intégration des LGBT. Les gens les plus vénères sont importants dans notre communauté, mais il n’y a pas un seul moyen d’action pour se faire entendre. On agit tous·tes à des endroits et des moments différents, selon le projet social qu’on a. Ce qu’on a en commun, c’est le respect de notre dignité, le respect de nos parcours et l’accès au droit commun. Malheureusement, certain·e·s et certains d’entres nous l’appliquent pour elles et eux-mêmes, sans l’étendre à l’ensemble des personnes minorisées dans une oppression systémique.
Mais du coup, qu’est-ce que tu appelles communauté exactement ? Parce que j’ai l’impression d’avoir beaucoup plus en commun avec des cis anticapitalistes qu’avec beaucoup de queers libéraux, et c’est plutôt avec les premiers que je veux m’organiser puisqu’il y a des luttes sociales et écologiques urgentes aujourd’hui.
Ali : J’étais à San Francisco il y a douze ans, et il n’y avait aucun problème à ce que j’aille à une transmarch, seul, avec mes seins, sans torsoplastie, ce qui aurait été impossible à Paris. Au bureau de tabac, sans porter de binder, on me disait monsieur. C’est le libéralisme, la marchandisation et la capitalisation de nos vies. Le capitalisme récupère tout, y compris nos identités. Quand en France t’as une campagne de pub pour Gillette avec un mec trans, ou des pubs pour des caleçons menstruels avec écrit « y’a pas que les femmes qui ont leur règle », c’est ça. Obtenir la visibilisation mais contre la normalisation et le capitalisme. Comme si notre acceptation sociale ne pouvait être validée que quand le capitalisme la récupère. C’est le capitalisme qui influence, parce qu’on reste un produit social capitalisable, c’est hyper déprimant.
Pour l’accès à la PMA ou la GPA, qui peut y avoir accès ? C’est pas deux pédés qui gagnent le SMIC qui vont aller faire une GPA. Et même s’il y a accès, c’est à quel prix ? Cela s’accompagne souvent d’une forme de normalisation, sans réflexion sur l’éducation, le pouvoir, la pluriparentalité. Même chose pour le mariage, on a lutté pour l’égalité des droits, et on se retrouve avec des teubés qui font pire que des hétéros dans les ruptures familiales, dans les divorces, avec l’enjeu de l’argent et celui de la garde des enfants qui est énorme. Ce qui est sûr, c’est que le capitalisme récupère toujours la valeur de nos vies, et c’est terrifiant. C’est aussi ce qui fait que je bosse avec les gens de la rue. Nos perspectives trans, en tant que personnes minorisées, peuvent être utiles à d’autres minorités.
Image à la une : Montage graphique ©leanealestra, photo de ©Loop Tempura
Relecture et édition : Apolline Bazin
Cet article « On est un mouvement social » : état des luttes trans avec Ali Aguado et Karine Espineira provient de Manifesto XXI.

Quoi de plus hétéronormé (et hétéronormatif) que la Saint-Valentin, direz-vous… Sauf que nous pouvons très bien retourner la tendance et faire du 14 février une célébration de nos amours queer!
L’article La Saint-Valentin sera queer ou ne sera pas! est apparu en premier sur 360°.

Près de quatre ans après sa vidéo polémique, Patrice Evra a été reconnu coupable d'injure homophobe et écope d'une amende avec dommages-intérêts.
L’article L’ancien capitaine de l’équipe de France, Patrice Evra, condamné pour injure homophobe est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.



La famille de Guillaume Tran-Tranh, étudiant qui s'est suicidé après avoir accusé début 2021 un élu parisien de viol et dont le témoignage avait déclenché un mouvement #MeTooGay, a déposé une nouvelle plainte pour qu'un juge d'instruction reprenne l'enquête, a appris l'AFP jeudi 9 février auprès de ses avocats.


Entre inondation d’informations et écailles ruisselantes d’idées, un mois électro-splash sous les signes du Verseau et des Poissons.
L’article Votre horoscope de février est apparu en premier sur 360°.

Cet article Alerte beautés ! Il faut passer une tête au Club Visage du 24 février provient de Manifesto XXI.
Si tu as déjà mis un pied dans Paris la nuit, tu connais Simone Thiébaut. Queen de la scène queer, fondatrice de la Parkingstone, c’est au Hasard Ludique qu’elle organise sa prochaine soirée Club Visage le vendredi 24 février. Et cette fois, pas besoin d’être un oiseau de nuit pour écouter de la bonne musique parce qu’on part sur des horaires 18h-2h du mat’.Derrière Club Visage, il y a bien évidemment une volonté de faire la teuf, mais il y a également une action politique : « Cette soirée, je l’ai créée par besoin. En tant que femme trans, j’avais des chirurgies à faire, et la première soirée m’a permis de m’offrir ma féminisation faciale » explique la programmatrice. C’est pour cela que la soirée s’appelle Club Visage, cette fête aide des personnes trans à financer leurs soins et opérations de réassignement. Cette nouvelle édition viendra clôturer les cagnottes de Naé et Séléna, deux jeunes femmes en situation de précarité. Si vous n’êtes pas dispo le 24 et que vous souhaitez tout de même les aider, cliquez ici et ici pour envoyer la monnaie !
« Les artistes viennent en connaissance de cause, iels jouent gratuitement et tous les bénéfices de la soirée sont pour payer les chirurgies des personnes concernées » expose Simone. Et même s’iels viennent jouer bénévolement pour Club Visage, le line-up est tout sauf bradé ! N’oubliez pas que Simone compose parmi les line-up les plus pointus et les plus éclectiques de la capitale. La talentueuse Inès Cherifi nous fera don d’un live de violon en mode électro-acoustique/papillons dans le ventre, et cinq autres artistes livreront des DJ sets pour vous faire bouncer toute la night. Le Marseillais Guerre Maladie Famine montera à Paris pour nous faire vibrer au rythme de ses sonorités fragmentées et toujours surprenantes, Olympe4000 balancera la techno à sa sauce déesse. Enfin, il y aura aussi Lagrima, Assyouti et RougeHotel.
Bref, bête de line-up, bête de soirée et tout ça pour soutenir une cause plus qu’importante. Tu peux prendre ta prévente ici, elle te coûtera 10 balles, et si t’es pas quelqu’un d’organisé, tu payeras 13 euros sur place, ce qui reste tout de même peu onéreux pour une soirée à Paris d’une telle qualité. On se voit là-bas !
Artwork : Rémi Calmont
Cet article Alerte beautés ! Il faut passer une tête au Club Visage du 24 février provient de Manifesto XXI.

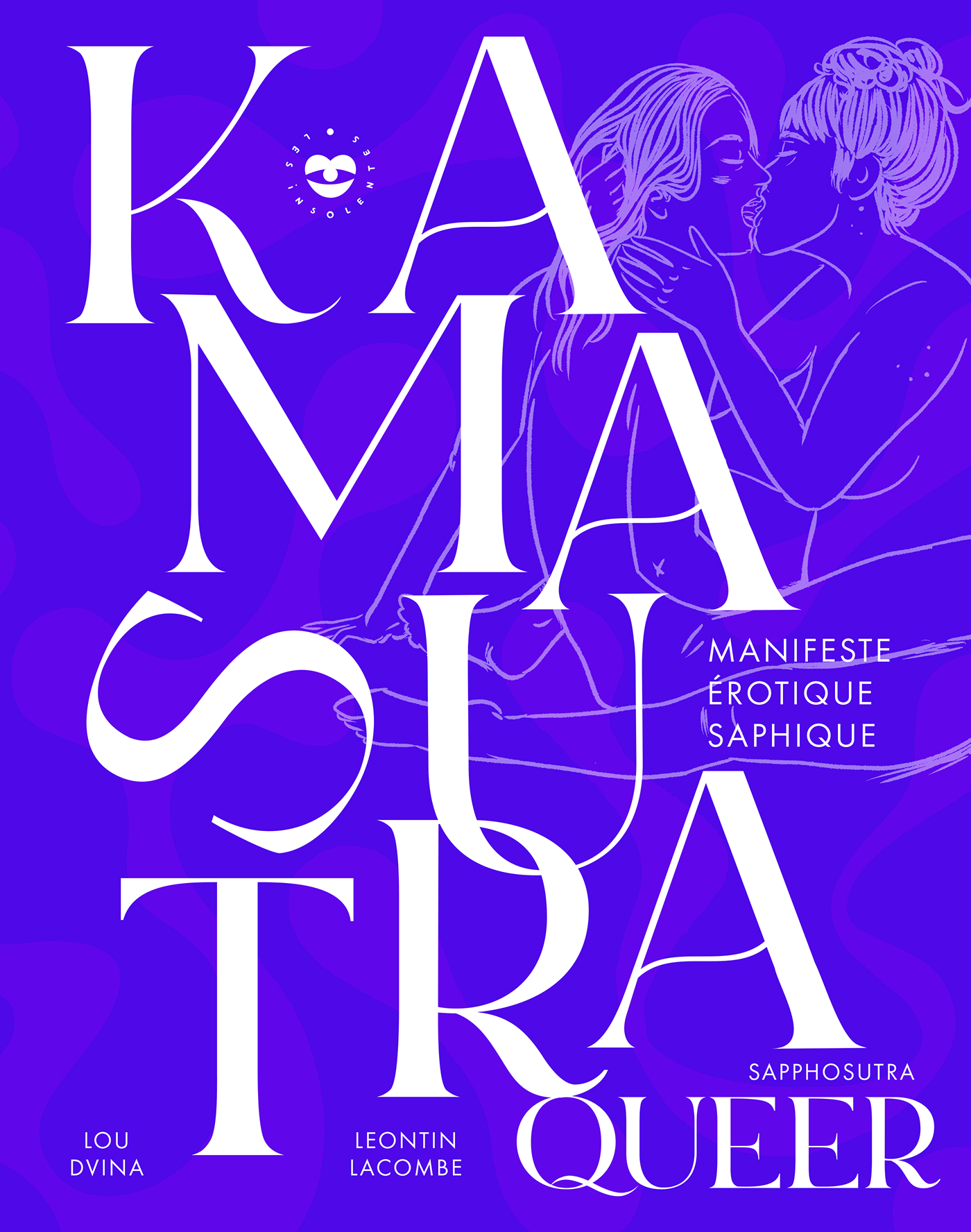 Aujourd’hui sort en librairies un livre qui devrait en séduire plus d’une : le Kamasutra queer ! Que ce soit dans les médias ou dans les livres, les questions portant ...
Aujourd’hui sort en librairies un livre qui devrait en séduire plus d’une : le Kamasutra queer ! Que ce soit dans les médias ou dans les livres, les questions portant ... 

Alors que Greta Gratos et Abdellah Taïa font partie du paysage artistique francophone depuis de nombreuses années, iels seront rejoint·e·s par Omar Gabriel lors des Rencontres Orient Occident de Sierre.
L’article A Letter To Myself est apparu en premier sur 360°.

Le philosophe et sociologue Daniel Defert, militant contre le sida, est décédé ce mardi 7 février, à l'âge de 85 ans, a annoncé l'association Aides, qu'il avait fondée en 1984 et présidée jusqu'en 1991.
L’article Hommage à Daniel Defert, président-fondateur d’Aides est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

En annonçant le limogeage du secrétaire exécutif du gouvernement pour propos haineux, Fumio Kishida s'est également engagé à faire voter une loi qui interdirait les discriminations en raison de l'orientation sexuelle.
L’article Le Premier ministre Japonais s’engage contre les discriminations LGBT+phobes est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

État des lieux, opportunités et enjeux... STOP homophobie organise, en collaboration avec l'ADUH, une conférence intitulée « Vers une dépénalisation universelle de l'homosexualité », le 6 mars 2023 à Paris.
L’article Conférence. « Vers une dépénalisation universelle de l’homosexualité » : quelles stratégies, quels agendas ? est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

L’homophobie, un trait culturel des pays non-occidentaux? C’est ce que défendent les discours homonationalistes. Mais dans les pays du Commonwealth, les lois anti-gais ont bien été implantées par l’Empire britannique. Retour sur un tabou historique.
L’article L’Empire britannique a-t-il implanté l’homophobie dans le monde? est apparu en premier sur 360°.

Le Pontife a réitéré son appel à une abrogation des réglementations lgbtphobes dans le monde, précisant que condamner, criminaliser les personnes pour leur orientation sexuelle « est une injustice inadmissible, et un péché ».
L’article « La criminalisation de l’homosexualité est un problème que l’on ne doit pas laisser passer », le Pape François est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Plus de 500 personnes, dont beaucoup de parents et enfant, on participé silencieusement ce dimanche 5 février après-midi à Épinal, dans les Vosges, à la marche blanche organisée en mémoire de Lucas, 13 ans, qui s’est suicidé le 7 janvier dernier, victime de harcèlement et d'homophobie.
L’article Marche blanche en hommage à Lucas, 13 ans : « Tu es dans mes pensées à chaque instant » est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Un jeune homme de 28 ans a été tabassé par un groupe d'adolescents, après une salve d'injures homophobes, sans doute parce qu'il arborait « un sac rose avec une licorne » et un bonnet assorti.
L’article Belgique : Violente agression homophobe et autistophobe dans le métro à Bruxelles est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Le ministère de l’Éducation annonce une campagne de sensibilisation contre l’homophobie. Matthieu, enseignant, a décidé de réagir, dénonçant « un fossé entre ces actions préconisées et leur application sur le terrain. »
L’article « L’homophobie tue. On ne le répétera jamais assez. Et l’école tue aussi en laissant faire », un enseignant dégouté ! est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

 Enfin ! Notre dimanche WTF au Balajo fait son grand retour après 2 ans d’absence !! La raison : une mystérieuse pandémie. Sors tes épaulettes, (re)mate Miami Vice, Flashdance et ...
Enfin ! Notre dimanche WTF au Balajo fait son grand retour après 2 ans d’absence !! La raison : une mystérieuse pandémie. Sors tes épaulettes, (re)mate Miami Vice, Flashdance et ... 
Quelle place pour les représentations des vieillesses LGBT+ aujourd’hui ?
En préparant cette rubrique autour des représentations des minorités LGBTI+ est venue l’envie de parler des vieux. Et avec cette envie, ces questions : où sont les vieux gays ? Les vieilles lesbiennes ? Les vieilles personnes bi et trans ? Qui peut citer trois noms de personnes âgées appartenant à la communauté LGBT+ et qui ont encore droit de citer à son propos ? Ou simplement dans les fictions, quels personnages de vieux ou de vieilles vivant leurs homosexualités et/ou leurs transidentités sont invités dans nos imaginaires et, soyons audacieux, dans nos fantasmes ? Où pouvons-nous les voir, les entendre ou ne serait-ce que les imaginer afin d’appréhender ce que sont aujourd’hui les vieillesses LGBT+ ? C’est curieux ce silence autour d’un des rares sujets qui, souhaitons-le, nous concernera pourtant toutes et tous un jour.
Un premier constat s’impose, celui que la vieillesse se pense et se parle de plus en plus. Impulsion portée par les mouvements féministes qui en se questionnant sur les corps objectalisés par le patriarcat, se sont interrogés sur ceux qui, comme disait Despentes, sont exclus du marché à la bonne meuf parmi lesquels les corps ménopausés, les corps supposés invalides et les corps vieillissants.
Puis la pandémie et les confinements ont mis en lumière les conditions de vie (et de travail) dans les EHPAD où les habitant·es ont été enfermé·es bien plus radicalement qu’ailleurs, bien plus longtemps et où les décisions se sont prises sans consultation des personnes concernées ni grande considération pour leurs droits. Enfin la vieillesse est de plus en plus parlée par une génération de jeunes vieux, des septuagénaires né·es pendant le baby-boom, dont certain·es rompu·es à l’exercice du militantisme puisqu’ayant eu 20 ans en 1968 et paniquant à l’idée de bientôt vieillir dans les mêmes conditions que leurs parents.
Des tribunes dans les journaux (Libération en mai 2017), des romans témoignages (Laure Adler, La voyageuse de nuit), cette génération s’exprime sur sa vieillesse. Idem pour les personnes LGBT+. Des podcasts (L’épisode de Gouinement Lundi Vieilles et Lesbiennes ou Marie-Pierre Pruvot aka Bambi, femme trans de 87 ans invitée de l’émission À voix nue sur France Culture en décembre dernier), des articles (la médiatisation du mariage de deux lesbiennes résidantes d’un EHPAD et votre serviteur Hétéroclite qui en juillet dernier dans sa rubrique dédiée aux discriminations parlait de l’âgisme, autrement dit les discriminations liées à l’âge). Il y a aussi des documentaires comme le bien-nommé Les invisibles de Sébastien Lifshitz.
Enfin des collectifs sont créés, toujours avec les féministes en pionnières (La Maison des Babayagas, maison pour femmes âgées située à Montreuil et fondée par la regrettée Thérèse Clerc) puis le collectif GreyPride et à Lyon l’association Les Audacieuses et les Audacieux qui sont en train de créer la Maison de la Diversité, première maison de retraite LGBT+ en France dont nous vous parlions également dans un précédent numéro.
Les représentations se multiplient donc sous l’impulsion d’observateur·ices et de personnes bientôt concernées qui s’alarment à juste titre d’une exclusion sociale manifeste des personnes vieilles, dites dépendantes, exclusion dont notre communauté LGBT+ n’est pas exempte. D’autant qu’il existe des risques spécifiques aux vieillesses LGBT+. Le risque d’un isolement social accru. Le passage à la retraite, la potentielle perte de mobilité et la baisse des revenus isolent les vieux et les vieilles qui ne gardent souvent comme lien social que leurs familles et leurs vieux amis quand ils sont encore de ce monde.
Mais au sein de la communauté LGBT+, nous restons nombreux·euses d’une part à ne pas pouvoir ou souhaiter avoir d’enfants et d’autre part chez qui les ruptures familiales sont plus nombreuses du fait de l’homophobie et/ou de la transphobie de certaines familles. Nous pouvons aussi évoquer celleux dont la sociabilité s’organisait autour des pratiques sexuelles – majoritairement des hommes gays – et dont iels se retrouvent exclu·es parce que désormais trop vieux. Ici, à moins d’avoir les moyens d’une carrière de Sugar Daddy, le risque d’isolement est très fort. Nommons aussi que l’autre espace de sociabilisation LGBT+, celui lié au militantisme, n’est pas toujours très accueillant avec les personnes âgées jugées has been et réactionnaires. Enfin dans les EHPAD où même les hétéros sont empêché·es dans leur vie sexuelle par l’absence d’intimité et par les idées reçues de certain·es professionnel·les sur la sexualité des personnes âgées (lire pour cela le rapport des Petits Frères des Pauvres Vie affective, intime et sexuelle des personnes âgées), les vieilles et les vieux LGBT+ se sentent parfois obligé·es de retourner dans le placard par crainte des discriminations.
On peut donc se réjouir que les choses bougent et se rappeler qu’elles doivent encore bouger car nos aîné·es LGBT+ d’aujourd’hui qui ont lutté souvent bien plus que nous pour sortir du placard et qui ont vécu leurs sexualités et/ou leurs transidentités avec moins de droits et peu de soutien autre que celui de la communauté expriment très justement qu’ils et elles ne supporteraient pas de se placardiser à nouveau. Faisons bouger les choses donc.
Mais reste une question en suspens. Pourquoi les vieilles personnes LGBT+ sont-elles si peu représentées dans les fictions ? Hormis le beau film Deux de Filippo Meneghetti, touchante histoire d’amour entre deux lesbiennes âgées, peu de film ou de roman existent sur le sujet. On peut penser à Gerontophilia de Bruce LaBruce qui a le mérite de ré-érotiser les corps vieux mais dont la limite est que la question du désir est amenée par un personnage jeune qui demeure le centre du film. Idem pour le personnage de Madame Madrigal dans les Chroniques de San Francisco qui devra attendre le 9ème tome avant d’être autre chose qu’un personnage annexe, une sage à l’écoute de ses jeunes pensionnaires. Des vieilles et des vieux donc mais qui sont rarement des protagonistes. Comme si même la fiction ne s’autorisait pas à les sortir du carcan des clichés sur les personnes âgées. Prochaine étape ? Souhaitons-le.
© Isabelle Valera
L’article Les vieillesses LGBT+ est apparu en premier sur Hétéroclite.

Début janvier, nous avons eu le plaisir de rencontrer Sandor lors de sa résidence aux Docks de Lausanne. Entre deux répétitions, nous avons échangé avec elle sur son nouvel album, La Médaille, et découvert en exclusivité quelques minutes de son nouveau spectacle.
L’article Sandor: «Je veux prendre cette place et expliquer moi-même les choses» est apparu en premier sur 360°.



Cet article Shooting & interview : Imer6ia, la body music propulsée dans le métavers provient de Manifesto XXI.
Pousser la composition électronique en France vers des terrains peu connus et casser la barrière des genres, le tout dans une harmonie hybride, c’est possible et Imer6ia le fait. Rencontre avec une artiste totale, à l’occasion de la sortie de son premier album, accompagné d’un shooting inédit pour Manifesto XXI.Un salon de thé en plein Paris dans l’après-midi. Dans l’arrière-salle, nous rencontrons Imer6ia, toute habillée de noir, jusqu’aux lunettes. Entre deux tasses, la compositrice et artiste 3D revient avec nous sur son tout premier album, Translucid, qui sortira le 23 février. Un dix-titres conséquent aux sonorités et à l’univers très maîtrisé. Sombre mais mélodieuse, la electronic body music d’Imer6ia fait naître des mondes parallèles créés de toutes pièces.
Projet total, la sortie de ce premier long format s’accompagne d’un shooting réalisé pour Manifesto XXI par le duo de directrices artistiques Caroline Dussuel et Amalia Jaulin, dont on a pu déjà repérer les esthétiques sci-fi enchantées dans les pages d’Ola Radio ou celles du numéro d’Ex Magazine sur la post-club/deconstructed music. L’artiste y apparaît sous des contours flous, toujours insaisissable derrière des jeux de clair-obscurs surréels.
Rencontre avec une « enfant de Burial », audidacte naviguant gracieusement entre les dimensions virtuelles de la wave music au métavers, sans jamais perdre de vue ce qui fait la force de son syncrétisme artistique : une puissance émotionnelle, capable de raconter des histoires « tout en faisant danser les gens ».
Toutes les frontières musicales ont été éclatées et maintenant, ce n’est plus vraiment une question de qui tient la barre, mais de comment bien utiliser ces codes, pour apporter de l’émotion.
Imer6ia
Manifesto XXI – Qui est Imer6ia ? Peux-tu commencer par te présenter ?
Imer6ia : Oui ! Je m’appelle Laetitia et j’opère dans l’art sous le nom Imer6ia, un nom qui s’inspire de mondes immersifs. C’est une façon de s’infiltrer dans des mondes parallèles, de l’audio à la 3D. Je fais de la musique depuis assez longtemps, et de la musique électronique depuis une dizaine d’années. J’ai un parcours classique à la base, que j’ai vite abandonné pour tout ce qui était synthétiseur et 3D. J’en ai fait mon métier et je suis autodidacte.
On retrouve dans ce projet des voix lointaines à la Burial, des mélodies nostalgiques, des envolées caractéristiques à l’EDM, ou encore des distorsions comme sur les morceaux « Nightshift » et « Earthbeat ». Un grand mélange d’influences, d’univers qui entrent en collision, mais avec harmonie. Après des singles, des remixes et des EP, depuis quand prépares-tu ce premier album ?
En réalité, j’ai toujours eu la vocation de faire des projets plus conséquents, accompagnés de visuels, et donc un album. Quelque chose de global qui propose une vision artistique plus poussée. Mais je n’avais pas réellement de date prévue. J’habitais au Pays basque, à Biarritz, et j’étais en production permanente de musique et de 3D. J’ai créé beaucoup de matière à ce moment-là, au niveau musical particulièrement, et surtout sans attentes. À cette période, mon rythme était d’aller chaque jour voir l’océan et de faire de la compo en rentrant. Je me suis vraiment isolée. Je ne cherchais pas à finaliser ou boucler un projet d’album, c’était un peu flou. C’est dans ce contexte que Brice Coudert, du label lavibe, m’a contactée par hasard, et qu’on m’a proposé une création solo. Je voyais la bande son d’un film, le film que j’avais envie de mettre en images, en 3D, j’avais des images et des scènes très précises en tête. C’était comme ça que j’imaginais le projet, je ne l’ai pas vu comme un album. Brice m’a demandé une démo et j’en avais déjà plusieurs. Mais en fait, il y a déjà un deuxième album qui répond à celui-ci.
 © Caroline Dussuel & Amalia Jaulin
© Caroline Dussuel & Amalia Jaulin
Le projet m’a fait aussi penser à ce que pouvait proposer par exemple Jon Hopkins, pour son aspect industriel, mais ici avec des tonalités plus décortiquées, des tempos plus accélérés, beaucoup de voix et un esprit plus club. Voulais-tu te rapprocher du dancefloor ou bien tirer le tout directement vers quelque chose de plus expérimental ?
En fait, je n’ai aucune prétention sur ce que ça va devenir parce que moi-même, je le découvre en faisant. Je préfère un processus très organique. Mais il y a quand même une volonté d’être plus club, ça c’est sûr, d’avoir un son plus beau, plus industriel aussi. C’est un peu un retour aux sources de mes influences initiales. Du coup, c’est dans ce sens-là, je dirais, que les sonorités sont expérimentales. Il y a plus de grain, plus de distorsion, mais c’est moins atmosphérique. J’ai l’impression que je cherche des choses plus précises et j’ai aussi envie d’essayer ce côté club, et finalement, le tout s’assemble. En tout cas, je voulais que ça puisse être à la fois narratif tout en faisant danser les gens.
Translucid vient marquer le paysage électronique français avec la musique club d’un monde imaginaire, comme issue d’une dimension parallèle. Quel·les sont les autres artistes qui t’influencent et avec qui tu travailles dans ces styles ? Parviens-tu à y retrouver des figures de femmes inspirantes ?
Trent Reznor est pour moi une influence majeure, autant la personne et son approche artistique que sa musique. Son évolution dans des musiques de films, de jeux vidéo, son travail de synthèse sonore, c’est assez exceptionnel. Il s’est infiltré un peu partout depuis des années. Dans cet univers qui me touche, les premières artistes femmes auxquelles je pense sont Caterina Barbieri et Eartheater. J’aime beaucoup leur travail, pour leur recherche de synthèse sonore, au niveau de la composition bien sûr, mais surtout pour cette sorte de texture à la fois analogique et très trance. J’aime leur manière d’aborder le son et le mash-up. Par exemple, Eartheater ramène un côté hybride dans un terrain pop. Des influences métal, lyriques, gothiques, trance et très orchestrales, très épiques. C’est un mélange qu’il faut quand même oser et c’est ce que j’adore : les artistes qui ont une approche hybride. Qui ne se collent pas un genre ou un exercice de style, mais qui essaient toutes sortes de mélanges. Au final, ça crée une sorte de syncrétisme qui fait bouger les choses.
 © Caroline Dussuel & Amalia Jaulin pour Manifesto XXI
© Caroline Dussuel & Amalia Jaulin pour Manifesto XXI
On t’a souvent attribué le genre wave music. Tu t’y reconnais ? Sinon comment décrirais-tu ta musique ?
Je ne m’y reconnais pas vraiment. Mais tout récemment, avec des amis américains avec qui on échangeait des sons à la maison, j’ai découvert un style : la body music. En fait, c’est l’héritage des créations de Nine Inch Nails. Je dirais bien que c’est ma base d’inspiration, c’est mon groupe préféré depuis des années et c’est le style qui en a découlé. Une musique industrielle, dance et émotionnelle, un peu sombre et riche d’une grande variété de styles. Ce qui m’émeut le corps, c’est l’idée de pouvoir faire danser, mais toujours avec une notion d’émotion. C’est un peu plus poussé et plus frais. Après, je ne me suis jamais mis d’étiquette.
Il y a une trop grosse agitation autour des mondes virtuels, c’est une sorte de ruée vers l’or qui s’est un peu cassée la gueule.
Imer6ia
 © Caroline Dussuel & Amalia Jaulin pour Manifesto XXI
© Caroline Dussuel & Amalia Jaulin pour Manifesto XXI
Ton EP Innerlight en 2019 présentait un aspect global plus lumineux, avec beaucoup d’utilisation de samples, même visuellement jusqu’à la pochette. Translucid est bien plus sombre, proches de la trap par moments. On entendait déjà ces sonorités dans ton mix « Le matin des magiciens », diffusé il y a quatre ans. Comment ces rythmiques se sont-elles retrouvées dans ton travail électronique ?
J’avais d’autres projets, mais je n’ai pas sorti de musique avant très longtemps. Disons que je suis assez prolifique, tout ce qui se trouve sur internet et même l’album, ça représente peut-être 3 à 5% de ce que je produis, je suis assez lente à sortir les choses. J’ai la chance d’avoir des gens qui m’entourent et qui me poussent, sinon je suis très habituée à l’exploration sonore.
Le mix dont tu parles contient énormément d’unreleased par exemple, avec des sons ambient, des sons trap, des chœurs d’église que j’avais enregistrés ou samplés, des chants géorgiens, des chœurs basques, des chants polyphoniques que j’ai mélangés à de la trap pour rendre l’ensemble plus riche. Je me souviens qu’à l’époque, j’aimais bien ce mélange un peu ghetto house. Quelque chose d’atmosphérique dans le sens onirique et fantastique, mais assez sombre. J’aimais bien l’ambiance qui se dégageait de ça, et c’est un peu ce que j’ai repris sur Translucid. C’est mon petit péché mignon. Puis en réalité, aujourd’hui la grime ou la trap utilisent énormément de sons hyper pointus et électroniques. Toutes les frontières musicales ont été éclatées et maintenant, ce n’est plus vraiment une question de qui tient la barre, mais de comment bien utiliser ces codes ou comment ça peut apporter de l’émotion. C’est subtil, mais j’adore cette explosion. Ce côté de la scène métal qui arrive dans la scène trap, ce n’est pas nouveau, ça fait vingt-cinq ans qu’il y a Aerosmith avec Run DMC. Ils ont tenté des premiers trucs et ça a complètement évolué, ça a changé les choses.
Hormis ton EP paru en 2019 chez Crystal Orca, tu sortais tes sons de manière indépendante avant cet album. Comment procédais-tu ?
Je viens d’une scène un peu de niche, je postais mes sons sur des groupes de musique sur Facebook. Les premières écoutes se sont faites comme ça. Et moi-même, j’écoutais et découvrais de la musique de cette façon. À l’époque, la communauté wave music était très présente et fédératrice. Du coup, j’étais très indépendante à ce moment-là. Dans cet univers, on est tous·tes un peu des enfants de Burial.
Tu réalises tous les visuels en 3D, des clips, des artworks aux live. Avec quoi travailles-tu ?
Je fais quasiment tout sur Cinéma 4D, et un peu Blender. Je travaille aussi avec ZBrush et beaucoup de plugins. J’adore ça, tu peux aller loin avec, c’est génial. Pour l’album, j’ai créé trois cartes, dans lesquelles je vais me balader pour faire mon film. C’est assez exceptionnel, il y a des hectares et des hectares de terrain à explorer, il y a un potentiel énorme pour pouvoir proposer aux gens de se poser, de se connecter dans un environnement virtuel ouvert. Après, il y a plein de manières de faire. Ça peut être sous forme de programmes que tu télécharges via un site ; une fois qu’il est sur ton ordinateur, tu charges le jeu et tu te lances dedans. C’est juste une question de format pour que ça fonctionne bien. Tu peux aussi avoir ton propre serveur et héberger ton jeu. Mais pour l’instant, je trouve qu’il y a une trop grosse agitation autour des mondes virtuels, c’est une sorte de ruée vers l’or qui s’est un peu cassée la gueule. Avec le métavers, tout le monde a été déçu. Il y a eu la crypto, qui s’est effondrée fin juin dernier. Aujourd’hui, tu vas prendre place sur le métavers simplement pour dire « coucou j’y suis ». Si c’est pour faire comme tout le monde, ça n’a pas d’intérêt.
 © Caroline Dussuel & Amalia Jaulin
© Caroline Dussuel & Amalia Jaulin
On a pu te voir au festival Girls Don’t Cry sur Toulouse. Comment prépares-tu tes performances live ? En as-tu d’autres prévues ?
Oui, c’est en cours. Là, je suis encore en pleine « livraison » du projet, mais j’ai une idée assez précise pour la suite. J’aimerais que les visuels soient mis en avant, avoir une bonne qualité sonore bien sûr, de belles basses, pour qu’on puisse vraiment écouter les textures avec précision. Idéalement, j’aimerais bien un ou plusieurs écrans. J’imagine différents types de scénographie, différents genres d’environnements ou manières de regarder. Ce n’est pas du snobisme, mais j’ai une exigence par rapport à ça. J’ai joué dans plein de types de salles et je le referais volontiers. Mais pour ce que j’essaie de proposer, il y a certaines plateformes plus propices à le diffuser, à faire comprendre l’expérience que j’espère faire vivre. Je suis en train de développer le live, c’en est encore au stade embryonnaire, donc je préfère en parler quand les choses sont actées, mais idéalement il y aura aussi un batteur sur scène. C’est hyper important pour moi, dans n’importe quelle musique.
Dans tes visuels, l’humain fait face à une présence humanoïde étrangère. Avec toute cette passion pour le métavers et les créations 3D, souhaiterais-tu amener ta musique et tes performances vers des contenus entièrement virtuels ?
C’est une bonne question. Ce qui est sûr, c’est que j’aimerais pouvoir emmener les gens de la manière la plus immersive possible. Avec un film par exemple, comme je te disais. Dans l’idéal, j’aimerais pouvoir proposer un clip de plusieurs tracks, un court métrage ou un film en plusieurs séquences. Ça pourrait exister sous forme de jeux vidéo, de salles ou de mondes dans lesquels on en fait l’expérience. J’y ai beaucoup pensé, surtout que le projet s’appelle Translucid. Mais j’ai des réserves, en tout cas sur ce que le métavers offre aujourd’hui. En fait, j’y travaille encore un peu indirectement. J’ai été un petit peu déçue de l’écart entre les promesses qu’on fait du métavers et la réalité. Pour l’instant, je trouve que c’est très orienté sur quelque chose de commercial. À chaque nouvelle technologie, il y a toujours une grosse attente au début. D’ici à quelques années, le truc va se décanter. Je t’avoue que j’attends avec impatience une certaine évolution technique de la part de Unreal Engine, par exemple. Pour que la qualité du métavers soit à la hauteur des jeux vidéo qui sortent actuellement. C’est une plateforme de streaming en direct et aujourd’hui les serveurs qui hébergent les métadonnées, pour des raisons d’optimisation, sont obligés d’optimiser aussi la résolution et les rendus de certains environnements. Le fait qu’on soit en 2023 et que l’on ait cette qualité de live, c’est super frustrant. Alors qu’à côté, il y a Last of Us 2 qui est sorti récemment et qui est complètement bluffant visuellement…
L’album d’imer6ia, Translucid, sortira le 23 février sur le label lavibe. Le clip du premier single de l’album Starships est disponible dès le 2 février.
Crédits shooting :
Photo + DA + styling : Caroline Dussuel
DA + props + set : Amalia Jaulin
Lights : Fleur Niquet
Hair : Aziza Bouzerba
Make up : Sainte
Assistante styliste : Charlotte Denner
Assistant + régie : Samuel Bassett
Assistantes set : Julie Zorrilla et Maele Herisson
Look rose : Lou Comte
Look vert kaki : Victor Clavelly
Bijou de tête : Alizée Quitman
Look blanc de loin : Victor Clavelly, Anna Heim et Rombaut
Les photos « de nuit » ont été réalisées en exclusivité pour Manifesto XXI.
Relecture et édition : Léa Simonnet et Sarah Diep
Cet article Shooting & interview : Imer6ia, la body music propulsée dans le métavers provient de Manifesto XXI.

«Le fond de l'air est gay.» C’est sur ces mots que débute le reportage de Mise au Point diffusé en juin 1998 sur ce qu’on nomme alors la TSR. À l’écran, on découvre les esquisses de la première édition du magazine 360° qui paraîtra en juillet de la même année. 1998 - 2023: 25 ans!
L’article «Le fond de l’air est gay» est apparu en premier sur 360°.

Début décembre la Commission Européenne a indiqué son projet d’instaurer un «certificat européen de filiation» afin que les enfants de familles homoparentales soient protégés dans tous les pays de l’UE.
Cette initiative semble découler d’une décision de la Cour Européenne de Justice qui a eu à se prononcer sur le cas d’une enfant, née en Espagne de deux mères bulgares, qui s’était vue refuser son certificat de naissance par les autorités bulgares qui ne reconnaissent aucune union légale entre personnes de même sexe. L’enfant avait donc légalement deux mères sur les documents espagnols, mais pas sur ceux bulgares. La Cour a statué que si un pays reconnaît une relation parentale avec un enfant, celle-ci doit être reconnue dans tous les États membres afin de garantir le droit de l’enfant à la libre circulation.
Ce «certificat européen de filiation» permettra aux familles homoparentales d’évoluer sereinement au sein de l’Union Européenne, chaque pays membres ayant pour obligation de reconnaître la filiation établie dans un autre pays membre, quelque soit sa propre législation concernant les familles homoparentales.
La Commission précise que ce certificat permettra à tous les enfants, où qu’ils se trouvent au sein de l’Union Européenne, «de bénéficier des droits qui découlent de la filiation dans des domaines tels que les successions, les obligations alimentaires, le droit de garde ou le droit des parents d’agir comme représentants légaux pour les questions scolaires ou médicales».
Pour être adoptée cette proposition devra être acceptée à l’unanimité par tous les États membres, ce qui semble une gageure quand on sait que de nombreux pays sont réticents à l’ouverture des droits pour tous·tes. En effet, six d’entre eux (la Bulgarie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Pologne et la Slovénie) n’ont prévu aucune possibilité d’union légale entre personnes de même sexe, tandis que, selon un rapport commandé par la commission des pétitions du Parlement, onze pays refusent la reconnaissance légale de la filiation homoparentale.
L’article Un certificat de filiation commun à tous les pays de l’UE pour les familles homoparentales ? est apparu en premier sur Hétéroclite.

La BBC a mené une enquête sur les pratiques déployées par la police égyptienne pour « chasser les homosexuels », via les réseaux sociaux et les applications de rencontres particulièrement dont la simple utilisation peut déjà constituer un motif d’arrestation pour « incitation à la débauche ».
L’article En Égypte, une police spécialisée pour traquer les personnes LGBT+ sur les applis de rencontre est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Un homme d'une trentaine d'années a été condamné à un an de prison, sans mandat de dépôt, pour des faits d'escroqueries et de vols à caractère homophobe, survenus en février et mars 2022.
L’article Nice : un an de prison pour des faits d’escroqueries et de vols à caractère homophobe est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Le ministre de l’éducation a décidé d’instaurer dans toutes les académies des observatoires dédiés, une campagne dédiée et souhaite aussi que « les portes soient grandes ouvertes » aux associations qui font de la prévention en milieu scolaire.
L’article LGBTphobie : Pap Ndiaye annonce une campagne de sensibilisation à l’école est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article En quête de réparation : l’origine des féminicides racontée par Laurène Daycard provient de Manifesto XXI.
Peut-on honorer la mémoire des victimes de violences conjugales avec une enquête ? Il semble que oui : avec Nos absentes. À l’origine des féminicides, la journaliste Laurène Daycard délivre à la fois une enquête rigoureuse, d’intérêt public, et un récit de soi original. Elle nous a raconté les coulisses de cet ouvrage qui se lit comme un polar.Laurène Daycard est une des premières journalistes à avoir travaillé sur les féminicides. Nos absentes (éd. Seuil) est un livre riche qui raconte l’émergence d’un thème de société. Il éclaire sous un jour nouveau ce sujet médiatique et militant qui s’est inscrit dans nos fils d’actualité ces dernières années. Mais c’est aussi un récit intime, hybride, dans lequel l’autrice raconte son lien avec le sujet, la manière dont elle-même a vécu la violence masculine. On passe d’un registre à l’autre, parfois sans que le lien soit immédiat, mais ça marche. On suit Laurène Daycard dans sa quête de compréhension et de mémoire pour Nos absentes à toustes, coûte que coûte.
Les féminicides, des crimes systémiquesC’est en Albanie puis en Turquie que Laurène Daycard a d’abord commencé à travailler sur les féminicides. Quand elle commence à enquêter sur le sujet à l’étranger en 2016, la presse française maltraite les violences de genre, confinées à la rubrique faits divers et aux remarques misogynes que la journaliste Sophie Gourion épingle sur son blog Les mots tuent. « En France ce n’est que depuis 2006 qu’on comptabilise les morts violentes au sein du couple, selon le terme officiel du rapport publié par la délégation aux victimes du ministère de l’Intérieur. Avant, on ne savait pas combien de mortes il y avait » rappelle l’autrice de Nos absentes. Et encore, ce décompte est mis en place à l’appel des Nations unies. On sait désormais que ces quinze dernières années, plus de 2 000 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex.
Si les violences sexistes et sexuelles sont un sujet de débat public plus courant depuis quelques années, la France accusait un sacré retard, notamment au sujet des crimes misogynes. « Le féminicide a tendance à être résumé à un mot-valise, à une sorte de tendance un peu dénigrée, alors qu’en fait c’est un concept universitaire. Ce terme s’inscrit dans une longue tradition de recherche qui remonte aux années 70, avec notamment ce Tribunal international des crimes contre les femmes, parrainé par Simone de Beauvoir, un événement qui a rassemblé des militantes du monde entier » raconte Laurène Daycard. Parmi les livres fondamentaux qu’elle mobilise, il y a Feminicide : The Politics of Killing Women (1992), co-écrit par les universitaires sud-africaines Julie Ratford et Diana E. H. Russel. L’ouvrage n’a encore jamais été traduit en français mais il a beaucoup voyagé en Amérique du Sud où la pensée sur les féminicides est très avancée. Laurène Daycard rend grâce au travail de typologie effectué par la chercheuse mexicaine Julia Monàrrez Fragoso, « qui inclut les féminicides non intimes, dont les crimes sexuels systémiques ou les professions à risque » explique-t-elle.
Car si le débat s’affine progressivement en France, les féminicides sont encore trop souvent réduits aux seules violences conjugales. Pour bien comprendre comment des dizaines de femmes sont assassinées chaque année, il faut prendre en compte l’ensemble. La journaliste cite l’anthropologue mexicaine Marcela Lagarde : « Le féminicide est un crime d’État parce que ça renvoie l’État à l’incapacité de protéger les femmes, d’enrayer les meurtres, mais aussi au climat de banalisation des violences sexistes qui jalonnent le parcours de ces femmes. » Fait surprenant, le terme de féminicide n’est pas encore entré dans la loi française, mais Laurène Daycard considère que l’arsenal législatif français est plutôt complet. C’est sur les formations de la police et les moyens alloués aux associations qu’il y a urgence.
En 2020, 35% des victimes de féminicide conjugal avaient subi des violences antérieures. Pourtant, moins de 20% des violences conjugales entraînent un dépôt de plainte, et les signalements, quand ils sont faits, ne suffisent pas à éviter les meurtres. Comme le montre l’histoire de Razia Askari, assassinée par son mari de dix-neuf coups de couteau en pleine rue à Besançon en 2018. Elle avait porté plainte trois fois. « C’est la répétition de ces défaillances qui fait système. C’est là que les travaux de Marcela Lagarde sur l’impunité font écho en France, à partir du moment où ces femmes ont cherché de l’aide et n’ont pas été protégées par les autorités » résume la reporter. Grande lectrice, Laurène Daycard est très rigoureuse dans ses réponses, n’hésite pas à ouvrir son livre posé sur la table de notre entretien pour n’oublier de citer personne, surtout pas les chercheurs et chercheuses français·es qui travaillent sur le sujet depuis de nombreuses années à l’instar des historien·nes Frédéric Chauvaud et Lydie Bodiou.
 Illustration : Aline Zalko
La fabrique d’un livre intime
Illustration : Aline Zalko
La fabrique d’un livre intime
« Pour raconter l’émergence de ce débat, je pense qu’il fallait raconter d’où je viens. » Alors Laurène Daycard raconte l’apprentissage de la féminité et les premiers témoignages de violences sexuelles qu’elle entend au tournant des années 2000 dans son Sud-Ouest natal. En parallèle des parcours de féminicides qu’elle déroule, elle raconte la contrainte à l’hétérosexualité (théorisée par l’autrice lesbienne Adrienne Rich) qui permet aux violences conjugales de s’installer. « Dans l’époque à laquelle j’ai grandi, on nous apprenait à nous protéger des MST mais pas de la jalousie, du sentiment de possession qu’on retrouve dans les parcours de féminicides » commente la trentenaire. Dès le premier chapitre de son livre, elle a, comme on dit, « posé les termes » : « L’hétérosexualité est l’un des principaux facteurs de risque d’homicide pour une femme en France. »
Sauf qu’aujourd’hui Laurène Daycard l’écrit, elle est lesbienne. Sans fard mais sans se revendiquer non plus d’un « génie lesbien », elle explique pourquoi il était essentiel de raconter cette partie de son identité dans son livre : « Je ne veux pas essentialiser mon regard mais je pense qu’effectivement être lesbienne et venir d’un milieu social modeste m’a permis de cultiver un regard un peu décalé sur ces questions. Ça m’a permis de développer une sensibilité, et de travailler avec une certaine empathie. » Ce travail méthodique sur les violences conjugales prend aussi ses racines dans un épisode familial qui a rendu l’écriture de ce livre si particulière : « Ça m’a appris qu’il ne faut jamais minimiser les traumas, résume la journaliste, émue lorsque je l’interroge sur son père. Sans tout mettre au même niveau, ce livre m’a permis d’ouvrir un dialogue dans le rapport à la violence dans ma famille. »
Situer son point de vue, se réapproprier sa propre narration, c’était aussi pour elle accepter la part d’émotion jusque-là non apparente dans son travail de reporter. Une dimension qui représente un travail d’introspection spécifique, en plus du terrain, pour arriver à la conclusion que l’empathie est un excellent complément à la rigueur journalistique : « Je sais ce que c’est que de se sentir jugé·e. Je pense que ça m’aide à essayer de ne pas trop juger les autres ou en tout cas de ne pas surplomber les histoires. Je n’ai pas eu envie de les raconter de haut mais dans une forme d’altérité, en tout cas avec tout le respect mérité. Je pense que c’est ce qui permet de bien travailler en tant que journaliste, comprendre pour mieux raconter. »
Responsabilisation des auteurs et de l’ÉtatComprendre est comme « une obsession », confesse-t-elle. Ce désir l’a amenée à rencontrer aussi des auteurs de violences conjugales. Elle insiste bien sur la nécessité d’utiliser ce terme, de ne pas parler « d’hommes violents », « parce que c’est sur cette ligne de crête que se trouve une forme d’espoir ». Le livre se termine près d’Arras, avec le récit de son séjour d’un mois au centre Clotaire, un dispositif d’accueil et de responsabilisation d’hommes auteurs de violences conjugales. Au début, dans les discours, c’est le déni qui domine, puis petit à petit des progrès se font jour vers la reconnaissance des violences. « La responsabilisation c’est des années de travail, tout comme pour la victime c’est souvent des années de travail pour arriver à se reconstruire » résume Laurène Daycard au terme de notre discussion. Après tant de pages de récits atroces émaillés de coups, menaces et humiliations, de manquements de la police, une ultime histoire éclaire la fin de cette enquête. André, ancien militaire, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour les violences infligées à sa femme. Après son séjour au centre et ses rendez-vous psy, il arrive à dire : « J’ai de la reconnaissance envers mon épouse parce qu’elle a porté plainte. J’ai pris conscience de la personne que j’étais. »
Si regarder la violence en face ne laisse pas indemne, ce travail essentiel permet de mettre en lumière des aspects méconnus des féminicides comme le statut des orphelins et orphelines de ces crimes. « On pense qu’une fois que le meutre a été perpétré c’est fini, mais en fait pour les familles ça se poursuit, voire ça commence, parce qu’il y a toute la paperasse à faire, raconte Laurène Daycard. Par exemple, c’est l’histoire de Brigitte Sohier qui passe son temps à la CAF pour obtenir l’indemnité et qui, en attendant, puise dans ses économies pour racheter des vêtements à ses petites filles parce que leur maison est sous scellé et qu’elles ne peuvent pas y accéder. » La création d’un statut similaire à celui des pupilles de l’État est une revendication soutenue par l’Union nationale des familles de féminicide, une des nombreuses batailles qui reste à mener autour de ce sujet.
« Quand j’ai commencé à écrire ce livre, naïvement je pensais qu’une fois qu’il serait terminé je n’allais plus jamais travailler sur les violences de genre, voire faire autre chose de ma vie. En fait non. » Le travail sur les violences masculines est loin d’être fini pour la journaliste. Ce n’est qu’un cycle de recherche qui se termine avec cette série d’histoires racontées. Avec Nos absentes, quelque chose s’achève pour ses sources, les victimes et leurs familles avec qui elle restée en contact au cours de ces années de travail : « Leur deuil continue mais leur histoire existe là et peut être lue par d’autres. »
Nos absentes. À l’origine des féminicides, éd. Seuil, 256 p.
Image à la Une : © Marie Rouge
Relecture : Sarah Diep
Cet article En quête de réparation : l’origine des féminicides racontée par Laurène Daycard provient de Manifesto XXI.



 Mes yeux s’embuent quand ils croisent les siens, au détour de ce couloir peint en violet pour l’occasion. Ce portrait, je le reconnais tout de suite. Je l’ai déjà aperçu ...
Mes yeux s’embuent quand ils croisent les siens, au détour de ce couloir peint en violet pour l’occasion. Ce portrait, je le reconnais tout de suite. Je l’ai déjà aperçu ... 


Trois semaines après le suicide de Lucas, sa maman a trouvé le courage de s'exprimer publiquement pour la première fois. Elle estime que la mort de son fils est bien la conséquence du harcèlement qu'il subissait en raison de son homosexualité.
L’article Décès de Lucas : sa maman s’exprime pour la première fois est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Trois semaines après le suicide de Lucas, sa maman a trouvé le courage de s'exprimer publiquement pour la première fois. Elle estime que la mort de son fils est bien la conséquence du harcèlement qu'il subissait en raison de son homosexualité.
L’article Décès de Lucas : sa maman s’exprime pour la première fois est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Ancien pilier des All Blacks et du Biarritz Olympique, le champion d’aujourd’hui 43 ans a évoqué son homosexualité dans une interview à la télévision néo-zélandaise.
L’article Rugby : l’ancien All Black, Campbell Johnstone, fait son coming-out gay est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Ancien pilier des All Blacks et du Biarritz Olympique, le champion d’aujourd’hui 43 ans a évoqué son homosexualité dans une interview à la télévision néo-zélandaise.
L’article Rugby : l’ancien All Black, Campbell Johnstone, fait son coming-out gay est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Evita Manji : « Mettre fin au spécisme serait un bon début pour freiner la catastrophe climatique » provient de Manifesto XXI.
Il y a tout juste un an, le premier épisode des Transvocalités était publié, dans lequel je rendais hommage à SOPHIE un an après sa disparition. Evita Manji, quant à iel, a choisi de faire paraître Spandrel?, son premier album, ce même jour de janvier aussi en mémoire à SOPHIE, car elle était la personne qui partageait sa vie. Spandrel? marque cette période douloureuse, aborde la perte soudaine et tragique d’un être cher, mais aussi celle plus progressive du vivant autour de nous, du contact avec celui-ci. Originaire d’Athènes, en ce moment en studio à Londres, elle me dit ne pas encore avoir trouvé là où iel veut vraiment habiter. Marqué par des silences nécessaires à notre échange, on a parlé stéréotypes de genre dans la pop, anti-spécisme et de son futur (pour le moment pas très proche) dans une ferme.En biologie évolutive, le terme « spandrel » fait référence aux caractéristiques d’un organisme qui ne sont pas des développements pour la survie et qui n’ont apparemment aucun but évident. Le mot est tiré du lexique architectural, et désigne les espaces triangulaires dans le coin d’une arche : de petits éléments esthétiques qui assurent la symétrie et délimitent les frontières. Le sound design dans Spandrel? peut faire référence à ce type d’ornementation. À la fois brutal et fin, il sous-tend une pop baroque et élégiaque en conjuguant mélodies simples, beats et rafales électroniques. Iel considère l’album « genderless », où le choral et l’élévation des notes de la voix de manière électronique participent de cette émancipation du sujet genré. Evita Manji y est une voix affectée et universelle, parfois enfantine, messagère d’images et d’émotions dont on fait tous·tes l’expérience aujourd’hui : pollution atmosphérique, urbanisation à outrance, feux d’océan et de forêt qui agressent la biosphère. Rigide tout en étant très délicat, ce premier album s’ajoute au catalogue de PAN qui n’a de cesse de bousculer la pop contemporaine, et dont le directeur artistique fait partie des proches d’Evita. Spandrel? étant endeuillé, iel me dit qu’il voit le jour aussi grâce aux personnes qui ont été à ses côtés, et qui l’ont aidé à le faire exister.
Ça s’est passé de manière organique. Après avoir fini l’album je n’avais pas beaucoup d’énergie pour le sortir, et PAN collait parce que je considérais collaborer avec des ami·es et Bill (Kouligas, directeur artistique) est un ami depuis un moment. Cet album documente une partie très spécifique de ma vie et c’était important pour moi de travailler avec les personnes qui ont été présentes à ce moment, et qui peuvent comprendre de quoi il s’agit.
Evita Manji
 Evita Manji par Maria Koutroubi
Evita Manji par Maria Koutroubi
Manifesto XXI : Qu’est-ce qui t’a nourri musicalement ? Quelles ont été tes influences ?
Evita Manji : En grandissant j’ai écouté beaucoup de choses – pour la plupart que j’ai oubliées –mais j’ai écouté beaucoup de jungle avec mon père, ça m’a influencé. J’ai eu des phases avec la musique emo, punk, métal, et ma musique reste intimement liée à ces formes d’intensité. Plus récemment il y a eu la psytrance. Jeune j’ai aussi été dans une chorale pendant plusieurs années. Aujourd’hui, je traduis tout cela d’une certaine façon, qui est plus maintenant, et moi, en quelque sorte.
Il y a eu aussi ce live qui a énormément influencé l’album et auquel je continue de revenir : celui de Lanark Artefax à No Bounds Festival 2018.
Dans « Lungs of a Burning Body » tu écris que nous « vivons et respirons le métal », qu’est-ce que ça veut dire ?
C’est plus abstrait que littéral, il y a plusieurs couches d’interprétation. La plus littérale serait toute la pollution qu’on respire dans les villes dans lesquelles on vit. Autrement, de façon plus figurée ça pourrait être à propos de notre lente transformation en robot, en des êtres froids, métalliques, détachés de nos racines. Je suppose que c’est le résultat des progrès technologiques, qui remplacent les forêts par des structures rigides, géométriques, bétonnées et en verre.
 PAN136 Evita Manji – Spandrel? Artwork
PAN136 Evita Manji – Spandrel? Artwork
Spandrel? est cyber-romantique mais aussi très pop, parce qu’il est marqué du sceau du deuil, et pleure la disparition de la vie.
Oui, Spandrel? pleure la perte d’un être cher, mais aussi la perte progressive du vivant autour de nous. Pas seulement les humains, mais la vie sur Terre. Je suis très préoccupé·e par l’avenir – sans mettre toute la faute sur les humain·es. Je suis encore tiraillé·e entre me dire, cela est fait pour arriver, c’est un cycle, un destin inéluctable, ou alors je me demande, sommes-nous responsables de ça ? Et qui est vraiment ce « nous » ?
La crise climatique est en effet très présente, et le feu est un élément récurrent. Oil/Too Much ou Eyes/Not Enough en sont les exemples les plus probants.
Oui, Oil/Too Much est à propos de l’extraction massive d’énergie fossile, et des dégâts que cela cause. On a vu ces images du feu à la surface de l’eau dans les médias à la suite d’une fuite de gaz d’un pipeline sous-marin au large du Mexique… Quant à Eyes/Not Enough, je l’ai écrite l’été 2021, lors des feux de forêt en Grèce. L’air était irrespirable, le ciel rouge, on ne pouvait pas sortir de chez soi.
Les paroles provoquent des images spacieuses, un environnement montagneux, mais le sound design, lui, alpague assez frontalement l’auditeur·ice.
Oui, le sound design adresse une urgence, c’est un élément qu’on ne peut pas ignorer. C’est la réaction qu’on devrait avoir au moment d’une catastrophe. La voix et les mélodies, elles, sont davantage là pour réconforter l’auditeur·ice dans ce chaos.
Tu as publié une compilation sur ton label myxoxym pour récolter des fonds pour ANIMA (une association à but non lucratif active pour l’environnement, dont l’activité principale est l’allaitement et la réhabilitation des animaux sauvages dans leur milieu naturel). Comment ça s’est passé ? Est-ce que tu penses poursuivre ces projets pour aider la faune ou d’autres formes de charité ?
PLASMODIUM I s’est bien passé. L’album m’a pris beaucoup de temps, mais j’ai réussi à faire cette compilation, même si elle est parue un peu tardivement. Il y aura surement d’autres volumes, toujours avec la musique d’ami·es. Le rendu est très varié. En ce qui concerne la cohésion sonore, je suis en train d’y réfléchir, mais je suis attaché à la diversité.
 PAN136 Evita Manji – Body/Prison single Artwork
PAN136 Evita Manji – Body/Prison single Artwork
Dans quelle mesure la musique est un outil d’action selon toi ?
Honnêtement, je me pose beaucoup la question. Les intentions peuvent être là, mais je mesure difficilement l’impact que cela peut avoir. Les gens peuvent acheter et écouter la musique, en ayant un regard dirigé vers des problématiques, mais est-ce que ça provoque vraiment l’action, c’est une vraie question.
Est-ce que tu dirais que ta non-binarité est présente dans ta musique ? Si oui, comment ?
(Iel réfléchit longuement) Beaucoup de paroles dans la pop sont basées sur des stéréotypes de genre.
Donc dans ce sens, oui, je pense que ma musique est sans genre (« genderless »). Ou non-binaire, ça c’est sûr. Il y a d’une part une forme de féminité dans mes voix, et le sound design peut incarner l’agressivité masculine. Pause. C’est aussi un stéréotype… « Masculinité » n’est peut-être le bon mot, mais, les hommes sont malheureusement associés au pouvoir, à la cupidité, à la destruction, à la rage et l’agressivité, et ce sont les causes majeures des points que j’aborde dans l’album.
Qu’est-ce que tu aimerais adresser à nos lecteur·ices et que tu penses qu’iels devraient savoir sur le disque ou sur ta vie de musicien·ne ?
Je dirai, lié aux deux : le disque et ma vie, que c’est important de sentir, et de prendre soin (to care). Je ressens les choses profondément et parfois c’est trop, mais si ce n’était pas le cas, je ne ferais pas la musique que je fais et je ne serais pas la personne que je suis. Et je trouve ça important et beau quand les gens sont passionné·es et font attention aux choses qui compte pour eux et elles. C’est ce que j’aimerais rappeler.
 Evita Manji par Maria Koutroubi
Evita Manji par Maria Koutroubi
Quels sont tes projets pour l’avenir, et si tu pouvais souhaiter le meilleur qu’est-ce que ça serait ?
Si tu veux savoir un truc que j’aimerais réellement faire dans le futur, et que j’espère je ferai, j’aimerais emménager dans une ferme et avoir des animaux à sauver. (rires) En ce qui concerne la musique, je préfère être dans le moment et ne pas avoir d’attente.
Ensuite, mon vœu pour le futur, (réfléchit)… serait de mettre fin au spécisme. Ce serait un bon début pour freiner la catastrophe climatique. Les émissions de l’industrie de la viande à elles seules ont un tel impact… C’est très spécifique, il y a beaucoup de choses qu’on peut changer. Je pourrais aussi dire que je veux la paix dans le monde… (rires).
Spandrel? est maintenant disponible à l’écoute sur toutes les plateformes : https://pan.lnk.to/Spandrel
Image à la Une : Maria Koutroubi
Relecture : Pier-Paolo Gault
Cet article Evita Manji : « Mettre fin au spécisme serait un bon début pour freiner la catastrophe climatique » provient de Manifesto XXI.



Les autorités sanitaires américaines proposent un assouplissement des restrictions encadrant les dons de sang des HSH, par la suppression du délai d’abstinence préalable, au profit d’une évaluation individuelle.
L’article États-Unis : vers une levée du délai d’abstinence encadrant le don du sang par les HSH est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Une première marche blanche sera organisée le dimanche 5 février 2023 à Epinal, à 14h, depuis la place du Maréchal Foch, en mémoire de Lucas, 13 ans, qui a mis fin à ses jours le 7 janvier dernier, victime de harcèlement scolaire et d'homophobie.
L’article Une marche blanche en hommage à Lucas, le 5 février à Epinal est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Une première marche blanche sera organisée le dimanche 5 février 2023 à Epinal, à 14h, depuis la place du Maréchal Foch, en mémoire de Lucas, 13 ans, qui a mis fin à ses jours le 7 janvier dernier, victime de harcèlement scolaire et d'homophobie.
L’article Une marche blanche en hommage à Lucas, le 5 février à Epinal est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Suite à l'ouverture de l'enquête préliminaire, quatre mineurs ont été placés en garde à vue par la sûreté urbaine du commissariat d'Épinal. Ils vont être « jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide » du jeune Lucas.
L’article Décès de Lucas : Quatre mineurs « jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide » est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.


L’Allemagne a salué vendredi la mémoire des victimes LGBT+ emprisonnées, torturées et assassinées sous le IIIe Reich, et encore contraintes longtemps après la guerre à « se cacher et à se renier ».
L’article Commémorations de l’Holocauste : L’Allemagne honore pour la première fois les victimes LGBT+ du nazisme est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

 Tar est le nouveau film qui met en scène Cate Blanchett dans le rôle d’une cheffe d’orchestre dont la vie s’écroule. Ok, c’est beau, mais bordel, il a voulu dire ...
Tar est le nouveau film qui met en scène Cate Blanchett dans le rôle d’une cheffe d’orchestre dont la vie s’écroule. Ok, c’est beau, mais bordel, il a voulu dire ... 
Cet article La soirée de cabaret au poil Velu·e débarque au Hasard Ludique provient de Manifesto XXI.
Jeudi 9 février, le Hasard Ludique accueille la 5ème édition de la Velu·e, « Cabaret de tous poils ».La scène cabaret parisienne est en plein renouveau, et il y en a pour tous les goûts. Avec son nom très imagé, la Velu·e promet de la douceur mais aussi une bonne dose d’irrévérence, tant le poil est mal aimé.
La soirée a été fondée au printemps 2022 par une bande d’artistes qui agitent la scène parisienne depuis quelques années déjà : enfant de Pigalle pleine de gouaille, la chanteuse Üghett (à qui on doit la reprise des nuits d’une demoiselle de Colette) est la madame Loyale de la troupe. La sélection musique de Velu·e est assurée par les DJs et organisateurs de soirée Fabisounours et Loki Starfish (membres du collectif Bragi Pufferfish). Enfin, c’est l’acteur et créateur de lumières Edouard L.K-H qui assure la mise en scène de l’ensemble des spectacles. Les fondateurices de Velu·e cherchent à créer une atmosphère de « Montmartre imaginaire », un lieu idéal perdu dans le temps, piochant dans le meilleur de toutes les époques pour composer un show unique. La troupe a fait ses armes au Cirque Electrique et s’apprête désormais à conquérir d’autres scènes, à commencer par la salle du Hasard Ludique.
A l’affiche de cette nouvelle soirée de cabaret, Velu·e vous propose des artistes drag et burlesques bien connu·es de la capitale. Pour vous éblouir, Velu·e accueille la belle Charly Broutille, la silhouette piquante de Mademoiselle Kiss (co-host du show Kiss my valentine !), la diva Ruby On the Nail (host de La boîte à bijoux) et enfin Père Eustache aka Julie Furton, qu’on a pu voir jouer dans le court-métrage King Max, très remarqué à Cannes en 2021.
Le cabaret sera bien sûr suivi d’un dancefloor.
La billetterie – L’événement Facebook
Image à la Une : Velu·e du 12 janvier © Susy Lagrange
Cet article La soirée de cabaret au poil Velu·e débarque au Hasard Ludique provient de Manifesto XXI.


Cet article Vers une éducation queer : comment repenser la pédagogie ? provient de Manifesto XXI.
À l’heure d’une implosion du monde éducatif et d’une renégociation des luttes, une poignée de professeur·es, chercheur·ses et activistes s’inspirent des pédagogies critiques pour tenter de transformer nos schémas d’enseignement. Réuni·es autour l’association Queer Education mais aussi au-delà, iels cherchent à dynamiter les normes pour insuffler un regard plus queer et progressiste dans nos écoles.Dans l’essai de bell hooks Apprendre à transgresser, publié en 1994 (et traduit en français en 2019 aux éditions Syllepse), on peut lire ceci : « Enseigner est un acte performatif. (…) J’ajoute à travers ces essais ma voix aux appels collectifs pour le renouvellement et la régénérescence de mes pratiques enseignantes. (…) Je célèbre l’enseignement qui favorise la transgression ». Des phrases lourdes de sens, aux teintes révolutionnaires, qui trouvent aujourd’hui une résonance chez certain·es professeur·es, activistes et théoricien·nes francophones.
Depuis plusieurs années, le malaise est palpable au sein de l’Éducation nationale et du corps enseignant. Omerta face à certaines dérives managériales dans les établissements, multiplication des burn out des enseignant·es, manque de moyens… Durant l’année scolaire 2018-2019, 58 agent·es de l’Éducation nationale se sont donné la mort, selon les chiffres du ministère. Par ailleurs, de plus en plus de professeur·es dénoncent leurs conditions de travail sur les réseaux sociaux, comme les personnels du Lycée Voillaume à Aulnay-sous-Bois, qui ont rapporté dans plusieurs médias la vétusté du bâtiment et le manque de moyens mis dans l’embauche d’agent·es et dans l’entretien de l’établissement. Un emballement médiatique qui a d’ailleurs poussé le nouveau ministre Pap N’Diaye et la présidente de région Valérie Pécresse à se rendre dans l’établissement pour constater les faits.
Aussi, la transmission en France reste très verticale, laissant toujours l’élève dans une position d’apprenant absorbant le savoir du ou de la professeur·e placé·e sur son piédestal. Et décentrer les points de vue ou adopter l’écriture inclusive pour aller dans le sens d’une évolution des mœurs semble encore difficile dans le contexte éducatif français, comme le souligne ce bulletin officiel de l’Éducation nationale en 2021.
Queeriser l’éducationAlors, comment faire pour que la situation évolue vraiment ? Pour beaucoup, le changement doit se faire de l’intérieur et en profondeur, du primaire au supérieur sans distinction. La clef : proposer de nouveaux modes de transmission. Un mouvement aujourd’hui majoritairement porté par des personnels queers et minorisés, qui tentent de réactualiser les fondements de la pédagogie critique. En s’appuyant sur la pensée de Célestin Freinet – qui dans la première moitié du XXème siècle prônait des modes d’enseignements plaçant l’élève au cœur du projet éducatif –, ou encore de celle de Paolo Freire – pédagogue bresilien concevant l’enseignement comme un outil d’émancipation des populations opprimées et d’ouverture à la conscience critique –, ces nouveaux·lles enseignant·es portent le projet d’une école inclusive, imprégnée par les avancées sociales de notre époque.
Pour Timothée Magellan, professeur agrégé de lettres en Ile-de France et instigateur de l’association Queer Education, le déclic s’opère en 2019. À cette période, il a des discussions passionnantes avec le designer social et professeur aux Pays-Bas Gabriel Fontana autour des pédagogies critiques, de la discrimination en milieu scolaire ou encore d’une approche queer de l’éducation. L’enseignant se met à chercher des associations traitant de ces questions, mais son investigation reste au point mort. La plupart des initiatives qu’il découvre ne se sont pas pérennisées dans le temps. Il décide alors, d’abord de façon amatrice, de lancer un groupe de discussion et de réflexion à destination des professeur·es sur les réseaux sociaux. L’engouement se fait rapidement sentir et le groupe s’élargit. « J’avais l’impression que mon lieu de travail était en marge des questionnements politiques que je traversais. À ce moment-là, je me suis dit que je ne pouvais pas continuer à être professeur sans essayer de jouer un rôle vis-à-vis des problématiques qui me préoccupaient », amorce Timothée.
Aujourd’hui, son association multiplie les actions. Elle développe des groupes de discussion et des formations à destination des professeur·es pour parler de leurs expériences en tant que personnels discriminés, des ateliers avec des artistes et designers en milieu scolaire comme ceux développés avec Gabriel Fontana sur la question du sport abordé dans une perspective critique et sociologique, mais aussi des journées d’études comme celle organisée en juillet 2021 à la Station Gare des Mines à Paris, « L’école : entre corps et espace ».
Il y a quelque chose chez Queer Education qui est de l’ordre d’une mise en commun informelle en termes de pratiques qui nous dit beaucoup de la manière dont les pédagogies alternatives sont maintenant mieux comprises et peut-être plus légitimées.
Gabrielle Richard, sociologue
 Atelier Queer Education au MAC Val
Atelier Queer Education au MAC Val
Une envie de porter d’autres modèles d’éducation, que l’on retrouve partagée et véhiculée dans les écrits de la sociologue du genre Gabrielle Richard. Cette chercheuse d’origine québécoise développe principalement ses recherches sur l’expérience scolaire et éducative des personnes LGBTQI+. En 2019, elle publie aux Éditions du remue-ménage Hétéro, l’école : Plaidoyer pour une éducation anti-oppressive à la sexualité, un essai qui met en lumière la capacité du système scolaire à reproduire insidieusement – notamment via ses « programmes d’éducation sexuelle » en vigueur depuis quelques décennies – les normes de genre et d’orientation sexuelle.
Depuis sa sortie, cet ouvrage a trouvé une résonance toute particulière en France chez le corps enseignant. Pour la sociologue régulièrement sollicitée pour animer des formations auprès des professeur·es, des associations telles que Queer Education permettent véritablement de pallier un manque et de mettre en application des conceptions de la pédagogie encore trop théoriques. « Il n’y a aucun doute à l’idée qu’il y avait déjà des professeur·es qui se posaient des questions, par rapport à leur pratique, aux rapports de domination dans l’enceinte de l’école, mais ces personnes-là n’étaient pas en mesure d’être en lien, de croiser leurs regards, ajoute-t-elle. Il y a quelque chose chez Queer Education qui est de l’ordre d’une mise en commun informelle en termes de pratiques qui nous dit beaucoup de la manière dont les pédagogies alternatives sont maintenant mieux comprises et peut-être plus légitimées. »
« Curriculum caché »Ce qui m’intéresse, c’est vraiment de regarder la manière dont les différentes idéologies façonnent des mouvements.
Gabriel Fontana, designer social et professeur
Certain·es œuvrent à hacker le système par des stratégies de détournement comme Sarah Viguer, professeure et designer textile basée à Marseille : « Au tout début de ma carrière de prof, j’étais pleine d’ambition. Je voulais tout changer. Forcément, tu te heurtes à des programmes, à l’Éducation nationale, à tes collègues. Tout l’appareil un peu carcéral de l’école, j’ai réussi à jouer avec, déclame la jeune femme enseignant aujourd’hui dans la section art du Lycée Diderot de Marseille. Elle use alors de plusieurs astuces qui lui permettent d’instituer un terrain de confiance avec ses élèves : « Je ne mettais la note à un rendu que lorsque j’avais fait plusieurs aller-retours avec l’élève, je ne faisais l’appel que l’après-midi… disons que ce sont mes choix et ça m’a permis de créer un milieu fertile. »
Pour cette professeure en classe de DNMade (diplôme national d’art, l’équivalent du niveau licence section mode), l’important est avant tout que les élèves se sentent bien et gagnent la confiance nécessaire pour mener à bien leur projet. Pour elle, cela passe aussi par la manière dont on place les élèves dans le discours. « Mon entrée dans le cours, c’est beaucoup la matière et le bagage personnel de mes étudiant·es. Il y a un vrai positionnement identitaire en mode. C’est souvent lié à des questions de genre, de race, de classe aussi. Le vêtement devient alors un support d’expression, de lutte, appuie Sarah Viguer. On prend le temps de mettre ça au centre, de voir la valeur de leurs expériences. » À cela s’ajoute un travail de recherche théorique et iconographique, pour que les élèves fassent dialoguer leurs expériences de vie avec celles d’autres artistes ou théoricien·nes. Une manière pour elleux de se sentir compris·es et entouré·es afin de gagner en confiance pour développer leur créativité.
Ce sont les personnels queers et discriminés qui peuvent porter de nouveaux modèles de pédagogie et en même temps, on souffre aussi des pratiques pédagogiques existantes, du coup il est difficile d’opérer des transformations.
Timothée Magellan, professeur de lettres et co-fondateur de Queer Education
C’est aussi la place du corps des étudiant·es qui est interrogée dans ces approches pédagogiques alternatives. Le corps de l’élève entre en résonance avec son environnement et cela a une incidence réelle sur son comportement. Des enjeux directement questionnés dans le travail de Gabriel Fontana, et qu’il essaye de transmettre à travers des ateliers en milieu scolaire avec des élèves en France et aux Pays-Bas. « Dans ma pratique, ce qui m’intéresse, c’est vraiment de regarder la manière dont les différentes idéologies façonnent des mouvements. Mon champ d’étude rend compte du fait que le corps exprime, intériorise différentes normes sociales et, du coup, différentes normes genrées. J’utilise des outils d’exploration et d’expérimentation qui visent à déconstruire ces normes et à repenser nos relations sociales » explique-t-il.
Avec son projet Multiform, le jeune designer remet en cause les rôles sociaux et leur fluidité à travers un jeu (prenant les contours d’un « Poule renard vipère ») qu’il transpose dans la classe de sport. Une manière de sonder ces enjeux conceptuels directement auprès des élèves. Ce jeu les invite à discuter par la suite d’inclusion sociale, d’empathie à l’échelle d’un groupe, mais aussi d’ouvrir à des questions liées à l’intimité ou à l’identité. C’est aussi l’espace éducatif que le designer tente de déconstruire : « L’idée c’est de pouvoir percevoir comment tout est agencé, que ce soit la cour de récré mais aussi les couloirs, les toilettes, la salle de classe, percevoir comment le design de ces espaces reproduit certaines normes, certaines idéologies et valeurs sociétales, et d’en constater l’impact sur les corps. On parle alors de curriculum caché. »
Pour une passation de la mémoire de luttesAdopter une posture critique est aussi une manière de pallier les manques et les souffrances du corps professoral, et plus particulièrement pour les personnels discriminés. « Ce qui m’a vraiment surpris, c’est que Queer Education a beaucoup essaimé. Il a suscité un intérêt considérable auprès de différentes personnes. On est plus de 2000 personnes aujourd’hui sur le groupe privé de l’association. Il y avait un vrai besoin » constate Timothée Magellan avant d’ajouter que « ce sont les personnels queers et discriminés qui peuvent porter de nouveaux modèles de pédagogie et en même temps, on souffre aussi des pratiques pédagogiques existantes, du coup il est difficile d’opérer des transformations. »
Le collectif et l’organisation en réseau semblent être les seules armes viables dans ce système oppressif. À plusieurs, on a la force nécessaire de mettre en œuvre des changements, comme le souligne le professeur de lettres : « Je pense à ce que disait Audre Lorde dans Sister Outsider sur l’idée qu’on ne détruit pas la maison du maître avec les outils du maître. C’est pour ça que l’on essaye de réfléchir à d’autres formes de luttes et que l’on travaille avec d’autres collectifs comme les Archives LGBTQI ou le Collectif MU. On est vraiment dans une période de passation des mémoires de luttes, des mémoires collectives. »

À travers leurs engagements, ces professeur·es et chercheur·ses témoignent d’un mouvement qui existe bel et bien pour faire bouger les lignes de l’éducation. À coups de tables rondes, de publications d’essais et d’articles, de formations, la révolution de nos systèmes scolaires pourrait bien être doucement en cours. Timothée Magellan de conclure, toujours optimiste : « Notre entretien témoigne d’un bouillonnement parmi les forces associatives et militantes. D’un feu qui peut nous éclairer. Un feu collectif qui est signe de vie parmi des instances qui aimeraient nous voir mortes. Je pense que quelque chose qui s’enracine va germer, se développer et prendre au piège tout ce pourquoi l’on se bat. »
Relecture et édition : Apolline Bazin, Anne-Charlotte Michaut et Sarah Diep
Image à la Une : Multiform © Iris Rijskamp
Cet article Vers une éducation queer : comment repenser la pédagogie ? provient de Manifesto XXI.

Paru en janvier 2017 aux éditions Julliard, le roman autobiographique de l'écrivain britannique Philippe Besson, « Arrête avec tes mensonges », best-seller traduit dans une quinzaine de langues et qui retrace le premier amour de deux adolescents, Stéphane et Thomas, à l’été 84, sort en salle ce 22 février.
L’article « Arrête avec tes mensonges » : l’autofiction de Philippe Besson enfin au cinéma est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Avec sa houppette blonde et son éternel outfit serpent-léopard, l'activiste lesbienne berlinoise Mahide Lein ne passe pas inaperçue. À 73 ans, elle promeut le sexe et l'humour comme élixir de jeunesse. Rencontre.
L’article Masturbez-vous! est apparu en premier sur 360°.

Le pontife appelle de ses vœux un « processus de conversion » pour que les prêtres qui soutiennent ces lois accordent une dignité égale à tous et accueillent des personnes homosexuelles dans leurs églises, qui doivent participer à l’abrogation de telles réglementations.
L’article Le pape François juge « injustes » les lois qui criminalisent l’homosexualité dans le monde est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Catherine Guesde, chercheuse de noises provient de Manifesto XXI.
Philosophe des musiques marginales et radicales, Catherine Guesde mène en parallèle un projet à mi-chemin entre drone et noise music sous le nom de Cígvë. Elle a dirigé la publication du livre Penser avec le punk, sorti au mois d’août dernier aux éditions PUF. Rencontre.Catherine Guesde a de quoi faire transpirer plus d’un·e journaliste. À la fois autrice, musicienne noise, docteure en philosophie, chercheuse et elle-même anciennement journaliste, il est difficile de la présenter avec concision. Rencontrée l’été dernier dans le cadre d’une conférence au SOMA à Marseille à propos de La Monte Young [un compositeur américain pionnier de la musique minimaliste drone et tout son mouvement], nous avions ensuite eu une discussion tous azimuts, débordant du seul cadre de la conférence.
Diplômée de l’École normale supérieure de Lyon puis de l’EHESS, Catherine Guesde a en 2018 co-écrit et publié avec Pauline Nadrigny The Most Beautiful Ugly Sound in the World (éd. MF), un ouvrage dans lequel elles étudient les codes et l’esthétique de la noise, et plus particulièrement de la harsh noise, afin d’en préciser les contours et d’interroger la place de ce genre qu’on a parfois du mal à qualifier de « musique ». Elle a également produit deux EP de drone/noise guitar sous son alias musical Cígvë : What Makes Them Burn (2020), dont les mélodies vous emmènent de la contemplation jusqu’à la brûlure, puis Hearth (2021), une cassette sortie en édition limitée sur le label Titania Tapes.
La récente publication de Penser avec le punk (PUF) était l’occasion rêvée pour nous de partager cet entretien. Ayant l’ambition « d’étendre le champ d’action du punk au domaine de la pensée », le propos du livre fait aussi écho à la conversation que nous avions eue, tissant des liens entre la musique et l’esprit. Entre son rapport aux bruits du quotidien, la portée spirituelle avérée ou non de la musique drone, les liens insoupçonnés entre black metal et débats de philosophie politique, sans oublier bien sûr son amour pour la noise, retour sur une rencontre passionnante avec Catherine Guesde.
Au-delà de l’esthétique, il y a presque quelque chose d’éthique dans la noise : une forme de franchise frontale qui ignore la politesse.
Catherine Guesde
 © Amandine Joannes
© Amandine Joannes
Manifesto XXI – Tu évoques un effet de « avant/après » la découverte de la noise dans ton approche de la musique. Pourrais-tu revenir sur « l’avant » et nous parler de tes premières affinités musicales : est-ce que tu vois a posteriori une « filiation logique » dans ton amour actuel de la noise ?
Catherine Guesde : Ce qui est drôle, c’est que j’ai d’abord été passionnée par la musique classique et baroque lorsque j’étais enfant. Je rêvais d’être cantatrice et de chanter du Pergolèse. Puis adolescente, j’en suis venue au punk, qui me plaisait par son côté à la fois harmonieux et agressif. Progressivement, via des magazines, j’ai découvert le black metal, qui m’a fascinée – même si à quatorze ans j’avais le sentiment que c’était transgressif et que ça faisait vaguement peur. En ce qui concerne la noise, je crois que j’avais envie de continuer à aller vers des choses un peu étranges et moins accessibles, mais dont la compréhension pouvait être gratifiante. C’est parti d’une curiosité et d’une envie d’expérimenter que je pourrais un peu comparer à l’idée d’apprendre une langue étrangère. J’ai vite eu une affinité avec les timbres très riches et abrasifs. Au-delà de l’esthétique, je trouve qu’il y a presque quelque chose d’éthique : une forme de franchise frontale qui ignore la politesse.
Est-ce que cette découverte t’a rendue insensible ou ennuyée par d’autres genres disons plus « conventionnels » ?
Ça dépend réellement des contextes d’écoute et des moments ; il m’arrive souvent d’écouter de la folk et plein d’autres choses. Là où cette découverte a changé des choses pour moi, et c’est sans doute un cliché mais qui est fondé dans l’expérience, c’est que ça a réellement modifié mon rapport aux bruits du quotidien : il y a les drones harmonieux du RER, qui varient selon les stations par exemple… En un sens c’est comme si j’entendais de la musique partout, donc c’est plutôt une expansion de la musique dans ma vie, à l’inverse d’une réduction.
Qu’est-ce qui t’a décidée à consacrer un livre (The Most Beautiful Ugly Sound in the World) autour de la noise ?
J’aimais déjà écrire sur la musique puisque j’ai travaillé comme journaliste. Mais lorsque j’ai exercé ce métier à plein temps, je trouvais que notre travail se faisait trop au rythme des sorties et des communiqués de presse, et ne nous permettait pas d’approfondir certains genres ou disques qui pourtant le méritaient. C’est ce qui m’a donné envie de retourner dans le cadre universitaire, pour écrire plus longuement sur les musiques qui me tenaient à cœur. C’était au début des années 2010, il y avait à l’époque des débats à propos du Hellfest, notamment avec Christine Boutin qui trouvait en gros que les groupes qui y sont programmés corrompent la jeunesse, risquent de rendre sataniste, etc. Leur argumentaire était assez perché, mais cette polémique soulevait une question philosophique très ancienne : la musique a été abordée dès l’Antiquité par le prisme de la morale. Platon et Aristote se demandent quels sont les effets de la musique sur le caractère et le comportement. Du coup j’ai eu envie d’aborder dans une perspective philosophique cette question de savoir si l’écoute de sons abrasifs, agressifs, que l’on trouve dans le metal extrême, nous modifie. J’ai resserré la question pour m’intéresser plus précisément au plaisir pris à ces genres que beaucoup de gens rejettent.
Écouter un son ou un accord pendant des heures peut être frustrant pour cet appétit de la distraction et du plaisir immédiat si cher à notre cerveau. Cela tend peut-être vers l’idée d’accueillir le monde comme tel.
Catherine Guesde
Lorsque John Cage déclare « Cela m’a pris 5 ans pour composer 4’33’’ » [une pièce de piano constituée uniquement de silence], est-ce qu’on peut le prendre au premier degré et y voir un apprentissage du silence voire de la méditation ? Plus généralement, crois-tu que la musique minimaliste, la noise ou la drone aient une portée d’éveil spirituel ?
Je crois que la portée de la noise et de ces musiques réside surtout dans une notion d’éducation au sensible, une sortie des schémas binaires du « j’aime » ou « j’aime pas » ce son. Pour moi, du côté de la noise, il s’agit surtout de se défaire des codes et de tenter d’accueillir l’expérience au-delà de nos réflexes habituels.
Cette manière de comparer l’écoute à des expériences mystiques, on la retrouve plutôt du côté du drone metal – il y a un bouquin d’Owen Coggins sur la question, Mysticism, Ritual and Religion in Drone Metal. Il recueille des témoignages d’auditeurs et repère qu’ils utilisent, dans leurs discours pour décrire leur expérience, des procédés similaires à ceux qu’on trouve dans les textes mystiques. Il s’agit plutôt d’une déformation du langage. On parle de mystique plutôt par comparaison, c’est de l’ordre du « comme si », et je reste assez attentive à cette distinction.
Pour revenir à la noise et au drone, il est vrai que chez John Cage, La Monte Young et bien d’autres, il y a effectivement une pratique du zen et de la méditation. Écouter un son ou un accord pendant des heures peut être frustrant pour cet appétit de la distraction et du plaisir immédiat si cher à notre cerveau. Donc je dirais que si on doit trouver un lien avec la spiritualité, il est éventuellement dans cette invitation à développer une discipline de l’attention, à la conserver aussi ouverte et curieuse que possible. Cela tend peut-être vers l’idée d’accueillir le monde comme tel.
À l’écoute de mantras ou de certaines musiques, il est possible qu’une légère modification de la conscience se produise. Dans le livre d’Owen Coggins que tu évoquais, un auditeur de drone metal déclare par exemple « Dieu existe, il m’a fouillé avec sa basse »…
Ce sont des expériences particulières, c’est certain. Cette musique produit un effet sur le corps et on ne peut pas le nier ou banaliser cela. C’est aussi une expérience physique qu’on ne fait pas tous les jours – sentir son squelette vibrer par exemple, comme ça peut arriver à un concert de Sunn O))). En revanche, il me semble important de préciser qu’il y a avant tout un amour du son pour lui-même et de la sensation qui y est liée ; ça n’est absolument pas une pilule ou un remède – cette conception nous ferait basculer du côté du new age et ce serait hors de propos. Après, il y a aussi le fait que la musique drone est une forme de ralentissement du temps, diamétralement différent du rythme de vie que nous connaissons dans l’expérience quotidienne. Ce ne sont pas les mêmes coordonnées. Le drone peut alors faire office de « mur blanc » pour méditer, comme le font certains pratiquants du zen.
L’esthétique contemporaine de la nuit et de la rave emprunte aussi de plus en plus fréquemment des références au sacré ou au mystique, comme si les fêtes étaient de nouvelles messes ?
Ce qui est ennuyeux avec les chercheur·ses, c’est qu’on ne veut pas s’aventurer dans les terrains qui ne sont pas les nôtres ! (Rires) Mais oui, ce sont des analyses que l’on peut trouver ; il faut cependant rester attentif au fait qu’il s’agit d’une analogie qui a ses limites. Après, dans la rave comme dans le drone metal, il y a certainement aussi quelque chose de corporel qui se joue. Un moment où l’esprit, la pensée ou la réflexion ne sont plus invités, où nous sommes là pour laisser le corps être dans cette répétition rythmique. C’est un moment de fête où nous avons besoin que l’ordre ne soit plus le même que dans le quotidien. Finalement les périodes de confinement ont interrogé ce rapport à la fête et à l’exutoire qu’elle représente, cela a véritablement pu créer un manque. La pandémie a amené des débats où l’on en venait à se demander si la fête est essentielle ou non. Elle a toujours eu un rôle anthropologique central en réalité.
 © Amandine Joannes
© Amandine Joannes
Tu as également un projet musical noise appelé Cígvë. Est-ce que le fait d’avoir étudié la musique avec autant de précision en tant que chercheuse a pu être quelque chose d’inhibant pour ta créativité ?
Je segmente à mort ! J’ai appris la guitare en autodidacte alors que j’ai une formation classique au piano, et je tiens absolument à garder ce côté spontané et barbare dans ma musique. Mon approche est expérimentale et instinctive et je souhaite qu’elle le reste. J’ai bien assez l’occasion d’avoir une pensée critique et de la réflexion dans d’autres aspects de ma vie…
Dans une époque où la musique mainstream devient hyper marketée et parfois formatée, l’approche des minimalistes est assez radicale, à contre-courant : est-ce que cela pourrait inspirer un renouveau et un rafraîchissement dans la créativité actuelle ?
Je pense que c’est déjà le cas ! Mais à l’échelle de scènes plutôt de niche comme le drone metal ou la noise, avec des groupes comme Earth ou Sunn O))), ou même du côté de la techno ou de l’IDM… C’est intéressant de constater que La Monte Young a un écho auprès des musiques populaires et marginales plutôt que dans les musiques dites savantes. Après, pour revenir à cette question du renouveau : pour l’écriture du livre The Most Beautiful Ugly Sound in the World, j’avais rencontré GX Jupitter-Larsen. Il est dans les performances noise depuis les années 70, et il m’avait dit en gros que, dans la noise parfois on se demande si on peut encore aller plus loin la non musicalité. Et il rigolait : « À chaque fois, quelqu’un débarque et y arrive, à faire quelque chose qui est encore pire, encore plus éloigné de la musique. » Je me cache un peu derrière lui pour cette réponse mais je dois dire qu’il était assez optimiste. Il y a toujours quelqu’un pour réinventer quelque chose encore plus perché, parfois encore moins musical, mais qui amène une nouvelle façon d’écouter. Je crois que c’est une attitude face au sonore et à la création qui pousse à constamment s’ouvrir.
Relecture et édition : Sarah Diep
Image à la Une : © Rudy Etienne
Cet article Catherine Guesde, chercheuse de noises provient de Manifesto XXI.

Dans un « souci d'apaisement », face aux attaques de militants de la Manif pour Tous et d'un groupuscule d'extrême droite, la mairie de Toulouse cède et annonce l'annulation d'un atelier de lecture visant à « sensibiliser » les jeunes « à la différence, de manière ludique ».
L’article La mairie de Toulouse déprogramme un atelier de lecture pour enfants animé par des drag-queens est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

 Marcia Burnier, autrice des Orageuses, dévoile aujourd’hui une nouvelle série d’entretiens autour de l’écriture, à écouter dès maintenant sur Radio Bascule. Avec l’émergence des réseaux sociaux, de nouveaux métiers ...
Marcia Burnier, autrice des Orageuses, dévoile aujourd’hui une nouvelle série d’entretiens autour de l’écriture, à écouter dès maintenant sur Radio Bascule. Avec l’émergence des réseaux sociaux, de nouveaux métiers ... 
Cet article Éviter le saccage : comment la lutte contre les JO Paris 2024 s’organise provient de Manifesto XXI.
Mardi 24 janvier, s’ouvrait au Sénat l’examen de la Loi olympique II, qui entend notamment légaliser la vidéosurveillance algorithmique, « dans un cadre expérimental jusqu’en juin 2025 ». A l’heure où les pelleteuses retournent la Seine-Saint-Denis, le ministère de l’Intérieur a déjà annoncé la mobilisation de 35 000 forces de sécurité intérieure pendant le méga-événement. Gentrification, surveillance, sécurité : quel genre de monde nous annonce l’approche des JO Paris 2024 ?Plus de 200 personnes étaient réunies ce samedi 14 janvier dernier à la Flèche d’or, autour de la soirée « JO sécuritaires : l’étau se resserre », co-organisée par La Quadrature du net et le collectif Saccages 2024. Des jeunes, des vieux, des moyens, habitant·es de la Seine-Saint-Denis et d’ailleurs, militant·es d’association et de collectifs, allié·es ou intéressé·es, chercheur·euses, élu·es locaux·ales, conseiller·es régional·es. Aux tables rondes (présentation de l’initative Technopolice par la Quadrature du net ; interventions de deux membres de Saccages 2024 ; de Matheus Viegas Ferrari, doctorant à l’université Paris 8 et à l’Université Fédérale de Bahia ; et de Marianna Kontos, doctorante à l’Université Paris Nanterre) ont succédé une discussion collective ainsi qu’une série d’ateliers contre-olympiques, puis un DJ set. « Les Jeux Olympiques, c’est le vieux monde qui ne veut pas mourir », déclare au micro un militant anti-JO , en clôture du débat.
Je vis dans le nord de la Seine-Saint-Denis, où l’essentiel des infrastructures olympiques manquantes sont en train d’être construites. Pas un jour ne passe sans que, sous nos yeux, la terre ne se remue en préparation du méga-événement. En plus des chantiers et de leurs effets imminents sur les conditions de vie des habitant·es du 93, les Jeux Olympiques de Paris 2024 se font le cheval de Troie d’un projet de gouvernement néolibéral, extractiviste et sécuritaire. Contre ce destin, la lutte est en cours depuis plusieurs années, en Île-de-France et ailleurs dans le monde.
Paris 2024, un présent dystopiqueLa cérémonie d’ouverture du méga-événement, dont le budget lunaire s’élève à 166 millions d’euros (sur un budget total passé de 6,2 à 8 milliards d’euros environ), semble contenir en elle-même tout l’arsenal d’un présent dystopique. D’après les annonces de Gérald Darmanin, la cérémonie devrait se dérouler hors stade (une première pour les Jeux Olympiques d’été), dans une immense mise en scène pyrotechnique, à bord d’installations et de bateaux circulant sur la Seine, le long d’un parcours de 6 km, entre le pont d’Austerlitz et le pont d’Iéna. 600 000 personnes seraient attendues le Jour J : 500 000 gratuitement, sous réserve de se munir d’un billet permettant de contrôler leur accès ; et 100 000 autres spectateurs, qui paieront leur place entre 90 et 25 000 euros. Ce jour là, et sur toute la durée des Jeux, 35 000 forces de sécurité intérieure (police et gendarmerie), accompagnées de 3 000 agents de sécurité privée, seront présents.
Lorsqu’on sait que les éditions précédentes des Jeux Olympiques ont rejeté en moyenne entre 1,5 et 3,5 millions de tonnes de CO2, on s’interroge sur le coût écologique d’un tel spectacle. Mais ça n’est pas tout : si les différents acteurs s’accordent pour construire la majorité des infrastructures olympiques manquantes en Seine-Saint-Denis, la cérémonie place évidemment Paris sous les feux des projecteurs, afin de démontrer sa puissance et sa légitimité internationale. Pour Mathieu Viegas Ferrari, qui s’intéresse aux effets politiques des méga-événements, il s’agit pour l’ancienne première destination touristique mondiale de « faire ses preuves concernant sa capacité à gérer un dispositif de sécurité après les attentats de 2015-2016 ».
Pour le chercheur, ces Jeux Olympiques vont produire un « effet cliquet », c’est-à-dire « justifier la mise en place de mesures drastiques, par un état qualifié d’exceptionnel, sur lesquelles il ne sera plus possible de revenir par la suite ». Ils sont un prétexte pour expérimenter et accélérer le déploiement de technologies de surveillance aujourd’hui illégales, en phase d’être légalisées (notamment par les Lois Olympiques I et II de 2018 et 2023, la Loi sécurité globale ou encore la Loi drones II, conçues en anticipation des Jeux). De tels effets ont déjà été observés lors d’éditions précédentes : par exemple, à Rio, en 2016, où Mathieu Viegas Ferrari était présent en tant que militant, les lois antiterroristes édictées pour l’événement ont ensuite servi d’instrument de répression contre les manifestants au gouvernement du président précédent.
 Vidéo de soutien des militant·es japonais de « Hangorin No Kai » envoyé à Saccages 2024 en décembre 2022, screenshot de la chaîne Youtube du collectif
Vidéo de soutien des militant·es japonais de « Hangorin No Kai » envoyé à Saccages 2024 en décembre 2022, screenshot de la chaîne Youtube du collectif
L’effet cliquet concerne aussi la fabrique de la ville, puisque la définition des Jeux Olympiques comme une OIN (Opération d’intérêt national) permet ne pas tenir compte des documents réglementaires d’urbanisme, ni des processus de concertations obligatoires (qui n’ont déjà, en général, qu’une valeur consultative). La voie est libre, donc, pour la spéculation foncière sauvage. « On s’inscrit dans un déjà-là, où, avec la désindustrialisation, de grandes surfaces de terrain se libèrent et représentent de très bonnes occasions pour les promoteurs », explique Marianna Kontos. Si le contexte urbain de Rio diffère du contexte francilien, les chiffres n’en restent pas moins parlants : pour préparer le terrain, 119 favelas ont été rasées, ainsi que d’autres logements, à la suite de quoi 77 000 brésilien·nes se sont retrouvé·es sans toît. 80 personnes environ sont mortes de violences policières au cours des d’expulsions. Si l’on est capables de s’indigner contre la Coupe du monde au Qatar, faisons-le aussi lorsque la Solidéo (Société de livraison des ouvrages olympiques) exploite des travailleurs sans papier par exemple.
A court terme et avant tout, les JO de Paris 2024 compromettent la vie des habitant·es du nord de la Seine-Saint-Denis — c’est-à-dire l’une des dernières zones de petite couronne où les populations précaires et issues de l’immigration sont encore majoritairement visibles, où les rencontres ont lieu dans la rue et où l’on peut se nourrir au marché pour dix euros par semaine. Les chantiers des projets olympiques, qui ont déjà commencé, correspondent chacun à des projets Grand Paris et Grand Paris Express : ils sont ainsi bras armé de la gentrification et de la bétonisation. Sur le plan de la répression, on imagine aussi très facilement qui sera visé en priorité, à l’annonce du « plan zéro délinquance » par Gérald Darmanin, destiné à « harceler et nettoyer de la délinquance », à travers 3500 opérations policières en Île-de-France.
Les premières victimes seront les habitant·es de la Seine-Saint-Denis et notamment toutes les personnes qui subissent déjà des violences policières, ou de la répression, quelle qu’elle soit.
Amel, membre de Saccages 2024 et habitante d’Aubervilliers
Le 11 décembre 2022, Saccages 2024 appelait à se réunir devant le siège du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques sur la place du Front populaire à Aubervilliers, pour « faire sa fête au COJO » à l’occasion de la réunion organisée pour révision du budget des Jeux (dont la hausse a finalement été actée à +10%). Une centaine de personnes sont réunies : cantine solidaire, chorale, match de foot improvisé, tables rondes autour de la question sécuritaire, de l’anti-validisme dans le sport et des liens entre écologie et grands projets inutiles et imposés.
Saccages 2024 est né en novembre 2020, suite à une journée d’action Contre la réintoxication du monde. D’abord, il a joué une fonction de coordination entre plusieurs collectifs d’habitant·es du 93 en lutte contre les projets olympiques : le Comité vigilance JO de Saint-Denis, qui collecte et diffuse des informations sur les Jeux depuis 2017 — Notre parc n’est pas à vendre, qui s’oppose à la construction du « cluster des médias », sur 7 hectares, dans le couloir écologique de l’Aire des Vents du Parc Georges Valbon à la Courneuve, puis à sa transformation en « éco-quartier » après 2024 — Pleyel avenir, qui refuse la construction d’un échangeur autoroutier, impliquant un trafic d’environ 20 000 véhicules par jour, aux abords immédiats des écoles maternelle et primaire du groupe scolaire Pleyel, comptant 700 enfants — ainsi que le collectif de Défense des jardins ouvriers d’Aubervilliers, dont les actions ont été plus particulièrement médiatisées. Des militant·es de Youth for Climate, des Brigades de solidarité populaire de Pantin et du collectif Non aux JO faisaient également partie du noyau fondateur. Le collectif s’est ensuite structuré comme un outil de veille autour des projets olympiques, de soutien des luttes contre-olympiques, et d’organisation d’événements anti-olympiques (rassemblements, soirées débats, projections de films au Malaqueen, « toxic tour » ou visites de sites impactés par les JO, organisation des Rencontres internationales anti-olympiques en mai 2022 à l’Université Paris-8, etc.)
Au rassemblement, Amel*, membre du collectif et habitante d’Aubervilliers, déclare : « Les premières victimes seront les habitant.es de la Seine-Saint-Denis (…) et notamment toutes les personnes qui subissent déjà des violences policières, ou de la répression, quelle qu’elle soit. »
« Moi je vis en squat, et la pression du foncier se fait sentir très très fort sur nous : expulsions plus rapides, difficultés pour ouvrir. Il faut que tout soit propre pour l’arrivée des Jeux Olympiques. L’augmentation des loyers a déjà commencé à Saint-Denis et va continuer. C’est un déplacement de population, c’est clair et net. On ne va sans doute plus pouvoir habiter là où on habitait, ou bien plus de la même manière ou dans les mêmes conditions (…) Dans deux ans, ça ne sera plus du tout les mêmes villes (…) Quand on vit ça en tant qu’habitant·es de la Seine-Saint-Denis et qu’on nous explique que ça va être un super héritage, qu’on devrait être très content·es, honoré·es que ça nous arrive, on ressent du mépris », poursuit Amel.
Début 2021, à Saint-Ouen, 286 habitants du Foyer de Travailleurs Migrants de l’ADEF ont déjà été expulsés, malgré une lutte de plusieurs mois, sans perspective de retour dans le quartier, pour laisser place à la construction du futur village olympique.
On s’oppose au chantier, qui ne prend pas en compte les usages qui existent déjà. Il y a des solidarités qui se nouent ici.
Léo, membre du collectif La Boulette, habitante de Saint-Denis
En plus du déplacement des populations minorisées toujours plus loin de la métropole, de la pollution de leurs espaces de vie et de la destruction des quelques portions d’espaces verts qui innervent encore la Seine-Saint-Denis, ce qui se joue, c’est aussi la privatisation massive des espaces publics, et donc, la menace des sociabilités et des solidarités de quartier.
Par exemple, La Boulette s’est formée début 2022, autour de la pratique de la pétanque à la Maltournée — une vaste friche, située à Porte de Paris, au bord du Canal de Saint-Denis, où il y a de l’herbe, des arbres… « C’est un collectif issu d’une bande de potes de Saint-Denis, des personnes qui ont entre la vingtaine et la trentaine, moitié kabyles, moitié français, moitié meufs, moitié mecs », explique Léo, membre du collectif et dionysienne. « Il y a beaucoup de gens qui viennent à la Maltournée, qui vont promener leur chien, des personnes chinoises qui viennent pêcher, des gens qui viennent de toute la Seine-Saint-Denis… Il y a des personnes qui habitent là, dans des cabanes, des gens qui font des barbecues, des kabyles qui viennent boire des coups et jouer à la pétanque, et aussi des personnes blanches ».
Il y a quelques mois, les membres du collectif apprennent que la Maltournée fait l’objet d’un projet de rénovation, réalisé en vue de glamouriser l’entrée de Saint-Denis pour l’événement mondial. « On s’oppose au chantier, qui ne prend pas en compte les usages qui existent déjà (…) ils disent qu’ils veulent mettre des pavés, une piste cyclable, faire un parc classique, réduire le terrain de pétanque. Ils veulent construire des résidences de standing sur une partie de la zone. Il y aura aussi un contrôle des usages avec caméras de vidéosurveillance ». Malgré leur participation à l’enquête publique concernant le chantier, celui-ci a commencé en décembre 2022. Le lieu est désormais inaccessible au public. Une fois par mois, La Boulette organise une cantine mobile pour visibiliser la situation.
Si le projet prévoit de reconstruire un parc, le temps du chantier risque de détruire les usages et d’exclure les usager·es actuel·le·s de cet espace : « Il y a des solidarités qui se nouent ici. Par exemple, Julia est allée là-bas quand elle est arrivée à Saint-Denis, et quelqu’un·e lui a trouvé du travail. C’est un endroit qui est important pour nous, qui le fréquentons de manière régulière et quotidienne ».
Ces luttes locales sont très importantes. Non seulement parce qu’elles émanent directement des premier·es concerné·es par les transformations liées aux Jeux Olympiques, mais aussi parce qu’elles permettent de constater que la machine, qui semble inarrêtable, rencontre néanmoins des pierres d’achoppement. Même si on est très loin d’une hypothétique annulation totale des projets, ces mobilisations ont déjà permis quelques victoires : l’annulation de la construction du surf parc, prévue à Sevran ; l’annulation de la déclaration d’utilité public du Franchissement Urbain Pleyel (qui ne suspend pas pour autant des travaux) ; la révision du permis de construire de la Solideo (Société de livraison des ouvrages olympiques) à Aubervilliers (où les jardins ont été expulsés, rasés, aujourd’hui impénétrables, mais sur l’emplacement desquels le Solarium ne sera finalement pas bâti).
Sécuritarisme et légalisation de la vidéosurveillance algorithmiqueLes Jeux de Paris ne menacent pas seulement de détruire le cadre de vie — voire la vie tout court — des séquano-dionysien·nes. Ce qui se prépare, c’est aussi la légalisation de dispositifs, aujourd’hui illégaux, qui permettront la surveillance généralisée de la population.
Retour à la soirée « JO sécuritaires : l’étau se resserre » du samedi 14 janvier, à la Flèche d’or. Le projet Technopolice réunit des personnes mobilisées contre les technologies de surveillances policières basées sur le Big Data et l’Intelligence Artificielle. Deux militant·e·s nous exposent la situation : L’Article 7 de la loi Olympiques II, dont l’examen sera ouvert au Sénat ce mardi 24 janvier 2023, comprend un article qui entend légaliser la vidéosurveillance algorithmique « dans un cadre expérimental jusqu’en juin 2025 » — expérimentation qui risque de se prolonger pour toujours selon Technopole.
La vidéosurveillance algorithmique permettra de rattacher des individus à une identité sociale, d’identifier les personnes racisées, ou bien leur classe sociale, de repérer les publics jugés indésirables.
Une militante du projet Technopolice
Mais qu’est-ce que la vidéosurveillance algorithmique ?
Il s’agit de la détection, sur des rushes tirés des caméras de vidéosurveillance, de comportements et d’événements considérés comme suspects par des logiciels et algorithmes. Les images recueillies par les caméras sont ensuite envoyées dans des CSU (centres de supervision urbains), où les agents de sécurité sont informés et appelés à intervenir lorsqu’un tel comportement est reconnu par le logiciel. D’après Technopolice, si les menaces évoquées par Gérald Darmanin sont « les attaques terroristes, l’ultra droite, l’ultra gauche », des actions simples telles que courir, s’allonger, rester statique un moment au même endroit, de pénétrer dans un espace privé, ou commettre une simple infraction, pourront alerter le système. « La vidéosurveillance algorithmique permettra de rattacher des individus à une identité sociale, d’identifier les personnes racisées, ou bien leur classe sociale (…) de repérer les publics jugés indésirables », déclare ainsi une activiste de Technopolice.
En France, plus de 800 000 caméras de vidéosurveillance sont déjà installées dans des lieux ouverts au public, parmi lesquelles plus de 70 000 se trouvent sur la voie publique. A l’occasion des JO, le Ministère de l’Intérieur annonce l’ajout de 500 nouvelles caméras de vidéosurveillance à Saint-Denis, 330 à Marseille (où se dérouleront certaines épreuves olympiques) et 1000 à Paris, en plus des 4171 déjà existantes. Sur l’ensemble du territoire, 15 000 nouvelles caméras devraient être installées en France pour les Jeux et la Coupe du monde de Rugby — qui semble avoir été désignée pour faire office de répétition générale en matière de dispositifs sécuritaires. Le budget sécurité pour les Jeux, initialement estimé à 182 millions d’euros, s’élève désormais à 295 millions.
La vidéosurveillance est, en réalité, déjà expérimentée dans une cinquantaine de villes (dont Marseille). D’autres (comme Nice) préfèrent tester des dispositifs de reconnaissance faciale. Ailleurs, le terrain se prépare : un nouveau CSU a été construit à Saint-Denis en 2021, la ville d’Élancourt (qui accueillera les épreuves de VTT) a signé un contrat avec l’entreprise GENETIC, afin de tester de nouveaux types de vidéosurveillance.
Plus généralement, « les JO sont aussi une vitrine pour que les industriels de la sécurité puissent montrer de quoi ils sont capables », déclare une militante. Technopolice a publié à ce sujet l’article « JO 2024 : la frénésie sécuritaire » sur le site du collectif : « [Les] industriels de la sécurité […] se sont regroupés dans un comité intitulé « GICAT » — « Groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestre et aéroterrestre » —, un lobby de pression sur les pouvoirs publics visant à faciliter le déploiement de leurs dispositifs de surveillance. Son délégué, Gérard Lacroix, n’a aucun problème à souligner que les JO seront un enjeu essentiel pour les entreprises françaises et qu’il compte bien faire comprendre aux parlementaires la nécessité de « faire évoluer certains textes » trop restrictifs. Comprendre : les textes qui protègent les libertés. »
Au-delà du pouvoir accru donné aux forces de l’ordre nationales (police, gendarmerie), les JO correspondent aussi à un moment de renfort et d’institutionnalisation de la sécurité privée.
Ysé, Saccages 2024
Le gouvernement estime que les forces de sécurité nationales mobilisées seront au nombre d’environ 35 000 : c’est peu, par rapport aux éditions précédentes des Jeux. Un scénario comparable à celui de l’édition londonienne, lors de laquelle les forces de l’armée sont intervenues, pourrait être à craindre. Pour pallier le manque d’agents disponibles, le gouvernement compte donc recourir à des agents de sécurité privés, qui ne sont pas assez nombreux à être formé·es ou disponibles aujourd’hui. Qu’à cela ne tienne : le gouvernement compte aussi adresser des appels personnalisés aux chômeur·euses et étudiant·es francilien·nes pour les inviter à s’engager dans des formations gratuites au métier.
« Ce ne sont pas les technologies de surveillance qui servent aux JO, mais le contraire », conclut, plus tard, Mathieu Viegas Ferrari. En effet : l’enjeu est bel et bien de se servir des Jeux Olympiques pour rendre acceptable et quotidien cet arsenal sécuritaire liberticide aux yeux de la population.
Démanteler la propagande olympique, faire annuler les JO ?Sur le site officiel de la prochaine édition des Jeux, on peut lire : « Paris 2024 c’est un projet qui vit bien au-delà des Jeux Olympiques et Paralympiques. Opportunité économique, écologique, sociale, c’est l’ensemble de la société qui profitera de l’héritage laissé par les Jeux (…) Éducation, santé, cohésion, le sport a le pouvoir de tout changer (…) Des Jeux durables et respectueux de l’environnement, pour inspirer les générations futures et laisser un héritage positif aux individus et à la société ».
A la lumière des informations exposées par les militant·es de Saccage et de Technopolice, le discours sur les Jeux, répandu par l’État, le CIO (Comité international olympique), mais aussi par de nombreux·ses élu·es, collectivités locales, et institutions culturelles, relève d’une vaste opération de propagande, qu’il faut démanteler.
L’héritage des Jeux olympiques ne bénéficiera évidemment pas à toutes et tous, mais bien plutôt au grand capital, aux promoteurs immobiliers, aux industries sécuritaires, et au gouvernement. Croire que les Jeux Olympiques puissent apporter une quelconque amélioration à la santé des francilien·nes, ou faciliter leur accès au sport, est une aberration lorsqu’on sait que les infrastructures olympiques viennent polluer l’air de la Seine-Saint-Denis et qu’elles seront majoritairement privatisées à la suite des Jeux. Concernant l’impact écologique, Anne Hidalgo avait posé comme préalable à la candidature de Paris le respect d’un objectif d’émission maximal d’1,56 million de tonnes de Co2 : c’est la moitié des émissions réalisées par les éditions de Londres et de Rio, mais c’est déjà trop, et rien ne dit que la promesse sera tenue. Sur le volet éducation et cohésion : n’est-il pas plutôt temps de « remettre en cause la notion de compétitivité, inhérente au sport olympique » comme le dit Ysé, militant de Saccages 2024 ?
Pour conclure, il serait bon de rappeler quelques éléments biographiques de Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux en 1896. Ce dernier se définissait comme un « colonial fanatique ». En 1935, il déclarait au micro d’une émission radiophonique diffusée à Berlin en préparation de l’édition de l’année suivante : « La première caractéristique de l’olympisme est d’être une religion. En ciselant son corps par l’exercice, l’athlète antique honorait les dieux. L’athlète moderne fait de même : il exalte sa race, sa patrie et son drapeau ». On ne s’étonne pas, donc, de la sympathie qu’il manifestait à l’égard du régime hitlérien.
L’édition parisienne de 2024 veut lui rendre hommage, et le CIO déclare que « nous devons à Pierre de Coubertin toute l’organisation des Jeux olympiques, qui ont bénéficié de son esprit méthodique, précis et de sa large compréhension des aspirations et des besoins de la jeunesse » En ce sens, les JO ne réaffirment-ils pas leur adhésion aux normes corporelles racistes et validistes qui sont à leurs fondements, malgré leur prétention ?
En février 2022, dans leur appel pour des Rencontres internationales anti-olympiques, les membres de Saccages 2024 déclaraient ainsi : « Il faut l’admettre : Paris 2024 n’est pas exceptionnel, c’est un événement comme les autres. Opportunités pour certains, dévastation pour les gens ordinaires. Privatisation du profit, nationalisation de la dette. Paris 2024 peut différer en termes de portée et d’échelle des Jeux récents, mais les grandes forces que les Jeux Olympiques libèrent sont les mêmes. »
Depuis 2013, chaque fois qu’une ville candidate a organisé un référendum sur sa candidature aux JO, la population a répondu par la négative. Les candidatures des villes s’amenuisent elles-mêmes au fil des ans, en raison des coûts économiques exorbitants liés aux Jeux : lorsque Paris est désignée, en 2017, elle est en fait la seule ville restant alors candidate. Ne serait-il donc pas temps de se mobiliser pour en finir une bonne fois pour toute avec ces méga-événements, qui accélèrent la destruction de nos espaces de vie, de nos libertés, et qui, sous couvert d’inclusivité, reconduisent l’exclusion des corps minorisés – en bref, qui nous donnent tout pour faire un monde que nous ne désirons pas ?
« Ces méga-événements ne sont pas réformables » concluait Natsuko, militante de Saccages 2024 à la Flèche d’Or. « Notre travail de militant·es n’est pas de tenter de les réformer : on demande la disparition des JO. »
*Le prénom a été modifié.
Image à la Une : action de Saccage le 6 février 2021, screenshot de la chaîne Youtube du collectif.
Edition : Apolline Bazin
Cet article Éviter le saccage : comment la lutte contre les JO Paris 2024 s’organise provient de Manifesto XXI.


Le président Mohamed Bazoum a évoqué la réforme du code pénal local hérité du colonialisme, et notamment de l’article 282, qui punit déjà mais insuffisamment, estime-t-il, les relations homosexuelles, jugées « contraires aux croyances religieuses et culturelles du pays ».
L’article Le Niger s’apprête à criminaliser l’homosexualité, prévoyant jusque la peine capitale pour le « mariage gay » est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Pour répondre à l'évolution des droits des familles LGBT+ , la DILCRAH a réalisé un guide pratique « sur les droits liés à la parentalité », avec toutes les informations utiles, démarches, délais ainsi que les effets à connaître pour exercer pleinement ces droits.
L’article Lancement d’un guide sur « Le respect des droits des familles et futures familles LGBT+ » est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article 1312 raisons d’abolir la police, et quelques stratégies pour le faire provient de Manifesto XXI.
Est-ce qu’un jour le terme « abolitionnisme » cessera en France de désigner des discours anti travail du sexe pour faire référence, comme aux États-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni, aux réflexions pour une abolition de la police et de la prison ? 1312 raisons d’abolir la police, le livre qui vient de paraître, dirigé par Gwenola Ricordeau, contribue à cette évolution lexicale et à la diffusion des idées et des stratégies abolitionnistes.Ouvrage d’anthologie qui rassemble un ensemble de traductions de textes abolitionnistes issus du monde anglo-saxon, il nous montre toute la richesse et la diversité de ces mouvements politiques. Nous en avons discuté avec Gwenola Ricordeau, sociologue, professeure associée en justice criminelle à la California State University et abolitionniste du système pénal. On lui doit notamment l’important Pour elles toutes (Lux Editeur) pour une approche abolitionniste du féminisme, autour duquel nous l’avions interviewée l’année dernière. Cette fois-ci, elle fait œuvre de transmission et de circulation des idées. Elle nous raconte qui sont ces abolitionnistes qui se situent au cœur des luttes révolutionnaires et de justice sociale.
Il est important de parler d’abolitionnisme, parce qu’il y a dans toute une partie des mouvements progressistes un manque de réflexion sur ces questions-là, et un penchant pour des approches réformistes de la police.
Gwenola Ricordeau
Manifesto XXI – Quels sont les enjeux spécifiques liés à la traduction des textes et des enjeux abolitionnistes du monde anglo-saxon vers la France ? L’histoire de la police et son fonctionnement actuel sont très différents dans chacun de ces pays. Qu’est-ce qu’il est intéressant de comparer et qu’est-ce qui, à l’inverse, est spécifique à chaque pays ?
Gwenola Ricordeau : Le but de l’ouvrage est de donner accès à un lectorat francophone à des réflexions et des luttes issues d’Amérique du Nord. Lorsqu’on réfléchit à l’abolition de la police dans le contexte de sociétés capitalistes, occidentales, il y a surtout beaucoup de choses en commun [entre ces espaces géographiques], davantage que des spécificités. Les fonctions de la police ne sont pas différentes d’un pays à l’autre, donc d’un côté comme de l’autre, il y a la nécessite d’un projet révolutionnaire d’abolition de la police. Il n’y a pas, à mon sens, une radicalité qui serait spécifique à l’Amérique du Nord. Par contre, il y a une avancée des stratégies et des débats abolitionnistes qui sont intéressants à apporter dans le contexte francophone. En revanche, une des spécificités du contexte étatsunien est qu’il y a peu de discussions en termes de révolution. Le mot même de « révolution » est peu utilisé (encore moins qu’en France), y compris dans la gauche dite « radicale ».
 Gwenola Ricordeau © Jessica Bartlett
Gwenola Ricordeau © Jessica Bartlett
Quelle est la structuration du mouvement abolitionniste en France, autant au niveau du terrain qu’en termes de recherches et de théorisations ?
Pour ce qui est des revendications en tant que telles, le projet d’abolir le système pénal, la police et la prison, n’est pas le monopole des mouvements abolitionnistes. Il y a, dans les mouvements révolutionnaires (un processus de changement profond d’une structure entamé, dans ce cas, par des personnes minorisées par le système en place, ndlr), déjà cette idée d’abolir la police puisque le projet même d’abolir l’État et de renverser le système capitaliste, amène à penser l’abolition de la police. Donc les expressions abolitionnistes peuvent se développer en dehors des mouvements qui s’identifient comme abolitionnistes, comme les mouvements de lutte contre les violences policières. Il faut distinguer le fait de se réclamer d’une identité politique et contribuer à l’avancée des idées.
C’est un appel à créer nos propres formes de justice non punitives qui répondent à nos besoins en tant que communauté, et en tant que victime ou auteur de préjudices.
Gwenola Ricordeau
Pensez-vous que l’on pourra voir naître en France, pays qui a exclu depuis plusieurs siècles les structurations politiques communautaires, des organisations de justice transformatrices et des formes de soin et de régulation des conflits autonomes et locaux ?
L’organisation sociale étasunienne est sans doute plus propice à ce type de justice communautaire. En même temps, l’idée même de justice transformatrice n’est pas quelque chose de figé, mais doit se penser selon les réalités sociales et les besoins des communautés et des individus qui ont commis ou subi un préjudice. C’est un appel à créer nos propres formes de justice non punitives qui répondent à nos besoins en tant que communauté, et en tant que victime ou auteur de préjudices. Leur développement se heurte à l’organisation de la vie dans une société capitaliste. Outre le risque de reproduction de rapports de domination au sein de ces alternatives, on a peu de temps et de ressources pour s’occuper de nos affaires. L’autre obstacle est le système pénal lui-même qui s’approprie nos conflits et ne nous permet pas de nous occuper de nos préjudices et de la manière dont on voudrait y répondre.
Être abolitionniste, c’est refuser de dire qu’il y a une meilleure police, car on remet en question son existence même.
Gwenola Ricordeau
Ne craignez-vous pas des formes de confusion si on applique trop rapidement un logiciel politique américain à la France, où les formes politiques sont différentes ? Par exemple, l’État n’a pas du tout la même forme aux États-Unis et en France.
Le livre propose de comprendre des débats et perspectives au sein des mouvements abolitionnistes. J’y développe ma propre vision dans le dernier texte, mais cela ne veut pas dire que je suis d’accord avec toutes les stratégies. Ensuite, certes, les spécificités de la police étasunienne ont sans doute contribué à faire émerger un mouvement abolitionniste beaucoup plus clairement qu’en France. Les forces de police sont extrêmement nombreuses et, avec l’histoire fédéraliste, elles sont très locales. Du coup, les citoyen·nes se sentent plus proches de leur police, iels peuvent prendre des décisions au niveau local sur leur police, ce qui contribue sans doute à penser la police de façon plus critique et radicale. Cependant, on ne peut pas penser la police sans penser le capitalisme et le suprématisme blanc. Il y a des différences entre les États-Unis et d’autres pays occidentaux, la police étasunienne tue par exemple beaucoup plus, mais la police tue dans tous les pays. On n’est pas dans une différence de nature, mais dans des nuances. Aux États-Unis, les réformistes parlent de la police en Europe qui serait moins violente, moins raciste. Or, être abolitionniste, c’est refuser de dire qu’il y a une meilleure police, car on remet en question son existence même.
Justement, quand on ne connaît pas ce qu’il désigne, le mot abolitionnisme peut effrayer par sa radicalité (« on ne peut quand même pas complètement se passer de police ! »), comme si la police avait toujours existé ou était un phénomène universel. Pouvez-vous revenir sur les raisons de l’existence des polices occidentales ? Pourquoi le réformisme n’est-il pas une option ?
Si on veut en finir avec l’organisation de la société telle qu’on la connaît, on bute sur la police. Donc dire clairement un projet révolutionnaire aujourd’hui, c’est assumer un antagonisme et une conflictualité avec la police. L’enjeu est de dénoncer l’illusion réformiste, l’illusion d’une police que l’on pourrait améliorer. La police ne dysfonctionne pas, elle fonctionne telle qu’elle doit fonctionner, pour maintenir le capitalisme, le suprématisme blanc, le patriarcat, le validisme (une contribution de Mad Resistance porte spécifiquement sur cet aspect-là). On ne remet pas en cause ses travers, mais son existence même.
Pour continuer sur votre critique du réformisme, est-ce que selon vous l’abolitionnisme est un mouvement qui peut servir d’inspiration à toutes les gauches pour sortir du réformisme ? Autrement dit, est-ce que toutes les luttes devraient être pensées au prisme de l’abolitionnisme ?
C’est effectivement ma perspective. C’est pour cela que j’appelle à défliquer les luttes, pour rompre avec certains courants qui se prétendent progressistes, tout en ne pensant pas la question de la police, voire qui pensent la police comme un allié potentiel du progrès social, que ce soit les luttes féministes, LGBTQIA+ ou antiracistes.
Lorsqu’on en appelle à la punition, rien de nous assure que cela fasse régresser le système de domination qui permet ces crimes. C’est même plutôt l’inverse. La criminalisation de certains auteurs peut nous détourner d’un projet politique qui est d’en finir avec ces systèmes de domination.
Gwenola Ricordeau
Voir cette publication sur InstagramUne publication partagée par Abolitionist Futures (@abolitionistfutures)
Vous développez dans votre livre l’exemple du féminisme carcéral qui prône comme stratégie politique la prison pour les auteurs de violences sexistes et sexuelles. Ce qui est effrayant est qu’il existe maintenant aussi un transféminisme carcéral, où certain·es militant·es trans mettent leur énergie dans la défense de la punition carcérale pour les agressions et meurtres transphobes. Pourquoi est-ce que ces stratégies, qui reposent sur la victimisation, mènent à l’impasse ?
Lorsqu’on en appelle à la punition, rien de nous assure que cela fasse régresser le système de domination qui permet ces crimes. C’est même plutôt l’inverse. La criminalisation de certains auteurs peut nous détourner d’un projet politique qui est d’en finir avec ces systèmes de domination. Un des textes, celui de Yanick Marshall (PhD en African studies, professeur associé à l’université de Knox, ndlr), remet en cause tous les appels à ce que les policiers rendent des comptes, car cela s’inscrit très bien dans le réformisme. Cela entretient l’idée qu’il y aurait des « brebis galeuses » qui devraient être punies, mais que le système fonctionne bien. Or les rapports sont systémiques, c’est cette question qu’il faut adresser.
Concrètement, quelles sont les stratégies abolitionnistes ?
Il n’y a pas un abolitionnisme, mais il y a des tactiques et différentes stratégies. Je décris principalement trois formes [destruction, abandon, démontage] qui dans la réalité des luttes peuvent se recouper. On a beaucoup entendu parler de la tactique qui consiste à demander le définancement de la police, dans le contexte de Black Lives Matter et à la suite du meurtre de George Floyd. Cette stratégie correspond à un démantèlement de la police par étapes. Par définition, cette stratégie n’est pas révolutionnaire. Quand on considère l’organisation de groupes et de modes de vie consistant à se passer de police et à construire des alternatives à la police, c’est une autre forme de stratégie également abolitionniste. Il faut donc avoir à l’esprit cette pluralité d’options. À mon sens, ces trois stratégies sont nécessaires et complémentaires.
Quels sont les liens entre l’abolitionnisme et nos formes de subjectivité ? Comment tuer le·la flic en nous ?
En effet, il ne s’agit pas simplement d’abolir la police en tant qu’institution si cela se traduit par de nouvelles formes de surveillance et de contrôle qui peuvent être liées à la technologie, et aussi à des comportements individuels qui finalement permettraient de se passer de police, car chacun·e ferait le flic à l’égard des autres. Il est donc important d’avoir à l’esprit que la cible c’est les formes de surveillance, de contrôle, de maintien de l’ordre, qu’il ne faut pas reproduire à l’échelle individuelle ou communautaire. Par contre, il faut aussi se méfier d’une tendance, qu’on peut voir dans certains courants abolitionnistes, mais pas que, qui fait des luttes progressistes des formes de développement personnel. C’est-à-dire des luttes qui nous invitent à devenir de meilleures personnes, de meilleur·es militant·es, dans une sorte d’egotrip individualiste, alors qu’il s’agit de processus collectifs. Par exemple, la lutte contre le suprématisme blanc, ce n’est pas seulement de faire que les blanc·hes aient moins de stéréotypes de race.
Voir cette publication sur InstagramUne publication partagée par Thinking Abolition (@thinkingabolition)
Une plus large part du budget de la police va chaque année aux équipements technologiques, et les villes contemporaines sont de plus en plus surveillées. On peut ajouter à cela la surveillance quotidienne exercée par nos propres outils technologiques. A quel point est-il urgent selon vous de faire le pont entre abolitionnisme et critique de la surveillance ?
C’est effectivement une question primordiale, car on pourrait envisager une abolition de la police qui serait remplacée par d’autres dispositifs de surveillance. Le texte de Brendan McQuade (sociologue, professeur associé à l’université de Soutern Maine, ndlr) dans le livre va en ce sens, il nous invite à cette vigilance. C’est une question d’autant plus importante que la surveillance peut prendre des formes relativement indolores avec tout ce qui est surveillance électronique et développement de la police prédictive.
Le livre aborde beaucoup la question des liens entre police et services sociaux et médicaux. On peut pointer notamment le caractère répressif et la centralité des institutions enfermantes dans la médecine occidentale, ce qui fait clairement le lien avec les luttes trans, mais aussi le racisme et l’entrelacement des services sociaux et médicaux avec les (néo)colonialismes. Comment concilier les luttes pour les services sociaux et médicaux, dont les budgets réduisent chaque année au profit des institutions policières et des armées, et la transformation de ces services pour qu’ils cessent d’être des endroits de violence envers ces potentiel·les bénéficiaires ?
Aux États-Unis il y a ce slogan important : « care not cops » [du soin, pas des policiers]. Une des limites des stratégies de définancement de la police est qu’elles peuvent appeler à davantage de travailleur·euse·s sociaux·ales et de personnels de santé mentale pour assurer des tâches de contrôle social. Il faut être vigilant car si on pense sérieusement la question du validisme, de la santé mentale, de la psychiatrisation notamment des personnes trans, il est évident qu’on ne peut pas se contenter de mesures basées sur des vases communicants qui retirent de l’argent à la police afin de développer (voire d’armer) le corps des psychiatres et des services sociaux. Les luttes pour l’abolition de la police, à mon sens, ne peuvent pas se construire en-dehors des luttes handies, trans, antiracistes et contre les formes de surveillance et d’encadrement des populations les plus pauvres.
Mais comment répondre aux besoins en termes de soin ?
Il faut distinguer les besoins, qui sont légitimes, notamment en santé mentale, et les usages, par exemple de la psychiatrie, qui peuvent faire problème. Une des contributions est écrite par Kirk « Jae » James et Cameron Rasmussen, deux travailleurs sociaux qui appellent à penser un travail social abolitionniste, donc en rupture avec les formes de travail social qui contribuent au contrôle et à la surveillance des pauvres. On peut aussi penser des services de soins en santé mentale qui sont au service des personnes.
Comment pensez-vous votre place en tant que personne blanche dans ce champ de recherche et de militantisme ?
Je pense que les privilèges vont avec des obligations. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai choisi non pas d’écrire moi-même un livre, mais de faire une anthologie qui puisse contribuer à faire entendre d’autres voix que la mienne, en particulier celle des personnes non blanches, des autochtones. Mais quand on parle de position sociale, cela ne peut pas être réduit à la question de la race. Je ne suis pas seulement une personne blanche mais aussi une femme, j’occupe une position sociale privilégiée, celle d’enseignante dans une université, vivant dans une colonie de peuplement que sont les États-Unis. Je me pense également comme une personne affectée par la criminalisation de proches, affectée par la violence d’État. Par ailleurs, un livre s’inscrit dans une production de savoirs qui, tout en se voulant critique, ne peut pas échapper à l’organisation de la société telle qu’elle est aujourd’hui. J’espère que ce livre est une invitation pour d’autres lectures, d’autres discours. Un livre peut participer de la circulation d’idées, mais un livre n’est jamais qu’un livre et les luttes se mènent sur le terrain politique.
1312 raisons d’abolir la police, Lux Editeur, 352 p.
Relecture et édition : Coco Spina et Apolline Bazin
Image à la Une : © Life Matters
Cet article 1312 raisons d’abolir la police, et quelques stratégies pour le faire provient de Manifesto XXI.

Fort du succès de l'événement qui a rassemblé plusieurs centaines de personnes en 2022, STOP homophobie renouvelle sa marche des fiertés à Chenevelles, avec des intervenions politiques, un défilé rural, des concours et une soirée avec dj's, podiums d'artistes et restauration libre.
L’article STOP homophobie lance la deuxième édition des « Fiertés rurales », la « Pride des Campagnes », ce 29 Juillet 2023 est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Artiste, enseignant, curateur, David Brülhart organise des brunchs avec des drag-queens au Château Bohème, près de Fribourg. Il présente UNICORNS, fresque de 20 mètres en paillettes et en poudre de métal, en février 2023 au Manoir de Martigny.
L’article David Brülhart, «la gourmandise de tout» est apparu en premier sur 360°.

Saurabh Kirpal, avocat expérimenté, à nouveau débouté de sa nomination à la Cour suprême de l'Inde parce qu'« ouvertement homosexuel et en couple », en dépit des recommandations des autres juges qui ont fait valoir ses mérites.
L’article Débouté de sa nomination à la Cour suprême de l’Inde parce qu’« homosexuel et en couple » est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Grande nouvelle au sein de la monarchie britannique avec l'annonce des fiançailles d'Ellen Lascelles - cousine de Charles III - et sa compagne, Channtel McPherson.
L’article Premier mariage lesbien au sein de la famille royale britannique est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

 Comme à chaque fin d’année quand je fais ma compta, je me suis posé des questions sur ma carrière de curatrice d’expériences musicales, sur l’industrie, pourquoi on galère encore avec ...
Comme à chaque fin d’année quand je fais ma compta, je me suis posé des questions sur ma carrière de curatrice d’expériences musicales, sur l’industrie, pourquoi on galère encore avec ... 
Diffusé en deux épisodes sur la RTS, les 26 janvier et 2 février, Guerre des sexes au chalet propose une téléréalité qui convoque un dialogue intergénérationnel réussi sur les questions de genre et de sexualité.
L’article Là-haut sur la montagne… le chalet où l’on cause genre est apparu en premier sur 360°.

Interrogé par la sénatrice écologiste Mélanie Vogel, qui dénonçait les responsabilité des politiques, Pap Ndiaye est apparu ému, saluant la mémoire de l'adolescent et de toutes les victimes, avant de concéder qu’il restait encore « beaucoup à faire » et d'annoncer une densification des mesures dédiées.
L’article Suicide de Lucas : le ministre de l’Éducation nationale Pap Ndiaye souhaite renforcer la prévention contre les LGBTphobies à l’école est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.



Première personne non binaire à gagner le Prix allemand du livre en 2022 avec Livre de sang, Kim de l’Horizon détonne dans le paysage littéraire. Portrait d’un·e auteur·ice suisse aux récits dynamités.
L’article Kim de l’Horizon, la révolution des mots est apparu en premier sur 360°.


Lors du match Montpellier-Nantes, ce 15 janvier 2023, dans le cadre de la 19e journée de Ligue 1, des supporters montpelliérains ont déployé dans les tribunes des banderoles avec les inscriptions, « Equipe de tapettes », « Vous valez pas une merde !! ». STOP homophobie, Mousse et Adheos portent plainte, ce mercredi, pour injure publique homophobe.
L’article Banderoles homophobes déployées lors du match Montpellier-Nantes : trois associations LGBT+ portent plainte est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

 Que se passe-t-il dans l’intimité des gens qu’on croise ? Ça veut dire quoi une sexualité “normale” ? Et est ce que ça veut dire quelque chose ? Dans un ...
Que se passe-t-il dans l’intimité des gens qu’on croise ? Ça veut dire quoi une sexualité “normale” ? Et est ce que ça veut dire quelque chose ? Dans un ... 
Cet article Désir… Désirs : le plus ancien festival de films LGBTQ+ de France fête ses 30 ans ! provient de Manifesto XXI.
Qui a dit que le cinéma LGBTQ+ n’était visible qu’à Paris ? Si le festival parisien Chéries-Chéris nous régale tous les ans avec une programmation audacieuse, c’est bien au festival Désir… Désirs, implanté à Tours, en Indre-et-Loire, que revient la palme de l’ancienneté. Retour sur l’histoire et le bilan de 30 années à célébrer le cinéma queer en France avant son lancement officiel le 18 janvier.On connaît la Vallée de la Loire pour ses châteaux royaux (Chambord, Chenonceau…) et peut-être même les romanciers qui y vécurent, comme Balzac ou Rabelais. Pourtant, loin de l’image Ancien Régime de son patrimoine, la ville de Tours, située à 1 heure de Paris, abrite un haut lieu de la vie culturelle française : les cinémas Studio. À l’origine en 1963, ses membres étaient des catholiques convaincu·es, sensibles aux questions sociales, engagé·es dans des mouvements de gauche et d’éducation populaire : « Un grand nombre pensaient que le cinéma pouvait avoir un rôle essentiel dans cette émancipation et qu’il était un moyen de culture fondamental », explique Claude du Peyrat dans le livre Cinémas Studio de Tours, 50 ans d’aventure. C’est donc dans ce cinéma associatif, plus grand complexe art et essai indépendant d’Europe, qu’a lieu depuis 1993 Désir… Désirs, le premier festival de films LGBTQ+ créé en France.
Mais pourquoi à Tours ? Philippe Perol, créateur du festival avec Rémi Lange, explique : « À Tours, les associations homos étaient encore confidentielles [dans les années 90]. Pas question pour le maire, Jean Royer, toujours en campagne contre “l’apologie des déviations homosexuelles dans tout”, d’aider ce qu’il estimait être un fléau social. La création du festival en 1993 était un coming-out, une manière de rendre public ce qui nous empêchait de vivre, ce mélange de souffrance et de besoin de hurler “nous ne sommes pas des monstres”. » Ce besoin de montrer les vies LGBTQ+ trouva donc des oreilles réceptives aux Studios sans qui, des mots de Mickaël Achard, coordinateur du festival, Désir… Désirs « n’aurait pas pu voir le jour ».
Ce n’est donc pas sans poésie que, pour contrer « les stéréotypes mortifères », la thématique de cette 30ème édition est « La quête du bonheur ». La programmation est foisonnante et dépasse la simple semaine dédiée au cinéma du 18 au 24 janvier 2023 pour s’étendre jusqu’au 26 février hors-les-murs. Au programme, l’organisation du premier salon du livre queer de Tours, la pièce Carte Noire nommée Désir de Rébecca Chaillon au Théâtre Olympia CDNT ou encore l’exposition Tom de Pékin à l’Hôtel Gouin.
Le contexte des droits et des représentations LGBTQ+ en France a bien changé depuis 1993 : arrivée des trithérapies en 1996, Pacs en 1999, Mariage pour tous en 2013… Si les discriminations et violences envers les personnes LGBTQ+ sont toujours d’actualité et que l’extrême droite devient de plus en plus puissante, Mickaël Achard se veut positif : « La réception du public s’est élargie au même titre que les thématiques liées aux questions LGBT+ et d’identité se sont démocratisées. Il y a trente ans, des abonné·es des Studio ont déchiré leurs cartes, ne supportant pas la création d’un festival sur les thématiques LGBTQI. Aujourd’hui il n’y a plus ce genre de réactions. » Il témoigne aussi d’un rajeunissement du public ces dernières années.
Et du point de vue du cinéma ? La création de Désir… Désirs en 1993 est concomitante avec l’émergence du « New Queer Cinema » symbolisée par des cinéastes comme Gus Van Sant, Gregg Araki, Rose Troche, Todd Haynes, etc. qui vont s’attacher « à transgresser les normes (esthétiques, sociales, de genre), à célébrer les minorités (sexuelles, mais pas que) et à dépasser les thématiques gays et lesbiennes traditionnelles pour aller voir notamment des désirs adolescents, des couples de même sexe ou des transidentités » selon l’historien et journaliste Didier Roth Bettoni. Si les identités LGBTQ+ sont trop souvent assimilées à des parcours de vie urbains, Mickaël Achard a à cœur de contrecarrer cette perception : « Comment faire quand on est LGBTQI+ et que l’on vit à la campagne ? [Il y a] des conditions sociales propres aux zones rurales (la situation des agriculteur·ices par exemple). Des films comme Los Fuertes, Le Secret de Brokeback Mountain ou encore Bruno Reidal [recommandé dans notre Top 2022] » sont autant de films qui traitent du sujet de la campagne et des identités queers. D’ailleurs, Désir… Désirs propose des évènements au-delà de la ville de Tours.
Le bonheur queer est une quête de chaque instant, un travail difficile et parfois accablant. Face aux méandres du monde contemporain et de ses angoisses, certains îlots de bonheur existent et résistent, façonnés dans l’adversité mais plus que jamais nécessaires. Désir… Désirs et les Studio en font partie. Ils ont permis à bien des personnes depuis trente ans de se ressourcer, se rencontrer et rêver… et ils continueront de le faire, on l’espère, pour encore au moins trente années de plus.
Festival Désir… Désirs (@festivaldesirdesirs) du 18 janvier au 24 janvier 2023 aux Cinémas Studio et hors-les-murs jusqu’au 26 février 2023. Plus d’infos
Image à la Une : Soy Niño de Lorena Zilleruelo (Chili, 2022)
Cet article Désir… Désirs : le plus ancien festival de films LGBTQ+ de France fête ses 30 ans ! provient de Manifesto XXI.

STOP homophobie dépose plainte contre l’Alliance générale contre le racisme et pour le Respect de l’Identité française et chrétienne (AGRIF) et le site internet « le Salon Beige » pour injures homophobes.
L’article Plainte contre l’AGRIF et « le Salon Beige » pour injures LGBTphobes est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Ce samedi 14 et dimanche 15 janvier, lors la 19e journée du championnat de France, à Rennes et Marseille les stades ont résonné des insultes, chants homophobes et autres « appels au meurtre de gays ». A Montpellier, les « ultras » ont opté pour des banderoles.
L’article « Folklore » homophobe lors la 19e journée du championnat de France de football est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Toucher l’inaccessible : nos 5 voix fortes à voir performer au Closer Music Festival provient de Manifesto XXI.
De quoi enjoliver ce début d’année : la 5ème édition du Closer Music Festival à Lafayette Anticipations prend place du 20 au 22 janvier. Toujours surprenante, la line-up de cette année touche par sa diversité de genres et de profils artistiques engagés.Il est temps de se poser à nouveau, pour écouter et comprendre ces têtes émergentes qui n’ont pas peur de tenter. Entre performances dream pop crues et live électronique expérimental, c’est toute une panoplie de propositions colorées à laquelle nous assisterons. Si la scène artistique anglaise y est encore majoritairement représentée cette année, la programmation est amplifiée par d’autres excellent·es artistes francophones. Trois jours d’intimité, dans les profondeurs de projets uniques à la liberté débordante. Suivant cette programmation hybride bien pensée où les artistes de nationalités différentes se complètent, voilà notre sélection de 5 concerts à aller voir au Closer Music Festival.
Iceboy Violet · Samedi 21 janvier
 © Anastassia Radtsenko
© Anastassia Radtsenko
Ce n’est pas la première et certainement pas la dernière fois que l’on parle d’Iceboy Violet chez Manifesto. Vu·e au Positive Education Festival en fin d’année dernière, iel a su bouleverser la soirée entière par sa performance brute et déchirante. Entre câlins et cris chantés dans le micro, iel n’hésitera pas à se faufiler dans le public pour un instant intense et intime. Deux figures de Manchester avaient déjà fait leur apparition en 2022 au Closer Music Festival, Blackhaine et Space Afrika, avec qui Iceboy Violet avait collaboré. Une occasion de replonger dans les chants et mouvements chorégraphiés à l’instinct, sur de la grime revendicatrice d’un milieu trop masculin, et des sonorités ambient/IDM.
aya · Vendredi 20 janvier
 © Suleika Müller
© Suleika Müller
Elle aussi issue de ce territoire rempli de talents qu’est le nord de l’Angleterre où les artistes n’ont pas peur de se mouiller, aya porte Manchester comme lieu de ralliement musical exceptionnel aux écrits honnêtes et revendications fortes. En pleine résidence sur NTS, elle avait sorti im hole en 2021, un premier opus personnel de club déconstruit, glitché aux voix pitchées. Aujourd’hui basée à Londres, aya, au-delà de ses sets déstabilisants, croise electronica, IDM et grime, dans des tonalités bien plus sombres que ses pairs. Dans un chaos orchestré, ses paroles se mélangent aux discours de lutte qu’elle tient entre chaque morceau. L’artiste prend tout l’espace dans une connexion constante avec le public.
Loraine James · Samedi 21 janvier
 © Vicki Couchman
© Vicki Couchman
Enseignante, elle laisse les cours de côté pour venir secouer Lafayette Anticipations. Si l’on s’en souvient bien, son album Reflection sorti en 2021 sur Hyperdub avait créé un beau raz-de-marée dans le monde de la musique électronique. Entre inspirations bass music, IDM et UK drill, on aura rarement vu ces horizons musicaux très différents aussi bien assemblés. Ses performances électrisantes sont toujours innovantes mais accessibles, une secousse qui vaut bien la peine. Avec ses dernières sorties ambient transperçantes, que ce soit sous son nom ou son alias Whatever The Weather, Loraine James mène la progressive électronique loin.
Lazza Gio · Samedi 21 janvier
 Extrait du clip « le sport life pt.1 (80 pompes) »
Extrait du clip « le sport life pt.1 (80 pompes) »
Au milieu une programmation de première journée presque entièrement UK, la compositrice et chanteuse/rappeuse belge Lazza Gio se faufile parfaitement par des textes crus d’une dérive globale, à laquelle nous nous identifions tous·tes. Elle sait mêler des discours motivants et pleins d’amour à des paroles bien plus tristes et vraies. Des tours de passe-passe sur de la glitch-hop et de l’electronica, aux compositions mélodieuses qui contrastent des propos forts sur l’égarement, l’addiction et l’identité.
Caterina Barbieri · Vendredi 20 janvier
 © Furmaan Ahmed
© Furmaan Ahmed
Guidée par les machines dans une performance immersive, la douceur des sons de Caterina Barbieri s’installe dans nos esprits. La compositrice, basée à Berlin, s’est ici associée à Ruben Spini pour un live visuel magique, influencé par les phénomènes météorologiques. Pour une véritable expérience sensorielle, les lumières et projections viennent sublimer les nuances sonores. Ayant commencé son parcours musical en jouant des concerts acoustiques au piano et au violon, l’artiste s’est vite tournée vers une expérimentation électronique, laissant place à des textures et motifs hypnotiques. La performance fait la part belle aux harmonies de voix et aux répétitions de synthétiseurs dont on a eu un bel aperçu sur sa dernière création : Spirit Exit.
Vous pouvez retrouver toute la sélection d’artistes de la programmation du Closer Music Festival ici.
Photographie de couverture : © Stephen Schieberl
Cet article Toucher l’inaccessible : nos 5 voix fortes à voir performer au Closer Music Festival provient de Manifesto XXI.


Lucas, l'adolescent de 13 ans qui s'est suicidé samedi 7 janvier à Golbey (Vosges) et dont les parents affirment qu'il était harcelé en raison de son homosexualité, avait exprimé « sa volonté de mettre fin à ses jours » dans son "journal intime", a indiqué vendredi 13 janvier le procureur de la République d'Epinal.


Dès le 20 janvier, le festival genevois des cinématographies d’ailleurs vous fera découvrir nombre de talents émergents et de cinéastes confirmés dont les œuvres restent inédites en Suisse. Avec, comme toujours, une forte présence des préoccupations LGBTIQ+.
L’article La sélection queer de Black Movie est apparu en premier sur 360°.

La chanteuse de 26 ans, a de nouveau dévoilé certains des milliers de messages d'injures et menaces de mort qu'elle reçoit quotidiennement, en dépit de sa plainte déposée en mars 2020, dénonçant l'inaction désespérante de la justice française.
L’article Hoshi, victime de cyberharcèlement lgbtphobe, dénonce l’inaction de la justice en France est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article « The Fall » d’Alexi Shell, un conte féministe où les sirènes ont le pouvoir provient de Manifesto XXI.
Le week-end, de temps en temps, la rédaction de Manifesto XXI met en avant un clip récent qui l’a marquée, avec un mot de la réalisatrice ou du réalisateur. Ce vendredi 13 janvier, on vous propose le clip « The Fall » de Alexi Shell réalisé par Florent Augizeau.Dans une ambiance extra-terrestre, nichée dans une bulle noire mouvante, liquide, entre le cuir et le pétrole, naît la figure Alexi Shell. Le premier clip du morceau « The Fall », tiré de l’album Sirens à paraître courant mars, a été tourné dans les paysages ruraux islandais, que l’on imagine entre deux volcans en éruption et la cabane d’enregistrement de Björk. Il s’inspire d’un conte co-écrit avec la directrice de publication et co-fondatrice de Manifesto XXI, la journaliste Coco Spina.
L’affection particulière pour les figures oniriques est le point de départ, mais aussi paysages islandais, chers à Lola Margrain qui a travaillé la photographie du clip avec le réalisateur Florent Augizeau, comme l’explique Alexi Shell : « La Sirène devait être omniprésente dans l’histoire. J’avais également demandé à Florent de s’inspirer du conte que j’avais co-écrit avec Coco Spina. A cette même période, Lola qui a fait les images du clip aux côtés de Florent, passait beaucoup de temps en Islande et nous a proposé de la rejoindre pour tourner le clip là-bas. Et tout a pris sens. Ils avaient tous les deux imaginés des paysages à la fois lunaires et marins, et l’histoire que Florent avait écrite ne pouvait que coller avec les paysages de l’Islande »
L’Islande donc comme terrain de jeu de la productrice à la croisée de la techno, l’ambient et la pop expérimentale. Elle s’incarne en héroïne hybride d’une épopée contemporaine : « Le personnage que j’incarne passe par différents états : la douloureuse sortie de l’eau, qui nous rappelle la souffrance mais aussi la volonté de devenir humaine, comme dans le conte de La petite sirène. Les autres plans suivent les paroles et poussent à croire que la sirène vient aussi sur terre pour accomplir la mission des mythes, noyer les hommes, envoûter, dominer. Elle se transforme petit à petit et gagne en force, sa combinaison l’aide à supporter l’air extérieur, comme s’il était toxique. C’est un conte féministe où les femmes/sirènes dont on a peur reprennent le pouvoir. »
Cet article « The Fall » d’Alexi Shell, un conte féministe où les sirènes ont le pouvoir provient de Manifesto XXI.


La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qui veille à l'application uniforme de la législation en vigueur au sein de l’UE, vient d'élargir sa directive antidiscriminatoire au travail, statuant, dans un arrêt historique, ce jeudi 12 janvier, que l'orientation sexuelle ne saurait être un motif pour résilier ou refuser de conclure un contrat.
L’article La justice européenne renforce ses dispositions contre les discriminations anti-LGBT+ à l’emploi est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

C’est courageux de poser cette question. Tu n’es de loin pas la seule personne ayant
L’article Je n’aime pas l’aspect de ma vulve, que faire? est apparu en premier sur 360°.

 Il fait moche, vous avez 17 abonnements à des plateformes de streaming à la demande et il faut tout rentabiliser. Ici, vous trouverez toutes les séries à ne pas manquer ...
Il fait moche, vous avez 17 abonnements à des plateformes de streaming à la demande et il faut tout rentabiliser. Ici, vous trouverez toutes les séries à ne pas manquer ...