
De premières initiatives pour lutter contre l'isolement des seniors LGBT+ et leur éventuel "retour au placard" voient le jour en France, souvent portées par des associations.
34739 éléments (3198 non lus) dans 75 canaux
 Radio/sons
(113 non lus)
Radio/sons
(113 non lus)
 Sexo anecdotique
(669 non lus)
Sexo anecdotique
(669 non lus)
 Actu et info sexe
(635 non lus)
Actu et info sexe
(635 non lus)
 Ecrits / bds / Edition
(109 non lus)
Ecrits / bds / Edition
(109 non lus)
 BDSM/cuir/latex/
(29 non lus)
BDSM/cuir/latex/
(29 non lus)
 feminisme
(791 non lus)
feminisme
(791 non lus)
 Libertinage
(19 non lus)
Libertinage
(19 non lus)
 Info LGBTI
(833 non lus)
Info LGBTI
(833 non lus)
 Info LGBTI
Info LGBTI


Après un vote du parlement, le Conseil fédéral a deux ans pour adapter la loi concernant le don d'ovules pour les couples mariés. Une avancée pour les femmes stériles.
L’article Vers une légalisation du don d’ovules en Suisse est apparu en premier sur 360°.


«Il n'y a pas de bar lesbien à Berlin.» Chaque fois que je laisse choir d'un air désolé cette réponse lapidaire à des copines de France ou d'ailleurs qui veulent en savoir plus sur les nuits folles de la communauté LGBTIQ+, c'est la consternation: «Comment? Quoi? C'est une blague? Non mais c'est pas possible! Il n'y a PAS de bar à gouines à Berlin?»
L’article «Il n’y a pas de bar lesbien à Berlin» est apparu en premier sur 360°.

Cet article Alma Dufour, la députée qui milite pour une écologie populaire provient de Manifesto XXI.
Alors qu’une nouvelle mobilisation sociale « contre la vie chère et l’inaction climatique » est annoncée le 16 octobre, Alma Dufour, députée NUPES à l’Assemblée nationale, se mobilise depuis juin contre l’inflation. À 32 ans, l’ancienne porte-parole des Amis de la Terre lutte désormais au cœur même de l’État pour démontrer qu’écologie et classes populaires ne sont pas irréconciliables. Portrait.Nous avons rencontré Alma Dufour au sortir de l’été. Les « vacances parlementaires » s’achevaient et l’on n’avait presque pas entendu parler de politique partisane depuis un mois – août oblige. Les universités d’été des partis s’étaient tenues le week-end précédent, au plus grand plaisir des chaînes d’informations en continu qui ont pu se régaler des polémiques sur le barbecue et les jets privés. En toile de fond, la perspective d’une dissolution de l’Assemblée nationale, qu’Alma Dufour jugeait possible « si LR décide vraiment de faire chier la Macronie sur le budget ». Et puis, alors que ce portrait prenait forme, cette gauche fédérée fut heurtée de plein fouet par des affaires de violences sexistes et sexuelles mettant en cause des personnalités emblématiques de la NUPES : Julien Bayou, député et secrétaire national d’Europe Écologie-Les Verts, et Adrien Quatennens, coordinateur de la France insoumise et député du Nord.
Comment écrire le portrait d’Alma Dufour, une des figures montantes du principal parti de gauche, après cette vague de déception ? La lutte n’est jamais un long fleuve tranquille et les idoles d’un temps peuvent devenir l’épine dans le pied des mouvements d’émancipation du présent. Une génération s’étiole et de nouveaux visages apparaissent. Déterminée à changer le monde sans laisser personne de côté, Alma Dufour est de ces nombreux néo-député·e·s issu·e·s de la jeunesse de gauche et élu·e·s sous l’étiquette NUPES. La relève est assurée et, c’est sûr, elle fera mieux.
L’écologie, nouvelle « mystique » populaireCe lundi 29 août, Alma Dufour arrive les écouteurs dans les oreilles, s’excuse pour son retard – la réunion a traîné – sans laisser paraître la fatigue des quatre derniers jours passés aux Amphis de la France insoumise. Elle y intervenait dans plusieurs tables rondes dont une avec François Ruffin, député et réalisateur, sur la lutte contre l’extrême droite dans la France périphérique. À peine assise et l’enregistreur pas encore allumé, elle commence à exprimer son respect et son admiration pour ses collègues de LFI avait qui elle vient de passer le week-end : « Je travaille beaucoup, oui, mais des gens comme Guetté, Bompard ou Panot, c’est toute leur vie. »
La vie politique, la vie à l’heure du réchauffement climatique et la vie des gens de sa circonscription, la députée ne cesse d’en parler, le cœur lourd de sa responsabilité d’élue. Elle ne veut pas décevoir et exprime son malaise quant à sa nouvelle position de députée siégeant sous un dôme de l’Ancien Régime : « Je pense à tous les gens de ma circo qui sont hyper pauvres. Tu te demandes comment les gens qui sont à l’Assemblée peuvent prendre au sérieux la crise du pouvoir d’achat… On baigne dans un nuage de luxe qui met extrêmement mal à l’aise. » En effet, Alma Dufour n’a pas choisi au hasard la 4ème circonscription de Seine-Maritime, à côté de Rouen : « Je voulais montrer qu’on pouvait associer transition écologique et emploi, c’était évident pour moi d’aller dans une circonscription industrielle et populaire. » Quand on la questionne sur la réaction des habitant·e·s à son parachutage en tant que « parisienne », la députée sourcille et nous reprend pour éviter tout malentendu : « Je suis née dans le Gers et j’ai grandi dans un HLM avec une mère au RSA. On oublie qu’il y a des gens pauvres qui vivent à Paris. Mais je suis une urbaine, ça, oui. » De toute manière, l’enjeu est ailleurs.
Dans les germes de l’écologie, il y a quelque chose qui peut soulever des foules. La jeunesse a besoin de ces luttes qui sont de l’ordre de l’existentiel.
Alma Dufour
Sur un territoire qui accueille le plus grand site de production et de stockage d’engrais chimiques d’Europe ainsi que de nombreuses industries lourdes, la question de l’emploi s’entremêle inévitablement avec la question écologique. Qui plus est, son ennemi n°1, Amazon, avec qui elle a croisé le fer pendant ses années chez les Amis de la Terre, avait pour projet d’ouvrir un entrepôt sur la circonscription : « Avec le collectif national d’opposition à Amazon, on n’arrivait pas à avancer sur de la réglementation, donc on s’est dit que notre seule arme c’était de les faire chier là où ça faisait mal, c’est-à-dire en bloquant les infrastructures logistiques. Ça a marché et on a fait tomber cinq entrepôts. »
Pour la députée, le choix d’Amazon de s’installer dans ces territoires pauvres n’est pas un hasard : « Ils savaient qu’il y avait beaucoup de chômage et qu’ils allaient être accueillis à bras ouverts. » En effet, à Elbeuf, ville de plus de 15 000 habitant·e·s sur sa circonscription, 28% de la population est sans emploi. C’est une obsession pour Alma Dufour pour qui l’emploi et les moyens de production des travailleur·se·s doivent être au cœur du discours de l’écologie politique. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle dit avoir rejoint les bancs de la France insoumise, dont le discours part des besoins de la collectivité, plutôt qu’Europe Écologie-Les Verts : « Le rôle de la production est centrale, sinon ton discours écologique reste au simple niveau de discours culturel que tu tartines sur une réalité que tu ne contrôles pas du tout. » Autre différence avec le parti vert selon elle, la priorité donnée d’abord « au problème de notre dépendance aux importations » avant de commencer à envisager « une réduction du temps travail et le salaire universel ». Elle juge même la logique inverse « irréaliste ».
Pour moi le travail écolo c’est cela : faire advenir ce dont on a réellement besoin collectivement.
Alma Dufour
Pour celle qui a vécu des phases d’éco-anxiété, l’enjeu est aussi de créer un récit puissant contenant une part de « mystique » qui puisse emporter les classes populaires et la jeunesse avec lui : « Dans les germes de l’écologie, il y a quelque chose qui peut soulever des foules. La jeunesse a besoin de ces luttes qui sont de l’ordre de l’existentiel » veut croire la députée. De surcroit à l’heure de la crise de l’énergie qu’elle décrit comme « à la fois une bombe sociale atroce et une opportunité pour créer un discours qui permet de lier pouvoir d’achat et changement climatique ». « L’emploi écolo » reste encore un concept à faire vivre en pratique mais Alma Dufour ouvre des brèches : « J’ai vu tellement de gens heureux qui avaient plaqué leur boulot pour aller faire de l’agriculture en n’étant même pas payé 70h semaine ! L’importance du sens dans le travail n’est pas à ignorer. J’ai connu des personnes très mal dans leur travail salarié et puis, quand l’entreprise est passée en coopérative, ça a changé toute leur vie car ils avaient l’impression de décider. Pour moi le travail écolo c’est cela : faire advenir ce dont on a réellement besoin collectivement [car cela crée aussi] quelque chose qui a une valeur immatérielle très forte et qui appartient [aux travailleur·ses]. »
Discriminations et salaires : « une question de vie ou de mort »Sa victoire, Alma Dufour l’a arrachée. Sa circonscription était une chasse gardée du Parti socialiste depuis des années et Dufour a accédé au second tour avec seulement 167 voix de plus que le dissident socialiste. Les journées commençaient avec une session de tractage à 7h du matin sur la voie rapide « comme les laveurs de vitres » puis les supermarchés, les sorties d’école, la sortie des mosquées… jusque tard le soir. Elle « assume totalement » être allée tracter à devant les mosquées : « Je suis convaincue que le vote de la communauté musulmane, et par extension, les quartiers populaires ont été le noyau dur qui nous a fait se détacher du lot. Cela a créé un phénomène d’agrégation des classes moyennes et des jeunes. Et puis, après tout, le vote catholique est orienté politiquement alors il est évident que le vote musulman aussi. » En effet, il suffisait de passer devant une église le dimanche lors de la campagne présidentielle pour voir que les militant·e·s de Zemmour savaient où se situait leur électorat. Au second tour, Alma Dufour affronte un candidat du Rassemblement national (RN) et fait une crise de brûlure d’estomac : « Je ne voyais que des vieux au bureau de vote, il était impossible que je perde devant le RN. » C’est d’ailleurs par l’abstention des jeunes qu’elle analyse le résultat des législatives : « S’il y a eu 89 députés RN, c’est aussi parce qu’il y a eu une disproportion du vote des personnes âgées alors que la majorité des moins de 35 s’est abstenue. Forcément, le poids de la droite et de l’extrême droite est très fort. »
J’ai toujours l’impression de trahir la cause, car quand tu es LGBTQI [et que tu ne t’exprimes pas haut et fort dessus], la communauté a l’impression que tu la lâches. Mais je ne suis pas dans le placard pour autant.
Alma Dufour
Pour recréer le lien avec la jeunesse et la ramener aux urnes, Alma Dufour souhaite investir les réseaux sociaux comme une « influenceuse politique » pour « aller chercher les jeunes là où ils sont ». Comment faire dans un monde si éclaté et divisé, sur le plan économique et identitaire, pour fédérer le collectif et toucher les masses ? L’exemple de l’écologie lui semble criant. Elle dénonce la manière dont celle-ci est utilisée comme un outil de division des classes alors que « c’est une lutte des classes ! Les médias ont construit l’écologie comme un enjeu de pratiques et de modes de vie et nous-mêmes sommes rentré·e·s dans un narratif du même ordre. On a eu tendance à s’intéresser à ce qui allait marcher médiatiquement plutôt qu’à ce qui allait toucher le plus grand monde. » Elle n’oppose cependant pas les questions identitaires et les thèmes dits sociétaux qui sont tout aussi importants à ses yeux : « Pour avoir connu les violences policières lors des Gilets jaunes – qui n’avaient rien à voir bien entendu avec de la discrimination dans mon cas –, il faut bien se rendre compte que c’est une question de vie ou de mort, donc bien sûr que ça intéresse autant que la lutte des classes et le salaire ! Pour les personnes LGBTQ+ qui ont peur de se faire agresser, c’est leur vie qui est en jeu, leur couple, leur droit à l’amour. »
Pourtant, la députée a fait le choix de ne pas faire de son identité lesbienne son cheval de bataille principal : « J’ai trop de combats et d’étiquettes : je suis volontairement allée me présenter dans un territoire difficile pour aller jusqu’au bout de mon idéal écologique et rapprocher l’écologie des classes populaires. Je ne me cache pas, si on me pose la question je le dis, mais oui, ce n’est pas moi qui mène la danse dans la NUPES là-dessus. » La situation n’est pas facile car, si la députée revendique un droit à la vie privée, elle n’a toujours pas trouvé la recette miracle : « J’ai toujours l’impression de trahir la cause, car quand tu es LGBTQI [et que tu ne t’exprimes pas haut et fort dessus], la communauté a l’impression que tu la lâches. Mais je ne suis pas dans le placard pour autant. » Sur son image de députée, Alma Dufour tâtonne encore : « Je ne suis pas encore vraiment sûre de savoir ce que les gens attendent d’un·e député·e. J’ai vu tellement de gens dégoûtés de la politique que je ne veux pas trop jouer à n’importe quoi. »
« Le trauma est réel »Depuis l’élection présidentielle, entre les accusations de viol envers le journaliste Taha Bouhafs et la mise en cause pour harcèlement d’Éric Coquerel, président de la commission des finances, la NUPES/LFI a été mise à rude épreuve [nous avons rencontré la députée avant les affaires Bayou et Quatennens, ndlr]. Lorsqu’elle a appris pour Bouhafs, qu’elle connaissait bien, Alma Dufour dit avoir eu « les pattes sciées ». Le choc encaissé, elle juge que « la décision [de désinvestir Taha Bouhafs] a été la bonne ». Elle rappelle la situation qu’a eu à gérer Clémentine Autain et le CVSS : « Dans leur position, tu es prise entre des injonctions contradictoires : on a dit à la victime de porter plainte pour qu’il y ait un dénouement qui soit clair et net mais elle n’a pas voulu. C’est cette zone grise qui est très dure à gérer. » Au front, aucun homme dont la voix pourrait changer la donne pour briser le « bro code » du boys’ club.
Le mouvement des Gilets jaunes a tellement été réprimé que cela a laissé aussi une espèce de peur qui a tué l’insouciance dans l’inconscient collectif des classes populaires.
Alma Dufour
La libération de l’écoute de la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles dans le milieu politique ne fait que commencer et ce n’est pas un hasard que cela commence à gauche bien que les actes concrets et crédibles sur le sujet se font encore attendre. Ce bouillonnement n’est pas prêt de s’arrêter tant sur la question des droits des femmes que sur le climat et la justice sociale. « Je sens que l’on va devant de grandes tensions sociales cet hiver », flaire Alma Dufour. Ancienne manifestante Gilet jaune, celle qui milite depuis plus de sept ans dans les mouvements sociaux ne prophétise pas une révolution et sait que « ce n’est pas parce que tous les ingrédients matériels sont réunis que ça pète ». D’autant plus que « le mouvement des Gilets jaunes a tellement été réprimé que cela a laissé aussi une espèce de peur qui a tué l’insouciance dans l’inconscient collectif des classes populaires. Cela peut être un frein pour redémarrer un mouvement social en France car le trauma est réel ».
Néanmoins, l’élue de la République ne perd pas espoir : « Le gouvernement peut lâcher sur pas mal de choses et très vite. Leur modèle économique se percute à la réalité. Ils patinent énormément car ils savent le risque d’un mouvement social puissant. Et, eux aussi, ils sont traumatisés des Gilets jaunes. Si tu voyais leur tête à chaque fois qu’on en parle ! » Sa prochaine mobilisation d’ampleur sera le 16 octobre pour « une grande marche contre la vie chère et contre l’inaction climatique », à l’appel de la NUPES mais sans les syndicats. Au-delà de cette date, l’enjeu pour la gauche est de s’organiser pour gagner dans cinq ans et éviter le fascisme, désormais aux portes de la France après l’élection de Giorgia Meloni en Italie. Inévitablement, la guerre de succession à gauche ne tardera pas à commencer. La politique électorale est aussi une question d’incarnation, de visage, de charisme et de représentation. Les talents sont nombreux mais la NUPES se doit d’être à l’écoute de la société et de la jeunesse si elle veut catalyser ce bouillonnement populaire contradictoire et chaotique mais désireux de vies meilleures. Un grand mouvement nous attend-il cet automne ? Alma Dufour conclut sagement : « Tu peux essayer de faire une grande stratégie mais ça ne marchera pas. Il faut que ça vienne des gens et que ce soit une évidence pour eux. »
Cet article Alma Dufour, la députée qui milite pour une écologie populaire provient de Manifesto XXI.


Simone Repele et Sasha Riva se penchent sur l’histoire de la peintre danoise trans Lili Elbe rendue populaire par le film The Danish Girl. Un voyage intime au cœur de son monde intérieur, à découvrir à Vernier (GE), les 20 et 21 octobre. Des places sont à gagner!
L’article Lili Elbe, hommage trans* par la danse est apparu en premier sur 360°.

Cet article Crack Cloud : « On veut que notre musique suscite cette forme d’imagination visuelle » provient de Manifesto XXI.
C’est surement l’un des projets les plus ambitieux et innovants que la musique nous donne à voir et à entendre aujourd’hui : celui de Crack Cloud, ce collectif pluridisciplinaire d’une vingtaine de personnes basé à Vancouver. Nous avons échangé avec la formation à l’occasion de la sortie de leur second album Tough Baby, paru le 16 septembre dernier.Art punk, punk instrumental, post-punk… difficile de déterminer réellement ce que créé l’ovni Crack Cloud dans notre environnement musical et visuel. Deux ans après le brillant et sincère Pain Olympics – un hymne à la désillusion et au chaos « based on true shit », comme iels le disent et l’écrivent si régulièrement – la formation donne naissance à Tough Baby. Une fable exutoire où le collectif pousse encore plus loin son rapport à l’expérimentation et à la création, et ce sous toutes ses formes. Rencontre avec Zach Choy – batteur, chanteur et fondateur du groupe -, Mohammad Ali Sharar – guitariste, bassiste et vidéaste – et Aleem Khan – claviériste.
 Crack Cloud © Clara de Latour pour Manifesto XXI
Crack Cloud © Clara de Latour pour Manifesto XXI
Manifesto XXI : Comment allez-vous et comment vous vivez la sortie à venir de votre second album ?
Zach : Je pense qu’on est plutôt bien vis-vis de ça !
Mohammad : Oui c’est cool, je pense que c’est plein de belles opportunités qu’on a manqué pendant le covid, donc on est content de reprendre et de repartir en tournée avec ce nouvel album. On est un peu fatigués mais tout va bien ! (rires)
Que diriez-vous si vous deviez présenter ce qu’est Crack Cloud avec vos propres mots ?
Zach : C’est un projet pluri-médias sur lequel on a travaillé pendant une bonne partie de notre vie je dirai. C’est un projet qui se transforme, se renouvelle sans cesse, ce n’est jamais la même chose, et on ne sait pas vraiment vers où on va !
Vous formez aujourd’hui un collectif qui s’est rassemblé autour de cette idée sensible et contemporaine du care. Comment faites-vous évoluer, vivre ce collectif avec tous les changements et mouvements que cela implique ?
Zach : Oui en effet il y a beaucoup de changements dans les cinq-six dernières années. Tous les aspects de Crack Cloud sont des indicateurs d’où l’on se trouve progressivement. On essaye sans cesse de travailler collectivement notre créativité.
Mohammad : On peut dire que tout cela se fait très naturellement, toutes les connexions que l’on créé se font naturellement et ce peu importe le contexte. On est très reconnaissant·es vis-à-vis de tout cela.
Aleem : Il y a aussi beaucoup d’évolutions car on a justement ce côté pluridisciplinaire. On rencontre régulièrement des gens qui s’intéressent au projet, qui veulent travailler avec nous, et tout cela nous fait avancer.
Concernant cette aspect pluridisciplinaire, sur scène on vous voit souvent changer d’un instrument à l’autre. Il n’y a jamais les mêmes personnes du collectif présentes. Vous faites aussi tout vous même avec ce côté DIY, la danse, la réalisation des clips, l’image, etc. Est-ce que tout ce chemin créatif s’est fait naturellement ? Avez-vous juste appris les un·es des autres progressivement ou avez-vous fait en sorte dès le départ de vous entourer de personnes expérimentées ?
Zach : Je pense qu’il y a un peu de tout cela dans Crack Cloud. On a toutes et tous des moyens différents de nous exprimer, et on a appris beaucoup de disciplines par nous-même. Crack Cloud permet de créer cet environnement où tout le monde peut apprendre à faire quelque chose, c’est cette mentalité DIY qui nous porte. On essaye sans cesse d’appréhender de nouvelles esthétiques, de nouveaux médiums, de nouvelles approches pour s’exprimer pas à pas.
Mohammad : On se dit qu’on ne se limite pas aux compétences que l’on a de base, on continue de grandir avec ça. Nous avons toujours voulu faire les choses même si l’on n’avait pas forcément les compétences pour ça, l’idée c’est d’essayer et de générer de la motivation dans le groupe.
Aleem : Je parle pour moi-même, mais peu importe qui fait partie de Crack Cloud, on aime toute·s pousser les choses au maximum dans notre travail, dans notre art. Pour moi on doit donner le maximum possible que ce soit physiquement ou psychologiquement dans le projet.
Est-ce que tout ce côté DIY vous permet de bien évoluer dans l’industrie musicale ? Vous arrivez à vivre de Crack Cloud globalement ?
Zach : Aussi ambitieux que cela puisse paraitre je pense que c’est le bon moment pour célébrer et profiter des nouvelles ressources que l’on nous apporte. Le Canada nous permet notamment de faire ça sans passer forcément par des structures traditionnelles. Ça progresse petit à petit mais c’est quelque chose qui est important pour nous. On s’est beaucoup investi dans le projet mais on en vit pas pour autant. On passe la moitié de l’année à enregistrer donc c’est assez nouveau.
Mohammad : La plupart des membres ont d’autres jobs à côté. Au début si on veut se lancer dans un nouveau projet créatif c’est forcément beaucoup de sacrifices.Iil faut parier sur ses compétences et sur tout l’investissement qu’on met dans ce travail, en espérant ensuite pouvoir vivre de cet art. Tu construis une mentalité particulière autour de la réussite et du succès.
Zach : Je pense aussi qu’on a jamais spécialement attendu que ça marche, enfin que ce soit rémunérateur en soi. Cet investissement dans Crack Cloud était avant tout émotionnel. Il n’y avait pas d’attente, on ressent toujours tout ce qu’il se passe autour de nous comme un privilège. On a encore beaucoup à apprendre, pour s’inclure dans toute cette industrie et cet environnement, si tu n’es pas sur un gros label c’est très différent.
Mohammad : En se regardant d’un point de vue extérieur on a juste l’impression de faire notre musique, de gagner en maturité, et c’est juste là que se trouve la qualité la plus importante. On doit avoir conscience de comment gérer tout cela, notamment financièrement, comment tu gères ce que tu gagnes à travers ce projet.
Zach : Il y a cinq ans on aurait jamais imaginé que Crack Cloud aurait à payer des taxes ! (rires)
Mohammad : En fait, de base, tu te dis que tu ne vas jamais sortir de la ville d’où tu viens avec la musique que tu fais.
Il y a une grande cohérence et en même temps on retrouve toujours ce côté surprenant et déroutant sur Tough Baby, qu’on pouvait sur vos précédentes compositions, comme Pain Olympics sorti en 2020. Comment avez-vous cette esthétique singulière ?
Aleem : Tout le monde pense que cet album est le troisième album, alors qu’en fait c’est seulement le deuxième, car notre première sortie – Crack Cloud, 2018 – était une compilation. Il y a un côté plus conceptuel.
Zach : Après notre premier album on s’est un peu éparpillés, personnellement j’ai pris la route et j’ai commencé à avoir des idées. On a ensuite passé deux ans à développer tout cela. Ce qu’il y avait avec Tough Baby, c’est qu’il n’y avait pas vraiment d’urgence à finir cet album avec le Covid etc. C’était un processus vraiment épanouissant pour le coup. Beaucoup de choses sur cet album se sont passées de manière organique, dans le sens où l’on faisait en sorte d’être raccord et se plonger vraiment dans le projet. Ça a pris la tournure que ça a pris, il y a eu beaucoup de versions de l’album, des sortes de réincarnations. Mais je pense que le produit fini est juste un artefact de où l’on était à tel moment. C’est naturel.
« Je trouve que ça s’adapte vraiment à la période, avec toute la douleur, la frustration qu’il y a en ce moment dans le monde, on essaye de mettre ça dans l’art que l’on fait. »
Mohammad sur Crack Cloud
Zach comme tu es à la base de ce qu’est Crack Cloud tu écris tout et tu partages les éléments ensuite ? Comment le processus se développe ?
Zach : En fait je construis les fondations de notre musique, une sorte de storyboard de ce qu’il y aura.
Mohammad : C’est le temps qui décide plus ou moins de ça, mais oui il y a toujours ce squelette de départ. Et Zach ne met pas beaucoup de temps à sortir toutes ces idées, il ne se perd pas. On ne se perd pas non plus émotionnellement du coup. Il y a une idée claire de l’album et de quelles sortes d’émotions l’on souhaite atteindre. Il y a des moments où ce que l’on fait nous convient et ce processus prend juste du temps. Et comme tu le disais, il y a différents enjeux esthétiques dans l’album et le résultat qu’on a ici c’est la finalité de ce processus.
Dans vos clips que ce soit dans Please Yourself, dans Tough Baby et plus récemment dans Costly Engeenired Illusion, il y a tout un côté « rêve dystopique » qui en émane. Où allez-vous puiser toute cette inspiration dans les histoires que vous cherchez à raconter ?
Zach : Je pense que tout cela est juste basé sur des souvenirs. Dans nos vidéos on essaye de donner vie a des personnages qui vivent leurs propres expériences. Je suis personnellement fasciné par la fantasy et la science-fiction. Donc donner vie et faire évoluer visuellement nos clips dans cette voie-là et créer des scénarios avec une philosophie certaine, ça nous plait vraiment.
Mohammad : C’est l’utilisation du storytelling. Comme le disait Zach, on est des fans de science-fiction et de fantasy, et on savait aussi à quel point le storytelling est efficient pour marquer l’imagination et aborder des problèmes sociaux sans pour autant utiliser quelque chose de purement politique, on est plus dans l’abstraction de ça. Donc tout ce dont tu parles c’est l’accumulation de tout ce que l’on a lu et vu.
Zach : Et spécifiquement pour les deux premiers clips que l’on a sorti pour cet album on voulait tout raconter du point de vue d’un enfant, et penser à comment on vit ce monde, à quel point on peut se sentir vulnérable, « insecure », à l’âge de 12 ou 14 ans. Mais aussi quels mécanismes on utilise à cet âge pour gérer ça, et aussi tout ce que l’imagination peut nous apporter face à cela. Il y a tous ces détails spécifiques à l’enfance sur lesquels on voulait vraiment se focus.
Mohammad : On continue d’en parler et on sait que les années les plus formatives pour la pensée se font à un âge plutôt jeune et je pense que c’était vraiment intéressant d’aborder la perception de l’art de ce point de vue avec les émotions qu’elle implique. Je trouve que ça s’adapte vraiment à la période, avec toute la douleur, la frustration qu’il y a en ce moment dans le monde, on essaye de mettre ça dans l’art que l’on fait. C’était vraiment fun de se diriger et d’avancer vers ces endroits. De plus, on a toujours fait en sorte d’inclure notre famille, notre entourage pour créer ces artefacts, ces vidéos que l’on regardera surement plus tard dans notre vie. Et peut-être que lorsqu’on ne sera plus là, ça laissera une trace intéressante de ce que l’on a été.
 Crack Cloud © Clara de Latour pour Manifesto XXI
Crack Cloud © Clara de Latour pour Manifesto XXI
Ma question va être liée à la précédente mais j’ai remarqué sur l’ensemble de l’album, et plus particulièrement sur des morceaux comme Criminal qu’il y avait cet aspect très soundtrack. Dans le futur est-ce que vous vous verriez travailler sur un film complet sur un album, ou réaliser une bande originale par exemple ?
Zach : Aujourd’hui la consommation de la musique se fait un peu de manière archaïque avec le streaming etc. On pense toujours à nos albums comme un ensemble continu et conceptuel du début à la fin, et c’est un peu comme ça que fonctionne une soundtrack d’une certaine façon.
Mohammad : De beaucoup de manières je romantise le côté esthétique quand je pense à la musique, tu construis forcément ces storylines, et ce côté narratif. On veut que notre musique suscite d’une certaine façon cette forme d’imagination visuelle. C’est vraiment le but. Donc si tu le ressens comme ça, cela montre que ce que l’on recherche fonctionne.
Si vous deviez parler de vos coups de cœur, ou de vos influences peu importe le domaine artistique, de quoi parleriez-vous ?
Zach : Je dirai que Fleetwood Mac et Kate Bush ont été de grosses influences dans le processus de création de Tough Baby, Tool aussi (rires). J’ai vu Nick Cave il y a quelques semaines également, c’était vraiment une expérience spirituelle, c’était très beau.
Aleem : Pour ma part je parlerai notamment de ce que fait le réalisateur Jordan Peel – à qui l’on doit Get Out ou Nope notamment – dont j’admire sincèrement le travail. Concernant musique je parlerai sans doute de Miles Davis Prince et de Kanye West, évidemment, de mon côté.
Mohammad : Je suis de plus en plus curieux et attiré par l’art abstrait. Je voudrais parler de cet artiste pluridisciplinaire, comédien, cinéaste basé à Vancouver, Nathan Fielder. On pourrait le comparer à Banksy d’une certaine façon. Il fait réfléchir sur comment l’on se sent, c’est aussi comment on se connecte avec les gens et c’est très intéressant pour moi. Sinon je suis plutôt à fond dans tout ce qui est musique rap, avec des artistes comme Kodak Black
Crack Cloud sera en concert le 27 octobre 2022 au Trabendo à Paris, le 15 novembre à l’Antipode à Rennes, le 16 novembre au Confort Moderne à Poitiers et en tournée dans toute l’Europe sur cette même période.
Cet article Crack Cloud : « On veut que notre musique suscite cette forme d’imagination visuelle » provient de Manifesto XXI.




Si le mariage des couples de même sexe est une avancée considérable, il ne doit pas occulter les discriminations qui demeurent envers les personnes LGBTIQ+, notamment en termes d'accès à la parentalité. On en parle avec Thierry Delessert, spécialiste de l'histoire de l'homosexualité en Suisse.
L’article Mariage pour tous·tes·x en Suisse: et après? est apparu en premier sur 360°.

Ce lundi 10 octobre, la communauté abolitionniste célèbre la 20e Journée mondiale contre la peine de mort partout dans le monde, nouvelle grande étape de mobilisation avant le 8e Congrès mondial contre la peine de mort, qui aura lieu à Berlin du 15 au 18 novembre 2022.
L’article 20e Journée mondiale contre la peine de mort encourue par les personnes LGBT+ dans 11 pays est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.


Un providentiel vide juridique a permis à plus de 200 couples de même sexe de braver l'interdiction de se marier en Chine pour s'unir par visioconférence dans le très conservateur État américain de l'Utah.
L’article Entre l’Utah et les gais et lesbiennes de Chine, une histoire d’amour est apparu en premier sur 360°.

Quelques jours après les 40 ans de la « dépénalisation » de l’homosexualité en France (le 4 août 2022), l’élue LR de Lyon 5 Anne Prost s’offusquait d’une performance drag de Midnight Xpress invitée par la MorningStar et proposée par Baston dans le cadre du festival Tout l’monde dehors, précisant à LyonMag qu’elle considérait que « c’est dangereux pour la population familiale », allant jusqu’à ajouter : « Je ne dis pas que je n’aime pas les drags queens, mais ça ne va pas un dimanche dans un lieu public ».
Face à de tels propos d’une élue, nous gratifiant de qui elle juge bienvenu·e ou non dans l’espace public, on ne peut que se réjouir de l’annonce d’Elisabeth Borne, à l’occasion des 40 ans de la « dépénalisation » de l’homosexualité, de la création d’un ambassadeur aux droits LGBT+. Cet ambassadeur devrait être nommé avant la fin de l’année mais reste à savoir quel sera son rôle. L’exécutif a indiqué qu’il serait rattaché au Ministère des Affaires étrangères, et qu’il « coordonnera l’action du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères pour la protection contre les discriminations et la promotion des droits LGBT + et portera la voix de la France ».
Cette annonce ne peut qu’être saluée. Néanmoins on regrette que le gouvernement ne semble pas tant enthousiaste face au dépôt d’une proposition de loi par le sénateur socialiste de l’Hérault Hussein Bourgi visant à la réparation des personnes condamnées pour homosexualité entre 1942 et 1982.
L’article 3 de cette proposition de loi prévoit que toute personne victime des anciennes lois homophobes aura droit à une allocation forfaitaire de 10 000 €, d’une allocation forfaitaire variable en fonction du nombre de jours de privation de liberté, fixée à 150 € par jour, et du remboursement du montant de l’amende dont elles se sont, le cas échéant, acquittées en application de leur condamnation.
Interrogée sur cette proposition de loi, Mme Borne s’est montrée très timorée, arguant qu’il était difficile de savoir comment réparer les discriminations passées et que l’essentiel était d’acter que l’introduction des discriminations dans la loi était une faute de l’État, sans oublier de commémorer leur abrogation. Pas un mot sur la proposition de réparation financière. Il est manifestement plus facile de créer un poste d’ambassadeur aux droits LGBT+ que de mettre la main au portefeuille pour indemniser les presque dix mille personnes condamnées pour homosexualité dans notre pays durant 40 ans…
L’article Pour les 40 ans de la « dépénalisation » de l’homosexualité : un ambassadeur mais pas d’indemnisations ? est apparu en premier sur Hétéroclite.

Dix-sept personnes, âgées de 20 à 26 ans, ont été jugées, ces 3, 4, 6 et 7 octobre 2022, pour le cyberharcèlement d’Eddy de Pretto, suite à sa performance dans l’Église Saint-Eustache à Paris en juin 2021. Le parquet a requis des peines de trois à six mois de prison avec sursis, pour un délibéré …
L’article De « 3 à 6 mois avec sursis » requis contre les cyberharceleurs d’Eddy de Pretto est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.


Cet article FTMA au 3537, une semaine d’art sonore du 11 au 16 octobre provient de Manifesto XXI.
Du 11 au 16 octobre 2022, la première édition du festival FTMA consacré à l’art sonore et aux musiques électro-acoustiques prendra place au 3537, nouvel hotspot culturel du Marais à Paris.Inspiré par des festivals comme Atonal à Berlin ou Mutek à Montréal, FTMA (Fluxus Tempory Music and Art) est né de la rencontre entre Ugo Nardini, curateur au 3537 et compositeur d’électro-acoustique, et Stéphane de Saint Louvent, producteur, éditeur de musique et DJ, à la tête de trois labels et de l’agence Rotary Lab. Celle-ci a notamment pour but de faire collaborer des compositeurices de musique sur des projets d’expositions, des installations ou dans le cinéma. C’est dans ce cadre-là que l’idée du festival a émergé.
FTMA a pour vocation de rendre accessible l’art sonore au plus grand nombre. « C’est quelque chose d’assez méconnu, y compris dans la communauté de l’art. Les expert·e·s même ne sont pas toustes d’accord sur la définition ! » plaisante Stéphane. « Pour moi, l’art sonore, c’est l’ensemble des pratiques artistiques qui placent le son ou le bruit au cœur du processus créatif d’une œuvre. Et qui, surtout, l’utilisent comme médium direct et objet de la création. Le débat qui revient souvent, c’est : est-ce que c’est de la musique ou ça n’en n’est pas ? »
Un système son 4DSOUND uniqueFTMA n’a pas lésiné sur le programme. Mardi soir aura lieu le vernissage de l’exposition qui se tiendra jusqu’au 16 octobre, présentant une douzaine d’installations, sur entrée libre et gratuite de 11h à 19h. Des workshops organisés par le GRM (groupe de recherches musicales) sur divers sujets autour de l’art sonore et de la musique acoustique seront également proposés gratuitement. Trois soirées de concerts sont prévues du jeudi au samedi soir, avec des artistes comme Shlømo, ou encore Jan Jelinek et Nova Materia, toustes deux en lives exclusifs sur un système son 4DSOUND.
Composé de 28 enceintes omnidirectionnelles, ce système son permet une expérience immersive unique. « Aujourd’hui, on parle beaucoup des systèmes son 360. Ici, l’idée n’est pas de donner l’impression que le son bouge. C’est plutôt de reproduire l’expérience d’écoute qu’une personne peut avoir avec ses oreilles dans la nature. Lorsqu’on est dans une forêt amazonienne par exemple, le son est partout autour de nous : en bas, à droite, à gauche », détaille Stéphane de Louvent.
Pour découvrir la programmation dans son intégralité, rendez-vous juste ici. Si l’expo est accessible librement, ce n’est pas le cas des soirées de concerts dont la vente de billets se fait dans la limite des places disponibles. Et comme on est sympa, on vous balance la playlist du festival, histoire de patienter jusqu’à mardi prochain !
Cet article FTMA au 3537, une semaine d’art sonore du 11 au 16 octobre provient de Manifesto XXI.


A l'occasion de la Coupe du monde de football, la France devrait envoyer au Qatar quelque 220 agents, « principalement issues de la gendarmerie nationale et de la sécurité civile », pour sécuriser la compétition, prévue du 20 novembre au 18 décembre.
L’article Qatar 2022 : un contingent d’experts français de la sécurité pour épauler les autorités d’un État criminel qui persécute les LGBT+ est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.

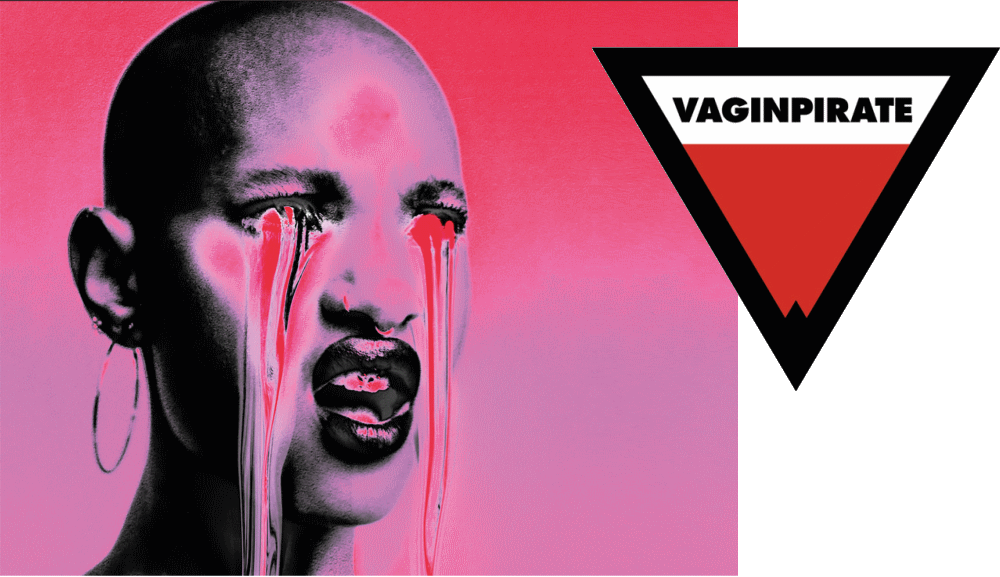
L’automne est là, les mini shorts sont rangés et les dykes sont dans les starting-blocks pour ressortir leur bonnet pref’. Vagin Pirate vous sert ce mois-ci WILLOW, Paulette Éditrice, Laval La Rue, Alex Lahey et Tegan & Sara.
L’article Les pépites d’octobre, par Vagin Pirate est apparu en premier sur 360°.

Cet article L’art écologique, mise en œuvre : Agathe Frochot & David Munoz provient de Manifesto XXI.
Après un échange avec l’association COAL, qui œuvre pour une « nouvelle écologie de l’art », Camille Sauer s’est rendue en haute-montagne, sur les pas de l’artiste David Munoz et d’Agathe Frochot (ENS Paris-Saclay), qui collaborent sur le terrain. Ensemble, iels ont discuté Anthropocène, engagement écologique et liens art-science. Propos recueillis.Comment l’art écologique se met-il en œuvre ? Pendant plusieurs semaines, je suis allée dans le massif de la Vanoise, dans les Alpes, pour suivre le travail de David Munoz et Agathe Frochot. Diplômé en 1993 de l’École nationale supérieure de chimie de Toulouse, l’artiste David Munoz confronte des procédés photographiques anciens (gommes bichromatées, ambrotypes) à des technologies innovantes (photogrammétrie, art génératif, image virtuelle…). Grand passionné d’astronomie, il déploie dans ses installations différents médiums, travaillant autour des notions de réalité augmentée ou d’hyperobjet. Il a exposé l’année dernière au Centquatre Paris le projet Cosa Mentale, dans lequel il questionne le lien entre l’esprit et la matière dans le paysage alpin, et a également présenté des œuvres à la résidence La Capsule au Bourget dans le cadre de la biennale Némo et de la biennale Photoclimat 2021.
Il collabore avec Agathe Frochot, chargée de mission culturelle et scientifique à l’École normale supérieure Paris-Saclay, qui a mené un long travail de recherches sur les mémoires et la mise en patrimoine de la nature alpine à l’heure de l’Anthropocène. Cette collaboration m’a questionnée : que peut apporter l’art à la science, et inversement ? Est-il nécessaire, pour un·e artiste engagé·e dans des questionnements écologiques, de se rendre sur le terrain ? Comment faire lien avec une diversité d’écosystèmes, naturels, sociaux, culturels ?
Avant toute chose, il est primordial pour moi d’établir un lien physique avec le paysage pour le ressentir et l’appréhender dans toutes ses dimensions.
David Munoz
 Cosa Mentale. Image générative, 2021 © David Munoz
Cosa Mentale. Image générative, 2021 © David Munoz
Manifesto XXI – David Munoz, tu es un des rares artistes que je connaisse qui produit ses œuvres sur le terrain. Tu passes des journées entières avec des guides pour apprivoiser et te familiariser au paysage qui t’entoure. Pourquoi une telle importance du terrain ? En quoi ton art nécessite-t-il cet engagement ? Pourrait-il en être autrement ?
David Munoz : Avant toute chose, il est primordial pour moi d’établir un lien physique avec le paysage pour le ressentir et l’appréhender dans toutes ses dimensions. C’est un besoin quasi vital. Avec les effets du réchauffement climatique, le paysage se recompose et se transforme à tel point que la représentation que l’on s’en fait est complètement obsolète et relève plus d’une vision passéiste et figée dans un imaginaire sclérosé. Pour beaucoup, la représentation du paysage relève de l’imaginaire culturel du XIXème siècle, d’une nature éloignée et inaccessible au plus grand nombre, car toujours ailleurs. Il est ainsi nécessaire de se confronter à cette nouvelle réalité pour donner à voir au spectateur cette nouvelle représentation du paysage, en lien avec notre réalité contemporaine et en reconnectant le spectateur avec cette nature dont il est partie prenante.
Pour moi artiste, seul l’art est capable de démanteler les effets insidieux de ce type de vision erronée sur l’imaginaire collectif, en permettant au spectateur de questionner sa propre vision du paysage et se réapproprier son environnement. Être artiste nécessite selon moi une implication avec son sujet, qui passe par le sensoriel, mais également par une implication vis-à-vis du spectateur et plus largement de notre société. C’est avant tout une question de cohérence et il ne pourrait pas vraiment en être autrement.
 Interview d’un habitant. Bessan, Savoie, 2021 © Camille Sauer
Interview d’un habitant. Bessan, Savoie, 2021 © Camille Sauer
Avec Agathe Frochot, tu es allé interviewer des populations locales, des élu·es, des guides, soit un large spectre de la population. Pourquoi cette nécessité de recueillir ces témoignages ? Pourquoi te confronter, et confronter ta vision du paysage, à la leur ? En quoi cela a-t-il impacté ton travail artistique ?
David Munoz : Avec Agathe, nous avons eu l’opportunité de rencontrer des personnes appartenant à des générations différentes et qui avaient toutes en commun une expérience sensible du paysage, mais également des personnes qui avaient fait ou qui font une expérience physique du paysage, comme des alpinistes ou encore des guides de montagne. Il était nécessaire de recueillir leurs témoignages pour qu’iels puissent faire état de cette expérience sensible et qu’iels puissent la partager avec le·la spectateur·rice par mon intermédiaire.
Un autre aspect important pour moi concerne le récit de la transformation du paysage. En l’espace de deux à trois générations, il a radicalement changé sous l’effet du réchauffement climatique alors jusque-là ce type de transformation s’opérait sur plusieurs siècles, voire à l’échelle d’un millénaire.
Il ne s’agit pas de confronter ma vision du paysage à la leur, mais plutôt d’enrichir ma propre vision du paysage de manière à l’élargir et l’approfondir. Ainsi cet apport à la fois sensible et documentaire me permet de nourrir mon art en lui donnant plus de consistance et de cohérence.
 Ascension des Évettes, Savoie, 2021 © Camille Sauer
Ascension des Évettes, Savoie, 2021 © Camille Sauer
Tu entretiens un rapport primaire avec la nature. De la même manière que tu paramètres les paysages de fractales sur des ordinateurs surpuissants, ici, tu calcules la lumière, l’environnement, la température. Tu t’adaptes aux conditions parfois extrêmes de celui-ci. Pourquoi donner à cet environnement déjà spectaculaire une dimension supplémentaire par l’art ? Quelle vision souhaites-tu capter de ce paysage dont l’équilibre demeure fragile ?
David Munoz : Avec l’usage de l’image générée par ordinateur et l’utilisation des fractales, il ne s’agit pas pour moi de restituer la dimension spectaculaire des paysages, des médiums comme la photographie le font déjà très bien. Il s’agit plutôt d’interroger la nature des images qui nous sont données à voir aujourd’hui avec les codes de représentation du paysage. L’art me permet d’intégrer le·la spectateur·rice à l’œuvre et de l’amener vers un questionnement plus critique des images que notre société lui donne à voir.
Avec ce type de procédé, ce qui m’intéresse, ce n’est pas la captation, mais plutôt le fait transmettre ma représentation mentale du paysage, le tout en la restituant avec les codes de représentation imposés par notre héritage culturel.
Il est essentiel d’introduire la dimension sensible dans le traitement de l’urgence écologique. Ce n’est que par ce biais que nous pourrons travailler sur l’imaginaire et la conscience du·de la spectateur·rice et ainsi ancrer une « culture écologique » durable qui aura la capacité de faire évoluer notre rapport au monde.
David Munoz
L’Anthropocène, c’est le thème à la mode. Quelle place pour l’urgence écologique dans tout ça ? Penses-tu que les gens aient conscience de toutes les dimensions de cette notion qui est largement utilisée en politique et par de plus en plus d’artistes ? Je pense par exemple à Tomás Saraceno au Palais de Tokyo en 2018.
David Munoz : La notion d’Anthropocène, dont les prémices remontent au XVIIIème siècle avec Buffon, fait davantage état d’une transformation profonde de la surface de la Terre par la main de l’homme, que d’une urgence écologique. Pour moi, l’urgence écologique réside plutôt dans une action politique concertée à l’échelle mondiale, dans laquelle l’artiste peut prendre place en aidant à sensibiliser les personnes, de manière à ce que celles-ci interrogent leurs classes politiques sur ce sujet, mais également en incitant à devenir des acteur·rices politiques actifs.
Malheureusement, je ne suis pas sûr que les gens aient pleinement conscience de toutes les dimensions que revêt cette notion car les différentes politiques écologiques et actions de sensibilisation qui ont été menées jusqu’à présent sont trop minimalistes et servent surtout à se donner bonne conscience en effectuant quelques petits gestes au quotidien au lieu d’élargir la vision des personnes et de leur permettre d’appréhender la globalité du phénomène en apportant des réponses globales.
Concernant les artistes, il y en a bien sûr certain·es qui surfent sur la vague de l’Anthropocène, mais il y en a aussi d’autres comme Tomás Saraceno qui, au travers d’initiatives comme « l’Aérocène », ont créé une communauté artistique interdisciplinaire, permettant aux gens venant de différents horizons de réactiver un imaginaire commun et de collaborer de manière éthique sur des sujets environnementaux.
Le terme Anthropocène ne me paraît pas adapté à la situation actuelle, car il inclut tous les humains, y compris les gardiens de vaches dans les alpages ou encore les Indiens d’Amazonie, or je ne suis pas sûr que ces personnes-là aient modifié la surface de la Terre de manière durable. Selon moi, il s’agit davantage des effets de la mondialisation sur notre planète, et pour cette raison, je lui préfère le terme de « capitalocène ».
 La Grande Casse. Sculpture, David Munoz, 2021 © Corentin Schimel
La Grande Casse. Sculpture, David Munoz, 2021 © Corentin Schimel
Peux-tu me parler de ton projet intitulé La Grande Casse ?
David Munoz : La Grande Casse est une métaphore de l’urgence climatique. La sculpture permet de rendre visibles les effets du réchauffement climatique sur un glacier. Bien plus qu’un phénomène naturel, la « Grande Casse » incarne la chute d’un mythe. En perpétuelle évolution, la sculpture témoigne du fragile équilibre des écosystèmes. Elle donne à voir au public un paysage en pleine mutation avec la disparition des mythes et des légendes qui l’accompagnent.
Ce projet puise ses origines dans une observation aiguë de la nature et plus largement dans mon rapport à l’environnement et au monde. Le titre fait référence au glacier de la « Grande Casse » situé dans le massif de la Vanoise. Ce projet est basé sur une collaboration avec les scientifiques de l’INRAE, spécialisé·es en glaciologie, les laboratoires de Génie mécanique et de Génie civil de l’ENS Paris-Saclay, avec les soutiens de la Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay, de la Diagonale de l’Université Paris-Saclay et du Centquatre Paris.
Comme pour beaucoup d’artistes, l’art pour moi est un puissant vecteur de représentation, à même d’insuffler et d’accompagner des changements de société profonds.
David Munoz
Pourquoi ce choix d’être le plus fidèle possible à la réalité ? Tu récoltes par exemple des données (LIDAR, numérisation 3D du glacier obtenu avec des drones, des équipements terrestres et des satellites, photogrammétrie, sondes et données climatiques) grâce à des partenariats tels que l’INRAE ou encore l’Université de Grenoble.
David Munoz : Pour moi, il ne s’agit pas tant d’être fidèle à la réalité. Mon objectif est plutôt de donner à voir au spectateur ce que sont les paysages vus par les machines utilisées par les scientifiques avec lesquels je collabore. C’est donc tout naturellement que je me suis tourné vers les scientifiques de l’INRAE qui utilisent des technologies de pointe pour capter des variations de quelques centimètres à la surface des glaciers.
J’utilise surtout le réel comme matière première. Cette matière me permet de générer des formes plastiques, comme des sculptures ou encore des images. Ceci en réintroduisant du sensible dans des phénomènes véhiculés avec des procédés scientifiques, comportant une certaine complexité. Pour parler d’urgence écologique, on a surtout un vocabulaire technique, et ce sujet est abordé essentiellement sous des angles politiques, économiques et scientifiques, en jouant sur les sentiments de culpabilité et de peur.
En tant qu’artiste, il me semble essentiel d’introduire la dimension sensible dans le traitement de l’urgence écologique. Ce n’est que par ce biais que nous pourrons travailler sur l’imaginaire et la conscience du·de la spectateur·rice et ainsi ancrer une « culture écologique » durable qui aura la capacité de faire évoluer notre rapport au monde. Comme pour beaucoup d’artistes, l’art est pour moi un puissant vecteur de représentation, à même d’insuffler et d’accompagner des changements de société profonds.
 © LIDAR – Numérisation 3D du glacier de la Grande Casse
© LIDAR – Numérisation 3D du glacier de la Grande Casse
Agathe Frochot, comment définis-tu l’écologie ?
Agathe Frochot : L’écologie désigne d’abord une discipline scientifique née au XIXème siècle. Plus précisément, le terme apparaît dans les écrits du zoologiste allemand Ernst Haeckel en 1866. Si l’écologie a toujours eu pour principe d’analyser le vivant en relation avec son milieu, elle a longtemps rejeté les activités anthropiques de son périmètre d’étude. Après les avoir considérées comme des « éléments perturbateurs » jusque dans les années 1980, l’écologie développe de nouveaux concepts et de nouvelles méthodes (socio-écosystème, services écosystémiques…) afin d’intégrer à son champ d’étude les multiples interactions entre l’humain et les écosystèmes.
L’écologie scientifique est à différencier de l’écologie politique qui représente divers courants de pensée et recouvre de multiples communautés politiques (partis, associations, collectifs…) qui ont pour point commun de proposer de nouvelles manières d’habiter le monde impliquant de nouvelles relations entre l’humain, le vivant et le non-vivant. À des degrés variés, tous agissent en faveur d’un bouleversement de nos systèmes politiques et de notre modèle économique et social.
Tu réalises un travail de recherche sur les mémoires et la mise en patrimoine de la nature alpine à l’heure de l’Anthropocène. Qu’est-ce que la vision et la collaboration avec David Munoz apporte à tes recherches ?
Agathe Frochot : En premier lieu, cette collaboration représente pour moi un espace d’exploration des apports possibles d’une démarche de recherche artistique à une pratique de recherche en humanités environnementales. En particulier, je m’interroge sur la manière dont le partage de cette création, dans ses phases amont et aval, peut enrichir la relation d’enquête nouée avec les communautés étudiées. La transformation visuelle du paysage de haute-montagne impliquée par le retrait glaciaire (assombrissement des cimes, verdissements des anciens espaces glaciaires, effondrements de parois…) représente un bouleversement sensible important pour les populations locales appelant à des réponses non seulement d’ordre socio-économique mais également d’ordre culturel. Dans la mesure où son processus de création et ses phases de diffusion s’ancrent sur les territoires touchés, l’œuvre de David Munoz peut participer à ces processus d’adaptation à l’échelle locale. C’est aussi le cas du travail artistique d’Olivier de Sépibus, un photographe et artiste plasticien qui explore nos rapports avec la nature et le monde vivant.
À un moment où la disparition des glaciers alpins est annoncée à moins de cent ans, je me questionne aussi sur les dynamiques de patrimonialisation qui peuvent émerger à l’horizon de ces pertes. Le travail artistique a peut-être aussi un rôle à jouer dans ces dynamiques de mémoire et de transmission intergénérationnelle.
Puis, les autres axes de collaboration art-science que développe cette recherche-création ont retenu mon attention non pas seulement dans une logique de coordination d’acteur·rices au sein d’un projet qui, je le rappelle, est lauréat d’un appel à projets de l’Université Paris-Saclay (EXPÉRIMENTATION 2020), mais également au titre des dynamiques interdisciplinaires qui peuvent se faire jour autour des sujets environnementaux.
David Munoz a eu des échanges avec plusieurs chercheur·ses impliqué·es dans le projet Life Without Ice notamment en écologie (CEFE, Montpellier) et en glaciologie (IGE, Grenoble), auxquels j’ai pu participer. Ce projet a pour objectif d’étudier les conséquences physiques, écologiques et sociales de l’extinction des glaciers à l’échelle mondiale, et en particulier dans les régions tempérées (Alpes) et tropicales (Andes et Rwenzori). Ces temps d’échanges impulsés par la création d’une œuvre ont démontré que des recherches en humanités environnementales peuvent s’enrichir à travers des échanges ponctuels ou durables avec des recherches en sciences de l’environnement et inversement, parce qu’elles partagent a minima une finalité, celle de la durabilité de ces socio-écosystèmes impactés par des changements climatiques globaux.
 Ascension des Évettes, Savoie, 2021 © Camille Sauer
Ascension des Évettes, Savoie, 2021 © Camille Sauer
Quel rapport entretient l’art avec la science selon toi ?
Agathe Frochot : Il n’existe pas un mais de multiples rapports entre les arts et les sciences, des disciplines fondamentales aux sciences sociales. Ils ont recouvert de multiples formes dans l’histoire et se renouvellent aujourd’hui principalement dans les contextes du développement des technologies numériques et des changements socio-environnementaux de l’Anthropocène.
De plus, comme l’ont montré plusieurs études, les cadres de travail des artistes se transforment au bénéfice de dispositifs qui font émerger la figure de l’artiste comme chercheur·se. Le travail de création peut désormais se déployer dans des temporalités et des cadres institutionnels (thèse, appels à projets) qui facilitent l’établissement de ponts avec le monde de la recherche académique classique. Ces échanges ne sont pas évidents, ils sont à construire conjointement par les artistes et les scientifiques qui, à partir d’un objet d’intérêt commun, sont sommé·es de trouver un langage partagé pour que les collaborations soient bénéfiques aux un·es et aux autres. C’est ce défi-là qui me semble intéressant aujourd’hui dans les projets art-science. Il porte en lui la promesse du développement de nouvelles manières de chercher et de façons de créer, et d’une extension du domaine de la preuve scientifique dans lequel les registres savants et sensibles se recomposent.
À mon sens, la réussite des projets art-science est également conditionnée par la mise en place de politiques culturelles ambitieuses permettant la diffusion et la médiation complexe des œuvres ainsi créées dans l’espace public et vers les publics. Les expériences sensibles mais aussi les différents apprentissages et mises en débat dont l’œuvre est le point de départ nécessitent, pour advenir concrètement, des moyens humains et matériels dont on ne peut faire l’économie. De même, on aurait beaucoup à apprendre d’études (en sciences de l’information et de la communication) qui permettraient de mieux connaître la réception de ces œuvres par les différents publics qui s’y exposent.
 Hyperobject. Glacier du Rhône, Suisse. Photographie, 2019 © David Munoz
Hyperobject. Glacier du Rhône, Suisse. Photographie, 2019 © David Munoz
Cet article L’art écologique, mise en œuvre : Agathe Frochot & David Munoz provient de Manifesto XXI.




Jamal est l'auteur du podcast « JINS » (sexe en arabe) qui propose un contenu riche, passionnant, utile. « JINS », c'est comme l'indique sa présentation, « le premier podcast sur la sexualité des personnes Arabes et/ou musulmanes. 100% indépendant, féministe, intersectionnel et inclusif. » Jamal nous a accordé une longue interview.

Cet article Pop & Psy : naissance d’un festival unique sur la santé mentale provient de Manifesto XXI.
Ce week-end à Ground Control, le docteur Jean-Victor Blanc vous convie à la première édition de Pop & Psy, le premier festival pop de la santé mentale. C’est un événement gratuit, porté avec la Fondation Falret reconnue d’utilité publique.Du 7 au 9 octobre, dans le 12ème on tentera de comprendre et de déstigmatiser les troubles psychiques grâce à la pop culture. Dans le monde, 1 milliard de personnes sont concerné•e•s par ces troubles et, au cours de la première année de cette chère pandémie de Covid-19, la fréquence des troubles anxieux ou dépressifs a augmenté de plus de 25 %. Premier événement pop consacré à la santé mentale, le Festival Pop & Psy a plusieurs vocations : dépoussiérer les idées reçues sur la psychiatrie, favoriser les échanges entre expert•e•s, personnes concerné•e•s et artistes. Imaginé par Jean-Victor Blanc, médecin psychiatre et addictologue à l’hôpital Saint-Antoine à Paris et auteur des livres Pop & Psy et Addicts, le festival met également en lumière des solutions innovantes qui existent. Tout ça dans une atmosphère ludique, festive et inclusive.
Talks, live et optimismePop & Psy vous offre une programmation riche et festive. Vous pourrez assister tout au long du week-end à des tables rondes autour de plusieurs sujets tels que « Femmes au bord de la crise de nerfs : quels regards sur les troubles psychiques des femmes à l’écran ? » ou encore sur l’éco-anxiété dont nous souffrons à peu près toustes avec un talk « Eco-anxiété : Greta, Euphoria, Melancholia : comment garder son calme lorsque la Terre brûle ? ». Ces prises de parole seront animées par des personnalités comme Charlotte Pudlowski, fondatrice de Louie Media, le rappeur Gringe, le docteur Serge Hefez ou encore l’humoriste Fary; et bien d’autres acteurices associatif•v•es, des personnes concernées et des artistes. Au cours du week-end, vous pourrez également faire un tour en toute bienveillance au « Village des solutions », ou apprécier l’exposition d’art graphique « les Icônes Pop & Psy » curatée par le media Kilblind.
 Artwork © Anna Wanda Gogusey
Fiesta loca
Artwork © Anna Wanda Gogusey
Fiesta loca
L’idée, c’est aussi de se détendre, et pour ça Pop & Psy vous a prévu des moments de fête qui promettent d’être exceptionnels, comme avec Madame Arthur qui s’invite pour un spectacle de cabaret. Une foultitude d’autres concerts, lives et DJ sets sont prévus, le programme se trouve juste ici. Le festival est gratuit et l’entrée se fait dans la limite des places disponibles, on vous conseille donc de réserver et d’arriver tôt !
Cet article Pop & Psy : naissance d’un festival unique sur la santé mentale provient de Manifesto XXI.

Un enfant de 12 ans a été victime d’une tentative d’empoisonnement à l’eau de javel par sa mère, qui venait de découvrir qu'il consultait des sites gays.
L’article Une mère soupçonnée d’avoir tenté de donner la mort à son fils « homosexuel » est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.


Unique en Suisse romande, le festival genevois Everybody's Perfect présente, du 7 au 16 octobre, 28 films en provenance d'une vingtaine de pays. On a sélectionné quelques-unes de ses pépites.
L’article Everybody’s Perfect voyage dans le cinéma queer est apparu en premier sur 360°.

Le Parlement slovène a adopté mardi 4 octobre un amendement autorisant le mariage des couples de même sexe et l'adoption homoparentale, après un arrêt de la Cour constitutionnelle, faisant de ce pays le premier d'Europe de l'Est à légiférer en ce sens.
L’article « Mariage et adoption pour toutes et tous » : La Slovénie entérine la réforme est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.




Réfléchir aux questions sur le sexe biologique et le genre chez les humains, à l'aune des observations sur nos cousins primates, chimpanzés ou bonobos: dans son dernier ouvrage, le célèbre primatologue Frans de Waal appelle à ne pas choisir entre nature et culture, à rebrousse-poils de combats souvent idéologiques.

Cet article Bizarre festival, une troisième édition toujours aussi curieuse et queer ! provient de Manifesto XXI.
Du jeudi 13 au dimanche 23 octobre, le Bizarre festival va insuffler un tourbillon d’énergies queers sur tout le parc de la Villette. Pour sa troisième édition, c’est plus de 18 évènements qui agiteront le Nord-Est Parisien et toute son étrange faune et flore.Initié par à la Folie et La Villette, le Bizarre festival se donne pour objectif de fédérer les énergies LGBTQIA+ pendant deux longs week-ends. Oiseaux de jours comme de nuits pourront être contenté·e·s, tout comme les bébé·s queers et les plus agé·e·s pourront se retrouver autour d’évènements en majorité gratuits.
Après la soirée d’ouverture menée par le magasine queer historique Têtu, Bizarre peut se penser pour les plus fétard·e·s d’entre nous comme une grande messe réunissant les collectifs emblématiques de la teuf techno indé LGBTQIA+. Autant de temps de communion que permettent d’aligner la Spectrum le 14, la “gay gay gay bien ouverte à toute” Mustang le 15, la Folle Sentimentale le 20 ou encore la Tech Noire et le cabaret Aïe, emmené par John Cameron Mitchell le 22.
 Affiche BIZARRE #3 octobre 2022 La Villette – illustration : Laho
Affiche BIZARRE #3 octobre 2022 La Villette – illustration : Laho
L’occasion aussi de se questionner autour de sa pratique de la fête : que choisir entre la Barbi(e)turix et la Créole le 16 octobre au soir ?! Plus sérieusement, la soirée “With Us” du 14 octobre, et le talk mené par la DJ et productrice Desire nous questionnera : « Comment articuler scène club, identités et vécus trans et queer, parole et dancefloor ? »
De jour, il sera possible de se retrouver autour d’un « Queer tatoo day » le 15, ou à la grande réunion des familles du 16. Les traditionnels bingo drag du dimanche seront à l’honneur les samedis 16 et 23 et lors d’un temps fort pour mettre. Enfin, les photographes et corps queers seront mis à l’honneur lors du « Queer Photo Day » le 22 octobre.
Toute la team Manifesto XXI vous donne rendez-vous l’avant dernier soir, le samedi 22 octobre à la Folie pour une soirée 100% lesbian love. Montée en collaboration avec Lesbien Raisonnable, cette soirée en entrée libre de culture saphique sera l’occasion de récupérer ses contreparties du financement du podcast Lesbiennes au coin du feu, de tester ses connaissances en musique et culture lesbienne et enfin, de danser un peu. Tout en gardant de l’énergie pour la vraie journée de clôture le lendemain, à base de brunch cabaret et bingo drag à la folie, en attendant le featuring Vitalic au Pavillon Villette

Image à la Une : © Vovotte Recto/Verso
Cet article Bizarre festival, une troisième édition toujours aussi curieuse et queer ! provient de Manifesto XXI.


On a rencontré Aloïse Sauvage à l'occasion de la sortie de son magnifique nouvel album, SAUVAGE, le 7 octobre. Ça déborde d’énergie positive filant droit vers un monde nouveau, le tout sans concession. Vagin Pirate est fan!
L’article Aloïse Sauvage, cheffe de meute est apparu en premier sur 360°.

Un an après l'entrée en vigueur de la loi bioéthique, trois couples de femmes engagés dans un protocole et trois célibataires, qui n'ont pas été acceptées ou ont préféré l'étranger, témoignent sur France Info, évoquant leurs joies et désillusions.
L’article PMA pour toutes : un an après la loi, neuf femmes partagent leur expérience est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.


C’est un exemple parmi tant d’autres: les manifestations en France, lors du débat autour de l’ouverture du mariage aux couples de même sexe, il y a dix ans de cela...
L’article Sujet politique est apparu en premier sur 360°.


Dr. Hazbi est enseignant·x universitaire, artiste et politicien·x. Son téléphone est bourré de réflexions qu'iel s'empresse de retranscrire, couche par couche.
L’article Une d’ces couches! est apparu en premier sur 360°.


Pour garder les pieds sur terre, rien ne vaut un plongeon la tête dans les étoiles. Ce mois, le signe à l’honneur est Balance.
L’article Attraction des astres est apparu en premier sur 360°.




360° a échangé avec deux personnes qui offrent du sexe tarifé pour les femmes / les personnes à vulve. En deuxième partie, une quinzaine d'entre elles nous partagent leurs impressions vis-à-vis du travail du sexe
L’article Du sexe tarifé pour tous·tes·x est apparu en premier sur 360°.

Six personnes comparaitront les 3, 4, 6 et 7 octobre 2022 pour le harcèlement homophobe d'Eddy de Pretto, après un concert à l'église Saint-Eustache à Paris en 2021. Il avait reçu plus de 3 000 messages d’injures et menaces de mort. STOP homophobie est partie civile.
L’article Eddy de Pretto : six personnes jugées pour harcèlement homophobe est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.


La plus haute juridiction administrative française a validé la circulaire du ministère de l'Éducation nationale de septembre 2021 qui préconise l'utilisation, par le personnel éducatif notamment, du prénom d'usage choisi par les élèves transgenres.
L’article Le Conseil d’État autorise les élèves transgenres à porter le prénom d’usage de leur choix est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.

Cet article LYZZA : « Je m’identifie aux moustiques parce que personne n’a envie qu’ils soient là » provient de Manifesto XXI.
L’artiste brésilienne LYZZA voit grand avec la sortie de sa nouvelle mixtape MOSQUITO, découverte le 16 septembre chez Big Dada. Accompagné d’un court métrage éponyme réalisé par Enantios Dromos, LYZZA présentera son projet au public français le 21 octobre à la Station Gare des Mines et au festival Girl’s Don’t Cry le 26 novembre.Après quatre EP, de nombreux singles et une place de DJ affirmée dans les plus grands festivals européens, LYZZA s’essaye au format album. Productrice, performeuse, chanteuse et maintenant actrice, celle qui ne se voyait pas comme une grande star dans sa chambre d’ados dévoile désormais l’étendue de son discours artistique sur nos écrans et dans nos oreilles. Rencontre.
 LYZZA par Pe Ferreira
LYZZA par Pe Ferreira
Manifesto XXI : Tes derniers concerts en France remontent à la Station en 2019 et, plus loin, aux Transmusicales de Rennes en 2018. Qu’est-ce qui a changé pour toi depuis ?
LYZZA : Je pense que le premier grand changement, c’est que je me concentre maintenant sur les performances live. Cela m’a pris du temps d’admettre que la manière dont j’ai envie de m’exprimer, c’est via mes propres productions. Je ne fais que du live depuis la fin du COVID. J’ai l’impression que ça me permet d’établir une connexion plus proche avec les gens, je leur parle vraiment, avec de vrais mots !
Je regardais avant notre entrevue une vidéo de ton DJ set au Sonar en 2018. Est-ce que tu pensais déjà arrêter le live à ce moment-là ?
J’ai toujours porté une attention à la manière dont je communiquais avec le public, à comment créer une atmosphère lors d’un show. Je pense que c’est pour ça que j’ai commencé à me sentir loin lors de mes DJ set. J’ai eu l’impression d’être face à un mur. Même si je produisais depuis 2016, et que je n’avais rien sorti depuis 2019, je me suis mise à me demander « pourquoi je ne me sens pas plus proche des gens ? Pourquoi je n’arrive pas à raconter d’histoires ? » C’est parce que je n’utilisais pas ma voix ! Il y a plein de DJ qui sont capables de raconter des histoires avec de la musique produite par d’autres, mais ce n’était pas mon cas. En tant que productrice et chanteuse, le DJing ce n’était pas assez pour pouvoir m’exprimer.
Est-ce que MOSQUITO, le court métrage, est la suite logique de cette évolution ?
C’est quelque chose que j’aime faire ! Je suis très créative et il me semble que la musique et l’image vont très bien ensemble. L’EP MOSQUITO a un concept très clair, c’est donc venu assez naturellement. J’avais envie de développer les thématiques qui y sont abordées de manière visuelle.
Pourquoi as- tu choisis de travailler avec Enantios Dromos, le réalisateur du film ?
Enantios Dromos et moi sommes de très bons ami·e·s. Quand iel a déménagé au Royaume-Uni en 2019, j’avais une place qui se libérait dans ma coloc, donc je lui ai proposé de venir habiter avec moi. Iel est arrivé·e avec Pe Ferreira, le photographe de mes covers d’albums. Iels sont aussi brésilien·nes et j’ai senti une bonne connexion avec elleux. Je pense que le Brésil est un pays spécial quand on parle des arts, de la communication, mais aussi de la construction des identités de genre et de race. C’est un pays chargé d’histoire. Ce dénominateur commun, venir du Brésil, nous a beaucoup rapproché·e·s, dans un endroit comme Londres. C’est donc venu naturellement de retourner au Brésil à trois et de travailler sur ce projet de film.
“Je pense que le Brésil est un pays spécial quand on parle des arts, de la communication, mais aussi de la construction des identités de genre et de race.”
LYZZA
Dans la première scène du film MOSQUITO, on te voit en train de danser plus jeune dans ce qui semble être ta chambre d’ado. Est-ce que la LYZZA ado avait envie de devenir artiste ?
Non, je pense que je n’y avais pas pensé plus jeune. Je sais que j’ai toujours aimé la musique, mais je ne pensais pas en faire mon métier. Ce n’était même pas conscient à ce moment-là, mais je n’avais pas de rôles modèles dans ma famille ou mes ami·e·s. Quand on a déménagé aux Pays-Bas, ma mère a passé un temps à être femme de ménage. Mon beau-père au Brésil travaillait dans l’informatique, ils ne sont pas artistes. Ce n’était donc pas du tout dans mon champ des possibles.
Je me souviens que mon père biologique avait une platine vinyle, mais il ne l’utilisait jamais. Il y avait aussi des figurines en porcelaine d’un groupe de jazz noir, mais il ne m’en a jamais parlé. C’était juste là, chez moi.
En déménageant en Europe, je suis arrivée dans une société très occidentale, mon entourage n’était plus le même. Au Brésil, il y a beaucoup de pauvreté, et une grande différence entre les riches et les pauvres, il n’y a pas de classe moyenne. Dans ces conditions, je ne pense pas que tu puisses te projeter en te disant “Je veux faire de l’art”. Ce n’est pas admis par plein de gens, car tu vis dans une société qui est concentrée sur le fait de subvenir à ses besoins vitaux.
Grandir en Europe m’a ouvert à de nouveaux horizons et j’ai commencé à faire de la musique. J’écoutais de l’indie pop : c’était le genre de musique électronique le plus alternatif à ce moment-là ! Des groupes comme Two Doors Cinema Club, Hyphen Hyphen… J’ai toujours fait des playlists et des mixtapes pour mes potes, je téléchargeais les musiques et mettais sur cassettes en me disant « j’ai tellement bon goût ». Un jour, je suis tombée sur un atelier de DJing qui coûtait 50 euros et je me suis dit pourquoi pas ! C’est à ce moment-là que j’ai eu mon premier ordinateur, j’ai appris à utiliser des CDJ et voilà. Je suis tombée dans la musique assez naturellement. Je ne voulais pas être riche et célèbre, je pense que j’ai quelque chose d’important à exprimer, sur la manière dont je pense le monde.
Je n’ai pas passé beaucoup de temps à danser devant mon miroir quand j’étais ado, mais je le fais beaucoup maintenant, sur mes chansons !
MOSQUITO : « The Movie »Il me semble que ta musique parle beaucoup du rejet…
Je ne pense pas que ça soit du rejet, mais plutôt de l’incompréhension. Il me semble que le rejet est un choix très actif, alors que, dans mon cas, je pense que les gens s’interrogent et me trouvent bizarre, n’arrivent pas à me mettre dans une case. Je ne peux pas dire que je me sens rejetée par l’industrie musicale, car je me suis sentie si connectée avec tellement de gens ces dernières années. Mais j’ai remarqué qu’en général, les gens n’arrivent pas très bien à saisir ce que je fais. Pourtant, je ne suis pas si bizarre ! Je produis juste ma musique et les gens me demandent « mais qu’est-ce que c’est que ça? LYZZA ? ». Je ne sais pas, de la techno alternative, mélangée à du reggaeton ? C’est très drôle. Ma musique parle du fait que personne ne sait quoi faire de moi, ni ce que je fais là. (rires) Mais je pense qu’elle touche les gens, même ceux qui ne veulent pas que je sois là. e m’identifie aux moustiques parce que personne n’a envie qu’ils soient là, on ne sait jamais ce qu’ils font là.
À la fin du film, tu donnes une carte de visite MOSQUITO à la personne accoudée à côté de toi au bar. LYZZA, si tu pouvais choisir n’importe qui, qui recruterais-tu dans le MOSQUITO gang ?
Oh mon dieu ! Je ne sais pas… Honnêtement, toutes les personnes qui font partie d’une diaspora, les personnes queer racisé·e·s. La diaspora est une chose importante pour moi, car il me semble que nous avons des vécus communs, qui viennent avec le fait de ne pas vraiment savoir où est ta place, d’où tu viens, etc. Cela fait partie des privilèges dans l’identité, de savoir d’où tu viens. Ce questionnement est aussi celui de la communauté queer, savoir que tu peux être à ta place quelque part. Tout le monde peut rejoindre le Mosquito gang, si tu sens que tu as besoin d’une maison !
Cet article LYZZA : « Je m’identifie aux moustiques parce que personne n’a envie qu’ils soient là » provient de Manifesto XXI.



L’automne est bien installé et vous vous demandez ce que vous pouvez mater d’original qui sorte des propositions algorithmiques de Netflix? 360° vous propose de découvrir la série Futura qui regroupe dix court-métrages suisses à visionner sans plus attendre.
L’article Futura: exploration helvétique en dix court-métrages est apparu en premier sur 360°.

Cet article Le courage de les appeler fascistes provient de Manifesto XXI.
A 100 ans presque jour pour jour de la Marche sur Rome, le coup d’Etat qui a permis à Benito Mussolini de prendre le pouvoir, le fascisme a remporté les élections en Italie grâce à l’union des droites de Silvio Berlusconi, Matteo Salvini et Giorgia Meloni.Le rêve mussolinien absolu est réalisé : le parti fasciste a été élu démocratiquement, sans besoin de recourir à la persuasion brutale. Le peuple a sciemment choisi le fascisme.
En France, on se berce d’illusions en parlant encore de « montée » du fascisme et de « possibilité » que Marine Le Pen gagne en 2027 : Marine Le Pen est déjà au pouvoir avec ses quatre-vingt neuf député·e·s à l’Assemblée Nationale. Son parti arrive au deuxième tour depuis vingt ans.
A celles et ceux qui perdent leur temps à se demander si « oui ou non » on doit les appeler fascistes : penser que le fascisme en 2022 se manifeste selon les mêmes modalités qu’en 1922, c’est d’une naïveté déroutante.
Le fascisme a un siècle d’histoire et en un siècle, une idéologie évolue et modifie ses langages et symboles. Le fascisme est une façon de regarder le monde qui s’oppose de manière presque manichéenne aux féminismes et aux théories queers. Le fascisme est une foi, et la foi, ne meurt pas en abattant simplement son Créateur.
Historiquement, il est inexact de parler de fin du fascisme. Après la guerre, il fût impossible en Italie et en France d’éradiquer les fascistes des institutions. Le chercheur Mimmo Franzinelli montre dans ses ouvrages (Il fascismo é finito il 25 aprile 1945, 2022) le continuum fasciste au sein des instances de justice, éducation, police italiennes : Mussolini était certes mort, mais ses fidèles étaient partout. L’Etat était gangréné par ses fonctionnaires fascistes.
Le continuum fasciste est présent également en France, où des lois vichystes persistent dans nos codes (L’héritage de Vichy – Ces 100 mesures toujours en vigueur, Cécile Desprairies, 2012), où la police ayant participé aux rafles n’a pas pu être épurée de tous les collaborationnistes, où la collaboration fût bien plus active que la résistance.
Il faut avoir le courage de les appeler fascistes. Ne pas nommer cette idéologie, c’est collaborer.
Les journalistes, hommes politiques, intellectuel·le·s qui tergiversent à appeler les fascistes avec leur nom ont une responsabilité historique dans leur prise de pouvoir.
S’intéresser au fascisme ce n’est pas faire de l’archéologie, mais une plongée dans la fragilité de nos démocraties.
Mimmo Franzinelli,
Il fascismo é finito il 25 aprile, 2022
La pensée féministe, queer intersectionnelle est l’antidote aux fascismes. C’est en contre-pouvoir que nous devons nous organiser. La révolution romantique (relire l’article ici) est et restera l’élan vers la justice, la responsabilité de l’amour politique et le renouveau de nos démocraties.
Iels veulent notre disparition parce que nous pouvons provoquer la leur. Tôt ou tard les démocraties seront queers.
Et nous écrirons les pages de l’Histoire que les générations futures seront fières de raconter, quand le 25 septembre 2022 ne sera qu’un terrible et honteux souvenir.
Image à la Une : Giorgia Meloni lors d’une allocution sur la chaîne Youtube de Fratelli d’Italia le 22 août, capture d’écran.
Cet article Le courage de les appeler fascistes provient de Manifesto XXI.

Cet article Porn Process : comment le collectif bruxellois Les PéPé·e·s s’empare du porno provient de Manifesto XXI.
« Fissurer l’industrie hétéro-patriarcale du porno » en s’y frayant une place, par et pour les concerné·es : telle est l’ambition du Porn Process, porté depuis cinq ans par le collectif queer bruxellois les PéPé·e·s. Iels seront de passage à Paris ce dimanche pour la cinquième édition du Marché de l’Illustration Impertinente, grand messe érotique de l’automne.Fondé en 2017 dans le cadre d’un projet d’études, le Porn Process (ex-Porn Project) regroupe une dizaine de personnes queers qui, portées par « l’urgence de créer des images de [leurs] individualités », réalisent des films porno en autogestion et sans financement. Sur les tournages, « en mixité choisie sans mec cis », l’idée est que chacun·e puisse s’emparer des images pornographiques, en se familiarisant aux différents rôles, de la performance à la technique, en passant par le scénario et le montage. Iels sont invité·es au Marché de l’Illustration Impertinente du Hasard Ludique, l’événement coquin qui réunit 30 illustrateurices érotiques et une dizaine d’animations sexy pendant le première week-end d’octobre. Le collectif y animera une projection-discussion autour de leurs films Ya personne qui nous regarde et Écoutez-moi le 2. Pour cette occasion, on a rencontré LoupKass, aurore et Hallux, trois membres du collectif.
Ce qui me trouble dans la pornographie, c’est qu’une image et des histoires puissent directement provoquer des choses sur un corps.
aurore, Porn Process
Manifesto XXI – Quelles ont été les réflexions derrière la création du Porn Process ?
aurore : En octobre 2017, dans le cadre de mes études à l’ERG [École de Recherche Graphique à Bruxelles, ndlr], j’ai organisé pendant 6 mois des réunions mensuelles sur les questions de pornographie, en invitant des gens à venir. On parlait de nos rapports aux images, de nos fantasmes, nos désirs. Et on a organisé un tournage parce qu’on ne pouvait simplement plus se satisfaire de la théorie. On a décidé de passer à l’acte, avec un tournage de 3 jours, et c’est dans ce cadre que Loup et Hallux ont débarqué. C’est-à-dire que le groupe des réunions mensuelles s’est retrouvé sur le tournage avec une autre moitié de personnes « neuves ».
Moi, j’aime raconter des histoires, je vois le monde comme ça, donc c’est à cet endroit que je me sens actant·e et politique. Au moment de la création du Porn Process, la pornographie condensait les questions que je me posais, avec les notions d’intime et de politique, de cadre et de représentation, de sexualité, de désir, de mise en relation et de manières d’être au monde. Il faut dire que ce qui me trouble dans la pornographie, c’est qu’une image et des histoires puissent directement provoquer des choses sur un corps.
 2019 © PornProject
2019 © PornProject
Hallux : Pour moi, la réflexion derrière les tournages, c’est comment on questionne le porno aujourd’hui. Quelles images sont véhiculées, comment on peut montrer d’autres sexualités. Tout le porno mainstream qu’on trouve sur internet est fait d’après un regard masculin, donc c’est voir comment changer la donne, en partant de nos désirs, de nos corps, de ce que nous on a envie de faire.
Le porno est figé dans cette dimension d’éthique depuis longtemps, depuis sa définition, c’est un peu épuisant.
aurore, Porn Process
Comment définiriez-vous le porno ?
aurore : Le porno est d’abord un genre cinématographique. Moi j’ai appris à faire du cinéma avec le porno. J’en ai consommé beaucoup, et il y a des pornos. Quand on en fait, il faut quand même se renseigner sur l’historique. D’ailleurs, on avait demandé à une amie de nous faire une re-situation historique du porno, que je trouve importante.
En 1832, le mot « pornographique » débarque, en 1834 « pornographe » et en 1840 « pornographie ». En français, le mot entre donc au dictionnaire en tant qu’adjectif d’abord, en même temps que « photographique ». La « pornographie », donc le sujet-même, apparaît en dernier. Il y a eu plusieurs définitions, mais au bout d’un moment ça se stabilise en « ce qui outrage les bonnes mœurs » et « la représentation sexuelle sans ambition artistique et avec l’intention délibérée de provoquer l’excitation sexuelle ». Actuellement, dans certains films, on peut voir apparaître le « à caractère pornographique ». La pornographie joue sur la notion d’obscénité, qui signifie « qui blesse ouvertement la pudeur ». Elle est donc toujours liée à la morale ou au juridique, c’est-à-dire que comme c’est obscène, il y a un tort fait à un pan de la population, il y a une victime et une espèce de crime. Et la société là-dedans a une mission régulatrice. Ce qui pose la question de comment on détermine l’obscénité. Ça dépend des époques, des cultures, des contextes qui fabriquent le regard. Voilà pour la petite définition. Après on a le post-porn avec Annie Sprinkle, etc. mais je m’arrête là.
Vous dites que vous ne vous retrouvez pas dans le concept de « porno éthique », et préférez parler de processus. Pourquoi ça ?
aurore : Le porno est figé dans cette dimension d’éthique depuis longtemps, depuis sa définition en fait, c’est un peu épuisant. L’éthique est en rapport avec la morale dans le sens courant, c’est ce qui est bien et mal, c’est dichotomique. Nous déclarer « porno éthique », ça signifierait qu’il y a du porno « pas éthique » donc ça voudrait dire qu’on est mieux que les autres. Plein de sortes de porno se jouent à des niveaux différents, dans les manières de faire, selon si c’est rémunéré, selon à qui ça s’adresse.
Oui, on accorde une importance à la manière de faire, au processus, mais ça ne fait pas de nous un porno éthique pour autant. Parce qu’on évite jamais les erreurs, les maladresses. On vient de ce système-là, qui nous a construit·es, donc je ne vois pas pourquoi on ne le rejouerait pas. Quand on parle de processus, c’est : « On rejoue certaines choses de cette société parce qu’on n’en est pas extérieur·es, mais on va quand même essayer de les comprendre et de les désengranger, de les désamorcer. » Pour moi, un processus c’est s’attacher, fonctionner ensemble depuis nos contradictions, être responsables de nos relations, affections, images, et dans un temps qui n’est pas capitaliste. On bosse souvent à l’urgence, mais les Porn Process sont des temps longs, qui durent deux ans pour une saison, et ça, c’est assez neuf, unique.
LoupKass : Je pense qu’on nous colle cette étiquette de porno éthique parce qu’on questionne les rapports de pouvoir, il y a énormément de réflexions dans notre production. Quand on fait des films, on met beaucoup de ce qu’il se passe quand la caméra coupe, et le fait d’avoir ça nous connecte beaucoup plus à l’humain, ce qu’il n’y a pas dans le porno mainstream. Avec l’idée de porno éthique, c’est aussi comment on prend soin des performeur·ses.
Ce qui m’intéresse dans la fabrication d’un film, là où je place le politique, c’est que cette image perde cette objectivité ou neutralité contemporaine. J’ai besoin d’images qui soient incarnées.
aurore, Porn Process
 Sex l’air de rien, 2019 © PornProject
Sex l’air de rien, 2019 © PornProject
En regardant Ya personne qui nous regarde, j’ai justement trouvé intéressant que porno et tournage ne fassent qu’un : on ne regarde pas simplement un objet pornographique, on assiste également à sa fabrication. En quoi c’était important pour vous de montrer les « backstages » ? Ça peut permettre de mieux comprendre le film ?
Hallux : Ça permet de comprendre ce qu’il se passe en dehors des scènes de sexualité filmées, oui. Mais filmer les backstages, introduire les caméras dès notre arrivée sur le tournage, c’était surtout important pour nous, pour qu’on s’habitue aux dispositifs. Certaines personnes, dont moi, n’avaient jamais tenu de caméra, ne savaient pas du tout comment faire. Ça nous a permis de nous familiariser avec cet objet, en filmant, dès le premier soir, à des endroits et moments où il n’y avait pas de pression du résultat. Ça permettait aussi, à l’inverse, de s’habituer à être filmé·e en toutes circonstances. À la fin, je disais : « De toute façon maintenant je peux baiser dans toutes circonstances, avec plein de monde autour, il y a pas de problème. »
Ya personne qui nous regarde est le seul film qu’on n’a pas vraiment scénarisé. Et toute cette improvisation n’aurait pas été possible sans les deux jours filmés avant.
Hallux, Porn Process
aurore : Ça peut permettre de mieux comprendre comment on fabrique une narration, parce que faire un film, c’est faire des choix en permanence. C’est une manière d’accéder au film, et ça fait notamment écho au voyeurisme, le processus même du cinéma, le male gaze, la pulsion scopique, qui peuvent exciter aussi. On est un écosystème, une équipe qui fabrique quelque chose, donc toutes les images qu’on considérerait normalement comme extérieures, elles font ici partie du tournage. C’est juste qu’on n’a pas l’habitude de les voir forcément.
LoupKass : C’est hyper intéressant, ça nous connecte beaucoup aux performeur·ses. Mais je ne suis pas sûr que ce soit obligatoire, qu’on ait forcément besoin de comprendre le porno. Il y aussi un truc de simple objet d’excitation, qui est hyper ok.
 Ya personne qui nous regarde, 2019 © PornProject
Ya personne qui nous regarde, 2019 © PornProject
Vous expliquez qu’il est important pour vous de montrer qui filme, que l’on voie qui est derrière la caméra, pour que l’on puisse « situer » ce regard, et non pas faire comme si la caméra était « objective ».
aurore : Je suis très inspirée par Nathalie Magnan, dans son film Donna Haraway Reads ‘The National Geographic’ on Primates. C’est elle qui filme Donna Haraway, et on la voit apparaître dans un miroir, tenant la caméra. Personnellement, ce qui m’intéresse dans la fabrication d’un film, là où je place le politique, c’est que cette image perde cette objectivité ou neutralité contemporaine. J’ai besoin d’images qui soient incarnées.
D’après moi, une des façons de faire sentir qu’elle est incarnée et pas objective, c’est de voir apparaître la personne qui filme. En tout cas, de sentir que la caméra est tenue, qu’elle est portée par un corps qui agit lui aussi. C’est un corps cyborg un peu, parce qu’il porte une caméra, et depuis ce corps il y a des prises de risque, des hésitations. C’est vrai que ça se place aussi pas mal dans les réflexions sur le female gaze et le queer gaze.
Situer ce film, situer qui prend la caméra à tel moment, ça permet d’affirmer des corps et des identités qui prennent peu la parole. Nous, on fonctionne en mixité choisie sans mec cis sur les tournages, et c’est à nous de faire les récits maintenant.
Quoi qu’il en soit, mon corps n’est ici plus mon corps mais un objet politique, dans sa grosseur, dans le fait d’être racisé.
Hallux, Porn Process
La quasi-totalité des personnes sur le tournage sont passées devant et derrière la caméra. Quel effet cela a-t-il eu ?
Hallux : On a essayé de tous·tes passer par tous les rôles. La performance n’était pas un pré-requis, parce qu’on sait à quel point ça peut être difficile par rapport à nos corps. Je trouve ça intéressant, parce que des personnes qui sont arrivées pour la technique sont passées dans la performance, et inversement. Ce croisement a permis de réaliser ce que c’est de faire un film, toutes les étapes que ça engage. Moi je suis venu·e plutôt pour la performance, et le fait d’avoir la caméra en main m’a permis de me rendre compte de cette partie voyeuriste, qui m’excite.
LoupKass : C’était une grande découverte, je me retrouvais face à des personnes que je ne connaissais pas vraiment. C’est une expérience collective, et le fait d’interchanger les rôles, c’est blindé d’apprentissages. Quand je tiens la caméra, c’est moi qui maîtrise l’image, et là je n’étais pas tout le temps maître de mon image. Il y a des rapports de pouvoir entre performance et technique, là on était un peu tous·tes au même endroit.
aurore : Quand je me suis retrouvé·e à sexer, je voyais tout le dispositif autour. Ça ne m’a pas donné du plaisir de me savoir filmé·e, mais ça ne m’a pas dérangé·e. Le fait qu’on m’ait demandé en permanence si c’était ok, qu’il y ait une conversation tout le temps, ça a fait beaucoup de bien à mon corps.
Au montage également, les personnes présentes dans les scènes avaient-elles un droit de regard ?
Hallux : Oui, on montait en binôme ou à trois, avec les personnes présentes dans les scènes, et c’était vraiment un casse-tête. Pour la plupart, c’était la première fois qu’on se voyait faire du sexe en vidéo à cette échelle. Et je pense qu’il y a eu cette confrontation difficile à nos corps, à nos complexes. Certaines personnes censuraient beaucoup les images d’elles-mêmes.
Moi, à ce stade, j’avais déjà un parcours de : « Quoi qu’il en soit, mon corps n’est ici plus mon corps mais un objet politique, dans sa grosseur, dans le fait d’être racisé. » Pour moi, il y avait déjà cette distance par rapport à ce corps, je ne me suis pas du tout censuré·e. Je me disais même : « Si là mon corps ne me plaît pas, je vais le montrer encore plus. » Parce qu’il y a sûrement quelque chose à montrer, et ça peut parler à des personnes qui pourraient s’identifier.
Performer des rôles prédéfinis par la société, masculins ou féminins, m’a permis de soigner certains traumas, d’aller plus loin dans ma sexualité.
Hallux, Porn Process
Vous parlez de pulsion scopique, de male gaze. Pensez-vous qu’on peut aller au-delà de ce regard masculin dans le porno, ou du moins se le réapproprier ?
Hallux : J’irais dans l’idée qu’on ne peut pas trop se défaire du male gaze, parce qu’il est constamment là, il régit toute notre culture. Mais se le réapproprier, oui. C’est ça qu’on fait.
L’excitation et les désirs, le fait qu’on soit plus attiré·e par une personne grosse ou mince par exemple, c’est culturel. Parce qu’il existe des discriminations, un culte de la beauté, un esthétisme différent selon les périodes, les époques et les pays. Tout ça influence notre sexualité. L’intérêt dans ce tournage, et dans les autres à suivre, c’est qu’on questionne ça. Ça veut pas dire qu’on ne va pas retomber dedans, parce qu’on en est tellement imprégné·e, mais qu’on se réapproprie ces codes. Si on est excité·e par une levrette, très bien. Mais comment on la fait, comment on la montre ? On avait cette mixité choisie, et je pense que ça montre aussi quelque chose, le fait qu’on puisse rejouer des scénarios qui sont imprégnés du male gaze, mais sans mec cis.
Personnellement, performer des rôles prédéfinis par la société, masculins ou féminins, m’a permis de soigner certains traumas, d’aller plus loin dans ma sexualité. Et ces traumas sexuels ont pu se soigner parce que c’était fait dans une bienveillance et un consentement total. Même dans la diffusion des images, j’ai toujours accès aux images de mon corps et de ma parole, je peux choisir de comment je veux les diffuser. Et si je veux revenir dessus, ce sera respecté. C’est ça qui est important.
Ça nous a été reproché aussi, de rejouer certains rapports dominants. J’ai envie de répondre que le fait qu’on ne soit pas de classes dominantes, ce n’est pas rejouer, c’est se réapproprier.
Chez nous, ce qui pourrait faire « des regards queers », ce serait la collectivité.
aurore, Porn Process
Vous diriez que le Porn Process met en scène un regard queer ?
aurore : Il n’y a pas un regard mais des regards. La plupart des histoires, de façon générale, c’est toujours un ou une héro·ïne qui fait des actions grandiloquentes. Chez nous, ce qui pourrait faire « des regards queers », ce serait la collectivité. Ce sont des personnes qui interagissent, qui baisent, qui ne sont pas d’accord. On ne cherche pas à résoudre des questions mais à se poser les bonnes. Celles qui font du sens pour tous·tes et dont on peut s’emparer. Faire du commun depuis là.
Retrouvez l’équipe du Porn Process pour une projection-discussion au Hasard Ludique pour le Marché de l’Illustration Impertinente, les 1 et 2 octobre. Au rendez-vous il y aura donc des dizaines d’illustrations sensuelles et un espace dédié à la micro-édition. L’artiste néerlandais·e non-binaire Hilde Atalanta qui a réalisé l’affiche de cette édition y exposera notamment sa Vulva Gallery.
Pour aller plus loin, les recos de pornos queers et féministes de Porn Process :
Films
Performances, spectacles et acteur·ices
Poésie
Suivre sur Instagram PornProcess, PornProcess 3
Contact : leprnprocess@gmail.com
Image à la Une : Pussyplay, 2019 © PornProject
Cet article Porn Process : comment le collectif bruxellois Les PéPé·e·s s’empare du porno provient de Manifesto XXI.


Dans cette chronique, je continue à discuter avec Julien. Un homme cisgenre, hétéro, avec qui je partage certaines de mes pensées. Il est fictif, sans être irréel. Julien ça pourrait être toi, moi et/ou nous.
L’article Pomme de Léon est apparu en premier sur 360°.

A quelques semaines du coup d'envoi du Mondial, seuls Jonahtan Clauss, Jules Koundé et Hugo Lloris auraient répondu à l'appel pour soutenir l'acceptation des LGBT+ dans le football.
L’article Football : Seuls 3 joueurs de l’équipe de France acceptent de participer à une vidéo contre l’homophobie est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.

Les résultats partiels donnant plus 66% de suffrages favorables sont «irréversibles», a déclaré la présidente du Conseil électoral national (CEN), à la télévision d’État. Le nouveau Code de la famille est donc approuvé par référendum.
L’article Référendum : Cuba dit « oui » au mariage égalitaire et à la GPA est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.


Lexie tient le compte @aggressively_trans, où elle crée du contenu sur les parcours trans. Pour prolonger ce travail pédagogique, elle a publié en 2021 «Une histoire de genres» un «guide pour comprendre et défendre les transidentités».
L’article Lexie: «Ma vertu queer préférée? Notre flamboyance!» est apparu en premier sur 360°.

Des inscriptions contre la marche des Fiertés, prévue ce samedi 24 septembre à Toulon, et qualifiant les personnes LGBT de déviants, ont été découverts dans la nuit du vendredi sur plusieurs abribus. Le maire annonce qu'une plainte sera déposée pour « homophobie et dégradation de biens publics ».
L’article Des tags anti-LGBT+ découverts sur des abribus à Toulon : Le maire dépose plainte est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.

Trois ans après une première tentative avortée de l'intégrer dans la Constitution, les Cubains vont pour la première fois voter une loi par référendum qui autorise le mariage entre personnes de même sexe, ainsi que la gestation pour autrui.
L’article Mariage égalitaire : Les Cubains appelés dimanche à se prononcer par référendum est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.

Cet article Aux Rencontres d’Arles 2022, une avant-garde qui se tient sage provient de Manifesto XXI.
Passage quasi obligé des Rencontres d’Arles, la Mécanique Générale a accueilli cette année l’exposition Une avant-garde féministe, où pas moins de 200 œuvres d’artistes femmes ont été réunies du 4 juillet au 25 septembre. Issues de la collection de l’entreprise Verbund – premier fournisseur d’électricité en Autriche – ces clichés et photographies de performances racontent leur époque tout en dénonçant les structures du pouvoir patriarcal, emboîtant le pas de la deuxième vague féministe. Retour sur une exposition qui permet de (re)découvrir des œuvres profondément radicales, malgré une curation sans prise de risque.Pour sa deuxième année à la tête des Rencontres, Christoph Wiesner place la programmation de cette 53e édition sous le signe de la « révélation ». Par un heureux hasard, la collection Verbund, montrée pour la première fois en France, aspire à rendre visible des postures artistiques qui étaient auparavant cachées. Fruit de dix-huit années de recherches, la collection rassemble des œuvres qui ont été négligées, ignorées ou minimisées par le passé, avec pour objectif de les replacer dans l’histoire de l’art et la mémoire culturelle. Par le biais de l’image, les clichés exposés à la Mécanique Générale témoignent de la condition féminine occidentale, offrant ainsi un aperçu des standards et revendications qui ont traversé les sociétés européennes et étasuniennes tout au long des années 1970.
 VALIE EXPORT. Die Geburtenmadonna [La Madone de la Nativité], 1976. Avec l’aimable autorisation de VALIE EXPORT / Galerie Thaddaeus Ropac / Bildrecht / COLLECTION VERBUND, Vienne.
Une chambre (noire) à soi
VALIE EXPORT. Die Geburtenmadonna [La Madone de la Nativité], 1976. Avec l’aimable autorisation de VALIE EXPORT / Galerie Thaddaeus Ropac / Bildrecht / COLLECTION VERBUND, Vienne.
Une chambre (noire) à soi
Médium de choix pour de nombreuses artistes, la photographie jouit d’un fort pouvoir émancipateur. Comme l’écrit la critique d’art et activiste américaine Lucy Lippard, elle agit « contre le culte du génie masculin ou l’hégémonie de la peinture pour une réinvention radicale de l’image de la femme par les femmes » ; théorisant sans le nommer le female gaze. Longtemps considérée comme un sous-médium de par sa dimension pratique et commerciale, la photographie prend un tournant radical dans les années 1970 et peut enfin prétendre accéder au rang des beaux arts. En 1973, l’essayiste et militante Susan Sontag théorise une « éthique du regard » dans Sur la photographie, son ouvrage depuis devenu culte. Elle y développe la pensée suivante : en documentant le passé comme le présent, les photographies participent à créer de nouveaux codes visuels et ainsi à élargir notre idée de ce qui mérite d’être regardé. Abondant dans ce sens, la directrice de la collection Verbund et commissaire de l’exposition Gabriele Schor affirme que « la photographie, le film et la vidéo (…) ont surtout profité aux artistes femmes, qui ont réussi par ce biais à se faire une place sur la scène artistique au-delà de la peinture dominée par les hommes. »
De la publication aux États-Unis en 1971 de Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grandes artistes femmes ? de Linda Nochlin à la loi Veil dépénalisant l’IVG en France en 1975, la décennie 1970 est également le berceau de nouveaux questionnements féministes. Il ne s’agit plus seulement de conquérir des droits mais de remettre en cause tout un système ancré dans des traditions misogynes. Des institutions de pouvoir aux universités en passant par le foyer, le privé est bel et bien devenu politique. C’est au cœur de cette ébullition, propre aux mouvements contestataires, que toute une génération d’artistes s’est emparé de l’outil photographique pour documenter, dénoncer et critiquer ; formant ainsi une avant-garde féministe.
 Penny Slinger. ICU, Eye Sea You, I See You, 1973. Avec l’aimable autorisation de Penny Slinger / Broadway 1602 Uptown & Harlem / Artists Right Society (ARS) / Bildrecht / Collection Verbund, Vienne.
Tuer l’ange du foyer
Penny Slinger. ICU, Eye Sea You, I See You, 1973. Avec l’aimable autorisation de Penny Slinger / Broadway 1602 Uptown & Harlem / Artists Right Society (ARS) / Bildrecht / Collection Verbund, Vienne.
Tuer l’ange du foyer
À l’entrée de la Mécanique Générale, il faut dans un premier temps s’attarder sur une longue frise chronologique avant de pouvoir découvrir les œuvres des 71 femmes exposées. Revenant sur les événements qui ont marqué la société occidentale entre la fin des années 1960 et le début des années 1980, cette frise est une piqûre de rappel aussi dense que nécessaire pour situer les œuvres dans leur contexte, qu’il soit européen ou étasunien. Un contexte qui fait tristement écho à une actualité plus récente, celle de la révocation aux États-Unis de l’arrêt Roe vs Wade, donnant ainsi le droit aux états de définir leur propre politique d’avortement.
C’est donc avec une pointe de désillusion que l’on commence le parcours de l’exposition, divisé en cinq thèmes. Le premier renvoie à la sacro-sainte trinité femme au foyer-mère-épouse. Comme le rappelle le cartel d’introduction, les valeurs de la société d’après-guerre érigent l’idéal d’une femme dévouée entièrement à son foyer. À l’époque, rares sont les femmes qui vivent en toute indépendance, si bien que l’une des seules options viables pour quitter le domicile parental est le mariage. Les voix de la deuxième vague féministe s’élèvent et appellent les femmes à lutter contre cette « servitude volontaire ». En France, les militantes marxistes du MLF (Mouvement de libération des femmes) pointent du doigt la répartition inégale du travail domestique tandis qu’aux États-Unis, on se passe de mains en mains le livre The Feminine Mystique (1963) de Betty Friedan qui tente d’expliquer la tristesse ressentie par des femmes au foyer qui ont pourtant tout pour aller bien. Parmi les œuvres exposées, il y a le tablier en forme de cuisinière de la plasticienne autrichienne Birgit Jürgenssen, qui illustre le drame de la ménagère ne faisant plus qu’une avec les objets de son quotidien. Agrémentée de plaques et d’un four dont la porte est ouverte, cette œuvre suggère autant l’asservissement que la disponibilité sexuelle.
 Annegret Soltau. Selbst (Moi), 1975. Avec l’aimable autorisation de Annegret Soltau / Bildrecht / Collection Verbund, Vienne.
Ne les libérez pas, elles s’en chargent
Annegret Soltau. Selbst (Moi), 1975. Avec l’aimable autorisation de Annegret Soltau / Bildrecht / Collection Verbund, Vienne.
Ne les libérez pas, elles s’en chargent
Le deuxième thème abordé par l’exposition est l’enfermement, autre motif récurrent de l’art féministe des années 1970. En réaction aux diverses restrictions et oppressions vécues, les artistes filent la métaphore de la cage, en s’enroulant par exemple le visage et le corps d’une ficelle afin de rendre palpable leur sensation d’étouffement. Gabriele Schor, la commissaire, note qu’il est frappant de constater que de nombreuses artistes, sans même se côtoyer, ont recours à des outils similaires pour représenter leur sentiment d’enfermement. Si les œuvres ne présentent pas de solution concrète pour sortir de cette captivité, le fait que les artistes utilisent leurs propres corps comme médium est déjà une émancipation en soi. Dans la performance Burial Pyramid, l’artiste cubano-américaine Ana Mendieta filme son corps enseveli par les pierres du site archéologique de Yagul à Oaxaca au Mexique. Sous l’effet de sa respiration, elle parvient progressivement à faire tomber les pierres et à s’en libérer.
Vient ensuite le thème de la sexualité, partie dans laquelle il est finalement assez peu question de plaisir, de désir ou de sexe. Alors que le texte introductif annonce des œuvres censées « s’élever contre la réduction de la femme à un objet de plaisir et contre le regard masculin voyeur dont sont empreintes les représentations de nus féminins depuis des siècles », on ne verra pas autre chose. Outre les œuvres évoquant les menstruations, qui sont pour le moins hors-sujet, pas un mot ni une œuvre n’évoquent la pornographie ou le travail du sexe autrement qu’en surface, alors même que ce sont des sujets de discorde au sein des mouvements féministes de l’époque. On regrette particulièrement l’absence du travail de l’artiste britannique Cosey Fanni Tutti dont les performances transgressives vont au-delà du discours. Refusant la posture de l’artiste voyeuriste, elle s’infiltre et exerce dans le commerce du sexe afin de pouvoir créer puis racheter sa propre image.
 Renate Bertlmann. Zärtlicher Tanz (Tendre danse), 1976. Avec l’aimable autorisation de Renate Bertlmann / Bildrecht / Collection Verbund, Vienne.
Nos identités ne sont pas des rôles
Renate Bertlmann. Zärtlicher Tanz (Tendre danse), 1976. Avec l’aimable autorisation de Renate Bertlmann / Bildrecht / Collection Verbund, Vienne.
Nos identités ne sont pas des rôles
Alors que la publicité est en plein essor, la société occidentale d’après-guerre véhicule déjà des standards de beauté inatteignables. Ces diktats, qui font l’objet du quatrième thème de l’exposition, sont l’occasion pour les artistes de l’époque de s’ériger contre les canons véhiculés par la télévision et les concours de beauté. Sur un ton légèrement redondant, elles usent de leur nudité pour prouver qu’elles sont libres de le faire. Alors que les années 1970 marquent le début d’un questionnement autour du genre et des réflexes essentialistes réduisant les femmes à leur prétendue essence biologique, l’exposition tourne autour de ces problématiques sans les adresser frontalement. Le cartel d’introduction parle de lui-même : « le corps, souvent nu, devient alors un support artistique, un moyen d’expression esthétique essentiel ». On (re)découvre cependant avec enthousiasme les œuvres d’ORLAN ou de Gina Pane, qui ont toutes deux été pionnières du travail sur le corps, sa modification et sa mutilation. Le propos de ces artistes dépasse la critique des normes établies en invoquant la monstruosité ou la douleur mais il semble avoir été poli et adapté version grand public. Bien que radical, leur propos reste accessible et il est regrettable de le voir amoindri. C’est dire combien on peine encore aujourd’hui à montrer et parler d’autre chose que de beauté lorsqu’il est question d’injonctions faites aux corps féminins.
La dernière partie de l’exposition explore les identités et d’emblée, il y a comme un malaise. On y lit que « les femmes racisées ont tout particulièrement été exclues de la scène artistique blanche principalement masculine, non seulement en raison de leur genre et de leur classe sociale, mais aussi de leur appartenance raciale ». En plus de répéter cette même exclusion en réunissant les artistes racisées à la toute fin de l’exposition, un parallèle hasardeux est tracé entre leurs œuvres et les « jeux de rôles » auxquels s’adonnent des artistes majoritairement blanches. À l’exception d’Ana Mendieta, qui est parvenue à se frayer un chemin sur la scène artistique féministe, le travail des artistes racisées fut presque entièrement invisibilisé. Elles étaient pourtant actives et engagées, à l’instar d’Adrian Piper, qui aborde dès les années 1970 les questions de genre et de race à travers ses performances. Malheureusement, dans l’histoire de l’art comme dans l’exposition à la Mécanique Générale, ses œuvres manquent à l’appel. Saupoudrer un semblant d’intersectionnalité à la dernière minute dénote d’un choix curatorial visant à répondre aux problématiques actuelles sans s’y pencher réellement. La pauvreté du travail de contextualisation empêche de prendre toute la mesure de l’effacement des artistes racisées tant dans les cercles artistiques que dans les mouvements féministes.
 Ana Mendieta. Sans titre (Verre sur empreintes corporelles), 1972. Avec l’aimable autorisation de The Estate of Ana Mendieta Collection, LLC / Galerie Lelong / COLLECTION VERBUND, Vienne.
« Faire voir ce qui nous crève les yeux »
Ana Mendieta. Sans titre (Verre sur empreintes corporelles), 1972. Avec l’aimable autorisation de The Estate of Ana Mendieta Collection, LLC / Galerie Lelong / COLLECTION VERBUND, Vienne.
« Faire voir ce qui nous crève les yeux »
D’Elles font l’abstraction au Centre Pompidou à Une avant-garde féministe aux Rencontres d’Arles, on a parfois le sentiment que les expositions estampillées féministes répondent à un agenda marketing et permettent aux institutions de se donner bonne conscience. Et s’il est relativement inédit de voir autant d’œuvres radicales d’artistes femmes réunies au même endroit, le propos ne suit pas. Aussi déprimant que ce soit, les problématiques féministes actuelles sont sensiblement les mêmes qu’il y a cinquante ans. Le fait de proposer une exposition sur l’avant-garde féministe des années 1970 sans démarche réflexive ou propos un tant soit peu engagé est du même ordre que porter un tee-shirt « we should all be feminist ». D’après les mots de Christoph Wiesner, l’ambition des Rencontres d’Arles était cette année de « faire voir ce qui nous crève les yeux mais qui prend tant de temps à apparaître ». Espérons que cette apparition se traduise de manière plus concrète à l’avenir, dans les expositions comme ailleurs.
Image à la une : Francesca Woodman. Visage, Providence, Rhode Island, 1975-1976. Avec l’aimable autorisation de The Woodman Family Foundation / Artists Rights Society (ARS) / Bildrecht / COLLECTION VERBUND, Vienne.
Cet article Aux Rencontres d’Arles 2022, une avant-garde qui se tient sage provient de Manifesto XXI.


Chroniqueur et présentateur, Laurent Ruquier est l’un des rares visages de la télévision et de la radio française à être out en tant que gai. Mais est-il pour autant un défenseur de la cause LGBT, ou une énième célébrité réac?
L’article Laurent Ruquier, un gai parmi les beaufs? est apparu en premier sur 360°.




Ce mois-ci, l’actualité est marquée par la poursuite d’une autre épidémie que celle du monkeypox: la transphobie.
L’article L’actu de septembre: épidémie de transphobie est apparu en premier sur 360°.

Un trentenaire, père de famille, à été condamné à 3 ans d’emprisonnement ferme, pour avoir agressé un groupe de six amis, rencontrés par hasard dans le XXe arrondissement de la capitale.
L’article Violences homophobes : Trois ans de prison ferme pour l’agression de six hommes à Paris en 2019 est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.

Les capitaines des équipes porteront un même brassard multicolore pour « promouvoir l’inclusion et l'égalité, et essayer de changer les choses par le pouvoir du football ».
L’article Mondial 2022 au Qatar : dix sélections européennes rejoignent la campagne anti-discrimination « One Love » est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.

La Ville de Lyon s'est engagée dans l'ouverture d'une « Maison de la diversité », d'ici 2024, un habitat participatif et partagé qui disposera de 15 logements, où se côtoieront des personnes queers de plus de 65 ans et des étudiants.
L’article Lyon va accueillir la première résidence en France dédiée aux séniors LGBT+ est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.

Cet article Fania Noël : penser le monde dans une perspective afroféministe provient de Manifesto XXI.
Avec son dernier essai, Et maintenant le pouvoir : un horizon politique afroféministe, publié aux Éditions Cambourakis, la militante, essayiste et chercheuse Fania Noël propose un manifeste politique à destination des militant·es, mettant à plat les concepts théoriques tout en amenant les lecteur·ices vers un horizon afroféministe. Entretien fleuve avec une grande penseuse contemporaine.C’est avec cette phrase, lourde de sens, que Fania Noël conclut notre riche entretien : « En collectif, on rêve au-delà de ses propres horizons. Le collectif permet de donner de la force. » Une phrase résumant parfaitement l’approche critique et le parcours politique de la militante, essayiste et chercheuse en sociologie de 35 ans. Reconnue pour son engagement politique au sein du projet Assiégées — dont elle reste aujourd’hui directrice de publication de la revue — et pour son affiliation au collectif Mwasi, Fania Noël affirme depuis ses débuts un positionnement radical pour les luttes antiracistes et féministes noires.
Avec son nouvel opus, Et maintenant le pouvoir : un horizon politique afroféministe, l’autrice s’est saisie de la période du confinement pour poser ses réflexions, mettre à plat certains concepts souvent récupérés et déchargés de leur essence. Mais aussi pour rendre compte de son expérience de militante de terrain, à même de délivrer des outils d’analyse d’une grande pertinence. Aujourd’hui doctorante en sociologie à la New School for Social Research de New York, l’activiste tire parti de son parcours pour affiner sa vision du monde et des sphères militantes dans une perspective de transmission.
Manifesto XXI – Peut-on revenir sur votre enfance et votre parcours ? Qu’est-ce qui vous a menée vers les voies de l’activisme ?
Fania Noël : Je pense que je me posais des questions, et que je suis une personne de groupe. J’ai grandi dans une famille nombreuse, et oui je suis une personne de groupe, tant en termes de fratrie, que de groupe à l’Église. J’aime les projets collectifs. Quand j’ai commencé mes études à Paris, je me posais des questions et j’ai commencé à les articuler de manière plus complexe. Je suis allée vers l’antiracisme et les questions féministes et afroféministes.
Je connais votre travail car vous faisiez partie pendant plusieurs années du collectif afroféministe Mwasi, basé à Paris. Peut-on revenir sur cette expérience, qui semble avoir forgé en partie votre esprit critique ? Avec peut-être la revue Assiégées que vous avez créée ?
J’ai créé la revue Assiégées pour parler d’intersectionnalité, et nous avons commencé à mettre en place des « journées intersectionnalité TMTC ». Très vite, on a invité des intervenant·es, des collectifs comme Mwasi, et il y a des personnes du collectif qui ont contribué à cette revue. En 2015, avec Assiégées et Mwasi, on a formé le premier cortège du 1er mai de personnes racisées, noires, arabes, asiatiques et roms. Assiégées, c’était un projet à destination de personnes qui subissent le patriarcat et le racisme, mais je sentais que j’avais besoin d’être dans un espace politique sur les questions féministes noires et sur la misogynoir. C’est pour ça que j’ai rejoint Mwasi, tout en restant toujours à Assiégées dont je suis encore directrice de publication. En parallèle de tout ça, j’ai créé le camp d’été décolonial avec Sihame Assbague.
Il y a toujours deux facettes [dans mon parcours] : moi militante à Mwasi, et mes projets annexes qui peuvent être plus ouverts. Aujourd’hui, j’entretiens toujours un lien politico-affectif avec le collectif même si je n’en fais plus partie. Si elles ont besoin d’intervention, je suis là. Avec Assiégées, ce sont les deux collectifs avec lesquels j’ai passé le plus de temps, j’y ai mis beaucoup d’énergie, j’y ai passé des étapes déterminantes de ma vie personnelle et politique. Vu que je n’habite plus à proximité, je ne peux plus m’investir de la même manière et Mwasi a quand même des règles. Je pense que l’on peut quitter des collectifs sans que ça se passe mal.

Aujourd’hui, vous poursuivez vos études en sociologie à la New School for Social Research à New York. Qu’est-ce qui vous a poussée à partir de France pour poursuivre votre doctorat ?
Le choix des États-Unis s’est fait bien avant car j’ai décidé en 2017 d’aller vivre au Canada, puis en Haïti, donc New York, c’était assez pratique. Et vu mon domaine de recherche, c’était mieux de rester aux États-Unis. En France, je n’aurais pas eu de financements et je n’aurais pas fait ma recherche dans les conditions que je voulais. J’avais envie de la faire dans la région de New York et pas forcément ailleurs. Je ne voulais pas trop chambouler ma vie et je me suis inscrite dans ce PhD [doctorat] pour avoir du temps, le temps de réfléchir à des questions spécifiques. Le PhD me permet de me focaliser sur ma recherche, de lire, d’analyser. C’est un moment qui est vraiment important pour moi. J’avais besoin de réfléchir, de divaguer, de prendre des risques intellectuellement.
Vous parlez de risques intellectuels. Quels risques prenez-vous en faisant cette recherche dans un contexte états-unien ? Qu’est-ce que cela vous apporte ?
C’est un contexte de recherche où les black studies, les gender and sexual studies, sont beaucoup plus développées. Dans tous les programmes, il y a des cours connexes à mes recherches, sur le black urbanism, sur les black bodies, et pour évoluer intellectuellement, je pense qu’il ne faut pas qu’il n’y ait qu’un seul type de cours comme « l’Histoire des noirs en France » mais avoir des enseignements connexes. Il faut pouvoir être dans un lieu prolifique. Prendre un risque intellectuel, c’est aller dans des directions que l’on ne connaît pas, c’est sortir de sa zone de confort. La théorie, c’est aussi un peu de souffrance car une fois qu’on comprend que ce que l’on pensait être juste et vrai ne l’est pas, c’est douloureux. L’idée n’est pas de rester dans la répétition de ce que l’on sait, mais d’aller dans la direction de chercheur·ses qui portent une pensée critique, qui remettent en question, qui défient notre organisation du monde et des possibilités d’organisation de celui-ci.
Quels sont vos angles d’analyse dans cette recherche en cours ?
C’est de la sociologie des espaces. Je travaille sur la racialisation des espaces et sur la spatialisation de la race, donc sur les organisations politiques noires en France et sur les espaces de la subjectivité noire. J’essaye de voir quels types d’espaces elles ont créés, quel a été l’impact de l’espace sur leurs actions. À la rentrée, je vais commencer la troisième année et j’espère avoir fini en 2024.
Votre deuxième essai, Et maintenant le pouvoir, prend pour moi les contours d’un manifeste afroféministe, mettant à plat les différents courants des féminismes noirs. Dans quel contexte l’avez-vous écrit ?
Je n’avais pas spécialement d’a priori de base. J’étais coincée à Paris à cause du covid, puis j’ai appris que j’étais prise en doctorat, et je me suis dit que vu que j’étais dans une période de transition, je devais en faire quelque chose. C’est un livre écrit par une militante pas encore universitaire, qui parle de la manière dont on crée de la théorie à partir de la pratique. De comment on crée de la théorie, de l’idéologie, à partir d’espaces militants, et non le contraire. C’était important pour moi d’écrire ce livre à ce moment-là. Je voulais mettre en lumière l’aspect conflictuel qu’il peut y avoir entre sphère universitaire et sphère militante. Et je voulais pouvoir recenser nos actions, montrer ce qui est possible en prenant les exemples d’Assiégées, du camp d’été décolonial, de Mwasi. Il y a des choses que j’ai apprises collectivement, il y a des choses que j’ai apprises par moi-même, et je voulais pouvoir léguer ça à travers cet ouvrage.
La question que je me pose également en vous écoutant est celle du passage de la théorie au terrain, du terrain à la théorie. Comment vous situez-vous aujourd’hui vis-à-vis de cela ?
Je pense que les gens qui font de la théorie sans terrain, ça se sent, et les gens qui font du terrain sans la théorie aussi, il y a une forme de court-termisme. Ma théorie se base sur mon expérience de terrain, même si j’ai eu besoin d’un petit temps de calme. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne suis pas active dans d’autres organisations. Il faut faire en sorte que les organisations qui créent de la pratique soient force de propositions pour mettre à plat la théorie en conversation avec d’autres approches théoriques, mais également en tirant parti de leur expérience de terrain. C’est ça qui fait qu’il y a de la substance parce que sinon, si on fait juste des manifestations et qu’on ne prend pas le temps de penser le monde, on reste juste dans la réponse et ça ne permet pas aux militant·es de progresser.
Entre le moment où j’ai commencé à militer et aujourd’hui, il y a un monde. Je pense que c’est militer qui a nourri et radicalisé ma conscience politique et ça ne passe pas que par des kilomètres de marche, ça passe par des lectures assidues, par des confrontations sur le terrain. Il faut pouvoir articuler notre propre idéologie aux autres lectures du monde. Il faut pouvoir répondre aux autres idéologies qui gravitent dans l’espace social, aux idéologies qui sont avec nous, contre nous. Et ça permet d’avoir une distance critique de se nourrir par des outils théoriques. L’éducation populaire par exemple est un outil important, ça permet d’éviter bien des écueils, de maintenir une conscience politique.
 Fania Noël © Georges Harry Rouzier
Fania Noël © Georges Harry Rouzier
Dans cet ouvrage, où vous utilisez à la fois le « je » et le « nous », vous revenez sur un certain nombre de concepts théoriques souffrant trop souvent d’une mauvaise récupération de certaines franges politiques, notamment de la gauche. Je pense en particulier au terme d’intersectionnalité. Selon vous, comment éviter ce type de récupération ?
J’ai pensé le livre comme un outil pour les organisations politiques, donc je suis très contente quand certaines organisations m’écrivent pour en discuter. Comme c’est un outil pédagogique, d’éducation populaire, il faut qu’il puisse servir à ça, et en même temps ce n’est pas un abécédaire donc le « je » ici sert à ça, c’est mon opinion sur l’utilisation de certains concepts politiques. La mise à plat, c’est une manière d’accompagner le lecteur, la lectrice, dans la compréhension de notre idéologie. Je leur montre où on en est et quelles sont les possibilités.
La lutte, ça transforme les individus. Même si on ne gagne pas, on gagne en finesse, en compréhension.
Fania Noël
Votre ouvrage s’appelle Et maintenant le pouvoir : un horizon politique afroféministe. Comment parvient-on, dans un contexte franco-français, à une telle révolution selon vous ? Nous sommes dans une période post-élections législatives, marquée par une non-majorité étatique, par l’arrivée en force de la NUPES, par l’entrée concrète de l’extrême droite dans l’hémicycle mais aussi par l’arrivée de nouvelles figures politiques.
Je pense que dans le contexte démographique, et au vu des forces politiques actuelles, une organisation politique afroféministe ne peut pas porter une révolution. Ce qu’une organisation afroféministe peut faire, c’est faire partie de ce mouvement social, et quand je parle de mouvement social je l’étends à la France insoumise, jusqu’à l’extrême gauche. Il faut pousser pour qu’il y ait quelque chose qui s’approche le plus d’une révolution ou du moins d’un changement de système. Ce que les afroféministes apportent, c’est une compréhension de comment le genre est racialisé, de la question du genre, de la racialisation du genre, de la classe.
Mais pour un jour parvenir à une prise en compte de ces questions, il faut être dans la guerre idéologique, il faut pousser pour que la conscience politique de ce qui est passé en terme d’avancée ne soit pas passé sous silence. Il faut donc vulgariser, faire de l’éducation populaire, faire en sorte que des termes comme le capitalisme racial, la chaîne du care, la misogynoir, la racialisation du genre fassent partie du vocabulaire politique des organisations politiques progressistes radicales, pour que le changement puisse comporter la liberté pour le maximum.
Aussi, en tant qu’afroféministe on fait partie d’un territoire non matériel qui s’appelle l’Atlantique noir, vu que nous sommes lié·es et que la négrophobie est une logique qui organise le monde, notre destin en tant que noir·es ne peut pas être confiné à la France, qu’elle soit hexagonale ou non hexagonale. Il faut que la lutte soit en lien avec des pays majoritairement noirs car la question de la négrophobie est beaucoup liée à la question de l’autonomie politique, économique et sociale des territoires et des pays majoritairement noirs. Donc la fin de la négrophobie nécessite l’indépendance complète de territoires majoritairement noirs. Et ce combat contre la négrophobie ne peut pas se mener à l’échelle d’un seul territoire, c’est une lutte globale, car c’est une logique qui organise le monde. Il faut mettre fin à ce monde pour en créer un nouveau, il faut mettre fin à cette logique métaphysique, qui écarte les individus noirs de nos sociétés.
J’aimerais que l’on discute de la figure de Rachel Keke [ndlr, anciennce porte-parole de la grève des femmes de chambre de l’hôtel Ibis Batignolles, élue députée LFI]. Que représente-t-elle selon vous pour un pays comme la France ?
Les luttes permettent de radicaliser la conscience politique des personnes. Depuis le moment où Rachel Keke a commencé cette grève, jusqu’à maintenant, on constate le chemin parcouru, la ligne politique qui s’est dessinée. La lutte, ça transforme les individus. Même si on ne gagne pas, on gagne en finesse, en compréhension. L’idée, c’est aussi de montrer qu’il y a des chemins différents. Elle a fait une grève, elle est syndicaliste, elle devient représentante nationale. Il ne faut pas voir cette trajectoire comme une ligne que tout un chacun pourrait adopter, il faut plutôt voir ça comme quelque chose de circulaire, et chacun fait son petit trou dans le système à des endroits différents pour voir si ça va craquer. Il y a des personnes comme Rachel Keke ou celles qui vont aux législatives, qui prennent le chemin des urnes, de la représentation, de l’éducation nationale. Il y a d’autres personnes comme les anarchistes, les anti-fa qui pensent avant tout occupation de la rue. Il y a des gens qui sont dans le contre-pouvoir, et même si nous ne sommes pas toustes sur la même ligne, si on partage plus ou moins le même chemin, on peut se retrouver à certains endroits, et ça c’est positif. Donc, dans tous les cas, cette victoire est une bonne nouvelle.
Vous avez évoqué le concept de l’Atlantique noir, pourriez-vous revenir sur cette idée ?
C’est un concept théorisé par Paul Gilroy, qui évoque la circulation de toutes ces personnes entre l’Afrique, les Amériques, et l’Europe. C’est un espace qu’il a étudié dans son ouvrage The Black Atlantic pour parler de l’identité des noir·es britanniques par exemple. Leur citoyenneté est britannique, et en même temps, leur identité est caribéenne. Cette idée, telle qu’il la théorise au début, est très restreinte. Le terme Atlantique noir regroupe toutes les personnes noires, les noir·es du Brésil, de France, du Cameroun, qui seraient dans une logique de circulation, dans un espace immatériel où il y a de la circulation des personnes, des concepts, des théories, mais aussi cela rend compte du rapport conflictuel avec la notion d’État-nation. Ce concept d’Atlantique noir est fondateur pour la construction de la modernité, pour la construction de l’ère post-esclavagiste.
Ce sont les mouvements qui font les individus et non l’inverse.
Fania Noël
Que constatez-vous de l’évolution de ces luttes aujourd’hui ? Quels impacts percevez-vous chez les jeunes générations ?
Je pense qu’il y a deux choses. Entre chaque génération, il y a des gaps théoriques, mais ce que je vois, et qui est positif, c’est que le vocabulaire est beaucoup plus diffusé. Entre ce qui était utilisé comme terminologie sur Twitter par une frange de la population en 2012 et aujourd’hui, il y a une évolution énorme. Les gens aujourd’hui connaissent les termes afroféministe, queer. Après, ce qu’il y a derrière, c’est la récupération néo-libérale, la mainstreamisation des concepts, le manque de recherche. Tout le monde fait un résumé de résumés et personne n’a vraiment lu sur les concepts. Il y a cette question d’édulcoration des termes. On va mettre en avant les concepts dont on peut le plus facilement se saisir. Par exemple, on est saturé par la notion de privilège qui ne règle rien et qui n’apporte rien, ou celles de représentation ou de charge mentale. Ce que l’on perçoit, c’est la transformation d’outils théoriques pour des luttes particulières, dans une perspective de développement personnel et non dans une perspective politique et collective.
Et à votre avis, dans un monde globalisé comme le nôtre, et à l’heure des réseaux sociaux, comment évite-t-on cela ?
Ce que l’on peut faire face à ces récupérations, c’est fight back, créer des contre-discours, créer de nouveaux espaces politiques où d’autres sons de cloche sont entendus. Pour moi, pour que les choses changent, il faut une mise en mouvement des volontés d’agir. Elles sont souvent mises en mouvement quand on a la rage, quand on est désespéré·e, et/ou quand on est déterminé·e. Il faut qu’on combatte le fait de créer des consommateur·ices de contenus militants, et je parle aussi des personnes qui ne font que les manifs. Bien sûr que les manifestations sont importantes, mais il y a ce qu’il se passe après. Le continuum des organisations ce sont les petites marches, c’est la personne qui va chercher la sono, qui va faire des photocopies. Il faut tenir les organisations pour pouvoir maintenir le mouvement.
J’aimerais pour conclure que l’on parle de la notion de collectif, qui est chère à votre pensée. Quel importance a-t-elle pu avoir dans votre trajectoire politique, dans votre vie de militante, et qu’est-ce que vous pourriez dire à la jeune génération ?
Il y a cette activiste, Miriam Makeba, qui parle de l’espoir comme discipline. Les gens ont tendance à confondre et à penser à l’espoir comme optimisme. L’espoir, c’est considérer qu’il se peut que les choses ne marchent pas, et prendre conscience que ce qui est fait mérite d’être fait. Non seulement parce que ça nous transforme, mais aussi parce que ce qu’on fait peut avoir un impact sur quelques personnes et sur les individus de demain. Et ça, c’est réalisable en collectif. En collectif, on rêve au-delà de ses propres horizons, le collectif permet de donner de la force. Ce sont les mouvements qui font les individus et non l’inverse.
Vos mots de la fin ?
On est dans une période lugubre et c’est justement dans ces périodes-là que l’on a besoin d’éthique politique, de discipline pour changer le monde, et de conscience que l’on peut changer le monde.
Cet article Fania Noël : penser le monde dans une perspective afroféministe provient de Manifesto XXI.


Même s’ils ne représentent pas un totem d’immunité, les vaccins contre la variole du singe sont attendus pour réduire les risques et participer à la prévention.
L’article Monkeypox: La Suisse toujours à la traîne et des vaccins attendus est apparu en premier sur 360°.

Cet article Transvocalités (4/4) : Enchanté·e, Marina Herlop provient de Manifesto XXI.
Dans Transvocalités, notre chroniqueur Charles Wesley se demande comment les voix samplées, traitées, participant d’un processus émancipatoire s’incarnent au sein des musiques électroniques actuelles. Pour ce dernier épisode, il rencontre Marina Herlop, musicienne catalane qui considère la voix comme un éventail de possibilités, un synthétiseur aux très larges options. Son troisième album, Pripyat, est sorti en mai dernier sur PAN. Fusionnant piano, voix et sonorités tatillonnes qui claquent et qui fusent, on revient avec elle sur ce qui l’a amenée à un tel disque, sur sa tournée, ses choix et ses horizons.Je suis au Nextones, festival intimiste situé dans le nord de l’Italie à Val d’Ossola, produit par les mêmes organisateur·ices (Threes Productions) que Terraforma près de Milan. Je grimpe une petite colline pour rejoindre la loge de Marina Herlop qui donne sur le site principal du festival : deux grandes scènes dans la carrière, une dans la pénombre, là où se produira notamment Squarepusher demain soir, et une autre encastrée dans la pierre, là où Marina fera son show dans un peu plus d’une heure. Lorsque j’arrive, Marina s’entraîne avec les deux chanteuses a cappella qui l’accompagnent. Le batteur est là aussi. À peine l’ai-je saluée, on rigole déjà quand elle me dit qu’elle revient de l’hiver australien et qu’elle pensait être en été ici. Il a plu aujourd’hui et il fait un peu frisquet dans les montagnes. Elle n’est pas encore en tenue, elle porte un manteau marron, un pantalon et des tatanes. On doit lui apporter des bottes montantes à talons blanches et brillantes. Déterminée, c’est cette impression que laissera la jeune trentenaire après notre échange, mêlée à beaucoup d’autodérision et d’humilité.
Manifesto XXI – Tu tournes de manière intensive cette année, comment ça se passe ?
Marina Herlop : C’est assez fou, parce qu’en 2020 et 2021 je n’avais presque pas de dates. J’ai eu quelques dates en dehors de l’Espagne à la fin de l’année dernière et depuis ça se multiplie. C’est génial, je suis vraiment heureuse, et je réalise à quel point j’attendais ça. J’ai dû changer de mindset, parce que je n’étais pas habituée à être toujours de sortie. Beaucoup de socialisation. J’adore. Ça commence aussi à me manquer, d’être à la maison parfois. J’aimerais avoir les deux. Mais c’est hyper satisfaisant de partager sa musique. Jusqu’à maintenant je n’avais pas beaucoup de retours, et là je me rends compte que les gens écoutent ma musique ! (rires)
Pripyat est sorti en mai. Qu’est-ce qui a initié cet album ? Est-ce que c’est le continuum de ce que tu avais fait jusqu’ici ?
Mira, quand j’ai fait Pripyat, c’était un « dernier appel ». Parce que j’avais déjà fait deux albums. Le premier avait eu un assez bon succès. Et je n’avais pas mis énormément d’effort dedans. Le second, j’ai mis énormément d’effort, et la réponse n’était pas celle que j’attendais. J’avais des dates, mais je n’avais pas vraiment de revenus, mon projet ne semblait pas être assez solide. J’approchais de la trentaine et je commençais à stresser. Ma profession me paraissait être trop comme un hobby. Donc pour Pripyat, je n’avais pas beaucoup d’énergie et j’avais du mal à y croire. Je me suis dit que j’allais y aller à fond. Car je n’avais pas de plan B, je devais le faire de toute façon.
Sur ce dernier album, tu as utilisé des techniques de chants carnatiques du sud de l’Inde, des sons notamment produits avec la langue. Comment définirais-tu ta façon de chanter et de mêler tes influences ?
Aléatoire (rires) !… et freak. Parfois je fais un track et je me dis : ohlala, là voilà de retour ! (rires) Je l’enregistre en me disant que personne ne l’écoutera. Et les gens l’écoutent, et je me dis : wow, pourquoi j’ai fait ça ? Souvent je ne mets pas de paroles parce qu’elles ne viennent pas. C’est plutôt comme si je faisais les choses en recevant des ordres de quelque chose ou de quelqu’un. Je ne suis pas folle, mais je ne me sens pas entièrement responsable de ce que je fais musicalement. Même si je sais que je suis l’auteure et que je devais le faire comme ça… Avec les paroles je ne sens pas le besoin de raconter ma vie. Venant des autres ça ne me paraît pas forcément mielleux, mais quand je le fais en anglais, parfois je me dis : qu’est-ce qui me prend ? (rires)
Les chants pour moi sont un peu lazy. Mais je ne veux pas être la fille qui ne met pas de paroles non plus dans ses musiques, même si elles m’importent peu. Tu ne peux pas savoir le nombre de personnes qui m’ont demandé dans quelle langue je chantais ! (Concernant les morceaux qui ne contiennent que des sons vocaux.) C’est fou. Et je me suis dit : allez, mets des paroles. Ça évolue. Ma voix c’est aussi le piano, le classique. Ce qui ne change pas c’est mon envie de faire de la musique qui sonne bien à mes oreilles.
Qu’est-ce que le concept des transvocalités soulève en toi ?
Pour moi ça m’évoque le mélange de différent·es traitements, textures, intentions de voix. Des voix que, a priori, tu ne mixerais pas ensemble, mais que tu mixes, leur permettant de coexister.
Dans quelle mesure est-ce que tu veux amener la/les voix vers des horizons non intelligibles et rythmiques ?
J’ai beaucoup joué au piano, et je ne dirais pas que je suis chanteuse, mais ces dernières années, la voix m’intéresse beaucoup, c’est quelque chose. Quand tu y penses, c’est mental. Tu inspires de l’air et tu le transformes. Ce qui est intéressant c’est la texture de la voix, où tu la mets. On a tendance à penser, à dire : « toi tu es né·e pour chanter, toi tu as une belle voix et tu chanteras », mais en entraînant nos voix, on peut faire tellement de choses, en essayant d’être en accord, en mettant le son dans différents endroits de nos corps. Et en fonction de là où tu le mets, ça sonne différemment. Pour moi c’est intéressant d’utiliser ces techniques, selon le contexte de la chanson.
La voix c’est comme un très large synthétiseur avec plein de timbres. J’aime les harmoniser, les couper, devenir dingue avec ce puzzle. Je l’utilise comme un sound effect, un harmonizer, une mélodie, une percussion… il y a tellement de manières de composer avec. J’ai aussi envie de m’entraîner à chanter. Pas forcément en harmonie. Mais d’explorer, oui, c’est certain.
Pripyat est le premier album que tu as composé avec l’aide d’un ordinateur. Comment cela a-t-il influencé ta musique ?
Ça a changé beaucoup de choses. Je n’avais jamais expérimenté avec les boucles, travaillé beaucoup de pistes à la fois, samplé… Je me suis amusée à créer des rythmes, etc. Avant j’étais très limitée, en n’utilisant que ma voix et le piano. Et maintenant c’est… trop ! J’ajoute tellement de sons ! Tu verrais les sessions Live (Ableton) de Pripyat. Très chaotique. (rires) Faut se méfier des très nombreuses possibilités, de la rapidité. C’est un peu jouer à être Dieu : tu peux faire ce que tu veux. Mais il ne faut pas te perdre en chemin.
À Pitchfork, tu as dit que la musique importait pour elle-même, comme quelque chose de beau et d’intrigant. Tu as aussi évoqué un certain degré d’inconfort qui est important pour rester stimulée. S’il y avait un effet autre que le plaisir sensoriel dans ta musique, qu’est-ce que tu aimerais susciter chez l’auditeur·ice ?
Quand je fais une chanson, je cherche ce sentiment de « WOW ». De devenir dingue parce que je suis en train de composer. Ce que mes auditeur·ices sentent, ou veulent faire après avoir écouté ma musique, cela leur appartient complètement. Je veux juste faire quelque chose de solide esthétiquement, de frais et qui claque. À part ça, je me sens un peu détachée du monde et par ce qu’il se passe politiquement et écologiquement. Honnêtement, ça me déprime. La musique est alors comme un refuge. Je suis privilégiée parce que j’ai les moyens et le temps de faire de la musique, et ce qu’il y a là-dedans, c’est le meilleur.
Bien sûr, être en tournée, être avec sa famille et ses ami·es, les gens, avoir un petit animal de compagnie (rires), c’est essentiel. Mais en t’entraînant à être musicien·ne, en jouant d’un instrument – ce qui n’est pas s’afficher sur les réseaux sociaux, ce qui n’est pas être la plus belle/le plus beau quand t’es sur scène – en étant seul·e avec ton travail, tu entres en contact avec une autre dimension. Ce n’est pas du bonheur, de la tristesse. Mais c’est sur ce chemin que tu perds un peu ton sens d’identité, d’ego. L’important, c’est cette chose qui ne sert strictement à rien (rires), que tu creuses tous les jours, et ce que tu y trouves, ce que t’y vois à l’intérieur. Ma musique ne va pas sauver des vies, mais on fait ce qu’on fait parce qu’on n’a pas d’autres options, et on écoute parce que ça nous est indispensable.
 © Piercarlo Quecchia
© Piercarlo Quecchia
Image à la une : © Anxo Casal
Transvocalités (1/4) : l’élan sonique de SOPHIE
Transvocalités (2/4), le corps et son écho : entretien avec Lyra Pramuk
Transvocalités (3/4) : le féminisme coupé/collé de Mira Calix
Cet article Transvocalités (4/4) : Enchanté·e, Marina Herlop provient de Manifesto XXI.


Attention, confusion! Il y a des personnes faisant partie de groupes dits «à risques» et des comportements considérés comme «à risque» pour les IST.
L’article Dr·e Goudou:«Ma nouvelle partenaire est bi. Y a-t-il plus de risques concernant les infections sexuellement transmissibles (IST)?» est apparu en premier sur 360°.


La dérive des continents (au sud) nous emmène en Sicile, où une fonctionnaire onusienne doit organiser la visite des deux chef·fe·s d'État dans un camp pour personnes migrantes. Une tragi-comédie politique doublée d’un gros différend familial.
L’article Macron et Merkel jouent l’Arlésienne chez Lionel Baier est apparu en premier sur 360°.


La dérive des continents (au sud) nous emmène en Sicile, où une fonctionnaire onusienne doit organiser la visite des deux chef·fe·s d'État dans un camp pour personnes migrantes. Une tragi-comédie politique doublée d’un gros différend familial.
L’article Macron et Merkel jouent l’Arlésienne chez Lionel Baier est apparu en premier sur 360°.

Un ancien chauffeur du réseau de transport public de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), victime d'un harcèlement homophobe pendant plus d’une dizaine d’années, avant d'être licencié en 2020, a gagné son procès contre les sociétés Transdev et Keolis, deux opérateurs privés qui l'employaient.
L’article Salarié victime d’un harcèlement homophobe à Bayonne : la justice condamne ses employeurs est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.

Suite à une demande de STOP homophobie, la RATP a rendu ses formulaires inclusifs pour les personnes non binaires. Les utilisateur.ices des applis « Bonjour RATP » et « Mappy » pourront désormais s’inscrire en cochant « non spécifié », en plus des traditionnelles cases « Mme. » et « M. ». La non-binarité concerne …
L’article Non-binarité : la RATP rend ses formulaires inclusifs est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.

Un homme ivre de 42 ans a été interpellé alors qu'il menaçait avec un couteau les invités d'un événement privé, dont il avait été refoulé. Il aurait proféré des injures homophobes et molesté un policier également.
L’article Violente agression homophobe dans le quartier de la Guillotière à Lyon est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.


Le plus beau roman de Natalie Clifford Barney est resté inédit pendant plus d'un siècle. Achevé en 1912, L'Adultère ingénue décrit la passion qui lia la célèbre salonnière parisienne à la femme de lettres Élisabeth de Gramont.
L’article «L’Adultère ingénue», un secret bien gardé est apparu en premier sur 360°.


Le plus beau roman de Natalie Clifford Barney est resté inédit pendant plus d'un siècle. Achevé en 1912, L'Adultère ingénue décrit la passion qui lia la célèbre salonnière parisienne à la femme de lettres Élisabeth de Gramont.
L’article «L’Adultère ingénue», un secret bien gardé est apparu en premier sur 360°.

Cet article Paris Electronic Week fête ses dix ans à la Villette avec une prog XXL ! provient de Manifesto XXI.
Du mercredi 21 au samedi 24 septembre, Paris Electronic Week 2022 célèbre sa dixième édition à la Villette. La PEW c’est le festival dédié aux cultures et aux musiques électroniques, pour les pros, les fans, les couche-tôt ou les lève-tard.Organisée par Technopol, la Paris Electronic Week est la plus grande convention de musiques et cultures électroniques en France. Sa vocation ? Informer et faire kiffer. « L’idée, c’est à la fois d’ouvrir des pistes de réflexions pour les professionnel•le•s des musiques électroniques qui sont déjà installé•e•s et de les ouvrir à des thématiques importantes aujourd’hui, notamment l’écologie et l’inclusion. D’une autre part, c’est d’apporter des bases et des compétences solides pour les générations futures, qu’iels soient pros ou non » explique Candice Demirdjibashian, responsable communication de Technopol. Plus d’une dizaine de lieux partenaires dans le parc accueilleront des conférences, des débats, des masterclasses et des workshops pour imaginer le futur des fêtes et les évolutions du secteur électronique.
Cette année, les conférences sont organisées autour de quatre grands thèmes : la musique, l’écologie, la politique et l’inclusion, avec des sujets tels que « Peut-on se passer de la fameuse close d’exclusivité ? » qui empêchent les circuits courts artistiques, « Les NFT sont-ils une aberration écologique », « Comment agir lorsqu’on est témoins de violences sexuelles et sexistes ? », « La santé mentale des artistes queers ». Côté intervenant•e•s, on attend Louisahhh, François X, Yanis, High Tribe, ou encore Frédéric Hoquard, l’adjoint à la mairie de Paris en charge de la vie nocturne qui viendra présenter des pistes pour un Paris festif aussi attractif que Berlin, Barcelone ou Amsterdam. Pour cette édition 2022, l’innovation technologique et les nouveaux outils de création seront mis à l’honneur : Beatport et Pioneer DJ s’associent à PEW et proposent un espace dédié aux artistes et aux labels de la scène électronique.
Enfin, nouveauté importante, « on a beaucoup travaillé l’offre festive qui existait moins sur les autres éditions » explique Candice. « Notre programmation est 100% paritaire et bien évidemment, en circuit court » ajoute-t-elle. A l’affiche, on retrouvera donc des artistes comme Clara3000, Lacchesi, Calling Marian et Bamao Yende. La soirée de lancement aura lieu à la Folie avec un apéro professionnel. Le jeudi soir, on se retrouve au Trabendo. Vendredi et samedi, rendez-vous au Périphérique, le nouveau lieu du parc en open air qui peut accueillir 3000 personnes !
Pour prendre sa place, c’est par ici !
Suivez le take-over Instagram de Manon à la PEW vendredi 23 septembre.
Relire notre compte-rendu de PEW 2021
Image à la Une : ZUT Artistique au Périphérique © Philippe Levy
Cet article Paris Electronic Week fête ses dix ans à la Villette avec une prog XXL ! provient de Manifesto XXI.

Après des semaines de controverse et d'intenses pressions internationales, la Marche des Fiertés paneuropéenne, quoi qu'écourtée, s'est finalement déroulée, sans incident notable, ce samedi 17 septembre, rassemblant plusieurs milliers de personnes dans les rues de la capitale serbe.
L’article Des milliers de personnes à Belgrade pour l’Europride, sous haute protection policière est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.


Les personnes LGBTIQ+ sont particulièrement exposées aux violences médicales et aux obstacles à la parentalité. Pour les aider à faire famille, les doulas tiennent une place particulière. Rencontre avec l’un·e d’entre elleux.
L’article Parentalité queer: quand les doulas vont au front est apparu en premier sur 360°.


Les personnes LGBTIQ+ sont particulièrement exposées aux violences médicales et aux obstacles à la parentalité. Pour les aider à faire famille, les doulas tiennent une place particulière. Rencontre avec l’un·e d’entre elleux.
L’article Parentalité queer: quand les doulas vont au front est apparu en premier sur 360°.



Six associations, dont STOP homophobie, déposent plainte contre le médecin-conseil de la CPAM de Roubaix-Tourcoing, qui a refusé à jeune femme transgenre le remboursement d’une plastie mammaire.
L’article Discrimination : Plainte pour un refus de remboursement de soins à une personne transgenre est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.

Cet article Podcast – Paye ta vie d’artiste ! Vendre à tout prix ? (4/5) provient de Manifesto XXI.
Paye ta vie d’artiste ! est une série de podcasts portée par Manifesto XXI, en partenariat avec Provence art contemporain, qui met en lumière les conditions sociales et économiques des artistes et travailleur·ses de l’art. Dans le sillage de la 16ème édition du salon Art-o-rama à Marseille, on s’intéresse à la question de la vente et toutes ses ambiguïtés.Comme chaque dernier week-end d’août, Marseille s’agite au rythme de la grande rentrée de l’art contemporain à Marseille. Son point d’orgue : le salon Art-o-rama qui réunit à la Friche Belle de Mai une quarantaine de galeries internationales. L’occasion de parler d’argent, et en particulier de vente. Pourquoi ces questions sont-elles encore largement taboues dans les milieux artistiques ? D’ailleurs, doit-on vendre pour pouvoir se sentir légitime d’être artiste ? A-t-on forcément besoin d’intermédiaire pour vendre ses pièces, et comment fixer le prix d’une œuvre ? À quel point celui-ci en détermine-t-il la valeur ? On parlera évidemment du marché de l’art et de ses contradictions, et on se demandera aussi si d’autres modèles sont possibles.
À retrouver sur Apple Podcasts, Deezer, SoundCloud et Spotify
On en discute au fil de ce quatrième épisode avec nos deux invité·es : Sophie Cras, historienne de l’art et économiste, autrice de l’ouvrage Écrits d’artistes sur l’économie, une anthologie paru cette année aux éditions B42 ; et Jérôme Pantalacci, fondateur du salon international d’art contemporain Art-o-rama. Nous entendrons aussi la voix de l’artiste Aurore Le Duc, celle de Nicolas Veidig-Favarel de la galerie Double V (Marseille/Paris) ainsi que Clémence Rivalier, cofondatrice de Super Sapin, une initiative qui organise des ventes d’œuvres d’art en dehors des galeries.
Ressources
• Sophie Cras, Écrits d’artistes sur l’économie, une anthologie, éd. B42, 2022
• Jean-Pierre Cometti et Nathalie Quintane (dir.), L’art et l’argent, éd. Amsterdam, 2017 pour la 1ère édition, réédité en 2021
• Antoine Bonnet, « Les artistes ont faim », revue Facettes n°6, 2020, p.28 à 39.
• « Quand les artistes s’intéressent à l’économie », France Culture, 16 mars 2022
• « Artistes et galeries : les enjeux du partenariat », Art Boulot, initialement publié dans la revue Lechassis.fr en mars 2020
• Zoé Haller, « Œuvrer en marge du marché de l’art », revue Marges, 2019
• The Art Market 2022, Art Basel & UBS
• Jérémy Sinigaglia, Artistes plasticiens, de l’école au marché, Presses Sciences Po, 2020
Initiatives
• Le Trait, association d’artistes auteurices en région PACA
• La Condamine, structure qui favorise les échanges de bonnes pratiques et le développement des artistes
• Economie solidaire de l’art, qui vise à améliorer la situation économique des artistes plasticien·ne·s et des travailleur·se·s de l’art en France
• Super Sapin, initiative composée de Clémence Rivalier, Julie Kieffer, Laura Pardini, Romane Domas et Louise Porte, pour organiser des ventes d’œuvres
• Wages For Wages Against, pour une plus juste rémunération des artistes en Suisse
• ATFU, nouvelle application pour plasticien·ne·s, pour aider à s’organiser au quotidien et encourager le troc d’œuvres entre artistes
Crédits
Invité·es : Sophie Cras, Jerôme Pantalacci
Avec les interventions de Aurore Le Duc, Nicolas Veidig-Favarel (Double V) et Clémence Rivalier (Super Sapin)
Animation, écriture, montage et réalisation : Soizic Pineau et Sarah Diep
Aide à la documentation : Anne-Charlotte Michaut
Musique et habillage sonore : Alexi Shell
Design graphique : Léna Araguas et Alaric Garnier
Merci à Papi et à Radio Grenouille pour la réalisation technique.
Un podcast Manifesto XXI produit avec Provence art contemporain, enregistré dans les studios de Radio Grenouille à Marseille
Image à la une : Aurore Le Duc © photo Sébastien Baverel
Cet article Podcast – Paye ta vie d’artiste ! Vendre à tout prix ? (4/5) provient de Manifesto XXI.

Cet article Le club selon Friction Magazine en 8 hits provient de Manifesto XXI.
C’est la rentrée, et avec pour certain·es le retour au sport mais aussi la reprise du clubbing ! L’équipe de Friction Magazine s’occupe de fusionner ces deux activités physiques en une soirée à Petit Bain.Qui s’y frotte cyprine, telle est leur devise ! Entre deux articles sur l’actualité des luttes et de la culture queer, les camarades de Friction Magazine organisent des soirées aussi de temps en temps. La prochaine c’est ce vendredi 16 septembre, elle s’appelle HIIT Edition, et promet une séance de cardio intense sur fond de techno avec Cate Hortl, le collectif Agressive(s) et Air-One. Détail de taille, l’entrée est à 6€, mini prix pour maxi kiff. Pour l’occasion, les membres de l’équipe nous ont partagé leurs hits fétiches, qui racontent à leur manière ce que chacun·e aime dans la fête.
Leslie : « It » – Cate HortlOn invite pour la première fois Cate Hortl pour un DJ set lors de notre soirée HIIT Edition et je suis vraiment ravie. J’adore son dernier EP sorti sur WARRIORECORDS et plus particulièrement le morceau « It » avec son côté darkwave et EBM. Il y a quelque chose de déstabilisant dans les paroles de cette voix qui nous emmène dans une ambiance de thriller sombre. J’adore !
« Chaos » – Louisahhh (wax wings remix)J’adore l’album The Practice of freedom de Louisahhh pour ces sons qui évoquent les années 80 et le rock alternatif. Mais la grosse découverte, c’est ce remix du morceau « Chaos » par Wax Wings avec un beat lourd et un tempo soutenu. De quoi se défouler et faire le plein d’endorphines en quelques minutes.
« Make you scream » – vtssLes sets de vtss sont généralement synonyme de grosse techno brutale qui tend presque vers l’EBM. Ce que j’aime avec ses productions et surtout avec ce morceau c’est qu’elle va vers l’electroclash avec des voix qui rappellent presque Peaches. C’est un peu plus pop tout en conservant des gros marqueurs techno et ça fait du bien.
J’ai eu le plaisir de voir Italoconnection en live à une Discoquette, un collectif qu’on adore d’ailleurs inviter aux soirées Friction. Leur dernier album, Midnight Confessions Vol. 1, donne des envies d’orgies homosexuelles dans un parking désaffecté. Un sentiment bien précis que j’aime parfois retrouver en club, j’admets.
Gaëlle : « You’re not alone » – OliveLorsque je pense aux fêtes, au monde de la nuit, je pense à cette chanson. Parce que je suis une vieille gouine nostalgique qui aime lever les bras en l’air dans la foule et accessoirement faire des pauses entre deux tracks de grosse techno. Ceci dit il serait temps de la remixer un peu pour la rendre un peu plus dansante sur la durée : ceci est un appel.
Matthieu : « It’s a fine day » – OPUS IIIÇa fait des années que je suis obsédé par ce morceau, je le joue quasiment chaque fois que j’ai l’occasion. J’aime tout de cette track, son côté Eurodance ultra kitsch, les paroles d’une naïveté confondante (empruntées à l’excentrique poète anglais Edward Barton) auxquelles on s’accroche comme un mantra, l’envolée jazzy qui surgit au milieu de nulle part (alors qu’en général les cuivres m’irritent). En plus de ça, j’ai appris un jour que c’était l’un des morceaux préférés de Guillaume Dustan, ce qui finalement ne m’étonne pas tant que ça, mais m’a conforté dans mon opinion qu’il s’agit d’un hymne club indépassable. Quoiqu’il arrive, demain sera beau, il faut bien y croire…
Benjamin : « Wake Up » – Laurent GarnierIl se trouve que j’ai vu Laurent Garnier en vrai pour la première fois le weekend dernier donc s’il faut un classique, voilà !
« Werewolf Disco Club » – I Hate ModelsJ’ai vu une fois I Hate Models en festival. J’ai eu l’impression de me faire rouler dessus par un 33 tonnes conduit par un twink. Et j’ai aimé ça.
FRICTION HIIT EDITION – CLUB 6€
Image à la Une : © Gaëlle Matata
Cet article Le club selon Friction Magazine en 8 hits provient de Manifesto XXI.

La semaine des Fiertés dédiée avait également été annulée, mais les organisateurs ont choisi de maintenir le défilé, quoi qu’en disent le gouvernement.
L’article Les autorités serbes réitèrent l’interdiction de l’Europride est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.


Dans un documentaire dont il fait exploser le cadre, Brett Morgen met en évidence le côté précurseur du charismatique génie anglais, ses performances délirantes, son talent de peintre. Sans omettre d'évoquer ses addictions.
L’article Moonage Daydream, hommage fascinant à David Bowie est apparu en premier sur 360°.


Dans un documentaire dont il fait exploser le cadre, Brett Morgen met en évidence le côté précurseur du charismatique génie anglais, ses performances délirantes, son talent de peintre. Sans omettre d'évoquer ses addictions.
L’article Moonage Daydream, hommage fascinant à David Bowie est apparu en premier sur 360°.


Avec Feu follet, le réalisateur portugais propose une fantaisie musicale queer, en forme d’ode au sexe et à la nature. Sa singularité et sa subversivité n’empêchent pas parfois la caricature et une certaine complaisance.
L’article Joao Pedro Rodrigues ose tout et ne cache rien est apparu en premier sur 360°.


Avec Feu follet, le réalisateur portugais propose une fantaisie musicale queer, en forme d’ode au sexe et à la nature. Sa singularité et sa subversivité n’empêchent pas parfois la caricature et une certaine complaisance.
L’article Joao Pedro Rodrigues ose tout et ne cache rien est apparu en premier sur 360°.


Dans une Venise confinée, une humaine s’éprend d’une sirène. Tel est le point d’ancrage de la pièce de théâtre Mångata, jouée à Fribourg et Lausanne cet automne. 360° rencontre la dramaturge Joëlle Richard qui en est l’autrice.
L’article Mångata – «À trop nier ses désirs, on risque de passer à côté de soi» est apparu en premier sur 360°.


Dans une Venise confinée, une humaine s’éprend d’une sirène. Tel est le point d’ancrage de la pièce de théâtre Mångata, jouée à Fribourg et Lausanne cet automne. 360° rencontre la dramaturge Joëlle Richard qui en est l’autrice.
L’article Mångata – «À trop nier ses désirs, on risque de passer à côté de soi» est apparu en premier sur 360°.

Cet article Le dimanche au Rosa Bonheur des Buttes, la fête anti-blues provient de Manifesto XXI.
Si tu passes un dimanche soir au beau milieu des Buttes Chaumont, tu entendras peut-être « Toxic » de Britney Spears qui résonne du fin fond d’un vieux pavillon en pierre. C’est le Rosa Bonheur, une institution où plein de garçons parisiens viennent finir leur weekend, et le lieu qu’a choisi d’explorer Manon pour la rentrée de sa chronique « Tous les jours c’est samedi soir ».Ça faisait longtemps qu’on ne s’était pas lu ! La vie fait qu’on se retrouve pour cette rentrée en plein dans les Buttes Chaumont et pas n’importe où ni n’importe quand : au Rosa Bonheur un dimanche soir. C’est la fin du week-end. Le moment de la semaine le plus badant à ce qu’il paraît. Pas pour tout le monde. Au milieu des Buttes Chaumont, une queue de dingue s’étire devant le Rosa Bonheur. Normal, c’est la rentrée. « Je viens ici parce que c’est la seule soirée qui réunit pas mal de mecs du milieu gay de tous horizons » m’explique Thomas, 30 ans, lunettes de soleil.
On est sans étiquette, c’est la politique du Rosa des Buttes. Si les gens veulent venir parce qu’ils aiment l’endroit, qu’ils s’y sentent bien et qu’ils se reconnaissent dans nos valeurs, ils viennent. On n’est pas là pour faire du marketing et attirer les gouines et les pédés avec une comm’ aguicheuse.
Zouzou, patronne du Rosa
Le dimanche au Rosa des Buttes, c’est LA soirée. « Le dimanche, clairement, la guinguette a été prise comme ça par un public plutôt garçon. Enfin, il y a aussi des meufs ! La preuve, je suis là » plaisante Zouzou, la patronne des lieux. Elle s’appelle Céline, mais on l’appelle Zouzou parce que « je suis née dans les années 70 et il y a un mec que je déteste, Hugues Aufray, qui a écrit une chanson qui s’appelle “Dis-moi Céline”. Il y en avait toujours au moins quatre ou cinq dans ma classe, donc les gens m’ont appelé Zouzou, c’est un diminutif de mon nom de famille. Et c’est resté ».
Zouzou a bossé au Pulp pendant neuf ans. Le Pulp, c’était le club lesbien de Paris avec des résidentes comme Jennifer Cardini ou Chloé. Il a fermé en 2007. « Après dix ans de nuit complète, on voulait un endroit où il y ait à manger, que les gens voient la lumière du jour, à commencer par nous ! » Le Rosa des Buttes Chaumont a ouvert en 2008. Avant, c’était le Pavillon Weber. Et encore avant ça, en 1860, c’était le Pavillon du Chemin de Fer, dénommé ainsi parce que la petite ceinture de Paris y passe. « Un endroit avec des dames qui portent des grandes robes et qui tiennent des ombrelles. C’est sûr que si tu viens un dimanche maintenant, comparé à 1860, ce n’est sûrement pas la même ambiance » s’amuse Zouzou.
Ici, c’est quand même un endroit très fun. La musique, c’est toujours génial, en tous cas pour le dimanche, c’est hyper commercial, mais c’est de ça dont on a envie.
Edouard, 29 ans
À l’intérieur, une grosse boule disco éclaire toute la salle, une barre de pole dance sur laquelle se hisser en toute tranquillité. Un pizzaiolo, un endroit où prendre à manger – tu y trouveras d’ailleurs des spécialités de la maison comme du « houmousexuel » – et un bar, toujours rempli où l’on vient pour s’abreuver. Il y a aussi les toilettes, cinq en tout, « presque plus qu’au Rex Club » rigole Zouzou. Et les toilettes, on sait comme c’est important. D’ailleurs au Rosa, elles sont rose bonbon et super bien éclairées. « C’est un lieu d’information et de prévention. Il y a beaucoup d’affichages sur le sexe, sur les drogues, et on a mis à disposition des alcootests et des préservatifs. » En tout cas, l’idée de Zouzou et ses acolytes – (elle a ouvert le Rosa avec son associée Mimi, mais aussi avec Christophe Vix de Technopol, sans oublier l’aide de la boîte de prod Why Not Productions qui a fait tous les films d’Audiard ou Desplechin) – c’était « d’avoir une grande maison accueillante, ouverte à toustes, où les gens se sentent bien, du matin au soir. Du cake à la carotte bio en passant par le chocolat chaud jusqu’à la vodka club maté, tout le monde trouve sa place : les joggeurs, les papis, les mamies, les promeneurs de chiens ». Et bien sûr la communauté LGBTQIA+. Mais ici, pas question de faire du pinkwhashing : « On est sans étiquette, c’est la politique du Rosa des Buttes. Si les gens veulent venir parce qu’ils aiment l’endroit, qu’ils s’y sentent bien et qu’ils se reconnaissent dans nos valeurs, ils viennent. On n’est pas là pour faire du marketing et attirer les gouines et les pédés avec une comm’ aguicheuse. »
Dua Lipa, Beyoncé et Dannii MinogueEt ça fonctionne. En allant me promener sur la terrasse où certain·e·s dégustent une pizza quand d’autres sirotent une bière (ou les deux en même temps !), je croise la route de Sam et Laurent. « Ça fait dix ans qu’on vient ici. Ça n’a pas trop changé, ce sont toujours les mêmes personnes, sauf qu’on vieillit un peu. Je me rappelle de soirées où je suis monté tout en haut de la barre de pole dance, comme d’autres où on était venus avec des enfants d’amis et qu’on les avait posés sur le bar comme des petites mascottes. C’est ça l’ambiance. » Ici, tout le monde se sent bien. Edouard, 29 ans, qui travaille dans les RP me raconte qu’au Rosa Bonheur, il y a un mood qu’il ne trouve pas ailleurs : « Ici, c’est quand même un endroit très fun. La musique, c’est toujours génial, en tous cas pour le dimanche, c’est hyper commercial, mais c’est de ça dont on a envie. » Effectivement, « Let’s Get Loud » de Jennifer Lopez résonne à balle sur les enceintes. Le kiff. Edouard reprend : « Il y a quelques années, c’était une des premières fois que je venais. Je buvais ma bière tranquille sur la terrasse, et d’un coup, j’ai entendu Christine & the Queens passer. J’étais méga étonné. Je me suis dit waw, j’ai trop de chance d’être ici et d’être gay. »
La bande son du dimanche au Rosa, moi, je la trouve incroyable. Et c’est dingue, car elle plaît à tout le monde. Celleux qui préfèrent les soirées maison, celleux qui ne sortent pas à des teufs en dessous de 180 BPM, celleux qui aiment l’italo-disco ou encore la tekhouse. « C’est ce qu’on appelle des musiques typiquement gay ! Dua Lipa, Beyoncé, Dannii Minogue » résume Laurent, le copain de Sam. Sur la piste, tout le monde est déchaîné, moi y compris. En passant, un homme m’alpague. Il porte un chino bleu marine et a une coupe en brosse. « Excusez-moi, c’est une soirée gay ici ? » Je lui réponds que oui, je crois bien. Il me semble qu’il est étranger et qu’il est venu ici par hasard. Il me dit, un petit peu décontenancé. « Mais il n’y a que des hommes ! Vous pensez que je suis le seul hétéro ? » Je rigole et je m’en vais. Effectivement, le Rosa le dimanche soir, c’est pas une soirée pour hétéros lourdingues. Sorry bro. C’est même « le rendez-vous des pédés » m’explique James, blond platine, sagittaire de 29 ans.
Il y a des mecs gays qui pensent que le Rosa n’est ouvert que le dimanche à partir de 17h. Mais c’est normal, c’est leur créneau. Moi quand je vais à la piscine, je ne me demande pas si elle est ouverte en dehors des vacances scolaires, je m’en branle.
Zouzou, patronne du Rosa
En bonne Hermione Granger que je suis, je demande tout de même à toutes ces personnes dont je croise la route si elles n’ont pas peur de la fatigue du lundi matin. Pour James le sagittaire, ici, c’est une manière de venir terminer le week-end entre copaines. « On ne boit pas d’alcool, juste un petit monaco et on rentre tôt ! » Pour Sam et Laurent, c’est différent : « Nous, on est des -euses ! » Interloquée, mais pas moins intéressée, je leur demande ce que sont des -euses. « Tous les métiers en -euse ! Celleux qui ne travaillent pas le lundi. Habilleuses, maquilleuses, coiffeuses, serveuses, ambianceuses, instagrammeuses, chômeuses, paresseuses ! Le dimanche, c’est notre samedi soir à nous. » En fait, m’explique Zouzou, au Rosa il y a plusieurs types de population : « Le dimanche, il y a celleux qui sont en terrasse et qui ne sont jamais rentré·es à part pour prendre un verre et qui ressortent aussi sec. Iels ne savent même pas quel type de musique on passe et iels s’en foutent. Il y a celleux qui passent leur soirée sur le dancefloor. Il y en a qui ne sont jamais venu·es le soir et d’autres qui ne savent pas qu’on est ouvert le midi. Il y a des mecs gays qui pensent que le Rosa n’est ouvert que le dimanche à partir de 17h. Mais c’est normal, c’est leur créneau. Moi quand je vais à la piscine, je ne me demande pas si elle est ouverte en dehors des vacances scolaires, je m’en branle. »
« Le chant, ça ne génère que du bonheur et du partage »Mais il y a un groupe de personnes dont on n’a pas parlé : la chorale du Rosa Bonheur. Tous les dimanches, sauf l’été, si tu arrives assez tôt, tu peux tomber sur 80 personnes en train de chanter du David Bowie en chœur. Cette chorale a été initiée par Mimi, l’associée de Zouzou qui adore chanter. « Au début, on était une dizaine de personnes, dont le staff ! On était presque obligé·e de chanter, moi qui chante comme une casserole ! » se rappelle la patronne du lieu. Cette époque est bien loin, c’était il y a treize ans. Aujourd’hui, si tu veux faire des vocalises au Rosa le dimanche, faut te lever tôt. Il y a une liste d’attente longue comme le bras et les places y sont très chères. « C’est-à-dire que quand il y a un déménagement ou que quelqu’un·e s’en va, ça fait des heureux·ses. Mais attention, ça demande une vraie assiduité dans les répétitions. Pas question de venir une fois sur deux. » Fort de son succès, le Rosa a décidé d’organiser des ateliers de chants intergénérationnels. La chorale et son chef de chœur se déplacent dans des écoles, des EHPAD, des foyers. « On mélange les personnes âgées et les jeunes enfants du 19e. Le chant, c’est un lien social énorme. De toute façon, chanter, ça ne génère que du bonheur et du partage, c’est hyper important. C’est un peu comme la cuisine. Sauf qu’on peut chanter partout, dans la rue, chez soi, avec ou sans micro. »
La chorale a même chanté devant l’Hôtel de Ville en plein marché de Noël pour une distribution de cadeaux à l’occasion d’un événement organisé par le Rosa avec Pedro Winter pour le Secours populaire. Un moment de l’année très cher à Zouzou : « La mère Noël est un amour ». Le seul événement où l’entrée est payante au Rosa Bonheur. « Juste avant Noël, on booke un plateau de DJ de ouf que tu ne verrais même pas dans un festival : Bambounou, Miss Kittin, Laurent Garnier, Vitalic, Kiddy Smile. Devant le Rosa, il y a les camions du Secours populaire qui font payer l’entrée avec un TPE. Soit tu viens avec un cadeau d’une valeur de 15 euros – plutôt éducatif et pas sexiste, genre tu ne viens pas avec une Barbie rose ou un camion de pompier – soit tu payes l’entrée si tu n’as pas eu le temps de faire tes courses. Tout le monde ramène un cadeau ! Même le staff, même les DJ. Tout le monde. » Ce soir-là, c’est le seul soir de l’année où la musique décoiffe toute la nuit au pavillon des Buttes. Zouzou essaie d’organiser des mères Noël dès qu’elle le peut : « la mère Noël est un amour même en été », « la mère Noël est un amour même en octobre »… « Vendre plein d’alcool pour aider les gens qui crèvent de faim avec cette thune, pour moi, c’est la plus belle des récompenses. » C’est dit. À dimanche prochain.
« Tous les jours c’est samedi soir », c’est la chronique de Manifesto XXI sur la nuit et la fête. Ici, pas d’analyse musicale ni de décryptage de line-up. L’idée est plutôt de raconter avec humour ce monde de la fête que l’on connaît tout bas. Qu’est-elle devenue après plus d’un an de confinements ? Qui sort, et où ? Et bien sûr, pourquoi ? Manon Pelinq, clubbeuse aguerrie, entre papillon de lumière et libellule de nuit, tente d’explorer nos névroses interlopes contemporaines, des clubs de Jean-Roch aux dancefloors les plus branchés de la capitale.
Relire :
• Le Sacré : la nouvelle formule pour un club plus safe
• « Un millilitre de trop et c’est le coma » : le chemsex, entre risques et plaisirs
• Pamela, l’espoir de la teuf rive gauche
Cet article Le dimanche au Rosa Bonheur des Buttes, la fête anti-blues provient de Manifesto XXI.

Cet article Scènes queers, où en est-on ? Entretien avec Bruno Péguy, directeur du festival Jerk Off provient de Manifesto XXI.
Le festival Jerk Off débute demain à Paris, avec une soirée au Micadanses, premier jour de deux semaines de festivités queers et artistiques. L’événement fête au passage ses 15 ans, un bel âge qui méritait bien une discussion rétrospective !Depuis 2008, Bruno Péguy et son équipe – qu’il préfère qualifier de « meute » – travaillent à visibiliser l’émergence artistique queer, en construisant des programmations autour d’artistes dont « l’imaginaire [est] en marge des normes dominantes ». À l’occasion de cette nouvelle édition à la programmation prometteuse, nous l’avons rencontré pour faire le bilan.
Manifesto XXI – Est-ce que tu pourrais me raconter la naissance de Jerk Off ? Quelle était l’idée première du festival ?
Bruno Péguy : Jerk Off est né d’un constat partagé avec Patrick Thevenin et Stéphane Viard, et ensuite David Dibilio, sur l’absence d’un espace où les communautés artistiques des scènes LGBTQIA++ à Paris. C’était il y a 15 ans…* À mon niveau, j’ai commencé ma carrière dans l’évènementiel, et j’organisais notamment des soirées ouvertes aux lesbiennes et aux gays, à l’époque on ne disait pas queer. C’était en 1999, on passait de la bonne électro minimale, un son un peu berlinois, le label B-pitch Control, des choses comme ça. On était assez proche de ce qu’il se faisait au Pulp le jeudi. À l’époque, j’avais deux choix. Soit j’allais au Rex pour écouter du bon son, mais chaque fois que deux garçons s’embrassaient sur la piste, on entendait « oh, c’est trop mignon ». Ce n’est pas méchant, mais c’est très vite fatiguant. Sinon, j’allais dans des soirées gays mais musicalement je ne m’y retrouvais pas du tout. Alors j’ai eu envie de créer des soirées qui me ressemblaient.
Puis avec Patrick, Stéphane et quelques autres*, on s’est rendu compte à ce moment-là que chaque capitale avait sa Gay Pride, mais qu’à Paris, il n’y avait pas de festival artistique qui parlait de la différence, de nos communautés et notre fragilité. La Pride c’est important, parce que ça défend nos intérêts d’un point de vue politique et que c’est à l’origine de beaucoup d’avancées. Mais avec mes ami·es, on voulait montrer qu’il n’y avait pas que ça. On voyait des drag queens qui passaient au journal de 20 heures, ce sont des grandes dames qui ont beaucoup fait avancer la cause, mais il nous semblait important de montrer aussi toutes les autres choses qui existaient. Alors au départ, on voulait s’appeler Pride Off. Mais en France c’est une marque déposée, alors on nous est tombé dessus à bras raccourcis et l’avocate du festival nous a dit de trouver un autre nom.
Pour moi il faut vraiment qu’on s’unisse, dans nos communautés, pour avoir plus de force.
Bruno Péguy, directeur du festival Jerk Off
C’est comme ça que Jerk Off est né. C’est un mot qui veut dire la même chose dans toutes nos communautés. À l’époque, comme tout le monde ne parlait pas aussi bien anglais, les gens ne comprenaient pas forcément ce que cela voulait dire, et on aimait le doute qui planait autour. On a commencé par organiser le festival en même temps que la Gay Pride, fin juin. On essayait de faire jouer des artistes dont l’imaginaire n’était pas celui de la norme dominante. On ne s’intéressait pas à la sexualité des gens qui jouaient au festival, on aimait plutôt parler de fragilité. Parce que finalement, la façon de les défendre au mieux et de mettre en valeur leur travail, c’est d’aller vers une forme de fragilité, de sensibilité, plutôt qu’une sexualité. Le festival a été décalé en octobre, au moment de la FIAC, et maintenant en septembre. Parce qu’on a pensé qu’il était important d’offrir des visibilités à d’autres moments de l’année. On voulait aller chercher de la visibilité partout où on n’en avait pas, et là où on en voulait plus.
Depuis trois ans et le départ de David Dibilio*, l’équipe fonctionne sur un modèle de décision collégial. J’aime bien parler d’une meute, plutôt. Je trouve que la richesse de nos communautés se joue aussi là : chacun·e propose des choses, avec sa sensibilité, son histoire et sa fragilité. Tout vient du groupe, il n’y a plus qu’une direction artistique avec deux personnes qui prennent des décisions. Tout est ouvert à toustes. C’est vraiment ce qui fait la force du festival. Pour moi il faut vraiment qu’on s’unisse, dans nos communautés, pour avoir plus de force.
 Cuir – un loup pour l’homme © Valerie Frossard
Cuir – un loup pour l’homme © Valerie Frossard
Dans les discours, les disciplines et les lieux, Jerk Off est un festival complètement multiple. Comment se forme cette programmation ? Au fil des rencontres ou suivant des envies particulières à l’époque ou à vos préférences ?
Au fil des rencontres, vraiment. Les premières années, forcément il y avait plus de musique, c’était mon métier et mes contacts. Puis on s’en est un peu détaché pour s’orienter plutôt vers du spectacle vivant ou de l’art contemporain. Et on va y revenir. Mais la programmation vient vraiment de coups de cœur de l’équipe. On voit des spectacles et on se dit qu’il faut faire quelque chose ensemble. Dans mon Dessin, par exemple, je l’ai découvert au festival FACT (Festival Arts et Création Trans) à la Flèche d’Or. J’ai été frappé par l’énergie et la force qui se dégageaient sur scène. C’est un peu un OVNI, par rapport à d’autres choses qu’on programme, qui sont des projets suivis par le Centre Culturel Suisse, ou programmé sur des scènes nationales… Il est important pour nous de faire ce grand écart.
Et puis ça fait un moment qu’on se préoccupe des questions trans, il y a beaucoup de choses à dire aujourd’hui. On a d’ailleurs organisé un événement au Centre Wallonie Bruxelles le 17 mai, pour la journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie. C’est parfois une rencontre, parfois l’envie de traiter un sujet en particulier, quand on constate un problème dans le monde. Je prends l’exemple d’une exposition qu’on a organisé quand Poutine à déclaré qu’il n’y avait pas de gays en Russie… J’ai donné une carte blanche à Sasha Pevak, un commissaire d’exposition russe, qui vit aujourd’hui à Paris parce qu’il est gay. Il a fait toute une exposition sur son ex-petit copain qui, lui, était resté en Russie.
Votre ligne éditoriale lie donc absolument le politique et l’artistique. Penses-tu que dans l’absolu, les deux puissent réellement être distingués ?
Je crois que nous sommes toujours politiques. En tout cas dans les pièces qu’on présente. Peut-être que certaines œuvres artistiques pour le grand public ne sont pas politiques, même si je pense qu’elles le sont toujours un peu. Nadia Larina, de la compagnie FluO, s’inspire énormément du travail de Virginie Despentes. Sur la question de la déconstruction des corps, sur tous ces acquis que l’on a, et pourquoi on les a, comment on pourrait les déconstruire pour trouver autre chose. Sa pièce est extrêmement esthétique, il y a une très belle installation plastique sur scène. Mais le sujet duquel elle s’inspire est profondément politique et l’œuvre, de fait, l’est aussi.
Il y aura toujours des connards, il faudra toujours leur cracher à la gueule et ne jamais se laisser faire.
Bruno Péguy, directeur du festival Jerk Off
Cela fait maintenant 15 ans que tu agis à faire entendre ces discours via des créations. Depuis la naissance de Jerk Off, quelles évolutions ou régressions as-tu pu observer sur la scène artistique française ?
Je suis toujours tenté d’être positif et de dire qu’il y a eu beaucoup d’évolutions dans le bon sens, parce qu’il y en a eu. Malheureusement, ce n’est pas tout. On essaye d’être présent·es dans les collèges et les lycées, on développe toute une partie éducation avec le festival, avec laquelle on fait intervenir les artistes, on essaye d’avoir des discussions avec les professeur·es et les élèves… Et parallèlement, on a vu ces dernières années un ancien ministre de l’Éducation Nationale mettre en place des think tank contre le « wokisme », dire des choses monstrueuses sur le genre, sur la façon dont on en parle à l’école, ou même sur l’écriture inclusive. En fait, sur toutes ces choses qu’on pensait avoir gagnées et sur lesquelles il y a finalement eu un retour en arrière. Encore une fois, je vais être positif et dire que j’espère que ça va changer, dans les années qui viennent et avec le nouveau ministre en place.
D’un point de vue sociétal, il y a eu de nombreuses avancées importantes. On peut se marier, adopter, avoir accès à la PMA, même si ça a mis beaucoup trop de temps, ce n’est pas normal qu’il y ait eu autant d’attente. Mais finalement il y a eu beaucoup de régressions aussi. Ce qu’on gagne, on le reperd ailleurs. Ce qu’il se passe aux États-Unis est juste monstrueux, je n’ai pas de mots pour décrire une horreur pareille, et on voit aujourd’hui des abrutis qui réclament un droit à discriminer ! Comment peut-on vouloir un droit à discriminer ? On cherche à mener des actions, à aller vers l’éducation, ça fait aussi trois ans qu’on dépose des dossiers auprès du Ministère de la Culture pour expliquer la richesse de la différence et à chaque fois on a des refus. Il faut aller vers l’éducation, c’est là que ça débute, c’est là qu’on pourra faire changer les lignes.
Il ne faut pas se voiler la face, quand on est de l’underground et qu’on cherche à percer, on se prend un mur qui est difficilement pénétrable, c’est très dur. Mais même si on tombe, encore et encore, il faut toujours se relever.
Bruno Péguy, directeur du Jerk Off festival
Selon ton expérience auprès de différentes disciplines, est-ce que tu penses que le spectacle vivant est, sur les questions sociétales, en retard ? Je pense notamment au MeToo Théâtre qui est apparu bien après les autres.
Le théâtre est un milieu très feutré. J’emploie le mot feutré à bon escient, parce qu’il est très compliqué d’y dire ce qu’on pense, d’aller à l’encontre de gens qui ont un pouvoir tellement énorme, qu’il en devient complètement écrasant. C’est un milieu extrêmement hiérarchisé. Mais j’ai quand même l’impression qu’il y a une grosse vague de changement. Je pense à Phia Ménard, une artiste dont je suis proche et dont j’adore le travail. Elle est associée au Théâtre de Bretagne, elle a joué à Avignon un spectacle magnifique dont toute la presse a parlé comme étant l’évènement du festival. Je pense aussi à Christophe et Jonathan de la compagnie Sine Qua Non Art dont la pièce sur le bondage, Nos désirs font désordre, est passée à Chaillot l’année dernière.
Ce sont quand même de nouveaux discours qui sont portés sur les scènes nationales. Je le vois aussi au niveau du festival, depuis 3 ans avec par exemple le Centre Culturel Suisse ou le Centre Wallonie Bruxelles qui nous suivent. L’année dernière, pour la première fois, nous étions soutenus par la DRAC, cette année par la DGCA (Direction Générale de la Création Artistique). Mais toujours pas d’aide de la part de l’Education Nationale. Et Metoo, en effet, arrive très tardivement.
Il ne faut pas se voiler la face, quand on est de l’underground et qu’on cherche à percer, on se prend un mur qui est difficilement pénétrable, c’est très dur. Mais même si on tombe, encore et encore, il faut toujours se relever. Des claques dans la gueule on en prend en permanence. Il y a deux ans, pour les César, on s’est pris un sacré seau d’eau en pleine face. Mais il faut aller de l’avant. Il y aura toujours des connards, il faudra toujours leur cracher à la gueule et ne jamais se laisser faire.
 Every drop of my blood – Compagnie FluO © Pierre Planchenault
Every drop of my blood – Compagnie FluO © Pierre Planchenault
Est-ce que ces changements sur les scènes nationales ne viennent pas en partie d’un changement de comportement du public ? Par exemple des jeunes qui se détachent de ces programmations attendues, pour aller vers de l’underground, vers des discours plus modernes et inclusifs ?
Complètement. Les artistes dont je parlais plus tôt viennent de l’underground et c’est là qu’ils·elles ont puisé leur force et leur énergie. Et aussi, je suis absolument bluffé par la rigueur et la façon de travailler des plus jeunes générations. Quand je reçois des dossiers de jeunes compagnies qui sont en train de créer leur tout premier spectacle, je suis impressionné. Les dossiers sont tellement bien faits, tellement carrés, tout est explicite. Il y a une réelle professionnalisation de l’émergence que je trouve très intéressante. Ce sont des choses comme ça aussi qui me font croire en l’avenir.
Cette année, côté programmation, il y a un retour à la musique, avec pas mal de soirées.
Oui, c’était important. D’abord parce que c’est les quinze ans du festival, ensuite parce que je pense que tout le monde a envie de faire la fête, la vie est déjà suffisamment dure. Et puis je ressens une telle énergie dans les soirées parisiennes en ce moment, que j’avais envie de la montrer. Donc on a laissé des cartes blanches à des collectifs : La Branlée, parce que je trouve qu’il se passe des choses très intéressantes dans le milieu underground porno et inclusif. Frivole de Nuit, parce qu’on avait déjà travaillé avec elleux et que nous voulions les laisser parler, musicalement. Et puis il y a le lieu, le Klub, avec qui on a déjà beaucoup travaillé. Je voulais faire passer toute cette énergie dans le festival.
C’est nos corps, ils nous appartiennent. Vraiment, il faut qu’on nous laisse en faire ce qu’on a envie d’en faire.
Bruno Péguy, directeur du festival Jerk Off
Un ADN particulier pour cette édition anniversaire ?
Je pense qu’elle reste la même que les années précédentes, l’idée est toujours de défendre l’émergence et d’aller dans des directions où d’autres ne vont pas forcément. Ce qui change, c’est tout ce qu’on développe au-delà du festival de septembre. On a eu ce week-end du 17 mai, on va être présent·es mi-octobre au Carreau du Temple et à la Ménagerie de Verre, on va lancer un cycle de conférences. On travaille avec Noëlla Bugni-Dubois, qui crée du contenu augmenté autour de spectacles, elle accompagne les spectateur·rices qui veulent en discuter, de façon conviviale ou plus formelle. On organise une table ronde autour des masculinités queer le 28 septembre. On voudrait aller dans cette direction. Pour 2023, on va tenter de mettre en place une fois par mois, une séance de projection de courts-métrages suivie de débats. Je crois qu’on a toustes envie de parler, et il le faut. Il faut qu’on parle entre nous. Donc je dirais que l’ADN des quinze ans c’est : on garde ce qui est déjà là et on en fait encore plus.
Un mot de la fin ?
Peut-être simplement dire qu’on reste un festival militant et que ce qui nous anime toujours c’est de défendre nos libertés. C’est nos corps, ils nous appartiennent. Vraiment, il faut qu’on nous laisse en faire ce qu’on a envie d’en faire. Et puis aussi mettre en avant une certaine bienveillance. Je trouve que c’est tellement important dans nos milieux, de se soutenir, de s’écouter et de faire en sorte de toujours permettre aux artistes de se sentir bien. Pour tenter d’aller plus loin dans la création, dans l’écoute et le dialogue. C’est vraiment ce qu’on essaye de mettre en place.
Prenez vos places ici !
Image à la Une : Nirvana – Delgado Fuchs © Alex Yocu
* L’article a été modifié le 14 septembre 11h.
Cet article Scènes queers, où en est-on ? Entretien avec Bruno Péguy, directeur du festival Jerk Off provient de Manifesto XXI.

Le gouvernement tanzanien prévoit des mesures contre les administrateurs et membres de groupes de médias sociaux notamment qui partagent des messages en ligne et autres vidéos promouvant les « relations homosexuelles ».
L’article La Tanzanie « met en garde » contre la diffusion en ligne des contenus pro-LGBT+ est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.

Cette année encore l’équipe de HF Auvergne-Rhône-Alpes, association qui lutte pour l’égalité femmes-hommes dans le champ culturel, organise pendant trois jours une multitude d’événements à travers la région afin de redonner de la visibilité à l’héritage laissé par des femmes et souvent oblitéré des livres d’histoire. Expositions, représentations théâtrales, visites commentées seront notamment au programme.
Les Journées du Matrimoine du 15 au 18 septembre 2022. Programme complet en ligne.
L’article Journées du Matrimoine 2022 en Auvergne-Rhône-Alpes est apparu en premier sur Hétéroclite.

Cet article Kindergarten : « L’image constitue la communauté du public » provient de Manifesto XXI.
C’est l’une des soirées queers les plus créatives de Paris, et elle va marquer cette rentrée : vendredi 16 septembre, le collectif Kindergarten fête son 5ème anniversaire en grande pompe à la Machine du Moulin Rouge avec une édition « birthday cake » gargantuesque. On s’est glissé dans les coulisses des préparatifs pour une interview de retrouvailles avec les co-fondateurs et hôtes de la fête.Déjà une demi décennie que la Kindergarten fait danser, rire, et crée une génération de clubbers. Ces derniers mois, le collectif n’a pas chômé : la Kinder a déménagé à Pigalle, et collaboré avec Tracks, l’émission culte d’Arte. La joyeuse bande s’est aussi exportée en Corée, le temps d’une soirée à Séoul. Enfin, le crew a lancé une nouvelle soirée, PlayTime, qui prend le relais à Petit Bain, la salle où tout a commencé. Seulement voilà, la pause forcée par la pandémie a empêché des rencontres, essentielles pour les jeunes queers. Comment renouer avec un public inconnu ? C’est bien la question que se posent tous les organisateurices de soirée post-covid. Alors dans le cas de la Kindergarten, comment expliquer ce qui fait de cette soirée un évènement si particulier, à la fois barjo et sympa, pointu esthétiquement et vraiment accueillant ? On peut commencer par revenir à l’héritage que revendique le collectif depuis ses débuts : celui des Club Kids, enfants terribles new-yorkais qui ont distordu les codes du drag et repoussé les frontières de la fête dans les années 90. Les cofondateurs de la Kinder, Thibault et Hugo, plus connus sous leurs noms de performers Tiggy Thorn et Marmoset, nous ont parlé de leur passion pour les looks improbables et la nuit, mais aussi de leur éthique de la fête et d’archives queers. Au passage, ils nous ont livré quelques anecdotes spectaculaires sur les meilleurs moments de la Kinder.
Manifesto XXI – Comment est-ce que vous présenteriez la Kindergarten à quelqu’un qui ne connaît pas ? Quelle est votre histoire ?
Marmoset : La Kindergarten, c’est à la fois un collectif et une organisation de soirées. On s’est toustes rencontré·es dans des fumoirs et des backstages de clubs. L’idée c’était de regrouper des DJ, des performers, des scénographes, des gens qui viennent d’un milieu artistique pour produire un projet qui s’inscrive dans l’esprit du club. Ce qui nous plaisait c’était de retrouver le club comme un endroit où les publics – notamment les minorités – peuvent se retrouver mais sont aussi capables de produire quelque chose d’artistique. Par la musique mais aussi à travers le visuel. Ça passe par les artistes qu’on produit mais aussi via le public qu’on invite à venir looké. Ce qu’on attend et qu’on espère créer, c’est que le public se sente suffisamment en adéquation avec le projet pour sentir qu’il en fait partie.
Tiggy Thorn : Pour nous le public c’est 90% de la réussite d’une soirée. Ça joue dans tous les types de soirée, mais peut-être d’autant plus à la Kinder où tu peux développer un personnage artistique. Tu peux t’y habiller comme tu le souhaites alors que tu ne peux pas le faire à Paris le reste du temps parce que les gens sont… des hommes, blancs, cis, hétérosexuels. (rires)
On va en club pour s’éclater, pour rencontrer des gens, pour se vomir dessus, être à 6g et n’en avoir rien à foutre. Le club, pour nous, c’est le fun.
Tiggy Thorn
 Tiggy Thorn et Marmoset © Jean Ranobrac pour la Kindergarten
Tiggy Thorn et Marmoset © Jean Ranobrac pour la Kindergarten
Vous vous placez dans l’héritage des Club Kids, comment avez-vous découvert le mouvement ?
Tiggy Thorn : C’est vrai que ce n’était pas hyper démocratisé à Paris avant qu’on en parle. Comment on en est arrivé là ? Bonne question. Comme le disait Hugo, on s’est toustes rencontré·es en club. On sortait notamment beaucoup à la House of Moda, la soirée lookée par excellence. Rapidement, avec notre groupe d’ami·es, on s’est mis en tête qu’on voulait respecter les thèmes mais d’une manière débile, pas en drag tel quel. Quand tu cherches des manières de te maquiller, sur Pinterest par exemple, tu tombes facilement sur le travail de Ryan Burke, un des plus gros Club Kids américains qui bosse depuis de nombreuses années. Il a ce truc non genré que j’ai toujours trouvé intéressant. À partir de ça, on a commencé à gratter un peu et on a découvert que le milieu était hyper intéressant dans ses démarches profondes. Iels étaient vraiment à rebours de ce qui se faisait à New York : les Club Kids, c’était une espèce de gros fuck à toute l’intelligentsia de la ville. Comme le Studio 54, qui était un projet génial – mais comme les jeunes artistes n’étaient pas invité·es, ça créait une scission complète entre l’artistique bourgeois et les Club Kids qui commençaient à faire des soirées dans un McDo, dans le métro, à l’arrière d’un camion.
Marmoset : Quand on s’est rencontrés il y a 8 ou 9 ans avec Thibault, j’avais commencé le drag et je sentais que ça ne me plaisait pas vraiment. Pour moi le club kid va avec le lieu, il faut que le costume bouge, se souille, il faut voir des gens. Il faut qu’il y ait du vécu. Venir en club kid, c’est vraiment être une performance à soi seul·e. Ce n’est pas forcément « débile » comme démarche mais il y a quelque chose d’innocent qui fait que tu peux venir dans un look hyper léché, ou en sac poubelle, ou couvert·e de peluches, ou à poil avec une salade sur la bite. (rires)
C’est bête mais il y a toujours plein de gens qui nous disent qu’ils ne se sentaient pas à l’aise avec leur corps, avec le fait de porter telle ou telle tenue, et que voir les photos leur a donné envie de venir à la soirée. L’image constitue la communauté du public.
Marmoset
 © Jean Ranobrac pour la Kindergarten
© Jean Ranobrac pour la Kindergarten
À chaque soirée il y a un photo call. Pourquoi ça fait partie de l’ensemble ?
Tiggy Thorn : Il y avait un grand questionnement sur la photo de club quand on a commencé. Prendre des photos de gens lookés qui n’ont pas envie que ça se retrouve sur les réseaux, c’est délicat. Mais assez rapidement, on a pris le parti de le faire quand même, en laissant la possibilité de ne pas le faire pour celles et ceux qui ne voudraient pas être montré·es. Les photographes avec lesquel·les on bosse sont briefé·es et sont hyper mignon·nes. L’image a été une pierre d’ancrage dans notre démarche. C’était important d’arriver à se démarquer des soirées qu’il y avait à Paris, de montrer quelque chose de mignon. Notre volonté de départ, la raison pour laquelle on fait du club, c’est pour que les gens s’amusent.
Il y a cinq ans on était dans quelque chose de particulier, lié à l’essor des réseaux sociaux, les gens se regardaient entre eux plutôt que de consommer le moment. On était plutôt sur du show off, et ça n’a jamais été notre conception. On va en club pour s’éclater, pour rencontrer des gens, pour se vomir dessus, être à 6g et n’en avoir rien à foutre. Le club, pour nous, c’est le fun. Cette conception qui ne nous plaisait pas tellement et le déclin de la House of Moda nous ont poussé à créer cette identité qui dénote dans le côté joyeux. C’est ce qui a sans doute contribué au fait que notre public est très, très chouette. On a eu très peu de problèmes sur nos cinq ans. On fait beaucoup de réduction des risques mais je pense que cette partie visuelle y contribue. C’est un vrai plus aussi parce que toutes les drags et tous les Club Kids n’ont pas les thunes de se payer un shooting photo, ou les capacités de se payer un appareil.
On a eu une drag queen qui est venue avec un appareil à raclette géant autour d’elle, et elle distribuait de la raclette pas cuite aux gens dans la soirée, bref n’importe quoi !
Tiggy Thorn
 © Jean Ranobrac pour la Kindergarten
© Jean Ranobrac pour la Kindergarten
Marmoset : Ça m’est déjà arrivé d’aller en soirée looké, d’être déjà bourré au moment de prendre une photo, donc de demander à quelqu’un de prendre la photo, et le résultat est nul. J’ai des looks qui se sont perdus dans les limbes du passé comme ça. (rires)
Organiser un vrai photo call, c’est récompenser les gens qui viennent. Ça nous aide en terme de communication auprès des bons publics, parce que quand on voit ces images, on voit la diversité et les looks. C’est bête mais il y a toujours plein de gens qui nous disent qu’ils ne se sentaient pas à l’aise avec leur corps, avec le fait de porter telle ou telle tenue, et que voir les photos leur a donné envie de venir à la soirée. L’image constitue la communauté du public. Aussi, même si ce n’était pas l’objectif initial, comme on parle beaucoup d’archives LGBTQIA+ en ce moment, une de mes fiertés c’est d’avoir ces milliers de photos de la jeunesse queer d’une certaine époque.
Tiggy Thorn : Oui avec des évolutions de personnes sur cinq ans qui sont folles !
Marmoset : Même moi oui, on voit bien l’évolution de mes looks ! (rires)
Mettre en avant ces portraits permet de mettre en avant des parcours individuels. Ça permet de montrer le clubbing en tant que mouvement de société.
Marmoset
Qu’est-ce que vous avez remarqué comme évolutions dans les tendances visuelles ?
Tiggy Thorn : Déjà on a vu la mise en place d’une vraie pratique club kid. Aux premières soirées, les gens avaient quelques paillettes sur le visage et puis au fur et à mesure on a vu des choses gigantesques arriver. On a eu une toque bigoudène faite en rouleaux de papier toilette par exemple. On a eu une drag queen qui est venue avec un appareil à raclette géant autour d’elle, et elle distribuait de la raclette pas cuite aux gens dans la soirée, bref n’importe quoi ! Un mec nous a fait des costumes avec les sacs Ikea et Monoprix, c’était incroyable, complètement fait à la main. Tu voyais que ça allait se déchirer pendant la soirée mais sur la photo, c’est dingo !
À propos de la production d’images et d’archives LGBTQIA+, étonnamment dans les soirées Club Kids des années 90 il y avait aussi beaucoup de photos. Il y avait déjà cette culture du photo call. Le livre Club Kids (de Walt Cassidy) retrace toute cette esthétique, c’est une énorme banque d’images. Pour nous trente ans après, ça véhicule un imaginaire très important. Reproduire cette démarche de l’archive de 2017 à 2022 fait que, dans trente ans, quand on sera morts, d’autres gens trouveront ces images. Ils pourront voir que le club kid des années 1990 n’est pas le même que celui des années 2020. Entre ces deux périodes on voit déjà la démocratisation du maquillage et peut-être un peu moins le côté crafty, mais encore que. Le milieu queer étant un milieu de personnes pauvres, on ne peut pas faire autrement.
 © Jean Ranobrac pour la Kindergarten
© Jean Ranobrac pour la Kindergarten
Marmoset : Quand tu regardes toutes les photos du clubbing LGBTQIA+ depuis quinze ans, tu vois les évolutions sur les gens. On a connu des gens qui sont venus à la Kinder qui n’étaient pas out, qui passent d’hétéro à gay, de gay à extrêmement gay… Mettre en avant ces portraits permet de mettre en avant des parcours individuels. Ça permet de montrer le clubbing en tant que mouvement de société. Depuis qu’il y a RuPaul’s Drag Race on recommence enfin à parler de l’histoire de la ballculture et de la culture drag des années 70 aux États-Unis. On redécouvre le clubbing originel, queer, noir et latino. Le clubbing dissident qui a façonné ce qu’on connaît aujourd’hui.
On le voit à Paris aussi, même s’il y a encore quelques boîtes techno bourges avec des mecs hétéros blancs en chemise. Dans les soirées gays on observe une plus grande diversité, on voit de plus en plus de meufs, lesbiennes ou non, on voit une plus grande affirmation des corps. Je me rappelerai toujours la première fois où je me suis senti fier en tant qu’organisateur, c’était à la première Kinder, où une meuf seins à l’air m’a dit que c’était la première fois qu’elle pouvait se sentir à l’aise avec son corps dans une soirée non lesbienne. C’est important de pouvoir se sentir en sécurité et en absence de jugement.
Tiggy Thorn : On a même une habituée de la Kinder qui est venue lookée à 4 mois de grossesse !
Marmoset : On a parfois des gens de 50 ans, 60 ans, qui se pointent. Une fois aussi, on a eu un car de touristes espagnols. Ça produit de la diversité, naturellement.
On ne peut pas vendre un safe space, mais en tant qu’orga tu peux travailler pour prévenir ton public.
Tiggy Thorn
 © Jean Ranobrac pour la Kindergarten
© Jean Ranobrac pour la Kindergarten
Comment avez-vous préparé votre changement de lieu pour maintenir des bonnes conditions d’accueil du public, un espace qui reste safe ?
Marmoset : On s’est un peu tordu l’esprit sur ce sujet, mais il me semble que maintenant, c’est relativement accepté qu’on ne peut pas simplement décréter être une soirée safe, que c’est quelque chose qui se construit avec le public. Quelque part, on a les publics qu’on mérite. Si certaines soirées connaissent encore autant de cas d’agressions sexuelles, de harcèlement, de mecs relous… c’est qu’il y a eu un souci dans l’intention initiale. Bien sûr, on s’est posé des questions en commençant à grossir, en changeant de club. Évidemment avec la Machine et Anaïs [Condado, programmatrice de la salle, ndlr], on savait qu’on ne prenait pas un gros risque. Une des premières choses qu’on nous a dites, c’est qu’on pouvait dégenrer les toilettes, et en tant qu’orga, ça rassure. Ensuite on a mis en place énormément de dispositifs, de réduction des risques, de maraudes. Une de nos premières expériences, c’était que des drags se faisaient toucher, les seins, les fesses, se prenaient des remarques transphobes. Aussi, on avait le cas de personnes trans bloquées aux points de sécurité. On a réfléchi à partir de ces cas-là pour développer une communication plus générale. On a réfléchi à des mécanismes ne serait-ce que pour éjecter les personnes qui agressent, on a essayé de se remettre en question au maximum au fil des événements… Après, force est de constater que la diversité et le respect sont là. La génération actuelle a des attentes.
Tiggy Thorn : Ce concept de safe place m’a toujours fait doucement rigoler. Ça ne peut pas, et ne doit pas être un argument marketing, pour la simple et bonne raison qu’on ne peut pas l’assurer. On peut assurer au public de tout mettre en œuvre pour que ça devienne le plus secure possible. Je ne pourrais jamais dire que la Kindergarten est une soirée safe parce que par définition, une soirée n’est pas un endroit safe. Les gens sont alcoolisés, ou drogués, et on n’est jamais à l’abri d’un problème. On ne peut pas vendre un safe space, mais en tant qu’orga tu peux travailler pour prévenir ton public.
Kindergarten – 5 years edition
DJ sets et lives : TTristana, Miss Jay, LISA
Performers : Klaus, Cuntessa Pinkessa, Rose Sainte-Verge et Hava
Image à la Une : © Jean Ranobrac pour la Kindergarten
Cet article Kindergarten : « L’image constitue la communauté du public » provient de Manifesto XXI.



Quatre associations LGBT+ déposent plainte avec constitution de partie civile, ce lundi 12 septembre, contre Caroline Cayeux pour injure et appel à la haine homophobes pour avoir réaffirmé en juillet dernier que le mariage et l'adoption des homosexuels étaient un « dessein qui va contre la nature ». Malgré le classement sans suite du parquet, les associations ont décidé de forcer le procès en saisissant le juge d'instruction.
L’article Caroline Cayeux sera jugée pour ses propos homophobes est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.


Cinéaste de la confusion des sentiments, il nous charme avec sa «Chronique d'une liaison passagère» montrée comme une aventure à suspense. Une comédie dramatique formidablement portée par Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne.
L’article Emmanuel Mouret filme le désir, prélude à tout est apparu en premier sur 360°.


Cinéaste de la confusion des sentiments, il nous charme avec sa «Chronique d'une liaison passagère» montrée comme une aventure à suspense. Une comédie dramatique formidablement portée par Sandrine Kiberlain et Vincent Macaigne.
L’article Emmanuel Mouret filme le désir, prélude à tout est apparu en premier sur 360°.


Les pratiques découlant de stéréotypes de genre à l’égard des enfants ont des conséquences sur les choix et les attitudes qu’iels adopteront tout au long de leur vie. Pour instaurer l’égalité et lutter contre ces stéréotypes dès le plus jeune âge, les structures de la petite enfance ont un rôle central à jouer.
L’article Contre les stéréotypes de genre: les crèches en première ligne est apparu en premier sur 360°.


Les pratiques découlant de stéréotypes de genre à l’égard des enfants ont des conséquences sur les choix et les attitudes qu’iels adopteront tout au long de leur vie. Pour instaurer l’égalité et lutter contre ces stéréotypes dès le plus jeune âge, les structures de la petite enfance ont un rôle central à jouer.
L’article Contre les stéréotypes de genre: les crèches en première ligne est apparu en premier sur 360°.

Collection privée conservée depuis 1992 à la Bibliothèque Municipale de Lyon, le fonds Michel Chomarat donne accès à de riches archives sur l’histoire LGBT+. Il recèle d’essais et de romans célèbres, mais aussi d’archives contemporaines éclairant l’histoire des luttes et cultures queers, créant une mémoire LGBT+ à la fois locale et internationale (recueils thématiques d’articles de presse, affiches, tracts, fanzines et périodiques, correspondances…). Pour fêter les trente ans du fonds, le sociologue et historien Antoine Idier organise cette année Dans les marges, une exposition créée intégralement à partir de la collection.
Dans les marges, du 15 septembre 2022 au 28 janvier 2023 à la Bibliothèque Municipale de Lyon/Part-Dieu.
L’article Dans les marges : Trente ans du fonds Michel Chomarat est apparu en premier sur Hétéroclite.

Les deux hommes avaient quitté leur pays, espérant trouver refuge en République centrafricaine, où ils s'étaient installés depuis 7 mois en tant que réfugiés homosexuels auprès du HCR.
L’article Deux Camerounais expulsés de Centrafrique pour « pratique d’homosexualité » est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.

L’ONU s’est déclarée vendredi « très préoccupée » après la condamnation prononcée à l’encontre de deux femmes, accusées de promouvoir l’homosexualité.
L’article L’ONU « très préoccupée » par les condamnations à mort prononcées contre deux militantes LGBT+ en Iran est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.

Cet article Josée Yvon: la femme la plus dangereuse du Québec provient de Manifesto XXI.
Peu connue en France, l’autrice canadienne Josée Yvon nous a laissé des récits au féminisme mordant et des pages incandescentes sur les vies underground. Cet article est initialement paru dans le numéro 10 du zine papier LE GOSPEL, disponible ici.Ian Svenonius le chantait, Andrew Weatherall le défendait haut et fort: « music is not for everyone« . Une façon d’affirmer que ce n’est pas dans la facilité que l’Art le plus précieux se modèle en totale opposition avec l’ère du plaisir immédiat et de la simplification extrême entamée dans la seconde moitié du XXème siècle. La littérature de Josée Yvon, non plus, n’est pas « pour tout le monde ». Cela n’a rien à voir avec la langue utilisée, les thèmes ou encore les images convoquées. Non, les mots de l’auteure québécoise sont accessibles à tout un chacun pour peu qu’on souhaite renouer avec la force viscérale du langage. Mais elle exige un abandon total auquel tout un chacun n’est pas forcément prêt. La littérature est un vaisseau poétique qui sert (aussi) à comprendre le monde qui nous entoure, nous façonne, nous malaxe et nous asservit. Josée Yvon était, à sa façon unique, un rempart contre la violence sociétale, un incendie brûlant capable de réchauffer les cœurs des laissé(e)s pour compte et de venger les êtres abandonnés sur le trottoir par la normalité.
Née à Montréal en 1950, Josée Yvon a exercé un paquet de métiers en parallèle de ses activités d’écriture (qui rassemblent fictions, poèmes et théâtre). Loin de l’insouciance hippie 70’s, ses premiers recueils semblent documenter une frange cachée de la vie montréalaise, celle peuplée de femmes soumises à la violence masculine: junkies, danseuses, fugueuses, prostituées, celles qu’elle appelle ses « sœurs rock » et qui se sont pris le libéralisme 80’s en pleine gueule.
Au début des années 1960, le Québec fait sa « Révolution Tranquille », une période de transition et de décléricalisation qui voit le pays ouvrir ses portes à une présence plus importante du gouvernement dans ses affaires. C’est aussi à cette époque que les souverainistes (qui veulent un « Québec Libre ») prennent davantage d’importance. A la différence de la France, Mai 1968 n’est pas un moment de grandes tensions sociales. Les contre-cultures sont arrivées au Canada via les déserteurs américains fuyant la conscription du Vietnam. Ils importent avec eux les idéaux hippies qui se diluent dans l’exception culturelle québécoise. Dans les années 1970, des mouvements artistiques émergent, le Jazz Libre en particulier qui amalgame autour de lui poètes, écrivain.es, dramaturges. En 1980, le parti souverainiste organise un référendum (qui donnera à cette nouvelle ère le nom de « Québec référendaire »). Il est défait mais traduit un élan nationaliste important. En réaction à cela se forme une véritable contre-culture punk qui se démarque largement du mouvement prog rock/jazz nationaliste de la décennie précédente (mené par Robert Charlebois entre autres). Influencé par des groupes anarchistes européens comme Crass ou Poison Girls, un rejet du patriarcat et des revendications pro-féministes (irriguées par la littérature américaine pro-sexe et lesbienne) et une vitalité particulière des expressions « multi-médias » (danse, vidéos, performances), l’underground québécois est actif mais particulièrement précaire. Le gouvernement canadien prendra pleinement conscience des enjeux de rayonnement culturel rendus possibles par ses artistes dans les années 1990. Avant cela, artistes et marginaux crèvent la dalle. C’est cette époque en particulier que documente de manière brute et brutale Josée Yvon.
En 1976, son premier recueil, Filles-commandos bandées, fait le lien entre l’héritage Beat américain et une forme d’expression pré-punk. Elle est une membre active du milieu de la poésie québécoise, lit régulièrement ses textes en public et commence au début des années 1980 une collaboration avec la maison d’édition Les Herbes Rouges, toujours active aujourd’hui. Travesties-kamikazes, sorti en 1980, est une de ses œuvres les plus puissantes. Elle y ouvre une fenêtre sur la marginalité, sur des figures prisonnières du patriarcat qui se démènent dans la misère sociale et psychologique, tout en touchant du doigt une certaine grâce que nulle aliénation ne saurait effacer. Son écriture adopte un angle de poésie documentaire assez unique en son genre. Elle explose les règles de la bienséance grammaticale et syntaxique, on s’y sent happé, attrapé par le col et mis le nez dans la pisse et les menstruations. Pourtant, l’auteure marche toujours sur le fil (et nous avec elle) sans jamais verser dans le sensationnalisme. Ici, pas de syndrome Strip Tease, de misérabilisme, de street cred factice. Yvon parle de ce qu’elle connaît, de celles qu’elle voit et fréquente. Une sororité de la casse et de la crasse qui ferait passer Sylvia Plath pour Traci Lords. La noirceur est sublimée par cette écriture au rasoir.
Danseuses mamelouks (1982) est une œuvre qui aspire le lecteur dans une intimité inédite avant de le mettre à la porte. Car il y a une forme de vengeance et de violence justifiée qui se dégagent de ces récits de séances punitives et d’empowerment de la part de ces femmes « au moteur brûlé ». Ces corps qui nous hypnotisent sont à mille lieux des canons hollywoodiens. Ils expriment une beauté fragile, organique que l’industrie du divertissement nie totalement. Si le body horror de Cronenberg dévoile les viscères et les organes, l’œil queer et humide de la Québécoise dépeint trous de seringues, cicatrices et pieds cornées par les platform shoes des lap-danseuses. En convoquant expressions anglophones et références pop, Yvon se place aussi dans une revendication plastique et politique du langage poétique.
personne ne peut abuser d’elle, c’est déjà fait.
Extrait de La chienne de l’hôtel Tropicana, José Yvon
une vulve mordue, fourrée avec des couteaux, tous
ses bleus de morphine sur les seins, son maquillage de
guerre offre la cible insolente de la brassière rapiécée,
les culottes à frange décolorée-cheap, la lumière crue
d’un mauvais éclairage
une nudité déconcertante au rang des méprisées d’avance
c’est sa peau familière, non synthétique qui est provocante
le verre brisé des bouteilles lui enfonce dans les pieds.
Il n’y a pas assez de mots pour décrire la réalité complexe de la féminité. Yvon s’y emploie comme on déchargerait un flingue. On pense bien sûr à la langue de Kathy Acker, à certains textes de Dorothy Allison ou à la persona de Lydia Lunch. Mais les textes abrasifs de Josée Yvon dans les années 1980 annoncent aussi, très en amont, l’impact qu’a pu avoir King Kong Théorie de Virginie Despentes. Décédée en 1994 du sida, elle est un personnage clé quoique méconnu de notre patrimoine littéraire et artistique mondial. La littérature québécoise a longtemps été snobée par la France, toujours moqueuse vis-à-vis du français d’outre hexagone. Elle mérite pourtant clairement d’être redécouverte tant, à l’image de l’œuvre de Josée Yvon, elle recèle une vitalité et une liberté qui fait souvent clairement défaut à notre scène littéraire locale. Un auteur comme Kevin Lambert, un de ses fils putatifs, est actif, vivant et passionnant. Ne passez pas à côté.
N.B. : La Femme la plus dangereuse du Québec est le nom d’une pièce de théâtre créée en 2017 à partir de textes de Josée Yvon et Denis Vanier.
En France, le Nouvel Attila a réédité certains des textes de Josée Yvon dans Filles-commandos bandées sous le label Othello.
Cet article Josée Yvon: la femme la plus dangereuse du Québec provient de Manifesto XXI.


Certain·e·x·s ont quitté l’école avec grand soulagement, alors que d’autres ont choisi d’en faire leur métier. Nous avons rencontré cinq enseignant·e·s LGBTIQ+ qui nous content avec lucidité leur quotidien dans des institutions pas toujours accueillantes. La cloche a sonné, mettez-vous en rang, on retourne en classe.
L’article Profs LGBTIQ+, à l’école de la visibilité est apparu en premier sur 360°.


Certain·e·x·s ont quitté l’école avec grand soulagement, alors que d’autres ont choisi d’en faire leur métier. Nous avons rencontré cinq enseignant·e·s LGBTIQ+ qui nous content avec lucidité leur quotidien dans des institutions pas toujours accueillantes. La cloche a sonné, mettez-vous en rang, on retourne en classe.
L’article Profs LGBTIQ+, à l’école de la visibilité est apparu en premier sur 360°.

Après à une défaite (2-0) de l’OM à Londres contre Tottenham, des supporteurs marseillais ont arraché une banderole arc-en-ciel, symbole de fraternité et d’inclusion pour les personnes LGBT+.
L’article Football : Une banderole arc-en-ciel arrachée par des supporteurs marseillais à Tottenham est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.

Le plaignant, âgé de 52 ans, avait été systématiquement exclu du don après avoir refusé d’indiquer son orientation sexuelle une première fois en 2004.
L’article La France condamnée par la CEDH pour avoir fiché un homosexuel supposé, candidat au don du sang est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.

Cet article WeToo festival : comment réconcilier féminisme et famille ? provient de Manifesto XXI.
Du 9 au 11 septembre, le WeToo festival s’installe à la Cité Fertile (Pantin), pour un week end festif et politique autour des thèmes du féminisme et de la famille. Un festival multidisciplinaire à destination de tous les âges.Porté par la compagnie Mi-Fugue Mi-Raison, le WeToo festival prend forme pour la troisième année consécutive, pour tenter de réconcilier les notions de féminisme et de famille, autour de spectacles, tables rondes ou ateliers. En effet, pour les organisatrices, la famille représente le catalyseur de l’idéologie patriarcale et hétéronormée sur laquelle notre société repose. Questionner cet espace intime et politique collectivement à travers une programmation multidisciplinaire et immersive, permettrait de mettre à mal les tabous et schémas inégalitaires de l’intérieur… Tout en rendant les plus jeunes actif·ves dans les débats.
 De gauche à droite : Del Kilhoffer, Cécile Martin, Caroline Sahuquet et Sephora Haymann © Sophie Zamora
De gauche à droite : Del Kilhoffer, Cécile Martin, Caroline Sahuquet et Sephora Haymann © Sophie Zamora
Pour engager cette réflexion collective, le WeToo festival fait appel à des artistes mais aussi des journalistes et militant·es dont le discours politique et artistique tend à rebattre les cartes. Comme par exemple l’autrice et journaliste Elise Thiébaut, Tal Madesta, journaliste et militant transfeministe, ou encore Lénaïg Bredoux, responsable éditoriale des questions de genre chez Mediapart, également invitée pour une table ronde. À l’affiche on trouve du théâtre, de la danse, de la musique, des ateliers, des tables rondes, mais aussi des DJ sets, le tout porté par un discours féministe intersectionnel. Dans chacune des propositions et dans l’organisation globale de l’événement, tout est pensé pour que l’accès soit possible en famille, à des prix abordables et équitables. Une garde d’enfant gratuite sera proposée sur place et sur présentation d’un billet, pour que les parents puissent assister aux représentations l’esprit tranquille. L’accès au site ainsi qu’à certaines performances et tables rondes sera gratuit et une tarification responsable sera proposée pour le reste des festivités.
Aussi, une attention particulière est accordée à créer une programmation à l’adresse des adolescent·es, génération souvent oubliée entre les spectacles pour enfants et ceux pour adultes, et pour laquelle les questions abordées sont cruciales.
Mais le WeToo a surtout à cœur de faire de ces moments de réflexion des instants joyeux. La sororité et la prise de conscience de sa propre valeur sont de mises pour que chacun·e y trouve un accomplissement personnel et termine le festival non pas miné·e par le chemin qu’il reste à parcourir mais heureux·se d’y avoir trouvé des complices, des amies, du réconfort.
Pour voir la programmation complète et réserver vos places, c’est par ici.
Image à la Une : Boulevard du Queer © Pauline Le Goff
Cet article WeToo festival : comment réconcilier féminisme et famille ? provient de Manifesto XXI.

Cet article WeToo festival : comment réconcilier féminisme et famille ? provient de Manifesto XXI.
Du 9 au 11 septembre, le WeToo festival s’installe à la Cité Fertile (Pantin), pour un week end festif et politique autour des thèmes du féminisme et de la famille. Un festival multidisciplinaire à destination de tous les âges.Porté par la compagnie Mi-Fugue Mi-Raison, le WeToo festival prend forme pour la troisième année consécutive, pour tenter de réconcilier les notions de féminisme et de famille, autour de spectacles, tables rondes ou ateliers. En effet, pour les organisatrices, la famille représente le catalyseur de l’idéologie patriarcale et hétéronormée sur laquelle notre société repose. Questionner cet espace intime et politique collectivement à travers une programmation multidisciplinaire et immersive, permettrait de mettre à mal les tabous et schémas inégalitaires de l’intérieur… Tout en rendant les plus jeunes actif·ves dans les débats.
 De gauche à droite : Del Kilhoffer, Cécile Martin, Caroline Sahuquet et Sephora Haymann © Sophie Zamora
De gauche à droite : Del Kilhoffer, Cécile Martin, Caroline Sahuquet et Sephora Haymann © Sophie Zamora
Pour engager cette réflexion collective, le WeToo festival fait appel à des artistes mais aussi des journalistes et militant.es dont le discours politique et artistique tend à rebattre les cartes. Comme par exemple l’autrice et journaliste Elise Thiébaut, Tal Madesta, journaliste et militant transfeministe, ou encore Lénaïg Bredoux, responsable éditoriale des questions de genre de Mediapart, également invitée pour une table ronde. À l’affiche on trouve du théâtre, de la danse, de la musique, des ateliers, des tables rondes, mais aussi des DJ sets, le tout porté par un discours féministe intersectionnel. Dans chacune des propositions et dans l’organisation globale de l’événement, tout est pensé pour que l’accès soit possible en famille, à des prix abordables et équitables. Une garde d’enfant gratuite sera proposée sur place et sur présentation d’un billet, pour que les parents puissent assister aux représentations l’esprit tranquille. L’accès au site ainsi qu’à certaines performances et tables rondes sera gratuit et une tarification responsable sera proposée pour le reste des festivités.
Aussi, une attention particulière est accordée à créer une programmation à l’adresse des adolescent.es, génération souvent oubliée entre les spectacles pour enfants et ceux pour adultes, et pour laquelle les questions abordées sont cruciales.
Mais le WeToo a surtout à cœur de faire de ces moments de réflexion des instants joyeux. La sororité et la prise de conscience de sa propre valeur sont de mises pour que chacun·e y trouve un accomplissement personnel et termine le festival non pas miné·e par le chemin qu’il reste à parcourir mais heureux·se d’y avoir trouvé des complices, des amies, du réconfort.
Pour voir la programmation complète et réserver vos places, c’est par ici.
Image à la Une : Boulevard du Queer © Pauline Le Goff
Cet article WeToo festival : comment réconcilier féminisme et famille ? provient de Manifesto XXI.



Prise dans une tension entre réalité épidémiologique et risque de stigmatisation de la communauté gaie, l'information autour du monkeypox (variole du singe) patine… au risque de perdre de vue ses cibles
L’article Monkeypox: l’information au risque de la stigmatisation est apparu en premier sur 360°.

Cet article Lisa Mandel, une éditrice exemplaire provient de Manifesto XXI.
Son dernier livre, Se rétablir, met en lumière les rétablis de la santé mentale : une BD brillante que Lisa Mandel a édité via sa propre maison, Exemplaire. Elle nous a raconté cette aventure littéraire mais aussi sociale et politique.En vingt ans de BD, Lisa Mandel a eu le temps de s’attaquer à pas mal de terrains : l’hôpital psychiatrique, la jungle de Calais, le cinéma porno… Elle n’a pas non plus hésité à secouer son propre milieu en co-fondant un collectif contre le sexisme en bande dessinée. Enfin, en 2020 elle a créé sa propre maison d’édition, Exemplaire, pour donner plus de moyens et de reconnaissance aux auteur·ices. Sortie en mai, sa dernière publication, Se rétablir, part à la rencontre de celles et ceux qui ont réussi à surmonter des maladies psychiques : nous sommes revenues avec elle sur cette dernière sortie et sur sa nouvelle aventure éditoriale.
Manifesto XXI – Se rétablir traite de santé mentale, un sujet de plus en plus présent en BD ces dernières années. Qu’est-ce qui vous a poussée à vous attaquer à cette thématique du rétablissement ?
Lisa Mandel : Le sujet de la santé mentale est peu à peu déstigmatisé, et c’est tant mieux car on en a très peu parlé pendant tellement de temps ! J’ai commencé à m’y attaquer avec ma BD HP : à l’époque, j’ai fait ce livre car mes parents étaient infirmiers en psychiatrie et j’avais plusieurs proches concernés par les maladies psychiques.
Ce livre a eu un certain succès chez les professionnels. J’ai été approchée par un médecin qui dirigeait un lieu axé sur le rétablissement : au départ je devais faire une BD qui suivait ce lieu, mais l’établissement a dû changer de projet en cours de route… J’ai fait une grosse pause de plusieurs années et j’ai décidé de reprendre le projet en suivant le parcours individuel de personnes rétablies, ou en cours de rétablissement.
Rentrer dans ce milieu du rétablissement m’a fait découvrir un autre monde… Cela m’a fait beaucoup de bien à titre personnel. C’est un message d’espoir car en santé mentale, un diagnostic est souvent une condamnation qui efface la personne derrière. Alors que si on regarde les études, deux tiers des personnes qui ont eu des troubles psychiatriques se rétablissent et mènent une vie « normale » ! Mais ces personnes sont peu à évoquer leurs troubles de manière publique car c’est encore tabou… On m’a reproché de regarder par le petit bout de la lorgnette en parlant des personnes rétablies, alors qu’en fait, je parle de la majorité des gens !
Le cinéma fait ses choux gras des psychopathes dangereux et fait croire que les gens sont fous tout le temps… Mais, par exemple, en dehors des crises, une personne psychotique va agir normalement 90 % de son temps ! C’est aussi ça le but d’un rétablissement : reprendre le pouvoir sur sa maladie, la comprendre, l’accepter et apprendre à vivre avec au quotidien. Une survivante de la psychiatrie m’a dit : « Quand on ne fait plus qu’un avec sa maladie, il n’y a plus personne à guérir. » Je pense que plus on va traiter les maladies psychiques comme les autres maladies chroniques, plus on va les dédramatiser et plus on va aider des gens à se soigner.
 Se rétablir
Se rétablir
Vous avez édité ce livre via votre propre maison d’édition. Quel est le constat qui vous a amenée à vous éditer par vous-même ?
Je suis dans la bande dessinée depuis vingt ans maintenant et jusqu’alors j’avais toujours été chez des gros éditeurs. J’ai assisté en direct à la paupérisation du métier. Quand j’ai débuté, on fonctionnait encore sur le mode classique de l’album de 46 pages payé 300 euros la page environ.
Mais deux gros facteurs ont tout bousculé : le délitement de la presse et le développement du roman graphique. La pré-publication de BD dans la presse était une source de revenus pour les auteurs, qui s’est tarie. Le roman graphique a certes donné ses lettres de noblesse à la BD en lui donnant une liberté de ton et une image plus adulte, mais la rémunération est passée d’une rémunération à la page à une rémunération forfaitaire, c’est-à-dire au livre.
C’est comme cela que l’on passe d’une rémunération de 10-15 000 euros pour 46 pages à la même chose mais pour 200 pages. À cela s’ajoute la multiplication des publications par les éditeur·ices : le volume de sorties a été multiplié par 10 en vingt ans, mais le pouvoir d’achat des lecteurices n’a pas forcément suivi. Les éditeur·ices ont lancé plein de nouveaux auteurs et autrices mais iels n’ont pas toustes trouvé un public. Vendre 20 000 exemplaires était une déception dans les années 80, vendre 5000 exemplaires est considéré comme un bon score aujourd’hui.
En revanche, la répartition des droits entre 8% et 10% du prix de vente n’a pas bougé. Mais comme les ventes sont beaucoup plus faibles, c’est mécanique : les auteur·ices gagnent beaucoup moins bien leur vie. Cette situation est déjà scandaleuse mais en plus, les éditeur·ices forcent souvent la main aux auteur·ices pour céder les droits audiovisuels des œuvres, autre source de revenu potentielle.
On s’adresse à des auteurices qui ont déjà un public sur internet qui méritent de le faire fructifier.
Lisa Mandel
Et comment avez-vous pu lancer cette maison d’édition ?
Forte de ce constat, j’ai essayé de m’auto-éditer pour ma BD Une année exemplaire. Je suis ce que l’on pourrait appeler une autrice « middle class » : je vends correctement mais je ne suis pas une star et j’avais l’impression que mon éditeur ne faisait pas beaucoup d’efforts pour me soutenir.
On m’a pas mal alertée en me disant que je serais noyée sous le boulot en m’auto-éditant, et j’ai donc monté une équipe. J’ai payé une correctrice, une graphiste, un ami m’a aidée pour le suivi de fabrication, ma sœur pour la mise en place du Ulule… C’est là que j’ai réalisé que le terme « auto-édition » n’était pas correct : je n’aurais pas réussi à faire un livre de cette qualité seule. J’ai gagné 5 fois plus que ce que j’aurais gagné chez un éditeur en vendant autant de livres, j’ai eu beaucoup de presse et j’ai été sélectionnée à Angoulême.
J’aurais pu continuer comme ça mais je crois beaucoup au collectif… Le coup de chance a été la rencontre avec mon voisin ingénieur informatique pendant le confinement : c’est lui qui a créé la plateforme de crowdfunding qui est à la base de la maison d’édition. J’ai monté une première équipe de 10 auteur·ices prêt·es à me suivre et ensemble on a récolté les 100 000 euros nécessaires pour lancer la boîte.

Comment la maison fonctionne-t-elle à l’heure actuelle ?
Le credo de la maison c’est la transparence totale. Tout le monde est payé au pourcentage, personne n’est salarié. L’auteur·ice touche entre 40 et 50% de droits. On propose à l’auteur·ice d’ajuster le pourcentage en fonction de prestations désirées comme la présentation en salons par exemple. L’auteur·rice ne cède ses droits que pour deux ans et ne cède que les droits du livre en français. Iel peut donc vendre ses droits à l’étranger, faire des produits dérivés, publier des strips dans un magazine ou vendre les droits d’adaptation comme iel le souhaite.
Nous n’avons pas de réseau de distribution en librairie et nous pratiquons la vente ferme : les libraires ne peuvent pas nous retourner les invendus. La vente en librairie est donc encore assez modeste mais ce n’est pas notre source principale de revenus. Nous sommes tout à fait pour travailler avec les librairies mais l’auteur·ice doit rester au cœur du processus. On lui demande une seule chose mais on lui demande de le faire bien : c’est la promo du crowdfunding en ligne. On a mis en place un système de coaching pour que les auteur·ices aguerri·es aident les débutant·es sur ce point contre un pourcentage sur la vente du premier titre. On part du principe que l’auteur·ice est polyvalent·e aujourd’hui et assure souvent sa propre promo sur les réseaux : on préfère que ce travail bénéficie à un·e auteur·ice et pas à une maison d’édition. On s’adresse à des auteur·ices qui ont déjà un public sur internet qui méritent de le faire fructifier.
Les auteurs de BD ne sont pas vraiment de grands rebelles de nature, il a vraiment fallu descendre au fond du trou pour que l’on se rebiffe et que la situation évolue.
Lisa Mandel
N’avez-vous pas peur d’être justement de trop dépendre des réseaux sociaux ?
Si, bien sûr. Aujourd’hui à Exemplaire, on ne peut pas lancer des auteur·ices sans présence en ligne et qui n’ont pas de fanbase prête à les suivre. Cela nous a permis de lancer plein de jeunes auteur·rices. On est prêt à aider ceux qui ne sont pas forcément à l’aise au départ avec les réseaux sociaux mais un·e auteur·ice qui serait absolument anti internet sera mieux chez un·e éditeur·ice traditionnel·le.
Nous assumons de ne pas pouvoir accueillir tout le monde : nous sommes déjà à deux crowdfundings par mois et 20 titres lancés, ce qui est énorme, nous ne voulons pas non plus participer à la saturation du marché. Mais la dépendance aux GAFA est clairement notre limite : nous n’avons pas quitté les gros éditeurs pour devenir dépendant·es de multinationales. Cela nous rend aussi vulnérables à la censure des réseaux, comme tous·tes les autres créateur·ices. Par exemple, un de nos auteur·ices, Petit Pied, a été shadow banned et nous n’avons aucune idée de pourquoi. Mon propre compte a été piraté et certains ont perdu leurs comptes définitivement avec les followers qui allaient avec… Nous réfléchissons à créer notre propre plateforme pour devenir indépendant, mais c’est un énorme projet en soi.
La situation des auteur·ices a-t-elle évolué depuis le lancement des Editions Exemplaire ?
On fait partie d’un mouvement global de mobilisation : plusieurs syndicats se sont montés, des chartes ont été établies pour mieux assurer la rémunération de certaines prestations, comme l’intervention en milieu scolaire. Les salons se sont alignés et désormais la plupart d’entre eux paient les interventions, ce qui ne se faisait pas du tout avant. J’ai remarqué que les avances sur droits remontent également, par rapport à une époque où on était descendu à près de 2000 euros d’avance.
Je ne crois pas que Exemplaire a tout changé à lui tout seul : on a ouvert une porte qui sert à certains types d’auteur·ices. Je serais pour adopter un système similaire à la Belgique, un statut d’intermittent pour les auteur·ices qui assure la rémunération entre les projets et nous sorte de la précarité. Les auteurs de BD ne sont pas vraiment de grands rebelles de nature, il a vraiment fallu descendre au fond du trou pour que l’on se rebiffe et que la situation évolue.
Se rétablir est disponible à la vente sur le site des Editions Exemplaire : n’hésitez pas à parcourir le catalogue pour découvrir de jeunes auteur·ices comme Caroline Nasica ou Tamos Le Thermos, ou des valeurs sûres comme Berberian ou Boulet. Et gardez un œil sur les nouveaux projets : votre artiste chouchou d’Instagram sera peut être le ou la prochain·e à être financé·e !
Cet article Lisa Mandel, une éditrice exemplaire provient de Manifesto XXI.

Cet article Lisa Mandel, une éditrice exemplaire provient de Manifesto XXI.
Son dernier livre, Se Rétablir, met en lumière les rétablis de la santé mentale : une BD brillante que Lisa Mandel a édité via sa propre maison, Exemplaire. Elle nous a raconté cette aventure littéraire mais aussi sociale et politique.En 20 ans de BD, Lisa Mandel a eu le temps de s’attaquer à pas mal de terrains : l’hôpital psychiatrique, la jungle de Calais, le cinéma porno… Elle n’a pas non plus hésité à secouer son propre milieu en co-fondant un collectif contre le sexisme en bande dessinée. Enfin, en 2020 elle a créé sa propre maison d’édition, les Editions Exemplaire, pour donner plus de moyens et de reconnaissance aux auteur·ices. Sortie en mai, sa dernière publication, Se Rétablir, part à la rencontre de celles et ceux qui ont réussi à surmonter des maladies psychiques : nous sommes revenues avec elle sur cette dernière sortie et sur sa nouvelle aventure éditoriale.
Manifesto XXI – Se rétablir traite de santé mentale, un sujet de plus en plus présent en BD ces dernières années. Qu’est-ce qui vous a poussé à vous attaquer à cette thématique du rétablissement ?
Lisa Mandel : Le sujet de la santé mentale se déstigmatise, et c’est tant mieux car on en a très peu parlé pendant tellement de temps ! J’ai commencé à m’y attaquer avec ma BD HP : à l’époque, j’ai fait ce livre car mes parents étaient infirmiers en psychiatrie et j’avais plusieurs proches concernés par les maladies psychiques.
Ce livre a eu un certain succès chez les professionnels. J’ai été approchée par un médecin qui dirigeait un lieu axé sur le rétablissement : au départ je devais faire une BD qui suivait ce lieu, mais l’établissement a dû changer de projet en cours de route… J’ai fait une grosse pause de plusieurs années et j’ai décidé de reprendre le projet en suivant le parcours individuel de personnes rétablies, ou en cours de rétablissement.
Rentrer dans ce milieu du rétablissement m’a fait découvrir un autre monde… Cela m’a fait beaucoup de bien à titre personnel. C’est un message d’espoir car en santé mentale, un diagnostic est souvent une condamnation qui efface la personne derrière. Alors que si on regarde les études, deux tiers des personnes qui ont eu des troubles psychiatriques se rétablissent et mènent une vie «normale» ! Mais ces personnes sont peu à évoquer leurs troubles de manière publique car c’est encore tabou… On m’a reproché de regarder par le petit bout de la lorgnette en parlant des personnes rétablies, alors qu’en fait, je parle de la majorité des gens !
Le cinéma fait ses choux gras des psychopathes dangereux et fait croire que les gens sont fous tout le temps… Mais, par exemple, en-dehors des crises, une personne psychotique va agir normalement 90 % de son temps ! C’est aussi ça le but d’un rétablissement : reprendre le pouvoir sur sa maladie, la comprendre, l’accepter et apprendre à vivre avec au quotidien.
Une survivante de la psychiatrie m’a dit : « Quand on ne fait plus qu’un avec sa maladie, il n’y a plus personne à guérir. » Je pense que plus on va traiter les maladies psychiques comme les autres maladies chroniques, plus on va dédramatiser et plus on va aider des gens à se soigner.
 Se rétablir
Se rétablir
Vous avez édité ce livre via votre propre maison d’édition. Quel est le constat qui vous a poussé à vous éditer par vous-même ?
Je suis dans la bande dessinée depuis 20 ans maintenant et jusqu’alors j’avais toujours été chez des gros éditeurs. J’ai assisté en direct à la paupérisation du métier. Quand j’ai débuté, on fonctionnait encore sur le mode classique de l’album de 46 pages payé 300 euros la page environ.
Mais deux gros facteurs ont tout bousculé : le délitement de la presse et le développement du roman graphique. La pré-publication de BD dans la presse était une source de revenus pour les auteurs, qui s’est tarie. Le roman graphique a certes donné ses lettres de noblesse à la BD en lui donnant une liberté de ton et une image plus adulte, mais la rémunération est passée d’une rémunération à la page à une rémunération forfaitaire, c’est-à-dire au livre.
C’est comme cela que l’on passe d’une rémunération de 10-15 000 euros pour 46 pages à la même chose mais pour 200 pages. A cela s’ajoute la multiplication des publications par les éditeur·trices : le volume de sorties a été multiplié par 10 en 20 ans, mais le pouvoir d’achat des lecteurices n’a pas forcément suivi. Les éditeur·trices ont lancé plein de nouveaux auteurs et autrices mais iels n’ont pas toustes trouvé un public. Vendre 20 000 exemplaires était une déception dans les années 80, vendre 5 000 exemplaires est considéré comme un bon score aujourd’hui.
En revanche, la répartition des droits entre 8% et 10% du prix de vente, n’a pas bougé. Mais comme les ventes sont beaucoup plus faibles, c’est mécanique : les auteu·rices gagnent beaucoup moins bien leur vie. Cette situation est déjà scandaleuse mais en plus, les éditeur·rices forcent souvent la main aux auteurs pour céder les droits audiovisuels des œuvres, autre source de revenu potentielle.
On s’adresse à des auteurs qui ont déjà un public sur internet qui méritent de le faire fructifier.
Lisa Mandel
Et comment avez-vous pu lancer cette maison d’édition ?
Forte de ce constat, j’ai essayé de m’auto-éditer pour ma BD Une année exemplaire. Je suis ce que l’on pourrait appeler une autrice « middle class » : je vends correctement mais je ne suis pas une star et j’avais l’impression que mon éditeur ne faisait pas beaucoup d’efforts pour me soutenir.
On m’a pas mal alertée en me disant que je serais noyée sous le boulot en m’auto-éditant, et j’ai donc monté une équipe. J’ai payé une correctrice, une graphiste, un ami m’a aidé pour le suivi de fabrication, ma sœur pour la mise en place du Ulule… C’est là que j’ai réalisé que le terme « auto-édition » n’était pas correct : je n’aurais pas réussi à faire un livre de cette qualité seule. J’ai gagné 5 fois plus que ce que j’aurais gagné chez un éditeur en vendant autant de livres, j’ai eu beaucoup de presse et j’ai été sélectionnée à Angoulême.
J’aurais pu continuer comme ça mais je crois beaucoup au collectif… Le coup de chance a été la rencontre avec mon voisin ingénieur informatique pendant le confinement : c’est lui qui a créé la plateforme de crowdfunding qui est à la base de la maison d’édition. J’ai monté une première équipe de 10 auteur·ices prêts à me suivre et ensemble on a récolté les 100 000 euros nécessaires pour lancer la boîte.

Comment la maison fonctionne-t-elle à l’heure actuelle ?
Le credo de la maison c’est la transparence totale. Tout le monde est payé au pourcentage, personne n’est salarié. L’auteur·ice touche entre 40 et 50% de droits. On propose à l’auteur·rice d’ajuster le pourcentage en fonction de prestations désirées comme la présentation en salons par exemple. L’auteur·rice ne cède ses droits que pour deux ans et ne cède que les droits du livre en français. Iel peut donc vendre ses droits à l’étranger, faire des produits dérivés, publier des strips dans un magazine ou vendre les droits d’adaptation comme iel le souhaite.
Nous n’avons pas de réseau de distribution en librairie et nous pratiquons la vente ferme : les libraires ne peuvent pas nous retourner les invendus. La vente en librairie est donc encore assez modeste mais ce n’est pas notre source principale de revenus. Nous sommes tout à fait pour travailler avec les librairies mais l’auteur doit rester au cœur du processus. On lui demande une seule chose mais on lui demande de le faire bien : c’est la promo du crowdfunding en ligne. On a mis en place un système de coaching pour que les auteurs aguerris aident les débutant·es sur ce point contre un pourcentage sur la vente du premier titre. On part du principe que l’auteur·ice est polyvalent·e aujourd’hui et assure souvent sa propre promo sur les réseaux : on préfère que ce travail bénéficie à un· auteur·ice et pas à une maison d’édition. On s’adresse à des auteurs qui ont déjà un public sur internet qui méritent de le faire fructifier.
Les auteurs de BD ne sont pas vraiment de grands rebelles de nature, il a vraiment fallu descendre au fond du trou pour que l’on se rebiffe et que la situation évolue.
Lisa Mandel
N’avez-vous pas peur d’être justement trop dépendants des réseaux sociaux ?
Si bien sûr. Aujourd’hui à Exemplaire, on ne peut pas lancer des auteu·rices sans présence en ligne et qui n’ont pas de fan base prête à les suivre. Cela nous a permis de lancer plein de jeunes auteur·trices. On est prêt à aider ceux qui ne sont pas forcément à l’aise au départ avec les réseaux sociaux mais un auteur qui serait absolument anti internet sera mieux chez un éditeur traditionnel.
Nous assumons de ne pas pouvoir accueillir tout le monde : nous sommes déjà à deux crowdfunding par mois et 20 titres lancés ce qui est énorme, nous ne voulons pas non plus participer à la saturation du marché. Mais la dépendance aux GAFA est clairement notre limite : nous n’avons pas quitté les gros éditeurs pour devenir dépendants de multinationales. Cela nous rend aussi vulnérables à la censure des réseaux, comme tous les autres créateurs. Par exemple, un de nos auteur Petit Pied a été shadowban et nous n’avons aucune idée de pourquoi. Mon propre compte a été piraté et certains ont perdu leurs comptes définitivement avec les followers qui allaient avec…
Nous réfléchissons à créer notre propre plateforme pour devenir indépendant, mais c’est un énorme projet en soi.
La situation des auteur·rices a-t-elle évolué depuis le lancement des Editions Exemplaires ?
On fait partie d’un mouvement global de mobilisation : plusieurs syndicats se sont montés, des chartes ont été établies pour mieux assurer la rémunération de certaines prestations, comme l’intervention en milieu scolaire. Les salons se sont alignés et désormais la plupart paient les interventions, ce qui ne se faisait pas du tout avant.
J’ai remarqué que les avances sur droits remontent également, par rapport à une époque où on était descendus à du 2000 euros d’avance.
Je ne crois pas que Exemplaire a tout changé à lui tout seul : on a ouvert une porte qui sert à certains types d’auteurs. Je serais pour adopter un système similaire à la Belgique, un statut d’intermittent pour les auteurs qui assure la rémunération entre les projets et nous sorte de la précarité.
Les auteurs de BD ne sont pas vraiment de grands rebelles de nature, il a vraiment fallu descendre au fond du trou pour que l’on se rebiffe et que la situation évolue.
Se Rétablir est disponible à la vente sur le site des Editions Exemplaire : n’hésitez pas à parcourir le catalogue pour découvrir de jeunes auteur·trices comme Caroline Nasica ou Tamos Le Thermos, ou des valeurs sûres comme Berberian ou Boulet. Et gardez un œil sur les nouveaux projets : votre artiste chouchou d’Instagram sera peut être le ou la prochain·e à être financé·e !
Cet article Lisa Mandel, une éditrice exemplaire provient de Manifesto XXI.

Cet article Le festival Jerk Off fête ses 15 ans avec une prog toujours aussi défricheuse provient de Manifesto XXI.
Le festival Jerk Off revient pour agiter les rues parisiennes du 14 au 29 septembre, à l’occasion de sa 15ème édition. Érigeant l’émergence en tête d’affiche, le programme des festivités nous aide à accueillir la rentrée avec douceur.Par ses lieux, ses disciplines et ses publics, le Jerk Off est un événement multiple. Chaque année, ce rendez-vous culturel qui fête sa quinzaine investit des salles de spectacle et propose un panel de performances, spectacles de danse ou de théâtre, DJ sets, concerts, expositions… L’importance portée à la diversité des parcours et des discours donne à ce line-up sa cohérence en même temps qu’une très belle singularité, l’œil toujours braqué sur l’émergence artistique.
Pour cette édition, le Point Ephémère se fait le principal hôte des hostilités. On y retrouvera Warm Inside, une exposition photo de Romy Alizée du 15 au 27 septembre (entrée libre). Côté performance, on y verra Audrey Liebot les mercredi 21 et jeudi 22, pour on se connaît de la nuit, une création qui tangue entre poésie, danse et installation plastique pour aborder le sujet du VIH-sida. Dans Mon Dessin du Collectif Offense prendra la suite et nous présentera Jenny Charreton, musicienne, régisseuse et performeuse, venue nous raconter sa réalité de femme trans, le vendredi 23. Enfin, le mardi 27, Alice et Adrien Martins présenteront une étape de travail de leur performance Echoes’ Fantasy – extended. Ce duo de frère et sœur s’intéresse à la relation que l’on entretient avec les objets qui nous entourent au quotidien.
 Dans Mon Dessin © Maxime Grimardias
Dans Mon Dessin © Maxime Grimardias
Les Laboratoires d’Aubervilliers, eux, accueilleront deux spectacles de danse le samedi 24, Dos et Nirvana, tous deux chorégraphiés et interprétés par le collectif Delgado Fuchs et qui mettent en scène les rapports entre les corps. La Compagnie FluO présentera également un spectacle de danse, Every Drop of my blood le mercredi 14 au Micadanses, accompagnée d’une installation plastique et de musique live. Cuir, une création circassienne centrée sur des portés acrobatiques, partagera l’affiche de cette soirée d’ouverture. Le cinéma aura également le droit à sa part avec la projection de trois courts-métrages pornographiques du collectif La Branlée, le vendredi 16 septembre à L’Archipel.
Deux courts métrages seront également projetés lors d’une soirée organisée à la Mairie du 10ème arrondissement. Le premier, To Da Bone, plonge dans la création du spectacle éponyme pour lequel (LA)HORDE, troupe du ballet national de Marseille, a invité des danseuses et danseurs de jumpstyle – style de danse qui se pratique « dans une chambre ou dans la rue » et que l’on retrouve majoritairement sur internet – à passer sur un plateau. Le second, Tephra, interroge la mythologie contemporaine du volcan, incarnée par « un corps collectif féminin ». Les projections seront suivies d’un talk : « Masculinités queer, Penser les masculinités entre intime et politique »
Enfin le Jerk Off s’attèle cette année à nous faire danser avec une série de soirées organisées au Klub. Sont annoncés des DJ sets, concerts et performance selon le programme du jour et les collectifs invités. Le festival baissera le rideau sur une soirée de clôture À la Folie. Cette dernière déroule un programme aussi chargé qu’excitant, s’ouvrant sur une performance de Matthieu Neto axée sur « la charge sensuelle et érotique du mouvement ». S’en suivra un concert chorégraphié de Roméo Agid avant que le collectif les inapproprié•es n’offrent une conférence performée, Queer As Us puis d’enchainer sur des DJ sets.
Pour consulter la programmation complète et réserver vos places, c’est par ici !
Image de couverture : Echoes’ Fantasy extended © Marco Pavone
Cet article Le festival Jerk Off fête ses 15 ans avec une prog toujours aussi défricheuse provient de Manifesto XXI.




Chaque mois, Payot Libraire nous propose une sélection littéraire queer. Au programme pour ce numéro, trois coups de cœur de la rentrée.
L’article La sélection littéraire de la rentrée est apparu en premier sur 360°.

Zahra Sediqi Hamadani (dite « Sareh »), 31 ans, et Elham Chubdar, 24 ans, militantes Kurdes pour la cause LGBT+, viennent d’être condamnées à la peine capitale par le tribunal révolutionnaire d’Ourmia, dans le nord-ouest de l’Iran. Une bien mauvaise « première ». Les deux femmes sont accusées de « corruption sur terre en promouvant …
L’article En Iran, deux militantes LGBT+ condamnées à mort pour « promotion de l’homosexualité » est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.


Pour garder les pieds sur terre, rien ne vaut un plongeon la tête dans les étoiles. Ce mois, le signe à l’honneur est à la Vierge.
L’article Attraction des astres, l’horoscope de septembre est apparu en premier sur 360°.

Plongé dans le coma, le jeune homme de 25 ans est décédé des suites de ses blessures.
L’article Allemagne : un jeune homme trans est décédé après une agression en marge de la Pride de Münster est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.

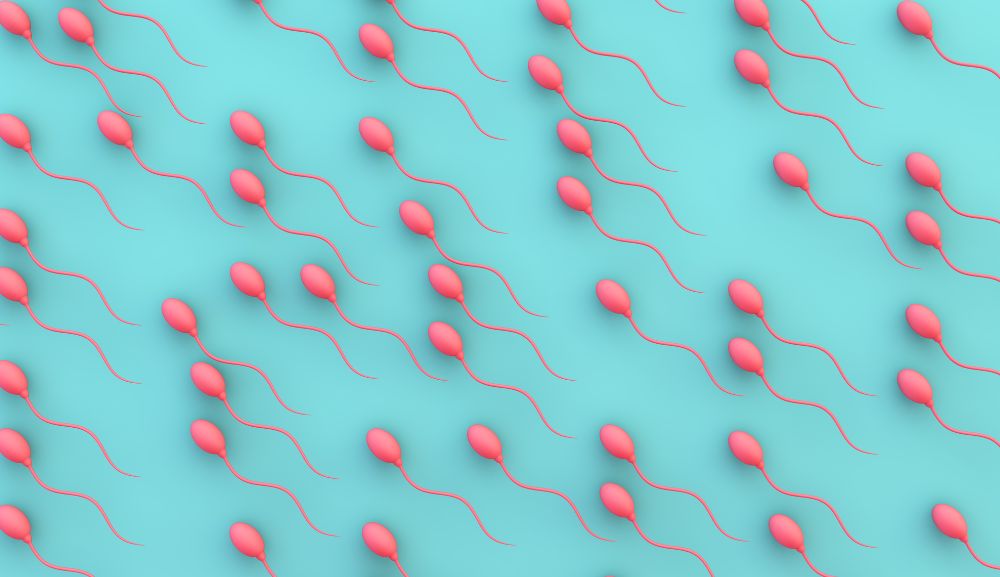
Alors que le mariage pour tous·tes·x est entré en vigueur le 1er juillet, la LOS dénonce la persistance d’une discrimination de poids envers les couples lesbiens.
L’article L’Organisation Suisse des lesbiennes (LOS) lance une pétition contre le non-remboursement de la PMA aux couples de femmes est apparu en premier sur 360°.



Hello les petits chats!
Pour les personnes qui ont passé l’été en digital detox, voici une petite séance des rattrapages lesbiche pour pouvoir briller en société à la rentrée.
L’article La mise à jour de rentrée de Vagin Pirate + la sélection de septembre est apparu en premier sur 360°.



Cet article Choose your fighter : Saku Sahara des kicks et des basses provient de Manifesto XXI.
Toutes les chapelles de la musique électronique se rencontrent à nouveau le 10 et 11 septembre pour la neuvième édition du Peacock Society au parc de Choisy. L’occasion pour Manifesto XXI d’aller à la rencontre de Saku Sahara, artiste spécialiste des esthétiques UK Bass, Jungle et Happy Hardcore. La DJ présente son univers à 160 BPM dans une mixtape survoltée spécialement concoctée pour l’occasion.Une énergie bouillonnante conjuguée à une maîtrise technique hors pair, Saku Sahara fait des platines la suite logique de la manette de gamer·euse. Graphiste et illustratrice à la ville, c’est pendant les week-ends que Saku Sahara sculpte une iconographie sonore digne d’un Battle of Rage sous acide. Elle puise ses inspirations dans les classiques rave UK des années 90/2000 comme chez ses modèles britanniques du moment : Sherelle et Samuraï Breaks. C’est en millénial avisée que Saku Sahara connaît ses premiers émois électroniques avec les productions gaming de Yuzo Koshiro et de Motohiro Kawashima. Son parcours de DJ, elle le débute à Lyon il y a seulement quatre ans avec l’organisation des soirées Kimochi Wave et ses premières dates au sein du duo Retro Futur. Aujourd’hui, la DJ – et nouvellement productrice – s’est imposée comme une pointure montante de la scène Bass et Breaks française.
À l’approche de son set sur la Mirror Stage du Peacock Society le 11 septembre prochain, Saku Sahara nous a accordé un entretien. L’occasion de faire un état des lieux sur son parcours, sur la place des esthétiques UK dans le paysage musical français ainsi que sur les avancées pour la visibilisation des artistes femmes sur les scènes électroniques. En prime, Saku Sahara met le spleen de la rentrée au placard avec une mixtape éclectique et percussive à (ré)écouter sur le soundcloud de Manifesto XXI. Rencontre avec cette diggeuse hors pair.
Manifesto XXI : Dans tes mix tu proposes un mélange de Breaks, UK Hardcore, Footwork, Bass Leftfield et Jungle. D’où tiens-tu ce goût pour la Rave UK ?
Saku Sahara : Je pense que ça vient de plusieurs choses. C’est d’abord le fruit d’une évolution musicale et artistique. Je pense qu’au début quand on apprend à mixer sur les platines des potes, on est influencé·es par ce qu’iels peuvent jouer. Je me rends compte qu’avec les années et l’entraînement assidu, j’ai pu vraiment me permettre de visiter la club culture UK même si ça sortait des sonorités plus classiques house ou techno. Le break et la scène UK, c’est aussi ce qui me donne le plus de plaisir à jouer, je m’amuse énormément sur scène. Puis c’est tout un panel d’émotions qui se relient aussi à des souvenirs de jeunesse. Je retrouve les sons des jeux vidéos auxquels j’ai joué, dans lesquels l’influence clubbing était déjà très présente. La rave UK c’est vraiment la rencontre entre ma jeunesse geek et ma passion pour le DJing.
Au-delà des inspirations UK, tu tiens le podcast « Conversations dans un Bento » consacré à la musique japonaise et aux Video Games Music. Comment fais-tu cohabiter ces différentes influences dans ton parcours artistique ?
La musique japonaise, je dirais que c’est quelque chose d’assez personnel et intime parce que ça s’inscrit dans mon quotidien. Je suis passionnée de nourriture japonaise, mais aussi de décoration et de toute l’imagerie nippone. J’aime bien pouvoir proposer une histoire avec ces sonorités-là, plutôt dans des rendez-vous radio ou mix sous format podcast. D’ailleurs, j’adore partir à la recherche des sons de jeux vidéos disparus. C’est quelque chose qui me passionne encore plus depuis ma rencontre avec Teki Latex. On a eu une sorte de coup de foudre amical et musical. La première fois qu’on s’est rencontré·es c’était autour d’un mix de musique japonaise chez Rinse. On ne s’était pas concerté·es avant sur ce qu’on allait jouer mais ça a matché du premier coup !
 Saku Sahara © Joan Baez
Saku Sahara © Joan Baez
Après, pour toutes mes influences UK, ça tabasse un peu plus (rires) ! Mais ça je l’exprime plus en club. Bien sûr, je fais quelques mix plutôt rave UK, mais c’est surtout pour montrer ce dont je suis capable en soirée. Les sonorités UK je les ai beaucoup entendues dans les jeux vidéos auxquels j’ai joué quand j’étais jeune : Tekken, GTA, Need for speed, etc… Il y en a tellement que je ne les ai pas tous en tête. Clairement ces jeux ont construit mes goûts et mon identité musicale actuelle. J’ai trouvé une citation dans un article de Vice récemment qui disait : « Si vous avez grandi en jouant à des jeux comme Zed Blade, Battle Garegga, Street of Rage, Wip3out, vous aviez déjà connu une expérience en boîte de nuit sauf que vous n’étiez pas assez vieux pour vous en rendre compte. ».
Tu sembles toujours à la recherche de la pépite sonore. Quelles sont tes influences musicales du moment ?
En ce moment, c’est vrai qu’il y a quatre artistes qui m’influencent particulièrement. La Dj et productrice Sherelle, c’est déjà une énorme source d’inspiration. Avec Naina, elle a monté le label Hooversound. Leur travail regroupe une génération de producteur·rices incroyables ! Sinon, j’écoute en boucle les sons du producteur anglais Samuraï Breaks. Puis en termes de production, le duo We Rob Rave c’est ma source d’inspiration par excellence. Tout ce que je rêverais de faire en musique, ils le font. D’ailleurs ils sont super accessibles donc on échange beaucoup sur les réseaux sociaux. Et si ça peut étonner parfois, la scène Drum et Rave italienne est très énervée, notamment le travail de l’artiste Neve.
Depuis tes premières scènes dans les clubs lyonnais, tu poursuis ton ascension sur la Mirror Stage du Peacock Society le dimanche 11 septembre prochain. Ça signifie quoi pour toi de jouer dans ce festival au line-up international ?
Je suis très honorée d’être invitée cette année. En tant que DJ émergente, j’ai tellement rêvé de jouer au Peacock ! Quand je fais le point, je suis déjà hyper contente d’être où je suis au bout de quatre ans. J’ai commencé le mix en 2018, avec la pandémie qui a débarqué en plein milieu de mes premières dates. Ce n’était pas facile, mais finalement, c’est une période qui m’a beaucoup apporté. Ça m’a permis de créer beaucoup de connexions avec d’autres artistes sur les réseaux. J’ai aussi fait plus de mix même si au bout d’un moment tout le monde était saoulé des streams (rires) ! C’est aussi la période de ma rencontre avec Teki Latex, enfin c’était énormément de positif au niveau artistique.
Qu’est-ce que ça représente de te produire aux côtés de Sherelle ?
Je suis super excitée de la revoir ! Je l’ai rencontrée pour la première fois aux Nuits Sonores quand j’y ai joué fin mai. Mon challenge c’était de me dire qu’il fallait absolument qu’elle reste pour mon set. Pour la petite anecdote, elle a adoré ce que j’ai fait et a envoyé des vidéos de mon set à Samuraï Breaks. J’étais hyper émue. On a dit qu’on resterait en contact à l’avenir et notamment pour des projets musicaux. C’était au-delà de mes espérances ! Des fois on se fait des films, puis on se dit que ça ne se passera jamais comme ça. Parce que c’est trop, parce que c’est irréalisable. Mais finalement ça arrive !
 Saku Sahara et Sherelle aux Nuits Sonores © Juliette Valero
Saku Sahara et Sherelle aux Nuits Sonores © Juliette Valero
Tu sembles aimer les défis artistiques…
Oui et le Peacock Society c’est un défi pour moi parce que je joue sur un horaire de début de soirée (rires) ! En général, je joue en peak time ou en closing. C’est aussi que ça correspond à mon genre musical. Là c’est un vrai challenge de passer tôt. Je vais tout faire pour amener ma patte sur un horaire un peu différent. D’ailleurs les défis sont hyper importants pour progresser dans mon parcours artistique. Je suis la reine de la liste (rires) ! Je liste les choses qui me portent, les rêves sur une année et j’essaye de me donner les moyens d’y arriver.
Tu te démarques des sonorités classiques House et Techno que l’on entend couramment dans les clubs français. Que penses-tu de la place faite aux esthétiques UK à Lyon et plus largement en France ?
Depuis un an ou deux, il y a une légère vague UK qui arrive sur la France avec notamment de plus en plus de personnes qui jouent du breakbeat. J’en entends un peu plus parler autour de moi, même si ça reste de niche. Sur la scène lyonnaise quand j’ai commencé à mixer du break, de la jungle ou du UK Hardcore, je connaissais très peu de personnes qui mixaient les mêmes choses. Je me suis rapidement dirigée autre part pour les soirées. J’ai été beaucoup sur Paris. Puis, pour mes premières dates je suis allée au Redlight à Amsterdam et à Radio Raheem à Milan.
Aujourd’hui, il y a encore un travail de promotion des esthétiques Drum ou Break à Lyon comme dans le reste de la France. Ça permettrait d’ouvrir le champ aux nouvelles propositions. Après des sets, ça m’est arrivé que des personnes me confient qu’elles ne savent pas ce que j’ai joué. Il y a même certaines personnes qui me confient qu’elles n’avaient jamais entendu ça avant. Mais je pense que ça change aussi avec le travail de certains collectifs comme la team Egregore à Toulouse. Puis un autre crew que je suis de près c’est [re]sources. Ils proposent de belles choses en termes de line-up.
« Drums Unity », ton premier morceau, est sorti le 10 juin dernier sur Quarantine Sonic Squad (QSS), une initiative en faveur de l’association Droit Au Logement créée par l’artiste Tim Karbon. Dans ce track, tu fais une place de choix aux sonorités Happy Hardcore, Jungle et Drum’n’bass. Comment s’est passée cette collaboration ?
Pour ce premier morceau, j’avais besoin de composer dans le genre dans lequel je suis la plus à l’aise. Je me suis inspirée du duo We Rob Rave et d’un morceau en particulier qui s’appelle « Exit ». En termes de musicalité, de structure, c’est un morceau que j’ai gardé en tant que fil conducteur. Après, ça faisait un moment que je voulais sortir un premier morceau. Je faisais des petites productions, des petits tests et je ne savais pas trop quoi en faire. Tout le processus était inconnu pour moi, notamment la recherche de label et la distribution. Mais j’ai eu de la chance ! J’ai contacté Tim Karbon qui cherchait des femmes productrices pour sa nouvelle compilation. Je savais qu’il faisait partie du label de Polaar, créé par l’artiste lyonnaise Flore. Bref c’était une ambiance familiale et puis la cause de l’association DAL me tient à cœur.
QSS VOL.3 "Salud Actions" by Saku SaharaTu es aussi cofondatrice du projet Unit-Sœurs aux côtés de Mensonges et de Maghdalene. C’est un collectif de visibilisation et d’entraide entre DJ et productrices femmes sur Lyon. De quel constat est partie cette initiative ?
C’est parti d’un énième projet que j’avais vu passer sur les réseaux. Il présentait les protagonistes de la scène lyonnaise avec une quinzaine de mix présentés et uniquement des DJs hommes dans la liste. Ça m’a fait grincer des dents qu’en 2021 ce genre de projets ne choque personne. J’ai directement partagé ça sur instagram, puis il y a eu un effet boule de neige. Pas mal de filles se sont mises à échanger. En discutant avec les DJs Mensonges et Maghdalene, on a décidé de monter quelque chose toutes les trois. C’est là qu’Unit-Sœurs est né.
Puis on a fait notre premier évènement au Sucre, c’était un livestream de dix heures pendant le covid. Un live assez conséquent ! Ça nous a permis aussi de vraiment mettre un coup de pied dans la fourmilière en montrant que pendant dix heures on a pu faire passer uniquement des DJs femmes. On pourra plus dire qu’il n’y en a pas. Clairement elles sont là. D’ailleurs c’était important pour nous de faire ça au Sucre, lieu emblématique de la nuit lyonnaise.
Qu’est-ce que la collaboration autour d’Unit-Sœurs t’a apportée en tant qu’artiste ?
Ça m’a permis de transmettre mes compétences et mon expérience à d’autres filles en découvrant le fonctionnement associatif. Quand j’ai commencé je n’ai pas eu accès aux contacts et aux opportunités pour jouer sur certaines scènes. J’ai vraiment aimé les accompagner, d’autant plus que j’aurais bien aimé avoir de l’aide et du soutien à mes débuts.
 Saku Sahara © Juliette Valero
Saku Sahara © Juliette Valero
Quel est ton constat quant à la visibilisation des DJ et productrices femmes dans les clubs et dans les festivals ?
Je pense qu’on peut voir une amélioration depuis la reprise post-covid, mais on ne peut pas crier victoire. On est encore loin de l’égalité sur les scènes électroniques. Des fois on a l’impression qu’on a gravi une montagne puis qu’on l’a redescendue sur les genoux. Depuis qu’on a monté Unit-Sœurs, il y a quand même un changement sur la scène lyonnaise. On voit beaucoup plus de filles sur les line-ups. Même s’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, on est hyper fières d’avoir pu faire bouger les choses. C’est pour ça qu’on doit continuer à monter des projets, à se serrer les coudes entre femmes. La solution c’est vraiment l’entraide.
Quels sont tes projets pour la suite ?
Clairement mon rêve c’est de m’exporter à l’international. Et surtout, je rêve de jouer en Angleterre ! Une étape qui va se concrétiser bientôt si le covid ne passe pas par là. J’aimerais aussi beaucoup sortir un EP en 2023. Comme c’est un projet sur lequel je me suis lancée récemment, je ne me mets pas encore la pression avec une date de release. Surtout que je travaille à côté donc je ne peux malheureusement pas me consacrer qu’à la musique. Sinon je m’imagine continuer à évoluer artistiquement dans des projets pluridisciplinaires. Pourquoi pas des initiatives avec des jeux vidéos, ou des collaborations pour revenir à mes premiers amours du graphisme et de l’illustration.
Vous pourrez retrouver Saku Sahara, le 11 septembre prochain sur la Mirror Stage du Peacock Society au Parc de Choisy dans le Val De Marne.
Plus d’infos disponibles sur le Peacock Society : site internet / FB / INSTA
Pour suivre Saku Sahara : FB / INSTA / SOUNDCLOUD
Tracklist :
Stefan Goodchild – Kyle (Disaffected Remix)
Yescal – Asuka Strikes
Norman Bates – Trends & Boylan (Please VIP)
HomeSick – Inna Dis VIP
Rascal & Lucid – Chav Juice
Disaffected – Up North Troops
Harka – Massive
Samurai Breaks & Origin – Extensiv Hype
Crypticz & Itoa – How it’s done
Cet article Choose your fighter : Saku Sahara des kicks et des basses provient de Manifesto XXI.


L'édito de Robin Corminbœuf, nouveau rédacteur en chef de 360°
L’article Prendre soin collectivement de cette maison est apparu en premier sur 360°.


Les meilleurs amis sont inestimables: ils rendent les bons moments inoubliables et sont indispensables lorsque, de temps en temps, la vie te malmène un peu. Il est donc grand temps de célébrer les gens qu’on aime et ce qu’on a vécu ensemble: quatre ami(e)s racontent leur histoire.
L’article Vive l’amitié! est apparu en premier sur 360°.


L’occasion de faire connaissance avec d’autres parents ou futurs parents arc-en-ciel.
L’article L’association Familles arc-en-ciel vous convie à une rencontre le 4 septembre à Lausanne est apparu en premier sur 360°.

Cet article Torus archive la mélancolie des temps modernes provient de Manifesto XXI.
Imaginée en 2016 par Station Gare des Mines, le rendez-vous annuel Station Électronique souhaite cartographier les innombrables pans des musiques électroniques. Aux aguets des moindres vagues artistiques, les organisateur·ices du festival font appel aux talents locaux et mondiaux pour faire un état des lieux. Cette année, l’édition s’organise autour de la musique club et se tiendra du 2 au 3 septembre ; iels invitent Zulu, Loto Retina, Imer6ia, Hajj et bien plus. Au programme du vendredi, on retrouve également Torus, DJ néerlandais que nous avons voulu rencontrer avant la grande inauguration. Interview en grandes lignes de l’artiste qui séduit les line-ups depuis quelques mois.Produisant depuis La Haye, sa ville natale, Torus choisit de miser sur le label londonien Sonic Router Records pour sortir ses trois premiers EP. Depuis 2012, il vole au-delà des frontières dans une stratosphère numérique où tout est possible. Sa curiosité musicale et son talent indéniable lui valent une résidence Redbull à Tokyo en 2014. Depuis, il intrigue les plumes de grands médias musique tels que XLR8R, Noisey, DJ Mag, ou encore The Guardian. C’est désormais au tour de Manifesto XXI, de tenter de déceler quelques-uns de ses secrets.
 ©adélaïde de cerjat, photo prise au Horst.
©adélaïde de cerjat, photo prise au Horst.
Le travail de Torus est représentatif d’un sentiment générationnel, une ère en quête de sens. Il convoque un sentiment qui se ressent aussi bien à l’échelle individuelle que sociétale. C’est un sentiment perplexe dans lequel nous stagnons mélancoliquement dans un archivage du passé, faisant face à un flux extensible futuriste. Entre les deux, notre capacité à se souvenir devient plus complexe. Nous consommons maintes informations par jour qui nous confortent dans notre individualité. C’est la raison pour laquelle Torus aime faire référence à la culture populaire. Il collectionne presque tous les sons qu’il rencontre : il shazam régulièrement ce qui passe à la radio, en marchant dans la rue, la pop qu’il entend surgir des magasins. Armé de son téléphone portable, il fait des fields recordings pour leur qualité de compression. Il explique : « la façon dont le vent passe dans le micro peut être reconnue par tous·tes; mais chacun·e connecte à ce son à travers des souvenirs différents. En combinant les qualités de nostalgie contemporaine de ces enregistrements aux échos de pop que nous entendons partout, j’espère évoquer une réponse mélancolique du subconscient ». Ces collages pop, il les confectionne à partir de titres collectionnés sur TikTok.
De cette manière, Torus veut puiser dans notre imaginaire collectif et créer une sorte d’archive moderne en diffusant des sons qui ont tendance à déclencher un processus de souvenir. Ayant pu participer à deux de ses lives, une chose en ressort : l’audience s’esclaffe souvent en tentant de mettre le doigt sur ce que lui évoque une certaine onde, réverbération, vocalisation. En tant que magicien des temps modernes, Torus a une ruse peu connue pour nous sortir de notre zone de confort : le sampling inversé. Sa technique consiste à jouer un titre à rebours, y ajouter des réverbérations pour ensuite enregistrer la fin de ce résultat. Il confie que « la technique crée un écho estompé d’une référence perdue à l’échantillon original ; juste assez de référence pour que les gens déclenchent une réponse, mais pas assez pour reconnaître ce qu’ils reconnaissent ». Torus a bien conscience que son processus crée une potentielle frustration auditive qui peut survenir à la suite d’une telle écoute. Selon lui, cette impression d’insaisissable est la clé de sa réflexion, car elle est propre à notre génération. Nous subissons une perte de mémoire à court terme et la musique permet de restituer les choses. Selon lui, c’est un des pouvoirs les plus puissants du son.
333 Mirrors by TorusSouvent associé à l’ambient, Torus préfère désigner son travail avec le terme post-rave. Si ses productions se basent sur des enregistrements sonores et collages expérimentaux, ses lives se fabriquent autour de l’envie de faire réagir nos cerveaux. Il parsème ses mix d’instants de contemplation et de détente ainsi que de moments de nostalgie émotionnelle. Torus nous livre qu’il préfère d’ailleurs jouer en club : « cela me permet d’expérimenter avec des titres ambiants et les mêler avec toutes les influences de musique d’où ils sont tirés ; de les rejouer dans leur contexte original afin de d’achever la boucle ». La puissance de ses sélections a d’ailleurs séduit le mythique label Trésor à Berlin, qui cherche constamment à dénicher les nouveaux talents qui feront danser les clubs de demain. On ne s’étonne donc pas de voir le nom de Torus se multiplier à travers les programmations de cet été et on se réjouit de le voir ce vendredi à La Station Électronique.
Les préventes pour Station Electronique se trouvent ici.
Vous pouvez suivre Torus sur Insta, Facebook, Soundcloud et Bandcamp.
Cet article Torus archive la mélancolie des temps modernes provient de Manifesto XXI.

Cet article Torus archive la mélancolie des temps modernes provient de Manifesto XXI.
Imaginée en 2016 par Station Gare des Mines, le rendez-vous annuel Station Électronique souhaite cartographier les innombrables pans des musiques électroniques. Aux aguets des moindres vagues artistiques, les organisateur·ices du festival font appel aux talents locaux et mondiaux pour faire un état des lieux. Cette année, l’édition s’organise autour de la musique club et se tiendra du 2 au 3 septembre ; iels invitent Zulu, Loto Retina, Imer6ia, Hajj et bien plus. Au programme du vendredi, on retrouve également Torus, DJ néerlandais que nous avons voulu rencontrer avant la grande inauguration. Interview en grandes lignes de l’artiste qui séduit les line-ups depuis quelques mois.Produisant depuis La Haye, sa ville natale, Torus choisit de miser sur le label londonien Sonic Router Records pour sortir ses trois premiers EP. Depuis 2012, il vole au-delà des frontières dans une stratosphère numérique où tout est possible. Sa curiosité musicale et son talent indéniable lui valent une résidence Redbull à Tokyo en 2014. Depuis, il intrigue les plumes de grands médias musique tels que XLR8R, Noisey, DJ Mag, ou encore The Guardian. C’est désormais au tour de Manifesto XXI, de tenter de déceler quelques-uns de ses secrets.
 ©adélaïde de cerjat, photo prise au Horst.
©adélaïde de cerjat, photo prise au Horst.
Le travail de Torus est représentatif d’un sentiment générationnel, une ère en quête de sens. Il convoque un sentiment qui se ressent aussi bien à l’échelle individuelle que sociétale. C’est un sentiment perplexe dans lequel nous stagnons mélancoliquement dans un archivage du passé, faisant face à un flux extensible futuriste. Entre les deux, notre capacité à se souvenir devient plus complexe. Nous consommons maintes informations par jour qui nous confortent dans notre individualité. C’est la raison pour laquelle Torus aime faire référence à la culture populaire. Il collectionne presque tous les sons qu’il rencontre : il shazam régulièrement ce qui passe à la radio, en marchant dans la rue, la pop qu’il entend surgir des magasins. Armé de son téléphone portable, il fait des fields recordings pour leur qualité de compression. Il explique : « la façon dont le vent passe dans le micro peut être reconnue par tous·tes; mais chacun·e connecte à ce son à travers des souvenirs différents. En combinant les qualités de nostalgie contemporaine de ces enregistrements aux échos de pop que nous entendons partout, j’espère évoquer une réponse mélancolique du subconscient ». Ces collages pop, il les confectionne à partir de titres collectionnés sur TikTok.
De cette manière, Torus veut puiser dans notre imaginaire collectif et créer une sorte d’archive moderne en diffusant des sons qui ont tendance à déclencher un processus de souvenir. Ayant pu participer à deux de ses lives, une chose en ressort : l’audience s’esclaffe souvent en tentant de mettre le doigt sur ce que lui évoque une certaine onde, réverbération, vocalisation. En tant que magicien des temps modernes, Torus a une ruse peu connue pour nous sortir de notre zone de confort : le sampling inversé. Sa technique consiste à jouer un titre à rebours, y ajouter des réverbérations pour ensuite enregistrer la fin de ce résultat. Il confie que « la technique crée un écho estompé d’une référence perdue à l’échantillon original ; juste assez de référence pour que les gens déclenchent une réponse, mais pas assez pour reconnaître ce qu’ils reconnaissent ». Torus a bien conscience que son processus crée une potentielle frustration auditive qui peut survenir à la suite d’une telle écoute. Selon lui, cette impression d’insaisissable est la clé de sa réflexion, car elle est propre à notre génération. Nous subissons une perte de mémoire à court terme et la musique permet de restituer les choses. Selon lui, c’est un des pouvoirs les plus puissants du son.
333 Mirrors by TorusSouvent associé à l’ambient, Torus préfère désigner son travail avec le terme post-rave. Si ses productions se basent sur des enregistrements sonores et collages expérimentaux, ses lives se fabriquent autour de l’envie de faire réagir nos cerveaux. Il parsème ses mix d’instants de contemplation et de détente ainsi que de moments de nostalgie émotionnelle. Torus nous livre qu’il préfère d’ailleurs jouer en club : « cela me permet d’expérimenter avec des titres ambiants et les mêler avec toutes les influences de musique d’où ils sont tirés ; de les rejouer dans leur contexte original afin de d’achever la boucle ». La puissance de ses sélections a d’ailleurs séduit le mythique label Trésor à Berlin, qui cherche constamment à dénicher les nouveaux talents qui feront danser les clubs de demain. On ne s’étonne donc pas de voir le nom de Torus se multiplier à travers les programmations de cet été et on se réjouit de le voir ce vendredi à La Station Électronique.
Les préventes pour Station Electronique se trouvent ici.
Vous pouvez suivre Torus sur Insta, Facebook, Soundcloud et Bandcamp.
Cet article Torus archive la mélancolie des temps modernes provient de Manifesto XXI.


Le président serbe l'a annoncé, arguant qu'il n'était « pas possible de tout gérer » alors que le pays est confronté à une « crise difficile » au Kosovo.
L’article En Serbie, des milliers d’orthodoxes manifestent contre l’EuroPride, déja annulée par les autorités est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.

Yaïr Lapid a participé aux célébrations organisées à Tel-Aviv pour les 20 ans de l'association IGY, dédiée aux jeunes LGBT+. Une première pour un chef de gouvernement israélien en exercice.
L’article Le Premier ministre israélien sur le mariage pour toute et tous : « une révolution sociale importante et juste » est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.


Annoncé comme l'événement de la rentrée littéraire, le roman de Despentes, Cher connard, Publié chez Grasset tient-il ses promesses? Notre rédacteur en chef nous partage son avis.
L’article «Cher connard» un tableau angoissant et magnifique du début de cette décennie est apparu en premier sur 360°.


Pour l'arrivée du chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui, La Bâtie-Festival de Genève invite le Ballet du Grand Théâtre avec la reprise de deux créations du chorégraphe belge, Faun et Noetic. Une première pour le Ballet et le point de départ d'une nouvelle tournée.
L’article Sidi Larbi Cherkaoui au Ballet de Genève est apparu en premier sur 360°.

Cet article Festival Off Avignon 2022 : Nos coups de cœur provient de Manifesto XXI.
Le Festival OFF Avignon revenait cet été sans restriction pour couvrir les rues de pierres de la cité des Papes de ses milliers d’affiches. Voici ce qu’on y a vu de mieux.Le catalogue du OFF, cet annuaire en libre service lourd comme un sac de pierre, recensait cette année plus de 1500 pièces qui se jouaient chaque jour. Alors si vous n’étiez pas en train de danser tout l’été sous la chape de plomb du ciel Avignonnais, nous avons préparé une sélection, à retrouver sur les routes de France.
Les Possédés d’Illfurth – Écrit par Yann Verburgh avec Lionel Lingelser, interprété et mis en scène par Lionel Lingelser, en collaboration artistique avec Louis Arène. Cie Munstrum Théâtre.
C’est sans aucun doute la claque du festival. Lionel Lingelser fait tomber l’habituel masque du Munstrum Théâtre pour un seul en scène transcendant. Il entre, auréolé de sa couronne en carton, tambourinant, fier et ambitieux comme un enfant courant à la bataille les poches pleines de boutons. Il entre et on se tait. Quelques secondes plus tard, semble-t-il, il se tait et on tape des mains. Entre-temps, Lionel incarne tous les personnages de la vie d’un garçon grandissant à Illfurth, campagne alsacienne où deux jeunes enfants auraient été possédés il y a de ça des années. Et alors que le garçon grandit et devient acteur, Illfurth lui revient, fantôme aimé et redouté, quand il doit s’y rendre pour une représentation. Comment se débarrasser de la malédiction qui hante son enfance ? Comment se réconcilier avec ses démons – ceux des croyances et ceux, bien réels, qui ont abîmé son enfance – pour en apprivoiser d’autres ? C’est le long parcours de cet homme qui se confronte à ses blessures et ses traumatismes pour entamer le long voyage de la cicatrisation. Il aborde les violences sexuelles, remet en question les croyances sous toutes leurs formes et s’interroge sur l’essence du théâtre. Métamorphosant son corps au gré du récit – d’une interprétation remarquable et largement empreinte du travail de masque inhérent au Munstrum – Lionel fait apparaître une galerie de personnages. Et au moment du salut, quand il apparaît démuni des valises de la fiction pour n’être que le comédien face au public, nous pourrions ne pas le reconnaître. Une des forces de sa prestation est de savoir, à travers la précision de la corporalité, nous faire apparaître des monstres à cornes, un dragon ou une table de massage, sans autres artifices qu’un corps dans un t-shirt et un jean. D’une rare intelligence, la création lumière de Victor Arancio fait vivre sur ce plateau nu les campagnes, les routes, les salons, les enfers et les théâtres qui abritent les événements de cette histoire.
Lionel nous chante une ode aux acteur·ices mêlée au récit de la vie de ce garçon homosexuel qui grandit sous le joug de la religion, des mœurs et des légendes, pour devenir l’interprète qui cherche la grâce. On rit, on pleure, on tremble, le souffle coupé par cette interprétation totale. Lionel est comme possédé, et le public conquis.
Dans le jeu, le corps, le texte et la lumière, Les Possédés d’Illfurth est une prestation théâtrale entière, complète et enivrante.
Vous trouverez le calendrier de la tournée 2022/2023 des Possédés d’Illfurth ici, ne tardez pas pour prendre vos places, elles risquent de partir vite !
 Soraya Thomas dans Et mon cœur dans tout cela ? – © PODJ
Soraya Thomas dans Et mon cœur dans tout cela ? – © PODJ
Et mon cœur dans tout cela ? – Chorégraphie et interprétation de Soraya Thomas. Cie Morphose.
Nu dans un liquide laiteux, un corps contraint peine à tenir debout. Le mouvement est douloureux, lent. Le corps est à la fois vulnérable et puissant, débarrassé de toute connotation sexuelle, délesté du poids des critères de beauté coloniaux apposés aux corps de femmes noires. Le corps, ici, se défend pour retrouver son identité. Durant 35 minutes qui filent comme des secondes, la danseuse et chorégraphe Soraya Thomas soustrait la parole au mouvement pour faire entendre la pensée politique et, plutôt que les discours, elle utilise le mouvement du corps pour faire valoir la réappropriation de celui-ci. Une fois extraite de son bain lactescent, Soraya Thomas divague sur le plateau, recherche un sens, retrace l’histoire, tente d’échapper à l’absurdité du cercle de la vie, de la violence et de la bêtise. Elle nous ouvre la porte de son intime, laissant parfois résonner dans le silence son souffle, saccadé par l’effort, comme la preuve qu’elle vit encore et vivra quoi qu’il en coûte. Elle souffle sa révolte, car c’est de cela qu’il s’agit, d’une révolte. Celle du corps contre les attaques, du cœur contre les discriminations, de la danse contre la violence du monde.
Les procédés scéniques sont simples et pourtant les images affluent, travaillent l’imaginaire et donnent à la danse sa chronologie. Soraya évolue sur un plateau sombre ou n’apparaît qu’un carré gorgé de cette eau épaisse et blanche, à gauche. La prison, les normes, les cases. Une simple bâche noire sortie de Terre nous donne à voir une renaissance, la puissance de cette femme qui soulève le monde. L’espace est sublimé par des jeux de lumière intelligents, sans prétention et pourtant terriblement efficaces. La simplicité de la création lumière la rend d’autant plus brillante qu’elle est chaque fois comme une flèche au cœur de la cible, précise, percutante. L’esthétisme est au service du sens, l’un complète l’autre et la beauté se fait l’écrin fragile de cette danse politique.
Soraya nous offre sa révolte. Elle nous invite à la cultiver et l’on en sort ému·es, un secret au creux des mains, un secret qui n’appartient qu’à nous, gonflé de l’histoire que l’on se conte chacun·e face à cette chorégraphie. Et mon cœur dans tout cela ? est un cadeau qu’elle nous fait, alors quand les lumières s’éteignent nous n’avons plus qu’à lui dire : merci.
 Alexandre Virapin dans Bob et Moi – © Loewen Photographie
Alexandre Virapin dans Bob et Moi – © Loewen Photographie
Bob et Moi – Mis en scène par Jules Meary, interprété par Alexandre Virapin. Une production BAJOUR.
Qu’est-ce qui pousse un enfant au bord de la fenêtre à faire un pas en arrière ? Parfois simplement la quantité d’espoir qu’une chanson peut trimballer dans ses grandes notes. Bob et Moi nous conte la rencontre entre un enfant et Bob Marley, entre la petite et la grande histoire. C’est dans une de ces nuits où la lune, taquine, nous prend le cœur sans nous rendre le sommeil que le jeune garçon rencontre la musique de l’icône du reggae. Il ne peut pas dormir et se couche alors dans l’œuvre de Bob. C’est l’espoir, la liberté, la paix et la vie toute entière qu’il trouve nichée dans ces mélodies reggae qui le transportent comme elles ont transporté tout un peuple des années auparavant.
Bob et moi retrace l’histoire de Bob Marley à travers la fascination qu’a Alexandre pour lui depuis petit. Au-delà de sa carrière musicale mondialement reconnue, l’artiste a marqué son époque par son engagement politique, prônant la paix comme seul parti, portant sa voix pour le peuple, grand oublié dans la guerre corrompue des puissants. De ses premiers balbutiements rastafaris à son combat contre la maladie qui le couchera sous la terre à trente-six ans, le récit de sa vie prend dans cette mise en scène la forme d’une épopée politique et artistique. Le long de ce monologue brillamment porté par la douce émotion d’Alexandre, on les rencontre, Bob et lui. Leurs histoires évoluent en parallèle et nous racontent l’influence des artistes sur la vie politique aussi bien qu’intime, les ressorts de l’admiration, l’amour de l’art et de la liberté, la recherche du bonheur.
C’est que le texte a cette finesse d’écriture qui laisse le récit filer pour mieux nous rattraper lorsque la narration refait surface, nous renvoie sans préambule dans la chambre de ce garçon qui ne peut pas dormir et qui danse. Et c’est précisément là, entre les murs de cette chambre, dans les grands mouvements de ce petit joué par un grand qui remue au rythme de ces hymnes d’amour; que l’histoire apparaît dans tout son sens et sa beauté. Parce que les héros n’existent que dans les cœurs de celleux qui portent leurs histoires et qu’un appel à la paix n’a de sens que lorsqu’il parvient à calmer les angoisses d’un garçon insomniaque. Nul besoin d’être un·e admirateur·ice de Bob Marley pour être touché par ce spectacle, puisque son plus grand mérite repose dans cette lecture qu’en a le garçon. Dans ce monologue qui tangue entre l’humour et l’émotion, c’est un chant d’espoir qu’Alexandre Virapin et Jules Meary – metteur en scène présent sur scène comme un pilier, pour partager le plaisir – nous ont transmis à leur tour. Et ainsi la petite histoire devient la grande à nouveau.
Bob et Moi se jouera à Laval en septembre et au Théâtre Public de Montreuil à Paris en 2023.
On a aussi aiméDe la mort qui tue – Écrit et interprété par Adèle Zouane, mis en scène par Marien Tillet et Eric Didry, au théâtre de l’Arthéphile. Une production BAJOUR.
Ce seul en scène aux allures de one-woman-show théâtralisé nous plonge la tête dans la question existentielle la plus terrifiante qui soit : qu’est-ce que la mort ? Une heure durant, Adèle nous fait part de ses questionnements, ses doutes, peurs ou carrément terreurs, tout en laissant la place à l’amour, le regret ou la solitude. Et nous guide dans ses pérégrinations d’une interprétation très juste et subtile. Émouvant et drôle, ce spectacle survient comme pour nous libérer de ce fardeau, pour que nous puissions ressortir plus léger·es, sans se soucier jamais de la grande faucheuse.
Our Daily Performance – Des auteur.es Giuseppe Chico et Barbara Matijevic, interprété par Camila Hernandez, Nicolas Maloufi, Thibault Mullot, Marie Nédélec et Shihya Peng, au théâtre du Train Bleu. Cie 1er Stratagème.
Our Daily Performance est un ensemble de pastilles performatives créées à partir des tutoriels, formats qui pullulent sur internet et notamment sur YouTube depuis une décennie. Comment bien tomber, séance de Yoga pour couple, ou imitation de la démarche du lézard pour survivre… Chaque tuto est mis en espace et en corps, et fait lire le portrait d’une humanité et de ses terreurs : la solitude, la mort, l’échec, le couple. On assiste à de très belles aspérités, parfois extrêmement touchantes, parfois carrément hilarantes.
Maryvonne – Écrit et mis en scène par Camille Berthelot, avec Alma Livert et Maryvonne Berthelot (en vidéo), au théâtre du Train Bleu. Cie Les Habitantes.
Une jeune femme filme ses discussions avec sa grand-mère. Alors que sur l’écran de projection, cette dernière apparaît, au plateau, la jeune femme lui répond. On assiste donc au dialogue de deux générations qui se connaissent mal et tente de réfléchir au poids de l’amour, de la mort, du deuil. Si on garde un petit regret sur la distance que le personnage de la jeune femme garde avec le public quand nous voudrions un peu plus de son intimité à elle, Maryvonne aura tout de même eu nos larmes, arrachées par de grands moments d’émotions.
La fabrique des idoles – Création collective, mise en scène par Théodore Olivier, interprétée par Chloé Sarrat, Simon Le Flo’ch et Quentin Quignon, au Théâtre 11. Cie MegaSuperThéâtre.
La fabrique des idoles interroge la posture de nos héros et héroïnes, des contes qui entourent les événements historiques qui ont marqué notre époque. Si le cœur du sujet se perd un peu dans un océan d’information, cette création est remarquable pour son ingéniosité musicale, scénique et scénographique, ainsi que par la qualité du jeu des interprètes. Un spectacle d’une rare inventivité qui saura être extrêmement inspirant pour quiconque exerce la mise en scène. Et qui laisse en mémoire des moments de justesse absolue.
Image mise en avant : Lionel Lingelser dans Les Possédés d’Illfurth – © Jean-Louis Fernandez
Cet article Festival Off Avignon 2022 : Nos coups de cœur provient de Manifesto XXI.



Deux femmes qui s'embrassaient dans un parc à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne, ont été agressées sexuellement, insultées et violentées. L'une d'elles a reçu « un violent coup de poing au visage ». Leurs deux agresseurs ont pris la fuite avant l'arrivée de passants.
L’article Fontenay-sous-Bois : Un couple de femmes « agressé sexuellement, insulté et violenté » est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.

La Russie développerait actuellement une « intelligence artificielle », l'« Oculus », pour surveiller l’activité des citoyens sur internet et analyser les sites à la recherche d’informations dites interdites, notamment « la propagande de l’homosexualité ».
L’article La Russie développe une IA pour surveiller ses citoyens et lutter contre « la propagande de l’homosexualité » sur le web est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.

La Russie développerait actuellement une « intelligence artificielle », l'« Oculus », pour surveiller l’activité des citoyens sur internet et analyser les sites à la recherche d’informations dites interdites, notamment « la propagande de l’homosexualité ».
L’article La Russie développe une IA pour surveiller ses citoyens et lutter contre « la propagande de l’homosexualité » sur le web est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.

Le premier ministre singapourien, Lee Hsien Loong, a annoncé, ce dimanche 21 août, que son gouvernement allait prochainement abroger l'article 377A du Code pénal, criminalisant les relations sexuelles entre hommes.
L’article Singapour va décriminaliser les relations homosexuelles est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.

Le premier ministre singapourien, Lee Hsien Loong, a annoncé, ce dimanche 21 août, que son gouvernement allait prochainement abroger l'article 377A du Code pénal, criminalisant les relations sexuelles entre hommes.
L’article Singapour va décriminaliser les relations homosexuelles est apparu en premier sur Association STOP HOMOPHOBIE | Information - Prévention - Aide aux victimes.


Deux guides indispensables pour réduire les risques en santé sexuelle
L’article Pour la rentrée, les deux guides des Klamydia’s consacrés au safer sex font peau neuve est apparu en premier sur 360°.