
Deux personnes, dont le rappeur surnommé "Amalek", ont été mises en examen à Paris vendredi, suspectées de tenir des propos homophobes ou antisémites sur Telegram, a appris l'AFP lundi 26 juin de source judiciaire.
34739 éléments (3198 non lus) dans 75 canaux
 Radio/sons
(113 non lus)
Radio/sons
(113 non lus)
 Sexo anecdotique
(669 non lus)
Sexo anecdotique
(669 non lus)
 Actu et info sexe
(635 non lus)
Actu et info sexe
(635 non lus)
 Ecrits / bds / Edition
(109 non lus)
Ecrits / bds / Edition
(109 non lus)
 BDSM/cuir/latex/
(29 non lus)
BDSM/cuir/latex/
(29 non lus)
 feminisme
(791 non lus)
feminisme
(791 non lus)
 Libertinage
(19 non lus)
Libertinage
(19 non lus)
 Info LGBTI
(833 non lus)
Info LGBTI
(833 non lus)
 Info LGBTI
Info LGBTI


Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont réunies à Paris, ce samedi 24 juin, pour marcher contre les violences, alors que nous célébrons cette année les 10 ans du mariage pour tou.te.s.
L’article Des dizaines de milliers de personnes à Paris pour la marche des Fiertés LGBT+ est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Des tags injurieux et menaçant de « tout faire sauter » ont été découverts sur le collège Saint-Exupéry, alors que devait s’y déroulait ce lundi matin les épreuves du brevet. Une plainte a été déposée.
L’article Un collège de Saint-Jean-de-Braye recouvert de tags lgbtphobes, sexistes et menaçants est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.


Le dessin a été recouvert du mot pédophiles avec un autre graffiti appelant au meurtre des personnes LGBT, signé d'une fleur de Lys, autre emblème auquel se réfère régulièrement les groupuscules d'extrême-droite.
L’article Une fresque arc-en-ciel dégradée et un graffiti appelant au meurtre des LGBT découvert à Nantes est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Canton par canton, les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle et l’identité de genre deviendront bientôt hors la loi en Suisse. Mais elles prennent parfois des formes insidieuses et difficiles à discerner
L’article Ces thérapies de conversion qui ne disent pas leur nom est apparu en premier sur 360°.


Luc Di Gallo a été agressé par quatre individus dans un parc de la ville, ce vendredi 2 juin, après un rendez-vous avec un homme organisé depuis une application de rencontre. Une plainte a été déposée.
L’article Un adjoint au maire de Montreuil victime d’un guet-apens homophobe est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.




En marge de la marche des Fiertés, une énorme banderole « Fuck LGBT » a été érigée sur une grue de chantier, à proximité du parcours de la parade. Cinq associations, dont STOP homophobie et le centre LGBT+ de Rennes, portent plainte.
L’article Banderole anti-LGBT déployée à Rennes : Cinq associations portent plainte est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Pour la 25ème édition du Festival, STOP homophobie rejoint le Village Solidarité, du 23 au 25 juin, à l'Hippodrome Paris Longchamp.
L’article Discrimination / Droits humains : STOP homophobie au Village Solidays 2023 est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

La créatrice du concours Miss France a été mise en examen dans le cadre de la procédure pénale engagée par STOP homophobie en décembre 2021.
L’article Geneviève de Fontenay mise en examen pour injure transphobe est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Le samedi 17 juin dernier, STOP homophobie était invitée par l'association CSD Mittelhessen à la marche des Fiertés de Giessen, en Hesse, dans le centre de l'ex Allemagne de l'Ouest, afin de renforcer l'ancrage européen de nos luttes et solidarités.
L’article STOP homophobie invitée à la marche des Fiertés de Giessen en Allemagne est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article « Le désir c’est plus fort que le genre »: être queer dans le monde du striptease provient de Manifesto XXI.
Souvent fantasmé, stéréotypé ou diabolisé, le striptease porte des enjeux complexes. Dans cet espace marqué par l’hétéronormativité, l’expression d’un soi hypersexualisé et la performance de genre questionnent nos libertés. Quatre (ex-)strippers queers nous ont raconté comment ielles naviguent dans cet univers.Franchir les portes d’un stripclub, c’est entrer dans une bulle, une parenthèse, hors du temps et de tout. Un endroit de perdition subversif. Mais c’est aussi entrer dans un espace qui réunit différents enjeux sociaux et dévoile des questions de genres, de sexualités et d’identités. Un cabinet de curiosités où diplomates et chauffeurs uber sont réunis autour d’un objet : le désir. Le désir sexuel, sensuel, émotionnel, humain. Le striptease, ça n’est pas que danser autour d’une barre de pole, c’est aussi parler. Pendant des heures, à des clients de tous âges, tous horizons, tous milieux sociaux. C’est charmer, convaincre ces clients de payer une danse privée pour vivre le meilleur moment de leur vie. C’est incarner un fantasme, une déesse, un objet de désir inaccessible. Dans cet espace qui place l’hétérosexualité au centre des interactions, la mise en scène d’une hyper-féminité et la performance artistique se mêlent et interrogent notre vision des normes et rôles de genre. Depuis toujours les liens entre les travailleur·se du sexe et les personnes LGBTQ+ sont marqués par une histoire et des luttes communes. Les lieux de séduction gays étaient autrefois des endroits de pratique des métiers du travail du sexe ; les lesbiennes et femmes travailleuses du sexe étaient longtemps perçues socialement comme déviantes car non conforme à une sexualité hétérosexuelle, régit par le mariage et la reproduction. Ainsi, les combats pour les droits des TDS, des femmes et des personnes LGBTQ+ partagent des revendications similaires : la liberté d’expression de sa sexualité, le droit à disposer de son corps, et la lutte contre la marginalisation sociale et la conformité aux critères hétéronormatifs.
Le striptease, la prestation du désirSi la sexualité, et en particulier l’hétérosexualité, est au centre du travail de stripteaseuse, l’orientation sexuelle et l’identité de genre des stripteaseuses, et plus largement leur vie intime, sont dissociées du personnage qu’elles incarnent sur scène. Stripper racisée et performeuse queer fem, Mila Furie a vécu neuf vies et de nombreuses années d’expérience dans le striptease, en France comme aux États-Unis. C’est au studio de sport KAH, où elle a donné un workshop de stripper tricks, qu’elle me donne rendez-vous. Lorsque l’on parle de son rapport à la scène, elle observe : « Que tu sois hétéro ou pas, au moment où tu arrives sur la scène, dans le club, tu rentres dans un personnage. » Ce personnage a constitué une carapace pour elle, étant une personne timide, et un moyen de mieux adapter ses rapports sociaux. L’hypersexualisation et la mise en avant d’attributs féminins lui a permis de jouer avec les codes : « Tout est XXL, tout est en grand, il y a un truc similaire au drag queen, c’est presque du grotesque. C’est de la performance de genre. »
 Foenixxx © @thebeuz
Foenixxx © @thebeuz
Pour Foenixxx, stripper racisé·e transmasc avec un passing fem, l’aspect scénique a aussi une place centrale dans son parcours. Foenixxx fait notamment partie de la scène ballroom, une culture créée par les personnes LGBTQ+ noires et latino à la fin des années 60 à New York, « pour contrer le racisme rencontré par les personnes racisées au sein de la communauté LGBTQ+. » A l’époque où la ballroom apparaît, les émeutes de Stonewall éclatent dans la nuit du 28 juin 1969. Après une descente de police violente au Stonewall Inn, un des seuls bars où pouvaient se retrouver les personnes gays et trans, des manifestations explosent, lançant le mouvement de revendication des droits LGBTQ+. Au premier rang de ce mouvement: des travailleur·ses du sexe trans racisées, dont Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera. Encore aujourd’hui, la convergence des personnes trans vers le travail du sexe a de nombreuses raisons, parmi lesquelles la discrimination à l’emploi, la marginalisation scolaire et le manque de reconnaissance juridique pouvant mener à la précarité. Foenixx entre lui dans le travail du sexe lorsqu’il a 18 ans par l’escorting. Après avoir subi un viol par l’un de ses clients, il arrête cette pratique et décide de se lancer dans le striptease. « J’avais déjà vécu plein de violences sexuelles avant. Je me suis dit : dans la rue tu te fais agresser, au travail tu te fais agresser, partout tu te fais agresser, donc fais de l’argent, capitalise sur ça. Fais de ce que les hommes attendent de toi le moyen de gagner ta vie. Capitalise sur l’oppression, tout simplement. » Ce constat politique révèle le renversement des rapports de domination que les personnes considérées comme femmes par la société effectuent lorsqu’elles capitalisent sur les attentes et pressions de la société et en font un produit qu’elles vendent, une prestation. « Ce travail, c’est de vendre du sex appeal. Une attirance, une alchimie sexuelle »… construite de toutes pièces et régie par la transaction financière.
 Dans l’atelier de Mathilde © Emma Breidi
Dans l’atelier de Mathilde © Emma Breidi
La performance artistique a été un facteur dans la décision de Mathilde, artiste et stripteaseuse féministe, de se lancer dans cette carrière. Je la rejoins dans son atelier où sont exposés ses tenues de scène, ses créations, ses projets ; une explosion de couleurs et de textures. Souriante, elle s’allume une roulée en revenant sur son départ de son village en Saône-et-Loire pour s’installer à Paris lorsqu’elle est admise aux Beaux-Arts. C’est à ce moment qu’elle emprunte de l’argent pour financer ses études. Elle habite pendant quelques années dans des squats, faisant partie de collectifs qui gèrent des logements pour réfugiés et des ateliers d’artistes. Lorsqu’elle se trouve obligée de quitter son squat et de trouver un appartement, elle se lance dans le striptease pour continuer à approfondir sa pratique artistique tout en travaillant.
Maintenant que j’ai déçu tout le monde et qu’on n’attend plus rien de moi, je peux faire ce que je veux et savoir qui je suis en arrêtant le “people pleasing”.
Etna
Dans un café à République, Etna, ancienne stripteaseuse, me parle de ses cheveux courts, de la liberté que cela a été de les couper et d’arborer un style plus androgyne, moins binaire. Si iel a arrêté le striptease, Etna exerce aujourd’hui en tant que masseur·se érotique et s’exprime sur le désir et sa beauté. C’est le fil conducteur de sa carrière: « L’élan vital du désir, c’est plus fort que le genre, plus fort que beaucoup de choses, c’est “on a envie”. C’est ça ce que j’essaye de transmettre. »
Incarnation et exploration de la féminitéCherchez l’origine du striptease et vous trouverez toutes sortes de contes et histoires. On vous dira que la première stripteaseuse était Salomé, la fille d’Hérodias dans la Bible qui charma le roi Hérode avec la danse des sept voiles. D’autres mythes racontent que des danses érotiques étaient exécutées dans les empires grec et romain ou dans les temples indiens lors de rituels pour gagner les faveurs des déesses et des dieux. On vous parlera des Ghawazi, un groupe de danseuses nomades égyptiennes au XIXème siècle ; des spectacles à Paris du Moulin Rouge, des Folies Bergère ou du Crazy Horse ; de Joséphine Baker (qui était bisexuelle), de Lydia Thompson Gypsy Rose Lee et Sally Rand, figures emblématiques de l’effeuillage et du burlesque, ou encore de Blanche Cavelli, la première danseuse à se déshabiller intégralement dans Le Coucher d’Yvette en 1895 à Paris. En fin de compte, toutes ces histoires-là nous racontent la même chose : qu’importe où et comment, et malgré le shaming des abolos et l’infantilisation des mascu, le striptease a toujours fait partie de nos sociétés et cultures, au fil des époques, des codes et des normes.
Ça m’a donné envie de moins m’hypersexualiser dans mon quotidien.
Foenixxx
 Mila © Marion May
Mila © Marion May
L’espace du stripclub met en scène une hyperféminité socialement dévalorisée : ses attributs (talons hauts, faux cils, ongles longs, tenue dénudée) sont considérés comme vulgaires et dégradants, à l’encontre d’une féminité sage et naïve attendue. Cette performance de genre poussée aux extrêmes peut permettre une liberté dans l’exploration et l’expression de ces codes, mais aussi présenter des contraintes. Pour Etna, le monde du striptease a constitué un espace pour incarner et revendiquer son identité queer. Face aux réactions de rejet de sa famille et ses proches concernant son travail de stripteaseuse, iel en vient à la conclusion : « Maintenant que j’ai déçu tout le monde et qu’on n’attend plus rien de moi, je peux faire ce que je veux et savoir qui je suis en arrêtant le “people pleasing”. Cela m’a ouvert des portes de liberté joyeuse et m’a permis de mieux vivre ma vie de lesbienne. » Lorsque Mathilde commence le striptease, elle ne connaît rien de ce monde et arrive le premier soir avec des poils sous les bras. Elle se retrouve alors confrontée à différentes féminités : que ce soit des femmes plus stéréotypées et refaites, des « poupées de magazines très belles », certaines plus naturelles, ou d’autres plus queers lui ressemblant davantage. Malgré certaines réflexions la ramenant aux codes du striptease, elle décide de ne pas coller à l’image attendue d’elle, de garder, d’affirmer et de revendiquer son identité, et de ne pas s’épiler. En conscientisant sa sexualité et ses attributs pour les monétiser, le striptease l’a ralliée à sa féminité. Sa pratique a constitué un acte d’empowerment et de revendication de son identité queer.
Cet espace d’exploration d’un soi sexuel et sensuel permet aussi une liberté dans la vie personnelle. « Ça m’a donné envie de moins m’hypersexualiser dans mon quotidien parce que de passer autant de temps en string à faire la chaudasse devant des mecs, quand t’as l’occasion de porter ton bon jogging dégueulasse, ta culotte de règles déchirée et de ne pas mettre de soutif, ça fait plaisir » déclare Foenixxx.
Après avoir été « traitée de grosse pendant toute [son] enfance et adolescence », c’est d’abord à travers la figure de la pin-up qu’Etna performe une forme de féminité et de sexualisation acceptée socialement. Mais cette féminisation a soulevé d’autres problématiques, notamment dans sa socialisation dans les communautés queers. En tant que personne performant fem, iel a subi du sexisme : « Les fem dans la séduction lesbienne, ce n’est pas ce qu’il y a de plus valorisé. » C’est par le muscle qu’iel se défait ensuite de cette féminité et conçoit une vision d’iel plus masculine, lui permettant de jouer avec les normes de genre. Se considérant depuis peu non-binaire, iel pointe les limites de cette hyper-féminité performée dans les stripclubs : « Le public me ramenait toujours à des performances plus carrées, de la féminité plus sage, pseudo-rebelle à la Gainsbourg, c’est-à-dire pas rebelle du tout, du tout. » Ces attentes précises le font se sentir empêché·e d’évoluer dans ses performances, et l’amènent finalement à arrêter le striptease.
En fait, c’est un taf de commercial. J’ai appris à me vendre.
Mila
Avoir une apparence féminine et un passing hétéro a été un challenge aussi pour Mila. « Je pense que j’ai beaucoup joué ce truc too much dans le féminin pour exprimer une féminité presque agressive ou offensante. » C’est à travers une hyper-féminité assumée qu’elle a reclamé son identité fem et son droit à exister dans le milieu queer. Pour Foenixxx, vivre sa féminité en milieu queer en tant que personne non-binaire a été compliqué : « J’aime beaucoup mon côté féminin. J’adore porter des robes, être maquillée, avoir des talons. Mais la ballroom, surtout en France, est encore tellement binaire. Il y a des normes, je ne peux pas me présenter avec une moustache ou des poils sur les jambes, alors que moi j’aime beaucoup combiner ma féminité et ma masculinité, parce que c’est moi. Je n’ai pas envie de choisir entre les deux. »
On se moque d’eux au fond. Eux pensent que je suis sincère et que je les trouve super, mais en fait je m’en fiche et souvent je ne me souviens pas de leur prénom
Mathilde
 Foenixxx © @thebeuz
Foenixxx © @thebeuz
Renverser les rôles de genre
On place souvent les hommes au cœur des interactions dans les stripclubs, réduisant les stripteaseuses à un objet de désir, quand en réalité elles sont bien plus proactives et prennent un rôle considéré socialement comme « masculin » dans ces interactions. Une importante partie du travail de stripteaseuse va être d’accoster les hommes et de les démarcher pour les convaincre de dépenser leur argent. « En fait, c’est un taf de commercial. J’ai appris à me vendre » rapporte Mila lorsqu’elle explique que son métier lui a donné beaucoup d’aplomb, lui a permis de poser ses limites et de gagner en assurance face aux hommes blancs cis hétéros. Pour Foenixxx aussi, ce rapport aux clients a constitué un espace de masculinisation : « Tu es à moitié à poil devant des mecs, tu es hyper vulnérable, c’est toi qui dois aller les démarcher donc il faut que tu agisses encore plus comme un mec qu’eux pour gagner leur respect, parce que la féminité c’est forcément synonyme de faiblesse dans notre société. »
 Mathilde dans son atelier © Emma Breidi
Mathilde dans son atelier © Emma Breidi
Mila, Foenixxx et Mathilde soulignent l’aspect « manipulateur » dans cette séduction régie par la transaction économique : « On se moque d’eux au fond. Eux pensent que je suis sincère et que je les trouve super, mais en fait je m’en fiche et souvent je ne me souviens pas de leur prénom » me confie Mathilde. Elle exprime aussi un sentiment de tendresse et de pitié à l’égard de ses clients : « Un de mes clients habitués me demande que je lui fasse des câlins en le serrant fort dans mes bras, c’est hyper touchant. » Elle me raconte que si certains peuvent être agressifs et désagréables, d’autres viennent seulement pour parler, raconter leur vie, se livrer et tout simplement avoir un contact humain, une position de vulnérabilité qu’on attribue socialement aux femmes.
Pour autant, si certaines formes de masculinité peuvent permettre de créer du lien, ainsi que de se défendre et poser ses limites face à certains comportements des clients, elles peuvent rapidement dérouter les hommes qui se sentent menacés. « La masculinité que tu as en toi peut les faire fuir. Parce que pour eux, ça voudrait dire être homosexuel » témoigne Foenixxx, pour qui vivre sa transidentité au sein du monde du striptease reste encore impossible. Il est souvent confronté à de la misogynoir, du sexisme ou encore de l’homophobie dans le milieu, où les agressions envers les personnes trans sont nombreuses, que ce soit de la part des clients, des managers, des vigiles ou de ses collègues. Aujourd’hui, Foenixxx a arrêté le striptease et aimerait commencer sa transition. Il ne sait pas encore s’il continuera le striptease ou le travail du sexe pendant et après sa transition.
Les stripclubs, espaces de libération ?Ces questionnements liés aux normes de genre et à l’expression de féminités et masculinités s’imbriquent dans un rapport aux corps spécifique aux stripclubs. Pour Etna, le stripclub a été un lieu d’acceptation de la pluralité des corps. « Souvent on a cette image que seules les personnes minces peuvent faire de l’érotisme, mais pas du tout. C’est beaucoup plus ouvert et inclusif que ça. » Mathilde aussi a été surprise, lors de son premier soir de travail, de voir autant de corps nus et différents. Elle exprime le sentiment galvanisant de se sentir désirée : « À écouter les clients, on est toutes parfaites. Ce n’est pas une question de physique mais plus d’attitude, d’aura et d’alchimie. Il suffit d’avoir confiance en soi pour que ça fonctionne. » Si le corps et sa portée sexuelle sont au centre du métier de stripteaseuse, sa banalisation via la nudité permet une désacralisation du tabou qu’il représente et une acceptation des complexes : « Moi j’ai ce qu’on appelle de la peau de fraise sur le cul, une peau un peu granuleuse, des petits boutons, révèle Foenixxx, mais les mecs ils s’en foutent tellement. Tu n’as pas besoin d’avoir un corps absolument parfait au moindre détail pour être une belle personne, pour être désiré·e et désirable. »
 © Mathilde Soares-Pereira
© Mathilde Soares-Pereira
Cette diversité de corps ne s’aligne pourtant pas à une inclusivité des désirs. La clientèle féminine reste encore minime, et dans certains clubs, les femmes ne peuvent pas rentrer si elles ne sont pas accompagnées d’hommes. L’inexistence de cette clientèle et de stripclubs queers souligne le tabou toujours présent autour du désir des femmes et des personnes non-binaires. Certaines soirées queers comme la Noche, la P3, Queer Slut Club, La Branlée, Cabaret Music Whore ou la Wet For Me proposent des performances de striptease ou de burlesque, mais pour Mila, « ce n’est pas du striptease, même si il y a un moment effeuillage ou de la pole dance, parce qu’il n’y a pas de clients à démarcher ». Un constat partagé par Etna, qui a aussi performé dans des soirées queers : « Je ne savais pas ce qui était en jeu. Je me demandais : est-ce que les gens sont tous consentants à de l’exhibition dans ce contexte ? Est-ce que ça va avec la soirée qui est de l’ordre de l’amusement, pas forcément du désir ? Moi, j’ai besoin de ce pacte de désir-là, et à la rigueur de performer dans un endroit qui serait un stripclub lesbien, mais pas une soirée. »
Si les stripclubs peuvent être des espaces d’inclusivité des corps, de liberté et d’exploration de la performance de genre, les féminités et masculinités possibles restent encore contraignantes et réduites à une binarité propre à l’hétéronormativité de ces espaces. En attendant l’existence de stripclubs queers, l’émergence de soirées queers autour du thème du striptease et des performances burlesques permet une évolution et une démocratisation des désirs et des sexualités autres que hétérosexuel·les. L’avènement de ces espaces offre une liberté grandissante de jeu et d’exploration des codes de genre, et met en avant l’acte de révolution et d’amour de soi que représente la performance de mettre son corps à nu.
Relecture et édition : Léane Alestra, Apolline Bazin et Sarah Diep
Image à la Une: Mila, série « Youles » © Jeanne Lucas
Cet article « Le désir c’est plus fort que le genre »: être queer dans le monde du striptease provient de Manifesto XXI.

Cet article Coachella : pourquoi c’est naze de se focaliser sur l’éthique des artistes queers provient de Manifesto XXI.
Le financement d’associations d’extrême-droite par le propriétaire du festival de Coachella a relancé cette année encore le débat sur le bien-fondé de la participation des artistes queers à l’événement. Mais la focalisation sur cette question fait écran aux problèmes plus profonds de l’industrie sur laquelle elle repose.Sur une des scènes du très médiatique festival de Coachella en avril, la chanteuse belge Angèle parle de ses amours lesbiens sous les cris du public avant de chanter « Ta reine », un drapeau LGBT à la main, entourée de ses danseur·ses en rose et cuir. Parmi les rares artistes francophones à jouer au festival le plus rentable du monde, sa présence, ainsi que celle d’autres influenceur·ses ouvertement queers – comme l’américain James Charles ou le français Antonin – a fait l’objet de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. On leur reproche leur manque de cohérence concernant leurs prises de position féministes ou de défense des personnes LGBTQIA+, jugées incompatibles avec l’évènement.
Depuis quelques années, les mêmes critiques reviennent inlassablement lorsque les maquillages pailletés des stars d’Instagram et des rich kids of LA envahissent les réseaux. À l’origine de la polémique, un article de 2016 du Washington Post qui révèle que Philip Anschutz, propriétaire d’Anschutz Entertainment Group (AEG), à qui appartient Goldenvoice, l’entreprise qui organise Coachella, figure parmi les financeurs des principaux et puissants lobbys anti-LGBT. Depuis, la participation des artistes et des festivalier·es LGBTQIA+ est chaque année commentée et pointée du doigt sur les réseaux sociaux. Mais, il est temps d’élargir la focale : les hypocrisies de l’industrie du divertissement ne peuvent plus peser uniquement sur les féministes, les LGBTQIA+ ou les personnes minorisées. Il faut collectivement prendre conscience du modèle global à bout de souffle sur lequel reposent ces évènements.
Du pétrole sur les mainsDès 2017, l’équipe de communication d’AEG, gênée par les révélations sur Anschutz à contre-courant de l’image inclusive que cherche à se donner le festival, a immédiatement mis le paquet pour faire oublier les affinités philanthropiques du milliardaire. Après avoir réagi à la polémique en qualifiant ces informations de « fake news » (sic), Anschutz a fait amende honorable en donnant 1 million de dollars à la fondation Elton John. Cette même année, le festival bat son record de rentabilité avec un bénéfice de 114 millions. Dans la foulée, Paul Tollett, PDG de Goldenvoice, jure que son patron a cessé toute donation douteuse et insiste sur le fait que le festival programme de nombreux·ses artistes issu·es de minorités. AEG est en outre noté 100/100 depuis 2019 dans le classement des meilleures entreprises en matière d’inclusivité par Human Rights Campaign, une association dédiée à la défense des droits des personnes LGBTQIA+. Depuis 2017, la production de Coachella serait irréprochable… On pardonnerait presque à Anschutz, de ne pas avoir pu résister à donner en 2020 75 000 dollars en soutien à l’abrogation de l’amendement Roe v. Wade, qui garantissait l’accès des Américain·es à l’avortement.
Les liens entre industrie du divertissement, politiques réactionnaires et climatoscepticisme ne relèvent pas d’un problème de casting ; l’existence d’événements comme Coachella dépendent bien directement du système d’exploitation capitaliste.
Le festival est loin d’être l’activité la plus lucrative d’Anschutz, mais s’il peut engendrer assez de bénéfices pour être extrêmement rentable malgré son coût, c’est bien parce qu’il bénéficie des (très) gros sous d’AEG. Les affinités philanthropiques du PDG ne sont pas particulièrement étonnantes quand on comprend les différents flux qui alimentent Coachella. Cheveux argentés coiffés en arrière, mocassins et costume en tweed, « the man who owns LA » ressemble plus à un respectable aristocrate qu’à l’image du supporter « white trash » de Trump. Pourtant, Anschutz, magnat du pétrole et de l’immobilier, propriétaire de sociétés dans les chemins de fer, les télécommunications, le divertissement et la presse est un fidèle soutien à l’ex-occupant de la Maison Blanche, et accessoirement un des hommes les plus riches des États-Unis.
Outre ses nombreux soutiens à des associations ultra conservatrices, anti-LGBTQIA+ et anti-avortement, Anschutz est un très puissant mécène du climatoscepticisme. Il est, entre autres, très proche des influents frères Koch, richissimes businessmen libertariens du pétrole, méga-donateurs du parti républicain et éminents acteurs de la guerre contre les politiques environnementales. La moralisation du milliardaire américain relève davantage d’un coûteux effort de com’ que d’un quelconque changement de cap. Rappelons que le concurrent d’AEG, Live Nation Entertainment, est détenu par un autre milliardaire, John Malone, qui partage la plupart des accointances politiques d’Anschutz. Les liens entre industrie du divertissement, politiques réactionnaires et climatoscepticisme ne relèvent pas d’un problème de casting ; l’existence d’événements comme Coachella dépendent bien directement du système d’exploitation capitaliste et impérialiste.
Danser sans la pluieLe succès de Coachella repose au moins autant sur son line-up cinq étoiles que sur son « capital cool », un savant mélange d’esthétique camp et de rêve californien que vend (très cher) AEG, dans le décor hollywoodien de la vallée de Coachella, en Californie du Sud, à environ trois heures de Los Angeles et tout près de Palm Springs. Façades colorées, gazons bien entretenus et palmiers croulants, c’est un lieu de villégiature prisé par les seniors argentés, une charmante oasis au beau milieu du désert. Charmante oasis qui a tout de même une consommation d’eau environ trois fois supérieure à la moyenne de la région. Il en faut en effet beaucoup pour entretenir les 120 golfs, les piscines privées et le parc aquatique de la ville dans un territoire où il ne pleut quasiment jamais.
À côté de ce décor de fin du monde vivent celleux qui sont resté·es, les ouvrier·es agricoles principalement d’origine mexicaine, qui souffrent de problèmes respiratoires de plus en plus inquiétants.
Paradoxalement, le raz-de-marée de photos éclipse ce qui est pourtant sous nos yeux : la localisation du festival est absurde, puisqu’en plein milieu du désert et les populations en hors champ. Le gazon et les palmiers de Coachella appartiennent au Polo Empire Club, propriété d’un promoteur moustachu (et soutien local du parti républicain). Comme les terrains de golf, la pelouse du club de polo est arrosée par l’aquifère sur laquelle repose l’oasis de Coachella. Asséchée par le pompage excessif qui entretient l’esthétique organique et les loisirs de la ville, la nappe est réapprovisionnée par l’eau prélevée dans le fleuve Colorado à plusieurs centaines de kilomètres de là. Or, la baisse de débit du fleuve est la cause d’une crise majeure pour les sept États qui en dépendent. Mais le Polo Empire Club ne souffre heureusement pas de restriction : l’activité agricole de la vallée de Coachella octroie aux usager·es un accès très privilégié à l’eau du Colorado, grâce à la législation mise en place avant l’intensification du développement urbain et l’assèchement du fleuve. De fait, en Californie, les milliers d’hectares de cultures intensives en plein désert nécessitent une irrigation constante et abondante accompagnée d’une utilisation massive de pesticides, polluant la nappe qui arrose le festival.
La cohabitation de l’agriculture intensive et la fête n’est pas nouvelle dans la vallée : à une petite demi-heure de Coachella se trouve la Salton Sea, ex-lieu branché de fête et d’insouciance des années 50, aujourd’hui le lac le plus pollué de Californie. La plage désertée est jonchée de cadavres de poissons et d’oiseaux empoisonnés par les émanations toxiques dues à la diminution drastique du niveau de l’eau. À côté de ce décor de fin du monde vivent celleux qui sont resté·es, les ouvrier·es agricoles principalement d’origine mexicaine, qui souffrent de problèmes respiratoires de plus en plus inquiétants.
La fête s’est donc déplacée de quelques kilomètres. Chaque année, malgré le coût d’entrée exorbitant nécessaire pour rester outrageusement rentable, Coachella accueille 200 000 festivalier·ères et des dizaines d’artistes avec leurs équipes et leur matériel. Afin de pourvoir aux quantités astronomiques d’énergie demandées par les méga-shows, plus de 300 panneaux solaires ont été construits. Mais les quelque 35 000 véhicules et centaines d’avions empruntés par les festivalier·ères fonctionnent quant à eux toujours aux énergies fossiles, et les participant·es produisent tout de même plus de 100 tonnes de déchets chaque jour, polluant encore un peu plus les sols de la vallée.
Qui doit enterrer Coachella ?Coachella semble, regardée avec un peu de distance, appartenir à un monde qui n’existe déjà plus mais qui se débat pour conserver son attractivité quoi qu’il en coûte, malgré les polémiques, les tarifs et l’engouement un peu passé. L’obstination de Goldenvoice, qui continue à investir dans des constructions permanentes au coût pharaonique, témoigne du refus complet de reconnaître l’absurdité de l’évènement dans un système à bout de souffle. Pourtant, nos frustrations – aussi légitimes soient-elles – peinent à dépasser l’individualisation des enjeux politiques et se traduisent inlassablement par la recherche de coupables. Le coût de l’événement excluant de fait la majorité de la population, éludant ainsi la possibilité d’un « boycott citoyen », nous les cherchons parmi les personnes qui semblent, à tort ou raison, les plus sensibles aux questions sociales.
Décentrer le problème et élargir la focale permettrait de répartir le poids de la responsabilité sur les épaules de celles et ceux qui tirent profit du luxe de ne jamais y être confrontés.
Angèle – qui jouit par ailleurs d’autres privilèges – n’est pas seulement une pop star qui défend le féminisme et les luttes LGBTQIA+, elle est une femme queer. L’obsession pour la cohérence morale des quelques personnes pour qui défendre une cause relève de la défense de leur propre existence masque les autres problèmes que pose le festival : on aura bien du mal à justifier la seule responsabilité des personnes LGBTQIA+ sur les questions écologiques. La segmentation des luttes et l’obsession de moralité demandées à chaque personne qui ne profite pas de la formule all-inclusive homme-hetero-cis-blanc a invariablement pour effet de faire peser toute la responsabilité d’une industrie oppressive sur les personnes les plus susceptibles d’être victimes de discriminations à différentes échelles. Décentrer le problème et élargir la focale permettrait de répartir le poids de la responsabilité sur les épaules de celles et ceux qui tirent profit du luxe de ne jamais y être confrontés.
L’interpellation d’artistes ou d’influenceur·ses identifié·es comme relais pour la visibilisation des luttes paraît inévitable dans un moment où la représentation médiatique ne suffit plus à dissimuler le rabotage progressif des droits et des conditions de vie des femmes, des pauvres et des minorités. On a beau retourner le problème dans tous les sens, la présence des personnes minorisées dans la pop culture implique forcément pour les artistes ou influenceur·ses de jouer avec les cartes de celles et ceux qui les distribuent, et cela aussi dans des espaces comme Coachella. Cela n’est ni incompatible avec le fait de critiquer sans compromis les politiques aux conséquences délétères qui permettent l’existence de ces espaces, ni de réclamer une politisation plus importante des figures qui incarnent les combats pour le grand public.
Sans pour autant balayer d’un revers de main tout questionnement par un cynique « il n’y a pas de consommation éthique sous le capitalisme », cette demande peut se faire sans rejouer la violence qu’iels subissent déjà bien plus que d’autres. Par ailleurs, ces relais dans la pop culture n’annulent en rien ni ne diminuent l’action des très nombreux·ses artistes engagé·es et radicaux·les, comme celle de la photographe Nan Goldin (voir le film récent de Laura Poitras Toute la beauté et le sang versé) ou, en France, de la comédienne Adèle Haenel. Au contraire, les différentes stratégies interagissent et se font écho, dans la mesure où le public sensible à ces causes renonce à la tentation de les opposer. Tant que Coachella existera, tant que les milliardaires monopoliseront les industries culturelles, tant que les avions voleront d’un bout à l’autre de la planète et tant qu’on jouera au golf dans le désert, en attendant que l’époque soit plus favorable aux grandes victoires sociales, il est sans doute souhaitable que les personnes discriminées n’abandonnent pas l’espace médiatique mainstream à ceux qui les oppressent.
Retrouvez Climarx sur TikTok !
Relecture et édition : Apolline Bazin, Léane Alestra et Sarah Diep
Illustration à la Une : Léane Alestra
Cet article Coachella : pourquoi c’est naze de se focaliser sur l’éthique des artistes queers provient de Manifesto XXI.

Quatre associations déposent plainte contre le youtubeur d’extrême droite Papacito, suite à la diffusion de deux vidéos agrémentées de déclarations homophobes à l’encontre de Christian Eurgal, maire de Montjoi.
L’article Plainte contre le vidéaste d’extrême droite Papacito pour injures et appels à la haine homophobes est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Après une banderole anti-LGBT déployée sur une grue à Rennes, c’est un passage piéton arc-en-ciel qui a été vandalisé, deux jours après son inauguration. La maire a déposé plainte.
L’article Un passage piéton aux couleurs arc-en-ciel dégradé à Quimper est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

M. Jean-Marc Berthon sera en déplacement au Cameroun pour évaluer la situation des personnes LGBT+ et assister à une conférence dédiée qui fait polémique. Certains évoquent même un risque de trouble à l’ordre public.
L’article « Tension » au Cameroun après l’annonce d’une visite de l’Ambassadeur français pour les droits des personnes LGBT+ est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Le Parlement estonien a approuvé ce 20 juin, par 55 voix contre 34, une loi légalisant le mariage pour toutes et tous, devenant ainsi le premier pays post-soviétique à l'autoriser. Le texte entrera en vigueur dès 2024.
L’article « Fière de l’Estonie », premier pays balte à légaliser le mariage pour toutes et tous est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Si vous avec 15 ans et plus, l'étude s’adresse aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans, intersex mais aussi non-binaires et au genre non-conforme. Il vous faudra environ 20 minutes pour répondre aux questions.
L’article Nouvelle édition de la plus grande enquête sur la situation des personnes LGBTIQ+ au sein de l’UE est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Ils ont été condamnés pour harcèlement scolaire le 5 juin par le tribunal pour enfants d'Épinal, mais leurs avocats reprochent au jugement de ne pas « individualiser » les agissements reprochés à chaque collégien.
L’article Suicide de Lucas : les quatre adolescents reconnus coupables de harcèlement font appel est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.



Trois jeunes, soupçonnés d'être sympathisants de l'EI et d’avoir planifié une attaque contre la Pride de Vienne, ont été arrêtés avant le début du défilé. Des armes ont également été saisis à leur domicile.
L’article Autriche : Une attaque terroriste contre la Marche des Fiertés déjouée à Vienne est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Le 23 janvier 2023 le gouvernement a lancé un guide sur « Le respect des droits des familles et futures familles LGBT+ ». Ce guide pratique a été mis en ligne par la Délégation Interministérielle à la Lutte Contre le Racisme, l’Antisémitisme et la Haine anti-LGBT (DILCRAH) et rédigé en collaboration avec l’Association des Parents et futurs parents Gays et Lesbiens (APGL), l’Association Des Familles Homoparentales (ADFH) et Les Enfants d’Arc en Ciel.
La publication de ce guide fait suite notamment à la promulgation le 3 août 2021 de la loi relative à la bioéthique et entre également dans le plan d’action national pour l’égalité des droits, contre la haine et les discriminations anti-LGBT+ 2020-2023 (voir Hétéroclite #156).
Ce guide de 48 pages recense les droits des familles selon leurs différentes configurations : PMA, parents transgenres, adoption, GPA. Deux chapitres abordent spécifiquement les questions de l’autorité parentale et des congés parentaux, tandis qu’un dernier donne des outils pour réagir face à des situations de discriminations dans l’exercice de ses droits. L’intérêt de ce guide, outre les informations apportées aux principaux·ales concerné·es, est qu’il a vocation à être diffusé aux personnes, structures et collectivités susceptibles d’intervenir pour les familles et souvent mal formées et informées sur leurs droits.
Bien que l’utilité de ce guide ne fasse aucun doute, il permet également de mettre en lumière le long chemin restant à parcourir pour aboutir à une égalité des droits entre toutes les familles ! En le parcourant, on lit noir sur blanc, ou parfois en creux, les trop nombreuses lacunes et retards du droit français au regard de la parentalité LGBT+ : interdiction de la PMA aux personnes transgenres, interdiction de la GPA, lenteur des procédures d’adoption et des parcours de PMA, obligation de la reconnaissance conjointe anticipée pour les couples de femmes, etc…
L’article Familles LGBT+ : Des inégalités encore manifestes est apparu en premier sur Hétéroclite.

Alors que Rennes célébrait la 29e édition de la Marche des Fiertés LGBT+, ce samedi 17 juin, une banderole hostile a été découverte flottante à plus de 60 mètres sur une grue de chantier.
L’article Banderole anti-LGBT déployée à Rennes en marge de la Pride : STOP homophobie dépose plainte est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.


En décembre 2022, ils avaient agressé et roué de coups trois autres jeunes, tranquillement attablés dans un bar, parce qu'ils étaient homosexuels. Ils ont été condamnés à des peines exemplaires. STOP homophobie était partie civile.
L’article Nice : Quatre jeunes de 19 ans condamnés pour des injures et violences homophobes est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Un homme de 46 ans a été condamné à 18 ans de prison pour avoir tiré des coups de feu sur le domicile d'une femme lesbienne, avec le délire de « débarrasser la ville de tous ses habitants LGBT + en les tuant ».
L’article États-Unis : 18 ans de prison pour une tentative de meurtre lesbophobe est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Les députés russes ont approuvé en première lecture une loi interdisant « les interventions médicales visant au changement de sexe », de suivre un traitement hormonal ou d'enregistrer à l'état civil des changements de mention du genre, sauf rares exceptions.
L’article Les transitions médicales et changement de genre à l’état civil désormais interdites en Russie est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Peacock fête ses dix ans les 8 et 9 juillet ! provient de Manifesto XXI.
Tu as prévu quoi les 8 et 9 juillet ? C’est les dix ans du festival Peacock Society donc, dans tous les cas, annule tout et viens faire la fête ! Pour cet anniversaire en grande pompe, l’équipe a programmé pas moins de 43 artistes qui joueront sur deux jours, de quatorze heures à minuit.C’est la troisième année consécutive que les DJs ambianceront le Parc de Choisy un véritable oasis de verdure à deux pas de Paris, accessible en RER (que demande le peuple ?). Pour souffler sa dixième bougie, Peacock reprend ses fondamentaux pour une expérience multi-sensorielle avec un line-up long comme mon bras. « Comme toujours, Peacock met un point d’honneur à représenter une belle diversité des cultures électroniques, des styles historiques aux nouveaux courants alternatifs » raconte Paul Bonabesse, l’un·e des programmateurices. Il reprend : « de nouvelles tendances sont à explorer chaque année, et nous avons la chance d’avoir une scène française à la pointe, garnie de talents ».
Cette année on retrouve « les piliers de Peacock »: Richie Hawtin, Paula Temple ou encore Bambounou qui jouera en B2B avec Bradley Zero. Mais il y en aura pour tous les goûts, de la house, du break, de l’italo-disco ou de la grosse techno… Vous aurez aussi la chance de voir jouer notre chouchou Lisa More, la reine de la rave Cera Khin ou la famille des Sœurs Malsaines, le collectif de fêtard·e·s enjoué·e·s et engagé·e·s. On retrouve également Nina Kraviz, la célèbre DJ russe critiquée pour sa prise de position timide en faveur de la paix l’année dernière quand à la guerre en Ukraine a éclaté. « Nous nous sommes beaucoup posé la question, s’il fallait la booker ou non. » reconnait Paul, programmateur de Peacock. L’équipe a estimé que la position de l’artiste était désormais suffisamment claire pour l’inviter a jouer pour la cinquième fois au festival: « On sait toustes ce que ça peut coûter à une artiste Russe de prendre position contre le régime de Poutine. Nina soutient depuis des années la culture underground russe qui est dans le viseur du gouvernement, ce qui est en soit un engagement. »
L’idée de cette programmation éclectique, c’est gommer les frontières entre les genres, rassembler les âges et les chapelles. Une espèce de tour d’horizon réjouissant de toutes les couleurs des musiques électroniques d’aujourd’hui. « On est assez fier·es d’arriver à représenter la diversité de la scène électronique actuelle. Ce n’est pas toujours évident d’arriver à trouver un équilibre dans un festival « underground ». Cette année autant les scènes house, break, techno, indus, proto reggaeton, jungle, footwork, gabber, UK, et même deep-house mélodique arrivent à vivre ensemble et en cohésion dans la prog » explique Paul Bonabesse. Les festivalier·e·s pourront naviguer entre quatre scènes dans une scénographie luxuriante pensée comme une parenthèse enchantée en pleine nature. « Pour celleux qui n’ont pas envie de mettre la tête dans le caisson toute la journée, on a aussi prévu des tipis où vous attendent plein de surprises ! Des karaokés, des talks, des platines ouvertes…» raconte le programmateur.
Mais la teuf ne s’arrête pas là. Pour célébrer les dix ans du festival, l’équipe a décidé de « pousser la fête plus loin, car chaque année on est un peu triste de se quitter à minuit. Alors pour la première fois Peacock investit 3 des meilleurs clubs parisiens, le Samedi soir à La Machine (x Global System), et au KM25 (x Maison Close), et Virage lendemain, comme pour célébrer la fin du festival tous ensemble en format plus réduit avec une prog surprise ! » se réjouit Paul Bonabesse.
Peacock, c’est aussi un festival engagé et bienveillant. Ainsi, l’équipe s’est entourée d’associations spécialisées dans la prévention des risques en milieu festif comme Fêtez Clairs qui oeuvre à la promotion d’une culture de la fête responsable. Analyse ton Prod’ Ile de France sera là également pour analyser gratuitement et anonymement les substances des fêtard·e·s qui le souhaiteraient. Enfin, pour lutter contre le harcèlement et les violences sexistes et sexuelles, l’équipe collabore avec Safer.safer, un dispositif visant à prévenir et porter assistance aux personnes qui en ont besoin. Le festival s’est engagé dans une démarche éco-responsable en misant notamment sur une alimentation en électricité par des générateurs fonctionnant aux biocarburants.
Pour retrouver le programme complet sur deux jours, rendez-vous juste ici.
Cet article Peacock fête ses dix ans les 8 et 9 juillet ! provient de Manifesto XXI.

Suite à un signalement du rectorat d’Amiens le parquet indique avoir ouvert samedi une enquête pour « diffamation », « injure » et « provocation publique à la haine et la discrimination » à l'encontre notamment du chef d’établissement.
L’article « Enquête ouverte » après les « propos homophobes » du directeur d’un lycée catholique de Compiègne est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Hot wings and tenders : les poèmes queers, tendres et frits de Marl Brun provient de Manifesto XXI.
Les éditions Burn~Août publient Hot wings and tenders, recueil de poèmes de Marl Brun dans la nouvelle collection 39°5. Crues, drôles, libérées de toute gêne formelle, parfois obsédantes mais toujours réconfortantes à la fin, les poésies de Marl Brun regorgent d’une sensibilité brute et analytique. L’introduction du livre est signée Sarah Netter, qui nous propose ici une lecture personnelle de l’ouvrage. L’édition est bilingue anglais-français et chaque poème est traduit par les ami·es de Marl.Hot wings and tenders de Marl Brun est un recueil de poèmes explosif et accrocheur, qui se dévore avant de dormir, en mangeant, aux chiottes, en faisant du vélo d’appartement… « Cru, queer, tendre et frit » : c’est une conversation rassurante que l’on n’a pas envie d’arrêter. Avec un humour subtil, qui se dégage au travers d’images criantes, ces poèmes nous rappellent que tout rapport humain est politique. En explorant l’intimité d’une personne queer, de son corps et de sa matérialité, ces textes nous mettent face à nos propres vécus, sans fioritures ni faux-semblants. Un portrait désarmant et plein de sincérité sur la découverte de soi, de sa sexualité, de la baise et de ses multiples possibilités, de notre rapport à l’étrangeté du monde et comment y survivre avec panache.
Artiste et poétesse, Marl Brun a développé une pratique vidéo d’installation de textes. Depuis ses études en Islande, elle travaille essentiellement sur l’écriture de textes en anglais qu’elle fait ensuite traduire en français par ses ami·es. Hot wings and tenders, son premier livre, explore les sujets de l’identité, du sexe, de l’amour et de la bouffe en nous plongeant dans une matérialité sans équivoques. Il est introduit par Sarah Netter, artiste, auteur·ice, traducteur·ice. C’est une rencontre inévitable entre deux âmes qui aiment triturer l’écriture et partagent une passion pour le poulet frit et toutes ses déclinaisons. À travers leurs pratiques respectives, les deux malmènent l’accord commun, le sens du goût, l’idée-même du moche et la frontière entre le moche et le vraiment laid. En cela, leurs écrits se rejoignent. Ils donnent vie, ensemble, grâce à l’amitié qui les unit, à un langage queer qui se joue même des plus queers des normes. Pour Manifesto XXI, Sarah Netter signe ce texte libre qui raconte (ou pas ?) cette rencontre et cette adelphité. Un compte-rendu du recueil qui nous plonge déjà dedans.

« Kids and Dykes », in Marl Brun, Hot wings and tenders, éditions Burn~Août, 2023
Je me demande à quel point on finit par se ressembler entre nous entre amixs, est-ce qu’on fait l’effet d’une teinture racines apparentes ?
Sarah Netter
Avec toi we can feel to reconnaitre quelles langues mix and matchent, qui se lèchent entre elles pour mieux oser lécher dehors.
Quelles croutes de poulet méritent notre attention, d’orange, de doigts dans, de sale dans/sur, de quand t’as glissé dans ta douche en essayant quelque chose, de pigeon choqué par le fait qu’il y ait toujours autant de bagnoles et pas assez de chienxs dans la vie.
Obligé.e.x de te sentir flex pour pas que ça soit juste la life qui te roule dessus
Obligé.e.x ou juste rappelé.e.x au wandering ?
Being passagèr.e.x de la vie n’est pas un truc de vicos.
C’est vraiment comme rider mais à pied, en ayant toujours un peu froid, pck tu voulais être sexy donc t’as pas mis de pull.
How to déconstruire la productivité militante/le productivisme militant
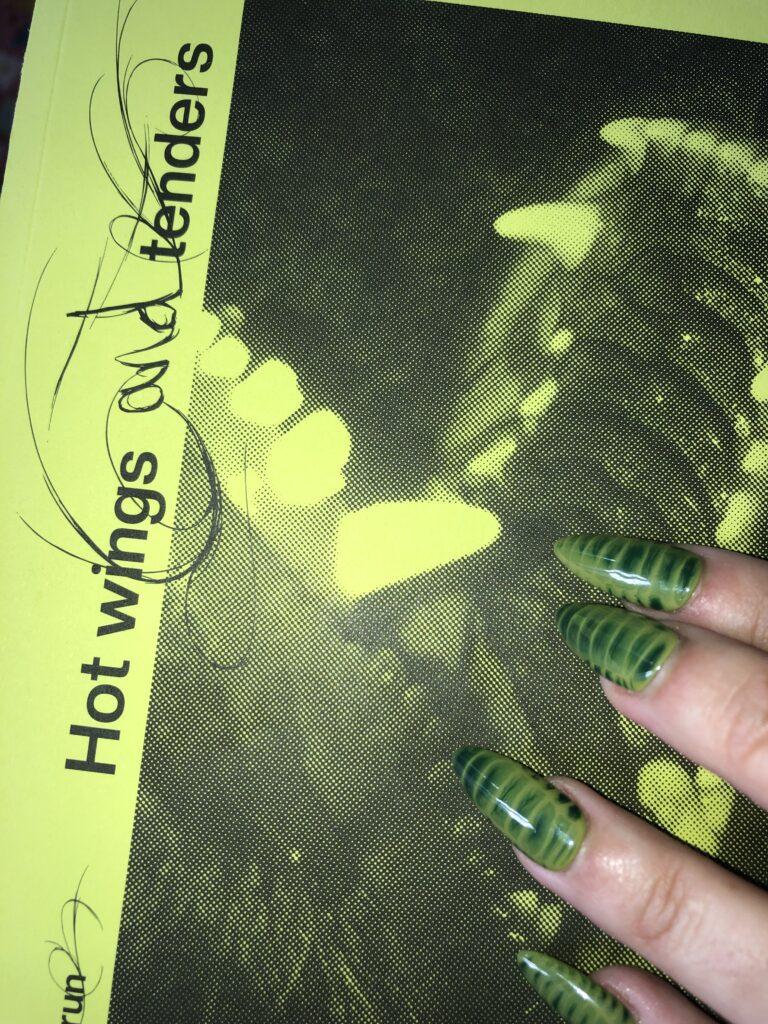
Couverture de Hot wings and tenders, graphisme par Fanny Lallart
reading
your.others
books/gentes
en plusieurs langues/voix
situées
non pro
qui s’aiment
à voix
hot
est ce qu’on peut intervertir, convertir ou fusionner horniness et avoir la dalle / envie que quelque chose se passe ?
est ce que toi aussi t’arrives parfois à changer ton stress en envie de (te) baiser
Je crois que ton first poem du livre, Kids and Dykes, est en train de devenir ICONIC
je pense qu’on traine pas assez avec des enfants, et qu’on a de la chance de trainer avec tousxtes ces dykes
(merci merci merci)
I want more for us.
Hâte des moments où les gens finiront par te demander si tu préfères les kids les chienxs ou les dykes (being one doesn’t prevent to be others)
Comment t’arrives à faire de tout ça un endroit bien muddy et moody.
Je me suis demandé si c’était pas parce que tu sais jamais où t’es et que tu belong jamais vraiment. Que c’est pour ça que ct kdo de se vautrer dans l’endroit le supposément + neutre / lisse / commun de l’anglais
ça doit être comme se tacher lourdement dans un resto branché ou sourire après avoir mangé du choco.
Vaut mieux rire, déjà que c’est pas toujours facile si en plus ce qui nous maintient on the hook vibrantxs c’est de bien suivre les consignes :
la dép
c’est pas mal de venir tâcher les langues qu’on nous instruit comme hégémoniques
ça aide à considérer toutes les tâches / fxmmes / chutes / erreur de ta vie
(choeur d’after : en moi réuuuuuniiiiieeeeexxssss)
Et puis tu aides à encaisser la sidération
(alors en fait sidération veut dire quelque chose de bien + vener que ce que je pensais)
je voulais trouver d’autres manières de dire que “c’est pas pck tu fais rien que tu subis”
Développe “rien faire” tu dirais,
ça va, on essaye déjà beaucoup de pas être comme nos parentxs et/ou nos chef.fxs je trouve
ça prend grave de temps
V. said “c’est chiant mais formateur”
lol
hyper d’accord
Jamais l’impression d’abandonner mais pas dedans non plus, i couldn’t express that feeling and then someone said “tu sais je suis pas combatif”
how can you be loyal.e.x et pas combattif.x.ve
pck iels font chier les gentes qui veulent toujours gagner
Est ce que j’ai bien compris ?
whatever it means comprendre
est ce que j’ai compris ou est ce que j’ai feel what I felt when it happened
Like l’envie de s’autoriser à sourire à lécher à choper
i wish
c’est le printemps
tout le monde fait semblant que c’est une évidence excitante
Heureusement que t’es là. T’es jamais en mode “c’est trop simple de faire”, pas d’incitation au passage à l’acte, à la preuve par le faire.
What do you mean by faire is supposed to be different de feel ?
Trop bizarre, je me suis posé là dessus et je me suis dit omg voilà. Toujours pareil. Dissociation because trauma, trahison, répétition de la trahison mais répétition de la vie en même temps puis confusion, réactions mal interprétées et enregistrées au mauvais endroit dans mon corps pour les mauvaises raisons malgré beaucoup de joie et de playfulness.
Je crois que c’est là qu’on a commencé à séparer faire de feel
I feel you frétillante, vibrating to meet (welcome?) new stuff, gentes, situations
Right now do you feel more like a kid, a dyke or a chienx ?
C’est d’autres temporalités, c’est long mais pas subi.
Can we talk about contemplation ou c’est old school ?
Mdr
Tu ré-investis la littérature contemplative.
Hâte de voir un bout de papier épinglé avec écrit ça dessus dans une librairie où tu serais le coup2keur contemplatif du mois.
Tu vois pour moi c’est sur le spectre de l’expression “croquer la vie à pleines dents” mais autrement.
à
chaque
fois
j’imagine une pomme méga dure et froide
j’ai toujours trouvé ça hyper austère les pommes.
Et puis on peut pas croquer la vie à pleines dent, c’est pas vrai, ça fait mal et c’est pas grave mais au moins toi tu fais pas croire aux gens que la vie c’est comme on veut si on veut.
It takes time to feel and process what we think we feel
c’est pas aussi simple que ça, peut-être moins
(je suis obsedé.e par dire “peut-être moins” en ce moment, j’ai l’impression que ça résume ma life = prudence mais tout est toujours possible)
I like your texts learning us to be more prospectif.ves mais pas explorateurices.
La vie c’est + comme manger du fried poulet ou whatever chose frite, c’est souvent trop chaud ou pas assez et tu sais jamais à quel point ça va être gras piquant ou secos mais tu continues
pck il faut savoir kiffer les choses réconfortantes instables.
Tu penses que les chien.x.nes sont très jeux de mots ?
En tout cas merci de pas laisser les jeux de mots aux boomers iels le méritent pas, alors qu’on mérite grave des jeux de mots
on devrait rire +
j’aimerais qu’on rie + en lisant des choses vener et aimantes
jamais rire des autres et pas systématiquement de soi non plus
on a même pas envie de se moquer quand tu prends les choses (trop?) au sérieux
c’est trop touchant et courageux.
Parfois je me dis que t’es quand même une enquêteuse de la life,
genre oulala attendez je suis pas experte moi on s’en fout des experts mais ça par contre je suis sur que je veux + comprendre pourquoi.
Tu mérites une émission de télé bb.
C’est même pas pour faire catégorie,
on pourrait penser que pck t’es taureau ton besoin inavoué était de faire des catégories plus précises et diverses designées par toi mais même pas
toujours autant surpris par ton absence d’autorité
ça suffit pas de décider d’être accueillante
faut arrêter de toujours tout décider et vouloir savoir maintenant
ça aide souvent de se perdre entre ses mots et ceux où on sait plus si on les a dits ou pas ni à la personne qu’on voulait
living with (dog, heat and love) ghosts in a fried queer life
est ce qu’on dit que c’est les gens qui finissent par ressembler à leurs chien.x.ne.s ou les chien.x.ne.s qui finissent par ressembler à leurs gens ?
Je me demande à quel point on finit par se ressembler entre nous entre amixs, est ce qu’on fait l’effet d’une teinture racines apparentes ?
En fait, je crois que tu m’as dit que ce que disent les gens à leurs chien.x.ne.s iels le disent pour iels mêmes.

Sarah Netter & Marl Brun au lancement de Hot wings and tenders à la galerie Treize, en mai 2023 à Paris
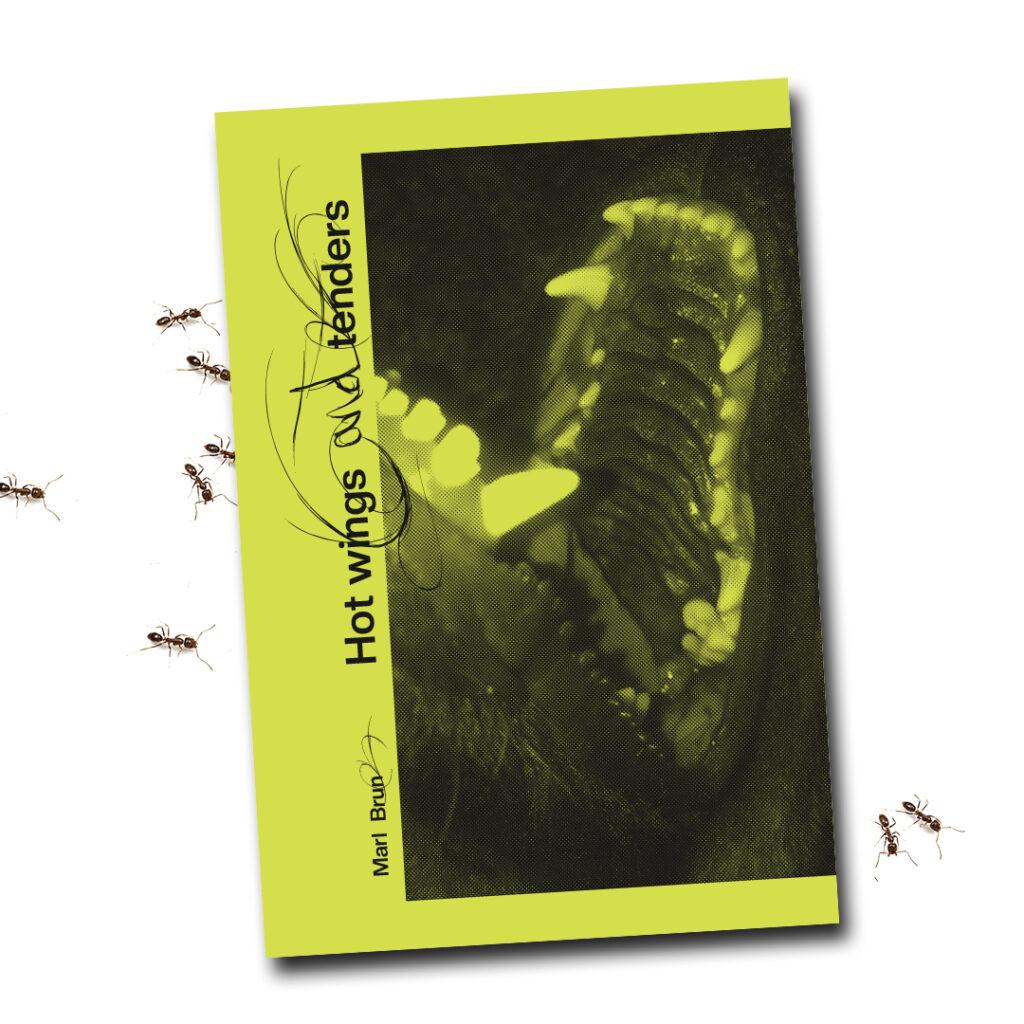

Hot wings and tenders, éditions Burn~Août, graphisme par Fanny Lallart
Image à la une : couverture de Hot wings and tenders, graphisme par Fanny Lallart
Relecture, édition et introduction : Costanza Spina & Sarah Diep
Cet article Hot wings and tenders : les poèmes queers, tendres et frits de Marl Brun provient de Manifesto XXI.

Après l'attaque du centre LGBT+ à l'explosif, ce sont les passages piétons aux couleurs arc-en-ciel installés pour le mois des fiertés qui ont été dégradés. La mairie annonce porter plainte.
L’article Des passages piétons arc-en-ciel dégradés à Tours est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.


Dans son rapport, l'inspection ne menace pas le contrat liant l’établissement à l’État mais a fait savoir qu’un signalement visant la direction avait bien été effectué auprès du parquet.
L’article Propos homophobes au sein d’un lycée catholique de l’Oise : le rectorat de l’académie d’Amiens alerte le procureur est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Les messages contenaient un lien renvoyant vers un site Internet « encourageant des actions de violences ultimes à caractère racistes, antisémites et homophobes », avec « plusieurs références explicites au régime nazi et au négationnisme de la Shoah, ainsi qu’un retour au national-socialisme ».
L’article Plus de 80 parlementaires de la majorité portent plainte après des courriels racistes ou homophobes est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article D’où vient le slogan « Bravo les lesbiennes » ? Enquête provient de Manifesto XXI.
Qu’il soit scandée en manif, tweeté à tout va ou entendu en soirée, « Bravo les lesbiennes » est devenu le slogan de toute une communauté. Né lors d’une soirée, retracer son origine nous emmène dans les méandres de Twitter, entre un discord lesbien, le ZEvent 2021, le youtubeur Antoine Daniel et le 11e arrondissement de Paris. Enquête.Apparition dès novembre 2021En disant « Bravo les lesbiennes » on présuppose non seulement l’existence des lesbiennes mais surtout leur existence au PLURIEL, la force de ce slogan c’est l’affirmation du collectif.
Léo Guerrier
Vue sur des pancartes, hurlées à chaque apparitions publiques d’une lesbienne connue, en 2023, l’expression « Bravo les lesbiennes ! » semble être entrée dans les mœurs saphiques et faire office de devise officielle, au point d’en oublier qu’il s’agit, en vérité, d’une tournure de phrase extrêmement récente. Si on remonte le fil, elle semble s’être popularisée en octobre 2021, suite à un stream du youtubeur Antoine Daniel, pendant le ZEvent. Cet événement caritatif a été fondé en 2017 par deux streamers français. L’idée est de réunir sur plusieurs jours de nombreux streamers francophones afin de récolter des dons pour des associations. Extrêmement populaire, notamment auprès des plus jeunes, ce marathon en ligne a permis de lever plus de dix millions d’euros en 2021 pour Action Contre la Faim. Les spectateur·ices sur la plateforme Twitch font leurs dons en direct du stream (retransmission d’un participant qui joue à un jeu vidéo, par exemple). Les noms des donneur·ses s’affichent en temps réel dans la barre de conversation à côté de l’écran et la coutume veut que le·la streamer le·la remercie en citant son nom.

Antoine Daniel, un des youtubeurs les plus connus de France, participe comme ses confrères et consoeurs à l’événement en 2021. Lors d’un de ses directs, une personne dont le pseudo est Bravo les lesbiennes réalise un don de 7€. Antoine Daniel s’exclame alors « Merci beaucoup, bravo les lesbiennes pour les 7 balles ! ». À partir de ce moment-là, de nombreux·ses internautes se mettent également à faire des dons sous le pseudonyme « Bravo les lesbiennes », afin d’inciter les streamers à prononcer le terme. Cet épisode fait le buzz sur Twitter, au point que certain·es participant·es du ZEvent demandent à leur audience d’arrêter d’utiliser ce pseudo, craignant qu’il s’agisse d’un détournement lesbophobe. La première donneuse nommée Bravo les lesbiennes, dont le pseudo est @meufmanga, tweete à ce propos : « Je n’ai pas réalisé les conséquences de mon don et honnêtement c’est le meilleur scénario » le 30 octobre 2021. Sur Twitter, le terme explose en terme de visibilité, et se retrouve même dans le top des tendances France le 31 octobre 2021. Du côté de Google, la phrase est également très recherchée à partir de ce moment-là. Néanmoins, même si l’usage a été popularisé sur Twitter, puis, plus largement dans la communauté en octobre 2021, il faut remonter encore en arrière pour retrouver son origine.
Une soirée lesbienne où tout commenceAvant la fin d’année 2021, il existe des occurrences de « Bravo les lesbiennes » sur Twitter. Majoritairement employée par la communauté lesbienne en ligne sur le réseau social, il existe également des photos de pancartes de manifestation « Bravo les lesbiennes » à la Pride de juin 2021, ou encore des vidéos prouvant que la phrase est hurlée lors d’un concert des chanteuses Pomme et Angèle 14 septembre 2021. Grâce à Twitter, il est possible de remonter toutes les mentions du terme jusqu’en août 2020, le 8 précisément. Avant cette date, il n’existe aucun tweet faisant mention de « Bravo les lesbiennes ». Lorsque l’on consulte l’historique du réseau social à partir du 8 août 2020, plusieurs internautes parlent d’une soirée lesbienne ayant eu lieu à Paris, où le terme serait apparu.

Ce jour-ci, le pseudo @blakeclipse tweete : « trop bien la soirée bravo les lesbiennes mais g pas parlé à assez de personnes : ( » Effectivement, une soirée lesbienne a bien eu lieu sur Paris le 7 août 2020. Elle a été organisée par Salomé Sourati, jeune femme à l’origine pendant le premier confinement d’un Discord (espace d’échange en ligne permettant de discuter autour d’une thématique) dédiée aux lesbiennes racisées. Une fois le confinement fini, elle décide de créer une soirée pour que la communauté se rencontre en vrai, et choisit de l’ouvrir à toutes les femmes qui aiment les femmes, lesbiennes ou bies. « On s’entendait bien, on venait d’être déconfinées, il y avait un grand manque, on était beaucoup à se sentir très isolées. Les soirées lesbiennes n’allaient pas reprendre tout de suite à cause de la pandémie. C’est dur à vivre de ne pas avoir de lien social. »
Elle réserve le bar La Bonne excuse dans le 11e arrondissement de la capitale et invite son réseau. « On partage des flyers sur Twitter et tout de suite, on a eu à peu près 70 personnes qui étaient intéressées. Au total, ce sont une cinquantaine qui sont venues. » La soirée se déroule dans la bonne ambiance, un karaoké a lieu, on y chante des tubes des années 2000, tout le monde semble y avoir passé un excellent moment. Salomé confirme que le terme « Bravo les lesbiennes » a bien été entendu, et tweeté ensuite par les participantes le lendemain. Qui en est à l’origine ? D’après Zoé, une autre des lesbiennes présentes sur place : « En gros, on était un groupe de 5 à se dire bravo pour la soirée, et l’une de nous a dit “bravo les lesbiennes !”. » Cet échange aurait eu lieu sur le trottoir devant le bar, à la fin de la soirée. Parmi ce groupe de cinq, aucune ne se souvient de qui a dit la phrase en premier. Néanmoins, c’est à partir de ce moment-là que la machine s’est lancée !
 Une expression à forte valeur symbolique
Une expression à forte valeur symbolique
Largement popularisée depuis, le terme est devenu une expression à forte valeur symbolique. Pour Léo Guerrier, linguiste : « En disant « bravo les lesbiennes » on présuppose non seulement l’existence des lesbiennes mais surtout leur existence au PLURIEL, la force de ce slogan c’est l’affirmation du collectif. » Le sens de la phrase est double, ajoute-t-il : « Le bravo marche dans deux sens : prononcé par des lesbiennes, il a quelque chose de l’ordre de la construction du groupe, on se congratule mutuellement pour la soirée (et plus tard, pour les luttes) ce qui participe à la construction de la cohésion du groupe. Il est aussi utilisé depuis par des personnes qui ne sont pas (ou plus) lesbiennes pour s’adresser à cette communauté, et alors c’est au-delà du compliment, c’est autre chose qui se joue : c’est à la fois la réaffirmation que cette commu existe en tant que telle et aussi l’expression d’une solidarité d’ordre performative (le dire c’est déjà soutenir). » La logique linguistique de la phrase est aussi historique : « Dans les deux cas, ça construit les lesbiennes comme actrices de l’histoire ! » conclut le linguiste. Dans la communauté, cette phrase s’utilise maintenant à chaque moment de joie, de fierté ou de revendication lesbienne, et risque bien de perdurer encore longtemps. BRAVO LES LESBIENNES !
Relecture et édition : Costanza Spina
Image à la une : Montage par Léane Alestra
Cet article D’où vient le slogan « Bravo les lesbiennes » ? Enquête provient de Manifesto XXI.

Dans le magazine So Foot, l'ancien arbitre mayennais dénonce une homophobie généralisée dans les instances du foot français. Et s'il a décidé de s'exprimer ouvertement, « c'est au nom de toutes les victimes ».
L’article L’ancien arbitre international Nicolas Pottier porte plainte pour viol, harcèlement moral et sexuel est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.


Le départ est annoncé pour 14h, après la prise de parole. A 16h30, le cortège marquera 3 minutes de silence en hommage aux victimes du VIH-SIDA. Pour une arrivée à partir de 17h30 sur la Place de la République, avec un Grand Podium, des artistes et animations.
L’article Marche des Fiertés LGBTI+ de Paris et d’Ile-de-France 2023 est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Faisant écho à son livre, l’ancien footballeur Ouissem Belgacem revient sur son parcours et l'homophobie qui gangrène le sport, dans un documentaire en quatre épisodes disponible sur Canal+.
L’article « Adieu ma honte » de Ouissem Belgacem : une série documentaire pour sensibiliser le monde du sport est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Un jeune de 21 ans a été pris à partie et injurié dans une supérette de Lille par un individu qui, ne comprenant pas pourquoi il était maquillé, lui a lâché « t’es un pd du coup ? ». Il a également tenté de l'agresser physiquement, sans qu'aucun client ou personnel du magasin n'intervienne.
L’article Agression homophobe dans un supermarché de Lille : « Personne n’a réagi, ni les clients ni le personnel » est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.


Toutes les références « lesbiennes », « gays », « bis » et « trans » ont notamment été recouvertes de peinture, ainsi que les logo, coordonnées et infos pratiques de l'association qui va déposer plainte.
L’article La façade du centre LGBT+ 66 de Perpignan dégradée par des tags LGBTphobes et croix celtique est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Les quatre collégiens qui étaient poursuivis pour le suicide de Lucas en janvier ont été condamnés pour harcèlement scolaire, mais le tribunal pour enfants d'Épinal n'a pas retenu de lien de causalité entre ces faits et le suicide de l'adolescent.
L’article Suicide de Lucas, 13 ans : quatre adolescents reconnus coupables de harcèlement est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Transphobie en club : « La “sécurité” n’est jamais pour les corps minoritaires » provient de Manifesto XXI.
Après la publication sur Instagram d’un texte dénonçant l’agression transphobe qu’elles ont subie à l’entrée d’un club de Marseille, la DJ edna, la poétesse Luz Volckmann et leur amie Sunsiaré reviennent sur l’affaire, et sa triste banalité. Pour prolonger la réflexion, nous avons discuté washing, sécu et culture militante marseillaise.Fin avril, edna est invitée à jouer lors d’une soirée organisée par un collectif queer dans un lieu festif d’un quartier populaire de Marseille. La DJ arrive avec deux copines, toutes les trois sont des personnes trans. À l’entrée, le personnel de sécurité commence à les mégenrer et tente de leur imposer une palpation par des hommes. Le ton monte et la situation tourne au scandale.
Pour dénoncer et rendre visible cette histoire, edna et Luz rédigent un texte : « Petite visite en transphobie ordinaire ». Publié sur leurs comptes Instagram, le post sera lu et partagé des centaines de fois, mais essentiellement dans des cercles trans et queers. Nous leur donnons ici la parole pour développer, au-delà de cet événement précis, ce que représentent les enjeux de sécurité dans les lieux festifs, et comment lutter contre la transphobie en club. Peut-on espérer être un jour safe en dehors des seules organisations en non-mixité queer ?
Voir cette publication sur Instagram
Si t’as l’air trop schlag, trop arabe, trop trans, la sécu est là pour faire en sorte que tu ne rentres pas, ou que tu sois juste découragé·e de venir. C’est très symptomatique de cette pensée : “On veut bien votre travail artistique, par contre ne ramenez pas vos potes !”
Luz
Manifesto XXI – D’où est partie cette nécessité de vous exprimer publiquement ? Pourquoi cette fois-ci, ça a été plus urgent qu’une autre ?
edna : On avait envie de profiter de l’occasion de visibiliser cette histoire, parce qu’en fait, c’est une histoire très très banale. Ce sont des choses qui arrivent vraiment tout le temps quand on est une personne trans et qu’on vient assister à un événement, les embrouilles avec la sécurité sont quasiment systématiques. La seule différence cette fois-ci, c’est que cette embrouille a eu lieu alors que je venais en tant qu’artiste, donc j’ai pu, au terme d’une longue altercation, refuser de présenter mes papiers pour la palpation, donc refuser la violence transphobe, mais aussi visibiliser l’histoire après coup. Tandis que quand on fait partie du public, on ferme sa gueule, on se fait palper par un homme et c’est tout.
Je me suis aussi dit que le fait de visibiliser cette histoire faciliterait le travail des orgas à l’avenir, à Marseille du moins, sachant qu’il y aurait un précédent connu. Parce que les personnes qui organisent des événements dans ce genre de lieux cherchent à négocier leurs conditions : que les toilettes soient non-genrées, que le public puisse choisir les vigiles qui les fouillent, que les artistes se fassent traiter correctement, etc. Mais la négociation n’est pas toujours facile.
Luz : Aussi, quand on est arrivées sur place, on sortait d’un mariage de personnes trans. Ça a fait un très joli contraste entre l’amour, la tendresse et la joie des personnes trans qui se retrouvent et célèbrent tout ça, et l’arrivée dans cet endroit terrible et moche, où tout ce qu’on nous propose, c’est de la violence. Le contraste nous a d’autant plus motivées à parler de cette expérience publiquement.
Quelle a été la réaction de la part du lieu ? Avez-vous trouvé ça satisfaisant ?
Luz : Le lieu a répondu quelques jours plus tard, après qu’une certaine mayonnaise ait pris, avec un communiqué qui disait en somme : « Nous sommes de gentilles personnes et nous ne cautionnons ni les discriminations, ni tout ça dans notre lieu. » En ne nommant rien, comme si rien de transphobe ne s’était passé. La discrimination n’a pas été pointée du doigt. Iels peuvent avoir le discours le plus généraliste, mais ça invisibilise encore plus l’affaire. « Quelque chose s’est produit, mais nous sommes contre les discriminations », ce qui ne veut absolument rien dire, alors qu’on désignait une agression très précise, dans un cadre très précis. Donc non, ce n’était vraiment pas satisfaisant.
edna : Après, on ne cite jamais le lieu dans le texte, même s’il est possible de retracer facilement l’information, parce que notre but n’était pas de call out ou de partir en guerre contre elleux. Ne pas le mentionner clairement, c’était une manière de montrer à quel point c’est quotidien : ça arrive tout le temps, ça aurait pu se passer partout où j’ai joué dans ma vie. À part dans des espaces autogérés, où on peut imposer nos propres sécu, nos moyens, nos staffs…
Une solution, c’est d’avoir plus de lieux, mais surtout des lieux politisés. Sans culture politique ou militante, ça devient du vent.
edna
Vous diriez que ce genre de position s’apparente à du queer washing ?
edna : Je ne sais pas si c’est du queer ou du féministe washing…
Luz : Ou juste du washing ! Leur discours, c’est « on est propre » ! (rires) Ce qui s’est passé est très symptomatique, d’autant plus que c’est l’artiste programmée qui a subi une agression transphobe. Ces lieux qui ont de la visibilité invitent des artistes trans, racisé·es, précaires, parce qu’on fait de l’excellent travail, parce que c’est classe. En revanche, il ne faut pas que ces minorités ramènent leur public. Ce lieu participe à la gentrification d’un quartier populaire de Marseille, tout est fait à l’entrée pour que le public soit uniquement composé des petits bobos du centre-ville. Et il faut que les petits bobos du centre-ville fassent la fête tranquillement. Si t’as l’air trop schlag, trop arabe, trop trans, la sécu est là pour faire en sorte que tu ne rentres pas, ou que tu sois juste découragé·e de venir. C’est très symptomatique de cette pensée : « On veut bien votre travail artistique, par contre ne ramenez pas vos potes ! »
edna : Ce que je trouve très parlant, c’est qu’il y ait écrit « sécurité » dès le début de leur page de prévention, et cette espèce de discours « on veut qu’il y ait de la bienveillance, que tout le monde soit libre de faire ce qu’iel veut, etc. », c’est une invisibilisation de tout ce qui peut se passer. Quelque chose de plus satisfaisant, ce serait : condamner les comportements homophobes, misogynes, racistes, les agressions, les viols, etc. Iels ne le font pas parce que ce serait reconnaître que ces violences existent, et qu’elles peuvent exister de leur fait aussi. Iels doivent être prêt·es à dire « on veut que tout le monde se sente bien, mais on veut particulièrement faire de la place aux personnes qui sont en danger » – parce que c’est ça qu’on leur demande de reconnaître ! Surtout avant le mois des fiertés, où on va entendre « love is love » partout, mais jamais « les personnes trans, les personnes queers, sont en danger ». Reconnaître ça, c’est reconnaître qu’il faut se bouger le cul pour nous accueillir un peu mieux que ça. Et iels ne sont pas prêt·es. Parce que ça demande 1) de se décentrer, 2) des moyens. Le queer washing paye mieux !
On fouille nos sacs pour voir s’il n’y a pas d’armes, mais si nous venons potentiellement armé·es, c’est justement pour notre sécurité quand la soirée se termine, que nous ne pouvons pas nous payer de taxi pour rentrer chez nous.
Sunsiaré
Ça soulève l’épineuse question de la sécurité dans les lieux festifs. En anglais, on a cette distinction intéressante entre « security » et « safety ». Il y a en effet des règles à accepter pour que les choses se passent bien dans une soirée. Où se trouve l’équilibre pour pouvoir être dans le lâcher-prise, l’amusement, et en même temps que ce soit safe pour tout le monde ?
edna : La sécurité, quand on la nomme si fort, c’est une « sécurité » pour qui ? Ce n’est jamais pour les corps minoritaires. Les événements où on peut effectivement se sentir bien, ce sont ceux où les orgas ont plus de pouvoir sur la sécurité s’il doit y en avoir une, sur comment le public et les artistes sont accueilli·es.
Sunsiaré : La question, c’est : pour qui la sécurité travaille-t-elle dans les lieux festifs ? Ce ne sont en général pas les organisateur·ices de ces événements qui embauchent ce personnel, mais les propriétaires des lieux. Quand on prend l’exemple des consommations de produits, iels ne sont pas là pour faire de la réduction des risques ou veiller à notre santé, mais pour s’assurer que le lieu ne risque pas une fermeture administrative. On fouille nos sacs pour voir s’il n’y a pas d’armes, mais si nous venons potentiellement armé·es, c’est justement pour notre sécurité quand la soirée se termine, que nous ne pouvons pas nous payer de taxi pour rentrer chez nous. À notre avis, c’est aux organisateur·ices de ces fêtes de penser et de former la sécurité en fonction de leur audience. Ça se faisait par exemple au Pulp à Paris au début des années 2000 avec un personnel exclusivement butch et ça fonctionnait très bien. En tant que personnes queers/trans, la non-mixité demeure un vrai gage de sécurité. Malheureusement, elle n’est quasiment jamais respectée, et on capitalise sur nos existences pour vendre plus d’entrées.
Comment faire passer nos revendications sans s’épuiser nous-mêmes ?
edna
La priorité se situe où aujourd’hui selon vous ? Une des solutions, c’est de continuer à créer ses propres lieux et événements ?
edna : Alors, il y a beaucoup d’urgences avant ça, comme le retrait de la réforme des retraites, priorité numéro 1 ! (rires) Ensuite ouvrir nos propres lieux, c’est aussi très lié à une autre problématique qui est celle de la gentrification. Il me semble important qu’il y ait une attention portée à des questions qui ne sont pas que spécifiquement queers. Par exemple, l’asso Baham, qui est focalisée sur des questions queers minoritaires, afro-queers ou trans, a une approche plus intéressante selon moi, parce qu’elle croise plusieurs problématiques. La Dar Lamifa, c’est aussi un lieu important, qui mêle plein de luttes différentes. Une solution, c’est donc d’avoir plus de lieux, mais surtout des lieux politisés. Sans culture politique ou militante, ça devient du vent. Parce que faire de vrais efforts d’inclusivité, ça demande de s’intéresser, de connaître les problématiques spécifiques à tel ou tel groupe. Ça demande de se dire : « Peut-être que je ne sais pas tout et je vais fermer ma gueule, faire le taf et écouter. » Les call-out, ça ne fait presque plus peur aujourd’hui, parce qu’il y a des community managers payé·es, spécifiquement entraîné·es à la gestion du call-out. Notre post, ça les a peut-être gêné·es, mais pas assez pour créer un vrai rapport de force.
Comment faire passer nos revendications sans s’épuiser nous-mêmes ? En ce moment, avec un collectif trans, on veut organiser un événement sur plusieurs jours et on s’en rend bien compte : trouver des lieux et pouvoir les faire se plier à nos conditions, c’est se garantir des heures et des heures de réunions qui ne vont peut-être servir à rien. C’est de l’épuisement pour des gens d’une communauté déjà épuisée par la vie et les activités militantes.
De manière générale, même à Paris, on manque de lieux. La Flèche d’Or est un lieu central pour la vie queer trans parisienne, mais sa pérennité n’est pas garantie, notamment à cause de problèmes de tunes. Donc oui, la question des lieux est centrale, mais aussi vachement complexe. Il faut prendre en compte les rapports de force avec les situations existantes.
Relecture et édition : Anne-Charlotte Michaut
Image à la une : © edna & Luz
Cet article Transphobie en club : « La “sécurité” n’est jamais pour les corps minoritaires » provient de Manifesto XXI.

Cet article L’enterrement – Des amis qui vous veulent du bien, par Fania Noël provient de Manifesto XXI.
Avez-vous déjà vécu une situation sexiste sans réussir à mettre le doigt sur ce qui clochait exactement ? La remarque anodine d’un camarade militant qui reste en travers de la gorge, une réaction véhémente d’un ami pourtant progressiste ou bien la « blague » cringe d’un collègue ? Le diable est dans les détails, le sexisme le plus difficile à dénoncer est peut-être celui qu’on appelle « bienveillant », celui des hommes « bien », bien diplômés, bien gentils, bien entourés et bien « féministes ». Dans ce cycle de 8 chroniques, la chercheuse et militante afroféministe Fania Noël vous propose de décortiquer des situations quotidiennes avec une courte fiction éclairée ensuite par une notion de critical feminist theory. [3/8]« Peut-être 2019 », « L’anniversaire en 2011 », « L’annonce du cancer », « Les 80 ans de Nana »… Cela fait deux semaines que Dana est aux prises avec un monologue interne. Deux semaines également qu’elle fonctionne en pilote automatique, suivant à la lettre LA to-do list. La veille de l’enterrement, elle avait prémédité de s’enfuir dans la maison familiale pour éviter les condoléances, les anecdotes sur sa défunte mère, et ces visages qui avaient disparu pendant les trois séances de chimiothérapie. Un stratagème qui s’était révélé inutile, d’abord au funérarium, et maintenant à la réception où son père est le centre de l’attention.
Déambulant entre la cuisine et le salon pour s’assurer que les invité·es ne manquent de rien, Dana, que tout le monde décrit comme une « fille à papa », rumine la rancœur qu’elle éprouve pour son père : rien n’y fait, même si le voir ainsi perdu et déboussolé dans cette maison qu’il lui faudra habiter seul après trente-cinq ans de mariage fait naître en elle un soupçon de compassion.
Il y avait eu Dana et Dan, un duo père-fille inséparable, et Maria. Si le prénom rapprochait Dana de son père, il y avait aussi ce qui séparait Dana de sa mère Maria : la joie de vivre, comme le répétait son père. Le duo auto-proclamé « D&D » aimait rire fort, faire du vélo, manger sur le canapé en regardant la télé, les blagues des Simpson, Le Seigneur des Anneaux et la spontanéité. Maria, qu’ils appelaient entre eux « OdS », l’Œil de Sauron, était une « intello », prévisible et pas fun.
C’était son père qui lui avait offert son premier livre féministe, quand elle avait eu son premier petit ami ; c’est à son père qu’elle en avait parlé, c’est lui qu’elle appelait tous les jours lors de sa première année à l’université à 800 km de sa ville natale. Comme son père, Dana avait choisi d’être journaliste, s’éloignant avec l’âge un peu plus de Maria, la taciturne gynécologue.
Le ressentiment avait commencé sporadiquement, mais disparaissait après de plates excuses ou une blague, puis un jour, il était resté. Le premier glissement avait eu lieu quand Dana et son unique cousine avaient dédié deux heures par semaine pendant huit mois à organiser les festivités familiales pour les quatre-vingts ans de sa grand-mère, Nana. Le jour J, son père et Nana étaient arrivés avec deux heures de retard. Pendant plus d’une heure, Dana avait appelé son père sans succès. La maison de retraite qui se trouvait seulement à quinze minutes en voiture avait confirmé qu’ils avaient bien quitté les lieux. 1h15 après l’heure de rendez-vous prévue, elle avait reçu un sms indiquant qu’ils arrivaient, qu’il avait décidé de faire « une petite surprise fun ». Il avait fait un détour pour récupérer une machine à barbe à papa. En guise d’excuses, Dana avait eu droit à des blagues sur l’incompétence du loueur, suivies d’un « relax, spontanéité ! », expression habituellement réservée à sa mère. C’était la première fois que cette réponse lui était adressée. Elle s’était souvenue qu’elle n’était pas comme sa mère. Elle, elle était fun, donc elle avait fini par en rire et profiter du reste de la soirée. Après cet épisode, de retour dans sa chambre étudiante, les appels quotidiens à son père s’étaient transformés en appels hebdomadaires.
Il y avait aussi eu son coming out. Son père, « féministe de la première heure », portait souvent son t-shirt Feminist Dad le vendredi. Ça n’avait pas été une surprise ni un secret mais elle avait demandé de ne pas en faire tout un plat, d’ailleurs elle l’avait annoncé par téléphone lors d’un de ses appels hebdomadaires. Son père, fidèle à son enthousiasme habituel, avait déroulé les anecdotes qui lui avaient mis la puce à l’oreille. Sa mère avait eu le temps de glisser des recommandations et messages de prévention concernant le consentement, les IST et MST dans les relations lesbiennes. À son retour pour les vacances de printemps, elle s’était retrouvée malgré elle dans une fête surprise organisée par son père. Là encore, face à ses protestations, il avait sorti le fameux « relax, spontanéité ! ». En y repensant aujourd’hui, elle se rappelle le sentiment de colère puis une vague de compassion inattendue pour sa mère. Cette dernière était à des milliers de kilomètres pour une conférence, totalement ignorante des projets de son mari, mais Dana savait que si elle avait été là, elle aurait empêché Dan d’organiser cette fête ou aurait prévenu sa fille. Pour la première fois, l’éventualité que toutes ces années, à de multiples occasions, elle ait été injuste vis-à-vis de sa mère et complaisante avec son père, lui était apparue.
Maria n’avait sans doute jamais su ce qui avait poussé Dana, sa « fille à papa » toujours un peu distante avec elle, à se mettre à l’appeler plusieurs fois par semaine, à lui proposer des week-ends entre filles, à discuter de son travail, et même à rire à ses blagues. La distance qui se creusait entre D&D n’avait pas échappé à Maria, cela avait commencé doucement pendant les études de Dana, puis s’était accéléré après son installation avec sa compagne. Dana s’éloignait de son père et se rapprochait de sa mère. Son père n’avait pas changé, c’était le même papa qu’elle admirait, chérissait plus jeune, mais le fun, l’enthousiasme et la spontanéité ne suffisaient plus pour masquer tous ses manquements, ses retards et son irresponsabilité. Maintenant, il n’y avait plus de rire complice lorsque Dan lançait un « okay Sauron » après une demande de Maria.
Le cancer de sa mère avait fini par sédimenter le tout : Dana était passée de témoin, parfois victime collatérale, de la constante bonhomie ou « joie de vivre » de son père, au rôle de suppléante de sa mère. Le point de non-retour avait été atteint lorsqu’au lieu d’accompagner Maria à une séance de chimiothérapie, il avait décidé qu’une escapade surprise à la mer serait une bonne idée. Dans les derniers mois, pendant ses visites hebdomadaires, Dana s’allongeait près de sa mère et, entre deux anecdotes, s’excusait de n’avoir pas compris et de ne l’avoir pas vue. Sa mère répondait souvent que c’était normal d’être différent·es, mais Dana ne désirait plus être différente de sa mère.
La veille de l’enterrement, assise dans sa voiture, attendant le costume que son père avait oublié au pressing, elle relisait cette to-do list qu’elle connaissait par cœur, préparée en amont six mois auparavant par Maria : « Chérie, ci-dessous deux listes, les choses déjà réglées et celles qui ne peuvent l’être qu’après. J’ai aussi mis tous les numéros utiles. J’espère que ça t’allégera un maximum ».
Ce qu’en dit Bonnie Burstow :
Souvent, le père et la fille regardent ensemble la mère (la femme) de haut. Ils échangent des regards complices lorsqu’elle rate un point. Ils conviennent qu’elle n’est pas aussi intelligente qu’eux, qu’elle ne parvient pas à raisonner comme eux. Cette connivence ne sauve pas la fille du sort de la mère. À son grand effroi, elle découvre que son père agit petit à petit selon d’autres règles. Au fur et à mesure qu’elle grandit, elle est de plus en plus souvent assimilée à la mère (la femme) à laquelle elle se pense supérieure. Par moments, elle est furieuse contre son père, qui a cautionné ce changement de statut injuste, et il lui arrive de reporter son affection sur d’autres personnes. Plus généralement, elle reproche à sa mère de lui avoir transmis la malédiction de la féminité, tout en continuant à considérer son père (l’homme) comme un allié ou un sauveur possible.
Bonnie Burstow
Décédée en 2020, Bonnie Burstow était une intellectuelle psychothérapeute et professeure féministe canadienne, pionnière du mouvement contre la psychiatrisation, analysant ses dommages et comment celle-ci est façonnée par le patriarcat.
Le père de Dana est l’archétype du papa cool et détendu souvent mis en avant dans les séries TV, en opposition à la mère rigide et empêcheuse de tourner en rond : Lois et Hal dans Malcolm, Tom et Lynette dans Desperate Housewives, Homer et Marge Simpson. Comme le père de Dana, ces hommes sont dépeints avec une âme d’enfant, moins stricts, un peu loufoques, alors que leurs femmes sont souvent montrées comme des espèces de castratrices.
Dana, qui en devenant adulte sort de l’idéalisation de son père, subit les conséquences de l’irresponsabilité de ce dernier, mais elle est aussi à même de mieux comprendre ce que signifie la vie commune entre deux adultes, à savoir que si la spontanéité est toujours bienvenue, il n’est pas possible d’en faire un mode de fonctionnement, a fortiori avec des enfants. La mère de Dana, perçue comme « l’Œil de Sauron », a sûrement dû pallier les manquements de son mari en étant « sur-responsable ».
Cette situation est assez proche de celle des travailleuses domestiques et les femmes qui les emploient : en l’absence d’engagement de l’homme, ce sont les femmes qui doivent gérer les interactions, donc les demandes, les conflits, mais c’est aussi sur elles que retombera le travail s’il n’est pas fait. Dans ce cas, l’investissement des pères dans une complicité parent/enfant contre la mère met celle-ci en situation marginale : elle est la seule responsable pour les côtés ingrats de la parentalité et la gestion du quotidien, et de fait, en incapacité de développer des couches d’identité complexes. C’est pour cela que l’analyse des relations toxiques et abusives mère/enfant·s ne peut être dissociée du patriarcat et de l’absence physique, émotionnelle ou parentale des pères.
Ce type de relation père/fille transforme la fille en complice de l’irresponsabilité du père, tandis que la mère, étant la seule adulte responsable, se retrouve exclue. Mais cette différence de traitement, comme l’explique Bonnie Burstow, ne permet pas aux filles d’échapper au sort de leurs mères, car sitôt qu’elles sont en âge de prendre ces responsabilités ou si les mères ne sont plus là (pour cause de divorce ou de décès), elles les relaient.
Pour aller plus loin : Bonnie Burstow, Radical Feminist Therapy: Working in the Context of Violence, p.13, traduction de l’autrice
Relecture et édition : Sarah Diep et Apolline Bazin
Illustration : Léane Alestra
Prochaine chronique le 3 juillet
Relire :
Note de bas de page [1/8]
Le dîner [2/8]
Cet article L’enterrement – Des amis qui vous veulent du bien, par Fania Noël provient de Manifesto XXI.


Selon une enquête Ipsos publiée à l'occasion du « Mois des Fiertés », 9 % des adultes dans 30 pays du monde s’identifient comme LGBT+, variant de 15% au Brésil à 4% au Pérou, et une personne sur dix en France.
L’article 10% des Français s’identifient comme LGBT+, 22% chez les moins de 26 ans, selon un sondage est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Il avait inondé l'artiste de messages haineux sur les réseaux sociaux, après sa prestation aux Victoires de la Musique en février 2020.
L’article Huit mois de prison « dont deux ferme <em>»</em> pour l’un des cyberharceleurs de la chanteuse Hoshi est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.


Cet article La LIG, un fonds inédit pour financer les Lesbiennes d’intérêt général ! provient de Manifesto XXI.
Pour ouvrir grand les portes du placard, il est nécessaire de soutenir les projets portés par et pour les lesbiennes. C’est dans cet objectif qu’a été créé un fonds de dotation d’un type particulier : Lesbiennes d’intérêt général (LIG). Entretien.Dans un pays où 63% des lesbiennes sont toujours au placard au travail (selon SOS Homophobie), quels moyens sont accessibles aux projets culturels et associatifs spécifiquement lesbiens ? Comment lutter contre l’invisibilisation et convaincre des institutions ou des marques que ces enjeux sont d’intérêt général, et de l’importance de leur laisser une place ? C’est pour financer des projets par et pour les lesbiennes qu’a été créé un fonds de dotation d’un type particulier : Lesbiennes d’intérêt général (LIG). Manifesto XXI a eu la chance de recevoir une dotation de 1500€ de la LIG afin de produire une deuxième saison de la série de podcasts Lesbien·nes au coin du feu. Nous sommes allé·es à la rencontre d’une de ses membres, Veronica Noseda. Militante lesbienne féministe au sein des Dégommeuses, de la LIG, du Front d’habitat lesbien, également responsable de la recherche opérationnelle à L’Initiative, elle nous raconte l’origine et la nécessité de ce projet.
Manifesto XXI – Comment est née la LIG ?
Veronica Noseda (LIG) : La LIG a été créée en 2016 sur l’impulsion de huit co-fondatrices, toutes lesbiennes. À l’origine de l’idée, il y a notamment une observation faite par Alice Coffin et Alix Béranger concernant l’absence de sources de financements attribuées aux projets spécifiquement lesbiens. Nous avons constaté que les lesbiennes étaient partout, sur tous les fronts et de tous les combats, mais que personne ne se souciait de savoir ce qui était fait pour elles. Résultat : la plupart du temps, les lesbiennes n’avaient pas d’argent pour mener elles-mêmes des projets sur les thématiques qui les visent. C’est en réponse à ce vide-là qu’est née la LIG, afin d’octroyer des financements à des projets faits par des lesbiennes, pour des lesbiennes. Nous avions aussi le souhait de créer un outil purement philanthropique, dont la nature même contrastait avec un paysage français très institutionnel. L’intention de la LIG est de dépoussiérer le panorama des modes de financement, en y introduisant de nouvelles logiques plus solidaires. Derrière ce projet, il y a réellement la volonté de marrainer un réseau de personnes et de collectifs.
Comment ça fonctionne ? Quels sont les différents moyens d’aider la LIG ?
Vous pouvez faire un don et même un petit don est vraiment le bienvenu, surtout s’il est régulier. Les dons mensuels nous permettent d’envisager la suite et de prévoir combien de projets on pourra financer dans les prochaines semaines, mois et années. Puis évidemment, vous pouvez vous aussi déposer un projet, en allant sur notre site, en remplissant un petit formulaire très simple afin de nous présenter votre idée. Comme toutes les associations ou tous les organismes philanthropiques, on reçoit généralement un pic de dons en fin d’année, car il est possible de défiscaliser les dons faits à la LIG. Cependant on aimerait beaucoup que ces dons arrivent également au printemps, à l’été, à l’automne, et pas juste en hiver, parce que la régularité est une marque de confiance tangible. Et comme on peut le voir sur notre site internet, ça permet de subventionner une très grande diversité d’idées. On a financé 54 projets en sept ans, qui sont tous très différents les uns des autres.
Comment vous faites-vous connaître auprès de potentiel·les donateurices ?
Pour l’instant, c’est un petit peu du fait-maison, on compte sur le réseau des personnes déjà financées par la LIG pour nous faire connaître, ainsi que sur le soutien communautaire. C’est surtout du bouche-à-oreille, mais on compte se déployer bien davantage à l’avenir. À ce propos, n’hésitez pas à nous écrire, à nous conseiller, à nous offrir vos multiples talents pour que cet outil devienne un véritable raz-de-marée et qu’on puisse aider toujours plus de projets lesbiens… et finalement, changer le monde ! Oui, on a cette ambition très modeste de changer le monde. (rires)
Vous pensez que le point de vue des lesbiennes ou leurs projets peuvent participer à changer le monde ?
Oui, je crois que les projets lesbiens ont ce pouvoir. Premièrement, parce que les lesbiennes sont habituées à avoir une vision multiple des sujets qui leur tiennent à cœur. La démarche intersectionnelle a été présente dès le départ dans le mouvement lesbien. Deuxièmement, parce qu’on est là où on ne nous attend pas. Nous finançons des projets très divers, qui reflètent la diversité de la communauté lesbienne. Nous aidons des projets artistiques, mais aussi des projets de solidarité, ce qui est très important pour nous. Il ne peut y avoir qu’un seul type de projet mis en avant, car nous sommes « lesbiennes » au pluriel. Il y a des lesbiennes migrantes, il y a aussi des lesbiennes exilées, des lesbiennes artistes, d’autres activistes. Nous voulons que les projets de la LIG représentent cette multiplicité de personnes et de champs sociaux. Je pense que nous pouvons créer de nouvelles alliances et ainsi faire bouger les lignes.
Quels sont les objectifs à court et long terme de la LIG ?
Avoir plus de donatrices et donateurs, et élargir notre socle de financements pour allouer des dotations plus importantes aux idées retenues. On a aussi envie d’animer davantage le réseau de la LIG en organisant des rencontres entre les donatrices et donateurs, mais aussi avec les porteur·ses de projets. En 2017, on avait octroyé un prix de la Lesbienne d’intérêt général de l’année. On l’avait décerné à Faïna Grossman, la fondatrice et coordinatrice du réseau « Les lesbiennes dépassent les frontières ». Cette cérémonie était surtout un moyen de nous réunir, et on aimerait recréer ce genre d’événements fédérateurs. Enfin, l’un de nos objectifs est de pouvoir tirer des bilans et des leçons des 54 projets financés en sept ans. Le premier projet, c’était Gouinement Lundi, et avec Lesbien·nes au coin du feu, vous êtes parmi les derniers !
Pour soutenir le fonds de dotation, cliquez ici.
Relecture et édition : Sarah Diep et Apolline Bazin
Merci à la LIG pour cet entretien, mais aussi pour l’aide qu’elles viennent d’allouer à notre podcast Lesbien·nes au coin du feu afin que nous puissions produire une saison 2 !
Cet article La LIG, un fonds inédit pour financer les Lesbiennes d’intérêt général ! provient de Manifesto XXI.

Un jeune de 17 ans, au profil de catholique intégriste, a été interpellé, après l’attaque ce 22 mai du centre LGBTI de Touraine. Il a expliqué aux policiers avoir agi par « exaspération de la théorie du genre ».
L’article Un suspect de 17 ans en garde à vue après l’attaque à l’explosif du centre LGBTI de Touraine est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

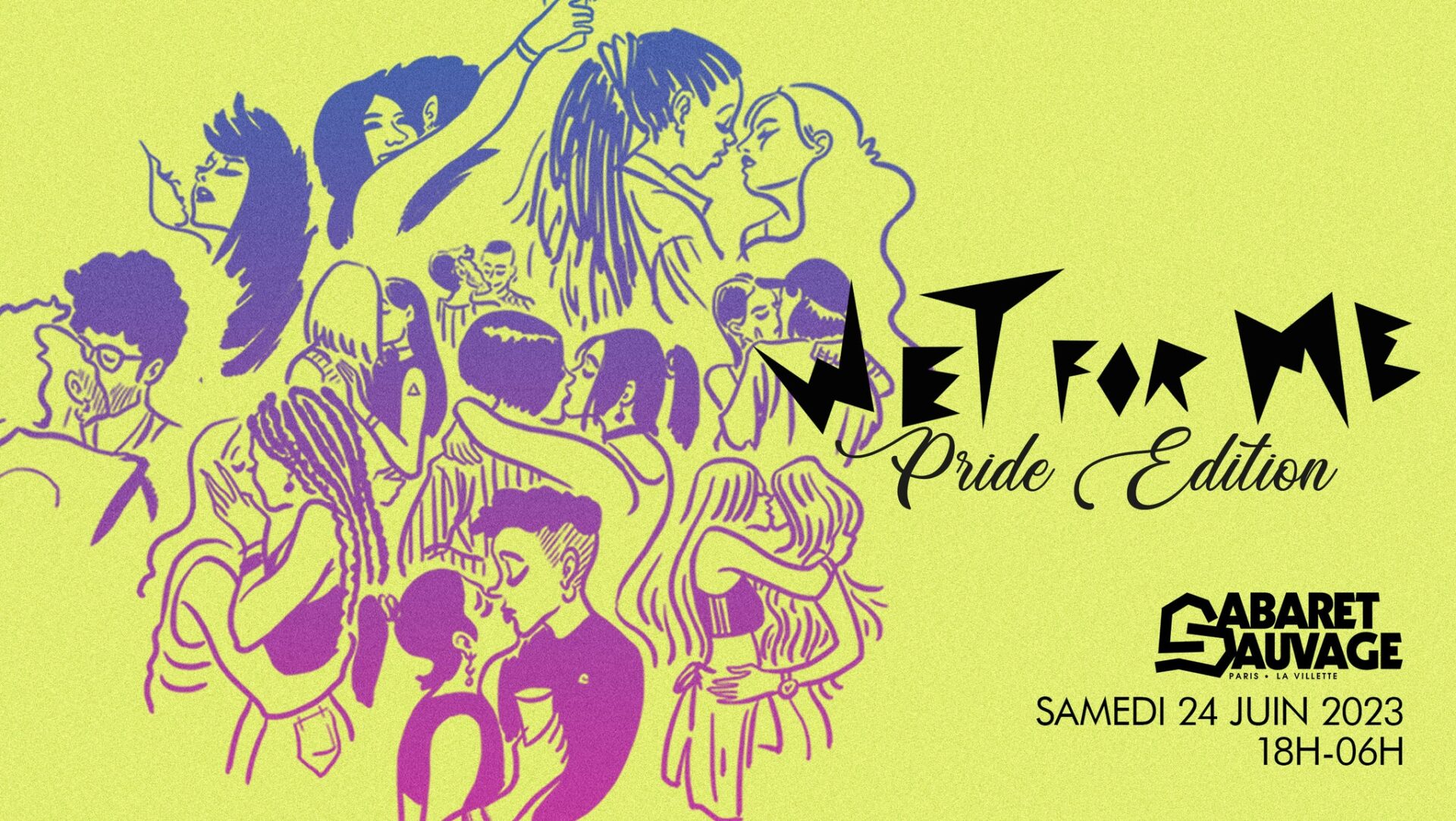 Qui dit mois de juin, dit Mois des Fiertés, avec la Pride du 24 juin (et la Wet sur deux jours !) en grand final. A cette occasion, on vous ...
Qui dit mois de juin, dit Mois des Fiertés, avec la Pride du 24 juin (et la Wet sur deux jours !) en grand final. A cette occasion, on vous ... 

Comme chaque année, le mois de juin officialise la saison des Fiertés, notamment à Paris avec une Marche qui se fera sans chars, afin de « poursuivre un travail d’éco-responsabilité et de “décarbonation” de l’évènement ».
L’article Mois des Fiertés 2023 : Calendrier des « Prides » et manifestations LGBT+ en France est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Alors que les députés tchèques repoussent le débat, la première obédience protestante du pays donne à une très large majorité sa bénédiction aux couples homosexuels.
L’article La plus grande Église protestante tchèque vote la bénédiction des couples de même sexe est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Face à la multiplication inquiétante des actes de vandalisme, de dégradation, de discours et de comportements haineux à l’encontre de plusieurs centres LGBT+, une cinquantaine d'associations, dont STOP homophobie, demandent à l'État de mieux protéger ces établissements essentiels à la communauté.
L’article TRIBUNE. Centres LGBT+ attaqués : « Nous demandons une meilleure protection de l’État » est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Diplomate de premier plan depuis 2011, il a été élu président d'Etat par le parlement, devenant ainsi la première personne ouvertement LGBT à occuper cette fonction, après avoir été la première personnalité politique du pays à faire son coming-out en 2014.
L’article Le nouveau président letton, Edgars Rinkevics, devient le premier chef d’État européen ouvertement gay est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Le queer est-il normatif ? Rencontre avec Pierre Niedergang provient de Manifesto XXI.
Dans Vers la normativité queer, le philosophe Pierre Niedergang identifie un dilemme qui parasite nos relations : nous devrions choisir entre rejeter toute norme sociale et morale, ou nous assimiler aux structures hétéro-patriarcales. Le philosophe propose une troisième voie : produire de nouvelles normes plutôt que de les abolir.Le titre fera sûrement tiquer certain·es de nos lecteurices : comment le terme de normativité peut-il bien être accolé à celui de queer ? Ne sont-ce pas deux termes antinomiques, si ce n’est ennemis ? Pierre Niedergang met le doigt sur une épineuse question qui traverse les communautés LGBTQIA+ depuis bien des années. Il ne se fera pas que des amix et il le sait. Le philosophe effectue une étude minutieuse de l’histoire de la scission entre les anti-normatifs et les autres, entre le rejet de toute morale et celleux qui défendent l’idée d’un nouveau système de normes morales. C’est autour des débats sur les violences sexistes et sexuelles que Niedergang ancre son analyse : et si le projet n’était pas de détruire les normes mais, plutôt, de construire une nouvelle normativité loin de l’assimilation, à la fois ancrée dans la pratique tout en restant critique d’elle-même ? Manifesto XXI a rencontré l’auteur pour mieux comprendre son projet théorique et le questionner sur son opérabilité.
Manifesto XXI – Le concept de queer est souvent associé à un positionnement contre la norme. Pourquoi proposer ce concept a priori paradoxal de normativité queer ?
Pierre Niedergang : Tout est parti de l’article qu’on a écrit avec Tal Piterbraut Merx suite au déboulonnage de la plaque de Guy Hocquenghem. Il y a deux ans, un groupe “féministe” avait jeté du sang sur la plaque en raison de sa proximité avec des défenseurs de la pédophilie dans les années 70. Nous avons tout de suite remarqué deux camps très distincts dans cette affaire. D’un côté, les queers qui revendiquaient l’héritage d’Hocquenghem et qui disaient qu’il était anachronique et moralisateur de l’accuser de défendre la pédophilie. Et d’un autre côté, il y avait des discours féministes qui voulaient réaffirmer l’existence de cette histoire, et la condamner à partir d’une norme qui consiste à condamner les violences sexuelles, y compris pédocriminelles. Ces féministes invoquaient donc plus ou moins explicitement une forme de normativité vis-à-vis de la sexualité afin de distinguer ce qui, au niveau sexuel, est acceptable ou inacceptable.
Dans cet article, nous arrivions au constat suivant : l’anti-normativité ne convient pas car il faut pouvoir réussir à dénoncer les violences sexuelles et, pour ce faire, il faut pouvoir se référer à une norme. Par conséquent, comment peut-on penser une normativité queer ? Après le décès de Tal, ses éditeurices m’ont appris qu’il avait évoqué l’idée d’écrire un livre ensemble autour de la normativité queer. J’ai donc décidé d’approfondir cette question.
Cette distinction entre le bon et le mauvais, entre ce qui est « radical » ou ne l’est pas, c’est de la norme. C’est même une norme qui refuse de se reconnaître comme telle, ce qui est le pire type de norme.
Pierre Niedergang
Pourquoi l’anti-normativité n’est-elle pas une solution viable ?
Je pense qu’on ne peut pas être anti-normatif sans que cela produise une nouvelle norme par opposition : nous sommes beaucoup à dénoncer, par exemple, le fait que les anti-normatifs distinguent « les bons queers anti-normatif·ves » des « méchant·es LGBT normatifs », cette distinction entre le bon et le mauvais, entre ce qui est « radical » ou ne l’est pas, c’est de la norme. C’est même une norme qui refuse de se reconnaître comme telle, ce qui est le pire type de norme. En réalité, la pratique anti-normative pure ne fonctionne pas. Se donner des normes de ce qui est acceptable et inacceptable est, précisément, ce qui permet de faire relation et de tisser des liens entre les queers. Donc s’il n’y avait pas de normativité queer, il n’y aurait pas de communs queers, il n’y aurait pas de relation entre les queers et pas de luttes queers.
La question c’est alors de savoir, qu’est-ce que ça fait, notamment en termes de culpabilité, de poursuivre l’établissement d’un espace psychique safe ? Est-ce que c’est vraiment utile ?
Pierre Niedergang
Vous raccrochez ce constat avec une histoire des différents cadres épistémiques et normatifs depuis les années 60. D’où vient ce langage du safe dans les discours sur la sexualité ?
Dans La volonté de savoir, Michel Foucault montre qu’avant le 18ᵉ siècle, le légal et l’illégal étaient les deux valeurs fondamentales par lesquelles on jugeait les plaisirs. A partir de l’invention de la science de la sexualité, et de ce que Foucault appelle le dispositif de la sexualité, on serait passé à une autre manière de juger plaisirs et désirs : le normal et l’anormal. Mais aujourd’hui, il me semble que le normal et l’anormal ne sont plus vraiment le cadre dans lequel on pense la sexualité. C’est plutôt la différence entre safe et violent qui domine. L’enjeu aujourd’hui est d’avoir une sexualité non violente, « safe » [« sécure »], consentie qui s’oppose à une sexualité violente. La sexualité est donc désormais jugée à l’aune de ce nouveau paradigme.
Et comment cela se déploie plus spécifiquement dans les discours queers sur la sexualité?
Il y a des travaux en France comme ceux d’Elsa Dorlin (Se défendre, 2017), qui font une généalogie de la construction de l’opposition entre le safe et la violence, notamment dans les milieux queers. Cette notion d’espace safe émerge dans les années 60 au sein des milieux queers pour désigner un espace protégé des violences policières ; mais Dorlin remarque que, parallèlement, la distinction entre safe et violence sert à des procédures d’exclusion racistes, à l’endroit des personnes noires et latino-américaines perçues comme « dangereuses » pour les queers (ce qui laisse bien sûr de côté les queers of colors). Dès le début, il y a donc eu un codage racial du « safe » au sein de nos luttes et de nos espaces. Puis, cette notion de safe s’est transformée, déplacée lors de l’épidémie de vih/sida entre celleux qui font du safe sex et celleux qui sont considéré·es comme violent·es, contaminant·es, dangereux·ses. Aujourd’hui, on retrouve cette distinction appliquée non plus seulement aux comportements mais aussi à la pensée et au désir eux-mêmes : la distinction entre des pensées, des désirs safe ; et des désirs honteux, unsafe, dangereux. La question c’est alors de savoir, qu’est-ce que ça fait, notamment en termes de culpabilité, de poursuivre l’établissement d’un espace psychique safe ? Est-ce que c’est vraiment utile ? C’est un sujet qu’on est en train de travailler avec mon amie psychologue, Salomé Mendès-Fournier.

Le vocabulaire du safe a donc une histoire raciste, sécuritaire et inscrite dans une forme de contrôle des corps entre queers. Comment faire cohabiter ces contradictions ? Faut-il jeter ce vocabulaire du safe à la poubelle ?
Le fait que les queers évoquent un besoin de se sentir en sécurité, encore aujourd’hui, fait que ce concept continue à s’imposer comme norme. Elle persiste parce qu’il y a là quelque chose de vital. Il faut prendre la question dans sa complexité, dans son ambivalence, tenir ensemble la critique de cette généalogie politique mais ne pas évacuer tout discours sur le safe au nom de la critique de cette généalogie. Quelque chose se dit de notre vulnérabilité et de nos vécus de violence derrière ces revendications au safe : la légitime critique de la construction raciste ou sérophobe de la distinction entre safe et violence doit nous mener à transformer et amender ces revendications, plutôt que de les exclure d’un revers de main comme le font certains discours.
Comment la normativité queer arrive donc à « tenir ensemble » un positionnement critique et le désir de produire de nouveaux cadres normatifs ?
Ce que j’affirme dans le livre, c’est que la première caractéristique de la normativité queer est qu’elle est critique : c’est une oscillation constante entre d’un côté les critiques des normes qui existent et d’un autre côté leur transformation et l’invention de nouvelles normes. Cette possibilité, elle s’explique par le deuxième aspect de la normativité queer: elle est communautaire. Si on reprend l’exemple de la norme du « safe », au sein de nos milieux, il y aura celleux qui invoquent cette norme, et d’autres qui seront critiques de cette notion de safe et rappeler la généalogie de la norme en question ; et dans le même temps, d’autres personnes encore vont travailler à transformer cette norme pour intégrer les critiques qui ont été faites. Le queer est toujours dans une double position de critique et d’inventivité des normes.
Pour ancrer le discours dans le matériel, vous semblez défendre l’idée d’un communisme queer…
Oui, j’évoque ce que j’appelle des pratiques communistes queers. Par exemple, le Front Transfem me semble faire ce type de travail. L’association soutient matériellement certaines femmes trans qui sont dans des situations compliquées, parfois d’extrême précarité à la fois matérielle et psychologique. Ces pratiques communistes se font dans les interstices des institutions, incapables de soutenir comme il se doit les personnes transféminines.
L’utopie permet d’articuler les luttes ensemble car on peut dessiner plusieurs choses en même temps et leur offrir un horizon intersectionnel.
Pierre Niedergang
Comment émergent les solidarités queers et communistes ? Pourquoi se réapproprier le terme de communisme ?
Ces solidarités émergent dans le tissage de relations affectives et matérielles entre les queers. Les communautés lesbiennes rurales aux Etats-Unis dans les années 70-80 en sont un exemple ; ou bien ce qui s’est passé pendant l’épidémie de sida, qui est pour moi un exemple de communisme queer dans le sens où il y avait un vrai soutien à la fois matériel et affectif de certains corps envers d’autres corps. En l’occurrence, je pense aux lesbiennes qui étaient moins touchées, du moins biologiquement, par la maladie, et qui ont soutenu affectivement et matériellement à la fois les pédés et les personnes trans.
Plutôt que le terme de « communisme », c’est plus précisément des « pratiques communistes » queers que je défends. Le communisme, ça peut renvoyer à l’idée du grand soir, de la grande révolution, du passage d’un État capitaliste à un État communiste. L’idée de « pratiques communistes » vise à souligner que l’objectif n’est pas l’établissement d’un État total. En disant que le communisme peut exister concrètement au présent et même au sein des structures néolibérales, nous pouvons commencer à vivre un avant-goût et apercevoir des lueurs de communisme.
Il s’agit donc de penser présent pratique plutôt que utopie future ?
Il ne faut pas perdre pour autant le désir d’un changement radical. Mais, pour maintenir ce désir d’utopie, il faut qu’on puisse l’incarner sous forme d’interstices au présent, qui nous font voir que c’est possible. Ici, je m’inspire de José Estéban Muñoz, qui est critique à l’égard de toutes les pensées dites « présentistes ». Ces dernières consistent à dire qu’il faut abandonner le futur car il est une construction hétérosexuelle et qu’il faudrait donc préférer le présent pur, l’événement. Muñoz dit qu’il faut garder cette dimension de la futurité car c’est la dimension du désir. L’utopie permet également d’articuler les luttes ensemble car on peut dessiner plusieurs choses en même temps et leur offrir un horizon intersectionnel. Par exemple, le travail de Cy Lecerf Maulpoix s’y attèle : comment s’inspirer d’écologistes pédés du passé pour penser nos pratiques aujourd’hui et créer des archives vivantes?
Pensez-vous qu’il est possible, dans la pratique, de dépasser ce clivage entre les discours anti-normatifs et ceux de la normativité ?
Je crois que cette alliance existe déjà de fait : les personnes qui produisent ces différents discours fréquentent les mêmes lieux et sont déjà prises dans des dynamiques de soutien matériel, affectif, mutuel. Ce qui me gêne, c’est de produire un discours simpliste qui construit un fantasme de la subversion totale et de la pure anti-normativité. Alors que je crois qu’y compris ceux qui se revendiquent de l’anti-normativité sont déjà dans des pratiques de normativité queer. J’ai peur qu’à force, ces discours-là finissent par créer des ruptures politiques qui amenuisent nos capacités de faire commun et de lutter ensemble.
Vers la nomartivité queer, Editions Blast, 176 pages, 15 euros
Aussi, les éditions Blast ont besoin de soutien pour continuer leur formidable travail, faites un don !
Relecture et édition: Anne Plaignaud et Apolline Bazin
Cet article Le queer est-il normatif ? Rencontre avec Pierre Niedergang provient de Manifesto XXI.

Suite à la plainte déposée par 64 personnes et les associations STOP homophobie et Mousse, une audience aura lieu le mercredi 31 mai 2023 au Conseil d’Etat contre la SNCF, marquant une étape majeure pour la reconnaissance légale d'un sexe neutre. Un événement significatif pour les personnes non binaires, transgenres et intersexes, ainsi que pour celles et ceux qui soutiennent l'inclusion et l'égalité des genres.
L’article Audience cruciale devant le Conseil d’État pour la reconnaissance du sexe neutre est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Qu’est-ce qu’une écriture politique ? Réponse de 6 auteurices en lutte provient de Manifesto XXI.
Vendredi 2 juin, Friction magazine organise « Langue de brute ou langue en lutte ? » une alléchante soirée dédiée aux écritures poético-politiques au Pavillon des Canaux.Comment la poésie peut-elle véhiculer un message politique ? Quand peut-on parler de poésie engagée ? Alors qu’on assiste à un renouveau des écrits poétiques et que les slogans politiques créatifs ont rythmé ce printemps de mobilisation sociale, l’équipe de Friction magazine nous invite à réfléchir au pouvoir des mots. La soirée « Langue de brute ou langue en lutte ? » propose un atelier d’écriture, des lectures et une table-ronde qui réunira les autrices et artistes Gorge, Treize, Leïla Chaix et Oxni. Chacune à sa manière lutte pour exprimer son désir, partager sa colère, se guérir, s’émanciper. Pour vous faire saliver un peu en amont de cet événement on a demandé aux orgas et leurs invitées de nous partager leur définition d’une écriture politique.
Treize, autrice de Charge (La Découverte)Pendant des années j’ai gardé l’espoir d’arriver un jour à écrire mon histoire psychiatrique de façon à ce qu’elle sonne juste à mes propres oreilles. Et si j’y arrivais je me disais que ça ferait circuler des forces à d’autres. Mais rien dans ma vie venait valider ça, rien me permettait de trouver cette idée raisonnable, cette croyance-là elle était purement politique. Edgar Sekloka, dans son album Unpeude sucrr : « La résistance c’est une cicatrice d’utopie ». Je trouve que c’est très important tout ça.
Gorge, poète et performeureuseL’écriture politique part du corps – elle dit comment l’injustice fractalise – elle montre les brèches avec sincérité – elle joue avec l’inconfort et le trouble pour actionner lae lecteurice. L’écriture sexuelle est politique.
Oxni, aka OxytocineJe pense que c’est grandement contre l’Histoire que nous construisons les histoires qui nous reconstruisent. L’écriture politique consiste donc à détricoter l’officiel pour affirmer l’officieux car la politique et les dominations qui la façonnent parlent déjà à travers nous. Par une tentative d’écriture que l’on souhaite politique, on cherche à parler d’elles et pas seulement depuis elles ; à devenir un obstacle et plus seulement un vecteur des rapports de forces. En disant « J’étais seul·e, mais on est des millions » j’affirme que mon expérience n’est pas (que) la mienne et que je n’écris donc pas seul·e. Pour me soigner je m’emploie à chercher ce qui est collectif dans ce qui m’arrive et si j’y parviens cette quête pourra peut-être aider d’autres personnes à qui on a infligées les mêmes blessures. Casey dit [ dans « Tragédie d’une trajectoire » ] : « J’voulais dire qu’il suffit de peu d’choses pour construire un·e enragé·e. Qu’il suffit de peu d’choses pour construire un·e engagé·e ». Je crois aussi que de la colère vient l’engagement et ça m’apaise de considérer qu’elle est donc fertile.
Leïla Chaix, poète chroniqueuse et micro éditriceUne écriture poétique ça sonne, claque, frappe, bave, danse, pleure, étonne, émeut. On se disait hier avec quelqu’une que la poésie, quand elle est bien, décapsule l’âme. On pourrait dire décapsul’âme. Ça permet d’éprouver des trucs, ça fait ressentir des émotions, ça fait un peu comme la musique : on redescend dans notre corps, dans notre folie, dans nos souvenirs, dans ce qui ne nous appartient pas, dans ce qui ne se gouverne pas, dans l’invisible et l’indicible. C’est une pratique politique, spirituelle. Je vois ça comme une main qui branle, caresse vivement, stimule l’esprit, l’aide à jouir et à jaillir.
Cami, modèratrice de la table-ronde, team FrictionUne écriture politique c’est une écriture qui annule le sentiment de solitude. Sa lecture, soudain, nous relie aux autres et nous invite à garder et en mémoire et en action ce lien.
Référence en terme d’écriture politique, je pense à Paul B. Preciado. Dans son dernier essai Dysphoria Mundi, il déploie ce concept : nous vivons dans un Régime pétro-sexo-racial. Ce régime a produit et est le produit de notre addiction collective au pétrole et à ses dérivés. Où l’ensemble de nos relations sont conditionnées par le binarisme sexuel, la soumission du genre féminin par le genre masculin, et la domination des populations blanches sur l’ensemble des autres populations et du vivant.
Allant au-delà d’une vision du capitalisme patriarcal comme puissance d’écrasement subi, le philosophe insiste pour dire qu’il s’agit d’un régime esthétique dans lequel nous prenons une part active. Un bon goût « toxique », auquel nous nous sommes accoutumés. Ainsi, pour sortir de ce « réalisme capitaliste » — qui fabrique violence, injustice, exploite ou tue tous les vivants — il nous faudra sortir de l’amour et de la dépendance que l’on entretient avec son esthétique. Cette idée d’addiction à l’esthétique capitaliste m’arrivait conjointement à la coupe du monde au Qatar. Dans un PMU de Paris qui ne diffusait pas de match, je soulignais les passages qui me donnaient la force de boycotter un sport-symbole que j’avais toujours voulu aimer et duquel j’avais toujours voulu être aimée
Leslie Préel, animatrice de l’atelier d’écriture, team FrictionJe pense que toute écriture est politique. On parle forcément de quelque part et quand bien même l’idée première ne serait pas de véhiculer un message explicite le simple fait d’écrire nous inscrit dans le monde. Il n’y a pas plus poétique que des slogans sur des pancartes !

Image à la Une & afficher, @peter.trelcat
Plus d’infos
Cet article Qu’est-ce qu’une écriture politique ? Réponse de 6 auteurices en lutte provient de Manifesto XXI.

STOP homophobie et Mousse déposent plainte contre la chaîne pour avoir écarté un journaliste gay qui dénonçait des propos homophobes de sa supérieure.
L’article Plainte pour discrimination homophobe contre Cnews est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Malgré les pressions internationales, le président ougandais, Yoweri Museveni, a finalement promulgué lundi 29 mai sa loi anti-homosexualité 2023, votée par les parlementaires le 21 mars dernier.
L’article En Ouganda, le président promulgue une loi anti-LGBT+ avec la peine de mort pour les « homosexuels récidivistes » ou séropositifs est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.


Ils évoquent un « phénomène » qui « explose » avec les « réseaux sociaux » et nécessite une « prise en charge par des psychiatres », car « être mal dans sa peau ne justifie pas d’aller dans ces dérives ».
L’article Les sénateurs LR créent un groupe de travail sur la « transidentification » des mineurs est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

La pièce a été annulée, sous pression des ayants droit du résistant, selon l'auteur de la pièce, Jean-Marie Besset, qui dénonce des préjugés homophobes ».
L’article Une pièce de théâtre évoquant « l’homosexualité » de Jean Moulin censurée à Béziers est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Suite à la plainte déposée par STOP homophobie, le groupe a indiqué être « en train d’analyser en détail la situation », assurant ne pas cautionner ce type de propos et comportements discriminatoires.
L’article Rediffusions de chants homophobes : Amazon réagit à nos accusations d’inaction est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

 Le 18 juin 2023, à 20h, c’est la cinquième édition des Out d’Or, l’unique cérémonie en France qui célèbre les personnes rendant visibles les combats LGBTQI+. Retour sur les différentes ...
Le 18 juin 2023, à 20h, c’est la cinquième édition des Out d’Or, l’unique cérémonie en France qui célèbre les personnes rendant visibles les combats LGBTQI+. Retour sur les différentes ... 
Cet article Les Sillons #1 : soutenir « l’émergence », un geste politique ? provient de Manifesto XXI.
Les Sillons n’est pas seulement une exposition, c’est un véritable programme d’accompagnement dédié aux artistes dit·es émergent·es et pensé par Thomas Conchou, arrivé à la direction artistique du Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson l’année dernière. La première édition rassemble treize artistes, dont les travaux sont à découvrir dans une exposition visible jusqu’au 16 juillet, et/ou lors d’une journée de performances, Les Sillons Fest, qui aura lieu le 24 juin prochain.Dans le journal de l’exposition, Thomas Conchou écrit : « En composant le nouveau projet du [centre d’art], il m’a semblé nécessaire qu’une structure d’accompagnement, de production et de diffusion des arts visuels s’investisse durablement en faveur des artistes et des travailleur·ses des arts visuels en début de carrière. » L’occasion de faire le point : pourquoi est-il crucial de proposer un accompagnement aux artistes en début de carrière, mais aussi de donner plus de place à des projets émergents et politiques au sein de nos institutions ? Les Sillons n’est pas le premier programme à s’engager pour la professionnalisation des artistes émergent·es, et certaines manifestations sont aujourd’hui reconnues comme de véritables tremplins pour débuter sa carrière, au premier rang desquelles on trouve le Salon de Montrouge. Et si ces initiatives absolument nécessaires se développent enfin, quelles sont les particularités du programme initié à la Ferme du Buisson ?
On s’embête beaucoup moins avec les cloisonnements, et c’est pour la meilleure santé du tissu artistique. Les artistes font ça depuis très longtemps. Le problème de l’institution, c’est de verbaliser un certain nombre de choses qui, en fait, existent déjà dans les pratiques quotidiennes, vernaculaires… On n’invente rien, on visibilise.
Thomas Conchou
 Mélina Ghorafi, MUSOGYNIE (musée de la misogynie), 2018-2023, vue de l’exposition Les Sillons #1, 2023, La Ferme du Buisson, Courtesy de l’artiste, © photo Émile Ouroumov.
Décloisonner et penser l’écosystème de l’art de façon globale
Mélina Ghorafi, MUSOGYNIE (musée de la misogynie), 2018-2023, vue de l’exposition Les Sillons #1, 2023, La Ferme du Buisson, Courtesy de l’artiste, © photo Émile Ouroumov.
Décloisonner et penser l’écosystème de l’art de façon globale
La première édition de Sillons rassemble des artistes (ou duos) découvert·es ces dernières années par Thomas Conchou, notamment lors de jurys d’écoles d’art. S’il n’y a pas de thématique directrice, la plupart des artistes sont issu·es d’écoles d’art de région, et non d’Île-de-France. Hormis cela, les artistes ne partagent, a priori, pas grand-chose : tous les médiums sont représentés (la part belle est faite aux pratiques pluridisciplinaires et performatives), iels ont entre 23 et 34 ans, sont de nationalités diverses et ont des parcours et niveaux de reconnaissance variables. Pour s’adapter au mieux aux besoins de chacun·e, il a fallu penser des modalités d’accompagnement fluides et adaptables à cette hétérogénéité de pratiques et de parcours. D’abord par la production : d’une œuvre (Omar Castillo Alfaro), d’une nouvelle version d’une œuvre préexistante (HaYoung), ou d’une performance (Théophylle Dcx). Les choses ont été pensées au cas par cas, comme pour Mélina Ghorafi, qui présente MUSOGYNIE, une installation évolutive qui dénonce les clichés sexistes. La Ferme du Buisson a financé l’achat de plusieurs objets qui viennent rejoindre sa collection personnelle et augmenter son œuvre. Le film What is a residue left from setting a black puddle on fire? de Nesrine Salem a quant à lui été co-produit par la Ferme du Buisson avec Mécènes du Sud (Sète-Montpellier) et le CNAC Magasin (Grenoble) tandis que Benoît Le Boulicaut a été sollicité à la fois en tant qu’artiste (il expose des tableaux dans l’espace et performera le 24 juin) et designer – il a également signé l’identité graphique de l’évènement. La Zone à Partager (ZAP), un espace de médiation en autonomie dans le centre d’art animé par un collectif inter-service de salarié·es, a d’ailleurs donné carte blanche à lae Clubmaed. La collective artistique y propose des textes, ressources et outils collaboratifs pour penser et réfléchir ensemble aux questions des inégalités de genre et des langages inclusifs.
 Théophylle Dcx, Curriculum Vihtae, 2022, vue de l’exposition Les Sillons #1, 2023, La Ferme du Buisson, Courtesy de l’artiste, © photo Émile Ouroumov.
Théophylle Dcx, Curriculum Vihtae, 2022, vue de l’exposition Les Sillons #1, 2023, La Ferme du Buisson, Courtesy de l’artiste, © photo Émile Ouroumov.
« On s’embête beaucoup moins avec les cloisonnements, et c’est pour la meilleure santé du tissu artistique. Les artistes font ça depuis très longtemps. Le problème de l’institution, c’est de verbaliser un certain nombre de choses qui, en fait, existent déjà dans les pratiques quotidiennes, vernaculaires… On n’invente rien, on visibilise » nous explique Thomas Conchou. Car il s’agit de favoriser la perméabilité entre les disciplines et de penser l’écosystème de l’art dit émergent de manière plus globale. Ainsi, il a invité la critique d’art Camille Bardin pour une résidence de création de deux mois avec son podcast PRÉSENT.E. Outre l’intégration dans l’équipe du centre d’art et la mise à disposition d’un studio son avec du matériel professionnel pendant deux mois, cela lui a permis de se consacrer pleinement à cette activité, d’être rémunérée, et de penser de nouveaux formats pour enrichir sa formule. « Ça a été génial de pouvoir avoir un temps dédié à la production de podcasts, sachant que PRÉSENT.E est un projet que je mène de manière bénévole de A à Z, des recherches à l’enregistrement, en passant par le montage, la communication… » nous confie celle qui devrait continuer à collaborer avec le centre d’art sur de futurs projets. Chacun des épisodes hors-série produits pour l’occasion se clôture d’ailleurs sur la même question adressée aux artistes : « Quelle(s) information(s) auriez-vous aimé qu’on vous donne avant de quitter l’école, quel(s) conseil(s) auriez-vous aimé avoir pendant vos études et avant de sauter dans le bain des travailleureuses de l’art ? »
 Omar Castillo Alfaro, Archéologie du goût, 2022 et Charles-Arthur Feuvrier, THE PERFECT DUDE, 2023, vue de l’exposition Les Sillons #1, 2023, La Ferme du Buisson, Courtesy de l’artiste, © photo Émile Ouroumov.
Un accompagnement pour combler les lacunes des écoles d’art ?
Omar Castillo Alfaro, Archéologie du goût, 2022 et Charles-Arthur Feuvrier, THE PERFECT DUDE, 2023, vue de l’exposition Les Sillons #1, 2023, La Ferme du Buisson, Courtesy de l’artiste, © photo Émile Ouroumov.
Un accompagnement pour combler les lacunes des écoles d’art ?
Pour Grand Chemin, qui présente une vidéo et performera au Les Sillons Fest, « les écoles gagneraient à préparer davantage les élèves. Malgré quelques “modules professionnalisants”, rien ne nous prépare vraiment à ce qui va suivre. Beaucoup de personnes se sentent perdues et minuscules au milieu du monde de l’art et du travail, et c’est vraiment une chance de pouvoir travailler avec des gens·tes qui sont à l’écoute et ont envie d’expliquer comment ça se passe ».
Alors que les artistes ont bien du mal à être considéré·es comme des travailleur·ses comme les autres, leur donner les outils nécessaires à leur professionnalisation et leur autonomisation en les accompagnant sur des éléments pratiques et concrets permet de prendre peu de distance avec le mythe délétère de l’artiste bohème. Il n’y a pas d’un côté la création, et de l’autre des questions pratiques, concrètes, juridiques. Par exemple, une mise au point sur les spécificités du statut d’artiste-auteur·ice était menée en partenariat avec Maison des Artistes auprès de celleux qui en avaient besoin, ou pour qui la création de ce statut était une nouveauté.
 HaYoung, DATA PERFUME, 2023, avec le soutien de la DRAC PACA, vue de l’exposition Les Sillons #1, 2023, production La Ferme du Buisson, Courtesy de l’artiste, © photo Émile Ouroumov.
HaYoung, DATA PERFUME, 2023, avec le soutien de la DRAC PACA, vue de l’exposition Les Sillons #1, 2023, production La Ferme du Buisson, Courtesy de l’artiste, © photo Émile Ouroumov.
Thomas Conchou et l’équipe du centre d’art se sont également rendu·es disponibles pour faire du cas par cas, comme le souligne Grand Chemin : « Il a écouté toutes mes interrogations et mes doutes par rapport au milieu de l’art, et a discuté avec moi du choix de mon pseudonyme. Je n’ai jamais envoyé de portfolio formel, et ça n’a pas posé de problème. Tout le déroulé et l’organisation des Sillons nous ont été expliqués dès le début, et nous avons été logé·es, nourri·es, défrayé·es pour le transport. » La qualité de l’accueil est une expérience partagée par Théophylle Dcx et HaYoung qui, toustes deux, insistent sur les bonnes conditions de travail proposées par Les Sillons #1. « Ce dispositif est important, surtout dans des centres d’art qui sont reconnus, qui ont une production, et qui nous proposent quelque chose de professionnel et réglo qu’on voit peu ailleurs » note Théophylle Dcx.
Alors, prendre soin de cette nouvelle génération d’artistes, sortir de schémas ascendants et précarisants, et partir du principe que si l’on traite bien les artistes, elleux-mêmes seront plus exigeant·es ensuite dans leurs futures collaborations… le début d’un ruissellement des bonnes pratiques ?
 Jacopo Belloni, Prophecies After the Blaze et Anathema Souvenirs, 2021, vue de l’exposition Les Sillons #1, 2023, La Ferme du Buisson, Courtesy de l’artiste, © photo Émile Ouroumov.
Mais finalement, c’est quoi l’émergence ?
Jacopo Belloni, Prophecies After the Blaze et Anathema Souvenirs, 2021, vue de l’exposition Les Sillons #1, 2023, La Ferme du Buisson, Courtesy de l’artiste, © photo Émile Ouroumov.
Mais finalement, c’est quoi l’émergence ?
« Je ne m’attache pas tellement à l’émergence, c’est juste qu’il faut un mot pour expliquer ce qu’on va essayer de faire dans un programme comme ça, qui est d’accompagner des artistes qui ont, selon moi, un besoin de visibilité et/ou de renforcement professionnel » nous explique Thomas Conchou. Une des définitions communément admises de l’émergence correspond aux dix premières années de pratique professionnelle, bien souvent à la sortie de l’école. Pourtant, il est difficile de délimiter les contours précis de cette notion, galvaudée mais parfois inévitable. Les artistes elleux-mêmes ont du mal à y voir clair, comme en témoigne Grand Chemin : « Je pense considérer l’émergence comme une scène à part entière au sein de l’art contemporain, et je ne sais pas si je coche toutes les cases ! » Même son de cloche chez Théophylle Dcx, dont le travail a pourtant déjà été présenté dans plusieurs institutions : «Je suis “en train d’émerger” plutôt que “émergent”, je n’ai pas encore des revenus suffisants, pas seulement pour vivre de mon art, mais au moins pour que l’art puisse payer mes loyers. »
Alors que la moitié des artistes gagnent encore moins de 800 euros par mois, la visibilité offerte à l’émergence ne s’accompagne pas souvent d’une rémunération à la hauteur. HaYoung insiste, la Ferme du Buisson n’offre « pas seulement de la visibilité », fait assez rare pour être souligné, parmi les propositions que les artistes reçoivent dans les années qui suivent le diplôme. Pour iel, l’émergence se situe au croisement de plusieurs données : le travail, les connexions, la visibilité et la rémunération.
 Vincent Caroff & Juliette Jaffeux, free fall 2, 2023, vue de l’exposition Les Sillons #1, 2023, production La Ferme du Buisson, Courtesy des artistes, © photo Émile Ouroumov.
Vincent Caroff & Juliette Jaffeux, free fall 2, 2023, vue de l’exposition Les Sillons #1, 2023, production La Ferme du Buisson, Courtesy des artistes, © photo Émile Ouroumov.
La question de la rémunération a donc été très importante pour cette première édition des Sillons, et elle s’inscrit dans un effort collectif mené notamment au sein de dca (l’association française de développement des centres d’art contemporain). Thomas Conchou en est enthousiaste : « Ce sont des discussions passionnantes qui sont menées collectivement, avec beaucoup d’engagement. Il y a aussi une responsabilité institutionnelle, politique. Le groupe chargé d’élaborer une nouvelle grille de rémunération conseillée par dca travaille énormément et arrive à des propositions vraiment intéressantes. » En se constituant en réseau et en mutualisant les réflexions, les centres d’art qui tentent de faire bouger les choses progressent ensemble. Car les institutions ont une responsabilité politique, et la manière dont elles traitent les artistes est le reflet de leurs engagements. Mais pour pouvoir accompagner ces artistes émergent·es, encore faut-il prendre en compte leurs spécificités, leurs enjeux, et valoriser leurs discours.
Une génération politique dans l’institutionJ’ai l’impression d’assister à une sorte de spectacle des valeurs émergentes, et de voir beaucoup de grosses institutions utiliser la représentation de thématiques politiques, peut-être pour éviter de se poser des questions plus structurelles.
Grand Chemin
Si la programmation des Sillons #1 n’a pas de ligne directrice dans ses thématiques, la plupart des travaux présentés sont porteurs d’un discours politique fort ou, du moins, témoignent d’un engagement. Thomas Conchou explique s’être dirigé vers des pratiques « qui portent des messages politiques tout en ayant un attachement à des formes extrêmement pop et des pratiques formelles généreuses. Les artistes sont pleinement dans leur époque et ne reculent jamais. Iels ne choisissent pas entre la forme et le propos politique ».
 Grand Chemin, Le Niveau de l’étang a encore baissé, 2022-2023, vue de l’exposition Les Sillons #1, 2023, La Ferme du Buisson, Courtesy de l’artiste, © photo Émile Ouroumov.
Grand Chemin, Le Niveau de l’étang a encore baissé, 2022-2023, vue de l’exposition Les Sillons #1, 2023, La Ferme du Buisson, Courtesy de l’artiste, © photo Émile Ouroumov.
« Ça fait partie des recherches que je mène, soulève Camille Bardin. Comment faire exister un propos politique au sein d’une institution, quand on sait que les musées sont aussi des espaces de pacification de nos recherches, de nos luttes ? »
À l’évocation de ces questions, Grand Chemin partage avoir « l’impression d’assister à une sorte de spectacle des valeurs émergentes, et de voir beaucoup de grosses institutions utiliser la représentation de thématiques politiques, peut-être pour éviter de se poser des questions plus structurelles ». Elle poursuit : « Aujourd’hui, dans la majorité des expositions, un grand nombre de pièces portent un fort message anti-capitaliste, décolonial, féministe, lié à une lutte ou à la représentation de populations marginalisées. L’art est souvent utilisé comme prétexte pour réfléchir à de nouveaux rituels d’organisation de la vie quotidienne. Le risque, lors de la présentation de ces thématiques au sein d’une grande institution, est de les réduire à une dimension de spectacle, celui des valeurs émergentes. »
Si la question du tokenisme et de la récupération de discours minorisés demeure épineuse, il semblerait qu’en soignant les modalités de sa collaboration avec les artistes, en prenant en compte les enjeux propres à l’émergence et en proposant une expérience humaine et collective, la Ferme du Buisson évite certains écueils.
 Nesrine Salem, What is the residue left from setting a black puddle on fire?, 2023, co-production Mécènes du Sud, La Ferme du Buisson et Le Magasin – CNAC, vue de l’exposition Les Sillons #1, 2023, La Ferme du Buisson, Courtesy de l’artiste, © photo Émile Ouroumov.
Nesrine Salem, What is the residue left from setting a black puddle on fire?, 2023, co-production Mécènes du Sud, La Ferme du Buisson et Le Magasin – CNAC, vue de l’exposition Les Sillons #1, 2023, La Ferme du Buisson, Courtesy de l’artiste, © photo Émile Ouroumov.
« Je n’avais pas envie de donner une image surplombante parce que j’accueille des personnes qui sont plus jeunes que moi », nous confie Thomas Conchou, qui estime que sa collaboration avec les artistes s’est jouée dans les deux sens : « J’apprends énormément de leur positionnement théorique, de leur érudition, de leur capacité à manier des systèmes référentiels et des systèmes esthétiques. Selon moi, tout le monde s’est beaucoup apporté [mutuellement] dans ce projet. »
Si cette première édition peut être considérée comme un coup d’essai réussi, Les Sillons seront amenés à revenir – d’ici deux ans ou plus – avec encore plus d’ambition, notamment celle de développer des collaborations avec les acteur·ices locaux·les. Ce sera également l’occasion de repenser la définition de l’émergence afin d’inclure des profils plus divers, comme des artistes autodidactes, qui se sont formé·es hors des sentiers battus des écoles d’art. « C’est une vraie question pour moi, je trouve que c’est quelque chose qui manque dans cette exposition » regrette Thomas Conchou. Autre ambition, celle de, peut-être, donner encore plus de place et de moyens aux pratiques performatives. En attendant, on retrouve les artistes des Sillons #1 le 24 juin, à l’occasion du (déjà ambitieux) Les Sillons Fest : une programmation de performances de 17h à 21h, précédée d’une visite de l’exposition par Thomas Conchou à 15h.
 Benoît Le Boulicaut, I’ve been wearing the same damn clothes for three damn days et And the woman in the subway giggled and smiled behind her mask like a little girl again, 2023, vue de l’exposition Les Sillons #1, 2023, La Ferme du Buisson, Courtesy de l’artiste, © photo Émile Ouroumov.
Benoît Le Boulicaut, I’ve been wearing the same damn clothes for three damn days et And the woman in the subway giggled and smiled behind her mask like a little girl again, 2023, vue de l’exposition Les Sillons #1, 2023, La Ferme du Buisson, Courtesy de l’artiste, © photo Émile Ouroumov.
Les Sillons #1, du 19 mars au 16 juillet 2023 au Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson, Noisiel (77).
Avec les œuvres de : Jacopo Belloni, Benoît Le Boulicaut, Vincent Caroff & Juliette Jaffeux, Grand Chemin, cluelesS, Omar Castillo Alfaro, Théophylle Dcx, Charles-Arthur Feuvrier, Mélina Ghorafi, HaYoung, Nesrine Salem.
Curateur : Thomas Conchou.
Les Sillons Fest, journée de performances, le samedi 24 juin de 17h à 21h. Avec une visite de l’exposition par Thomas Conchou à 15h.
Relecture et édition : Sarah Diep
Image à la une : Omar Castillo Alfaro, ah naab, 2023, vue de l’exposition Les Sillons #1, 2023, production La Ferme du Buisson, Courtesy de l’artiste, © photo Émile Ouroumov.
Cet article Les Sillons #1 : soutenir « l’émergence », un geste politique ? provient de Manifesto XXI.

Elle a été sanctionnée pour « manquement grave », après une plainte déposée fin février par deux parents d’élèves qui l'accusent de faire « l'apologie de l’homosexualité ». La procédure est pourtant en cours.
L’article Au Maroc, une enseignante suspendue d’une école française après une plainte pour « apologie de l’homosexualité » est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article TTristana, Lisa More & Goldie B : les ambassadrices du Bon Air 2023 racontent leur prog provient de Manifesto XXI.
Le Bon Air Festival revient du 26 au 28 mai 2023 à la Friche la Belle de Mai à Marseille, avec une nouveauté : trois artistes ambassadrices, TTristana, Lisa More et Goldie B, ont eu carte blanche sur une partie de la programmation. On a discuté avec elles de leur curation inclusive et audacieuse, au prisme des dynamiques culturelles marseillaises.Après une année 2022 qui a vu affluer plus de 20 000 festivalier·es, Marseille s’apprête à fêter la 8ème édition du Bon Air. Du 26 au 28 mai 2023, plus de cinquante artistes sont programmé·es sur trois nuits et deux jours à la Friche la Belle de Mai qui se transforme en labyrinthe de la teuf pour l’occasion. Du toit terrasse au cabaret, en passant par les petit et grand plateaux ainsi qu’une scène secrète, la programmation met comme toujours à l’honneur des musiques électroniques aventureuses et pointues, entre techno rave, house mais aussi bass music, dancehall ou ebm.
On y retrouvera des têtes d’affiche internationales : la renommée Jane Fitz, la queen new-yorkaise Honey Dijon, la brésilienne Badsista, ou encore Darkside, le projet de Nicolas Jaar et du multi-instrumentaliste américain Dave Harrington. Mais comme chaque année, le festival met également en lumière la scène marseillaise dans toute sa diversité, avec Vanda Forte b2b Bernadette, le collectif techno queer Discordance, Lugal Lanbada et Arthur Campi de l’antenne locale de Lyl Radio, ou la rayonnante Mystique qui s’associe pour l’occasion avec la suisse Miss Sheitana.
Et pour la première fois, le festival a fait appel à trois ambassadrices locales, les artistes TTristana, Goldie B et Lisa More. Invitées à participer au comité de programmation de cette édition, elles ont même reçu une carte blanche pour composer entièrement le line up de la scène du cabaret. Ainsi, on aura l’occasion de découvrir chaque soir l’univers et les influences de chacune d’elles. À quelques jours du festival, elles nous en disent plus sur ce processus de curation et leur vision de la vie culturelle marseillaise.
 Le Bon Air 2022 © naïri
Le Bon Air 2022 © naïri
Manifesto XXI – En tant qu’ambassadrices du Bon Air 2023, comment avez-vous élaboré votre programmation? Quel·les sont les artistes que vous êtes particulièrement fières de mettre en avant ?
Goldie B : Le processus de conception du line up a été collaboratif, impliquant des réunions et des discussions approfondies entre les membres permanents du comité de programmation et nous-mêmes les ambassadrices. Ensemble, nous avons travaillé à créer une programmation audacieuse et haute en couleurs, représentative de la culture club actuelle. Chacune d’entre nous a pu y apporter ses propres couleurs musicales, notamment par le biais de nos curations sur la scène du cabaret. Pour ma part, j’ai saisi cette opportunité pour mettre en avant la culture bass et UK sound dans laquelle j’évolue depuis plusieurs années. Je suis particulièrement heureuse d’avoir pu inviter des artistes tel·les que Coco Bryce, TSVI, La Dame, DJTB et Kumanope, qui représentent parfaitement le spectre large et ultra riche de cette mouvance musicale.
Lisa More : On a d’abord envoyé un gros rush de noms que nous aimerions voir sur le festival, autant de têtes d’affiche que de newcomers, puis le tout était d’être cohérentes en les plaçant de la manière la plus adéquate sur la timetable en respectant les directions artistiques et les parités. Quand est venu le moment de réfléchir à notre carte blanche sur la curation de notre scène, vu l’éclectisme de mes influences et de mon projet musical, j’ai dû me restreindre un peu en adoptant une esthétique particulière. TTristana est très spécialisée dans le post-club et Goldie B plutôt dans la musique UK, deux styles que j’aime aussi énormément, mais je me suis dis que j’allais partir dans une autre direction, pour apporter autre chose. Je tenais à jouer en b2b avec A Strange Wedding, qui a un univers deep tech sound-designé bien précis, donc j’ai construit le line up de ma scène en partant de cette esthétique-là.
TTristana : Nos identités sont plurielles. Musicalement je souhaitais défendre des couleurs post-club, mais je voulais aussi instaurer un line up qui soit 100% inclusif, en passant par le dj set, le b2b ou encore le live. Je voulais que ma stage soit éclectique dans les sonorités mais qu’elle reste cohérente : Mama Yha Yha fera l’opening avec un set bien techno/club, suivi d’un live ultra immersif de aya qui mélange collage post-club, grime, UK, bass music… Puis on enchaînera avec Badsista, productrice, musicienne et dj qui fait part de sa culture brésilienne dans ses sets, et un closing de Miss Jay, incroyable productrice dont je suis le travail depuis de nombreuses années et qui sera en b2b avec moi-même.
Souvent si on n’est pas mis·e en avant, ce n’est pas par manque de talent, c’est juste parce qu’on s’est toujours fait écraser par le patriarcat et qu’on n’a pas eu la visibilité qu’on méritait pendant longtemps.
Lisa More
En quoi s’agit-il d’une programmation engagée selon vous ?
TTristana : L’équipe du Bon Air a toujours fait part de son intérêt pour une programmation paritaire mais aussi inclusive. Là où je trouve ça malheureux, c’est qu’il est toujours important de le souligner en 2023 car il y a encore trop peu de femmes et de personnes queers et/ou racisées sur les line up de festivals. N’oublions pas que la genèse de ce que l’on écoute et produit aujourd’hui provient de la culture club et rave créée par ces personnes-là !
Goldie B : La programmation se distingue par son caractère paritaire, ce qui est encore trop rare dans le paysage festivalier actuel pour mériter d’être souligné ! Elle met en avant des esthétiques musicales variées et novatrices, donnant une visibilité aux artistes et aux styles trop souvent marginalisés. Elle se distingue aussi par son engagement envers les artistes émergent·es, notamment en installant un dialogue artistique avec des talents plus établis.
Lisa More : J’ai beaucoup souffert de ce truc de remplir une case : quand il fallait une femme sur l’affiche, on me mettait dessus (souvent en warm up) et parfois sur des progs qui n’avaient rien à voir avec ce que je jouais. Ça prouvait bien que ces gens-là n’avaient pas diggé mon projet et qu’ils voulaient juste m’inviter pour avoir l’air engagé et inclusif, je trouve ça vraiment naze. Pour éviter de faire ça, il faut revoir ses habitudes d’écoute au quotidien et arrêter d’écouter les trois mêmes mecs qui dominent tel ou tel style qu’on aime, mais aller creuser en dénichant des talents de tous genres, toutes origines. Car souvent si on n’est pas mis·e en avant, ce n’est pas par manque de talent, c’est juste parce qu’on s’est toujours fait écraser par le patriarcat et qu’on n’a pas eu la visibilité qu’on méritait pendant longtemps. Je dirais que la programmation du Bon Air respecte la parité au mieux, en bookant des minorités de genre ou des personnes racisées, mais sans tomber dans quelque chose d’hypocrite pour cocher des cases, en s’intéressant réellement à la musique produite par ces artistes.
Marseille accueille de plus en plus de nouvelles personnes, au risque d’une certaine gentrification : comment s’ouvrir culturellement sans risquer de perdre l’identité de la ville ?
Lisa More : En continuant de mettre toujours en avant la scène locale et celles et ceux qui la font vivre depuis bien longtemps. C’est hyper important, parce que ce sont ces personnes-là qui font l’identité de la ville.
Goldie B : Effectivement, je pense qu’il est essentiel de soutenir notre scène artistique locale, celle qui est ancrée dans la culture de notre ville, qui s’en inspire. Par ailleurs, il me semble absolument primordial de faciliter l’accès à la culture pour tous·tes, en veillant à ce que les activités culturelles soient abordables et accessibles à tous les segments de la population. Cela peut inclure la mise en place de tarifs réduits, des programmes éducatifs ou des collaborations avec des associations locales, à l’image des actions culturelles que nous animons actuellement avec mon label Omakase Recordings au sein du collège Jean-Claude Izzo. Il faut intégrer la durabilité culturelle dans le développement de la ville, pour qu’elle puisse évoluer harmonieusement en préservant son caractère unique et son identité culturelle.
TTristana : Je ne suis pas contre l’expansion de la ville culturellement, je trouve ça plutôt positif que de nouvelles personnes arrivent ici et fassent profiter de leurs talents. J’ai fait partie de ces gens-là quand j’ai emménagé à Marseille donc je ne peux pas dire le contraire ! Même si ça fait maintenant de nombreuses années que je suis ici, je ne suis pas très patriote, pour être honnête. Marseille est une ville avec de belles opportunités, qui a toujours fait preuve d’après moi d’expérimentation dans la culture. Je ne vois pas pourquoi il faudrait voir l’arrivée de nouvelles personnes comme une perte de cette identité. Je le vois au contraire comme une opportunité de pouvoir accroître cette belle ville, que Marseille se réinvente à certains niveaux.
La scène musicale marseillaise actuelle est en pleine effervescence, mais il y a un manque notable et assez handicapant de structures adaptées pouvant accueillir et suivre ses artistes.
Goldie B
Une grande place a été donnée à la scène locale dans le festival, via des collectifs, des radios, des disquaires. Quel regard portez-vous sur la scène musicale marseillaise actuelle ? Quelles tendances se dessinent ?
Lisa More : J’ai toujours observé la scène marseillaise de loin et je la trouve merveilleuse, j’ai rarement vu une ville aussi riche d’arts en tous genres et qui pourtant se serre autant les coudes et ne crée pas de cases. Il n’y a pas une tendance, il y en a plein, c’est hyper inspirant et enrichissant.
TTristana : Je ne vais pas vous mentir, je ne sors pas beaucoup, je suis très casanière ! (rires) Mais j’ai écho de ce qui se passe ici, je vois bien que la scène locale s’agrandit encore et encore, avec les webradios Lyl et Ola, les soirées Styx [curatées par Mystique et Guerre Maladie Famine, ndlr], Dreamachine, Error.tpg… Je peux juste souligner qu’à l’époque de mon collectif PailletteS, on manquait déjà de structures, et c’est toujours le cas aujourd’hui, cinq ans après… Il est temps je pense que de ce côté-là les choses bougent.
Goldie B : Oui, la scène musicale marseillaise actuelle est en pleine effervescence, mais il y a un manque notable et assez handicapant de structures adaptées pouvant accueillir et suivre ses artistes. Le nombre de collectifs et d’initiatives ne cesse de croître, avec toujours plus de propositions innovantes. Je pense qu’une dynamique positive de dialogue et de création est en cours au sein de la communauté artistique et qu’elle nécessite aujourd’hui le soutien des institutions et des acteur·ices professionnel·les du secteur.
 TTristana, Lisa More et Goldie B © Robin Plus
TTristana, Lisa More et Goldie B © Robin Plus
Le Bon Air Festival, du 26 au 28 mai 2023 à la Friche la Belle de Mai, Marseille
Toutes les infos à retrouver ici
Cet article TTristana, Lisa More & Goldie B : les ambassadrices du Bon Air 2023 racontent leur prog provient de Manifesto XXI.



Des couples homosexuels font condamner la Roumanie par la CEDH pour violation de leurs droits, en refusant de reconnaître légalement leur union.
L’article La Roumanie condamnée par la CEDH pour « absence de reconnaissance légale des relations entre personnes de même sexe » est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.


La plateforme a retransmis en direct puis en replay des matchs avec des « comptines » haineuses, notamment « il faut tuer ces pédés », entonnés par des supporters.
L’article Plainte contre Amazon Prime Video pour la rediffusion de chants homophobes est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Un individu a balancé un engin détonnant dans l'enceinte du local, alors que deux salariés et un bénévole étaient en charge de l'accueil. Heureusement, il n'y a pas eu de blessé.
L’article Après cinq dégradations en moins de trois mois, le centre LGBTI de Touraine attaqué à l’explosif est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Avec #Autizzy, les autistes noir·es luttent contre l’invisibilisation provient de Manifesto XXI.
Peut-on changer le monde avec des hashtags ? Même quand on est autiste, noir·e et queer ? #BlackLivesMatter, #MeToo, #BalanceTonPorc ou #FridayForFuture nous ont prouvé la force fédératrice des réseaux sociaux. Aujourd’hui le mouvement #Autizzy connecte des milliers d’autistes noir·es à travers le monde. Un outil puissant pour rendre visibles leurs vécus, et s’entraider face aux oppressions subies, à l’intersection du validisme, du racisme et de la queerphobie.À l’âge de 23 ans, après des années à faire face à des difficultés sociales, sensorielles et de communication de plus en plus handicapantes, j’ai finalement reçu un diagnostic me permettant de nommer ma différence : l’autisme. En même temps que j’apprenais enfin à me connaître, je cherchais à en savoir le plus possible sur ce fameux spectre sur lequel je me trouvais. Si l’on définit l’autisme comme une variation neurologique qui se manifeste par une altération des interactions sociales, de la communication, et par des intérêts restreints et répétitifs, il n’y a pas qu’une seule façon d’être autiste : cette neurodivergence regroupe un ensemble très disparate de vécus et de symptômes, c’est d’ailleurs pour cela que l’on parle de « spectre de l’autisme ». Pourtant après avoir passé des jours voire des semaines à tenter de trouver une représentation à laquelle je m’identifiais, j’en suis arrivé·e à une conclusion assez déprimante mais pas si surprenante : les recherches, le diagnostic tout comme les représentations de l’autisme ne comprennent pas les personnes noires ou racisées. Un soir, cependant, en scrollant sur TikTok, je tombe sur une vidéo de @theythemplural, influenceur·se queer, noir·e et autiste qui a popularisé le terme #Autizzy. Le hashtag, qu’iel a introduit spécifiquement pour les autistes noir·es en 2021, réunit à présent des milliers d’internautes et cumule près d’un demi-milliard de vues sur la plateforme. Beaucoup de thèmes y sont abordés, allant des violences policières, du validisme, du racisme ou de la précarité des noir·es handicapé·es, à des anecdotes plus légères, des story time dans lesquels on se confie, ou encore des conseils et des ressources.
Le privilège du diagnosticMon diagnostic tardif m’a fait réaliser une chose qui me semble évidente aujourd’hui : le diagnostic est un privilège. Une des raisons à cela étant que les premières descriptions de l’autisme furent basées sur l’observation de sujets blancs, principalement masculins, et que les minorités continuent aujourd’hui d’être sous-représentées dans les études scientifiques sur le sujet. Ainsi s’il est déjà difficile pour les blanc·hes assigné·es femmes à la naissance d’être diagnostiqué·es, les noir·es sont elleux complètement abandonné·es face au manque de recherche sur l’autisme noir, les discriminations présentes dans le système de santé, les biais racistes des médécins et soignant·es auxquels iels sont confronté·es, mais aussi les tabous sur la santé mentale qui persistent au sein de la diaspora africaine. Pour l’écriture de cet article, j’ai échangé avec cinq personnes concernées par ces intersections, qui ont toutes pointé la difficulté à obtenir un diagnostic médical – trois d’entre elleux n’en ont pas.
Aujourd’hui, même si j’assume mon autisme ouvertement, il peut m’arriver d’avoir peur de ne pas être cru·e.
Zhaki
Pour Zhaki, poète·sse et auteurice, c’est l’une des différences les plus frappantes entre les autistes blanc·hes et noir·es : « Le fait que les personnes blanches puissent être diagnostiquées plus facilement les préserve des difficultés auxquelles nous autres devons être inévitablement confronté·es. » Traitements inadaptés, hospitalisations à répétition, absence d’accommodations et d’aides financières ou humaines font partie des obstacles à surmonter lorsque notre handicap n’est pas reconnu officiellement.
Toutefois les réseaux sociaux permettent enfin une certaine démocratisation du diagnostic : dans un système de santé que l’on sait défaillant, l’autodiagnostic a autant sa place qu’un diagnostic dit « officiel ». C’est d’ailleurs sur des plateformes telles que TikTok et Instagram qu’une étudiante américaine à choisi de mener ses investigations dans le cadre d’un projet de fin d’études sur l’autisme noir, dans lequel elle explique : « Le but de ce projet est de montrer comment les diagnostics tardifs d’autisme sont discutés sur les réseaux sans pour autant faire l’objet de recherches dans le monde scientifique. » Et en effet, sous le hashtag #Autizzy, on discute beaucoup des spécificités de l’autisme noir et des différences culturelles qui ne rentrent pas dans le champ du diagnostic blanc et ethnocentré. Pour Zhaki, c’est un outil pour s’entraider, à défaut d’être aidé·e par le système : « Le hashtag nous permet d’avoir les infos, les ressources et la représentation qu’on ne trouverait pas autrement. »
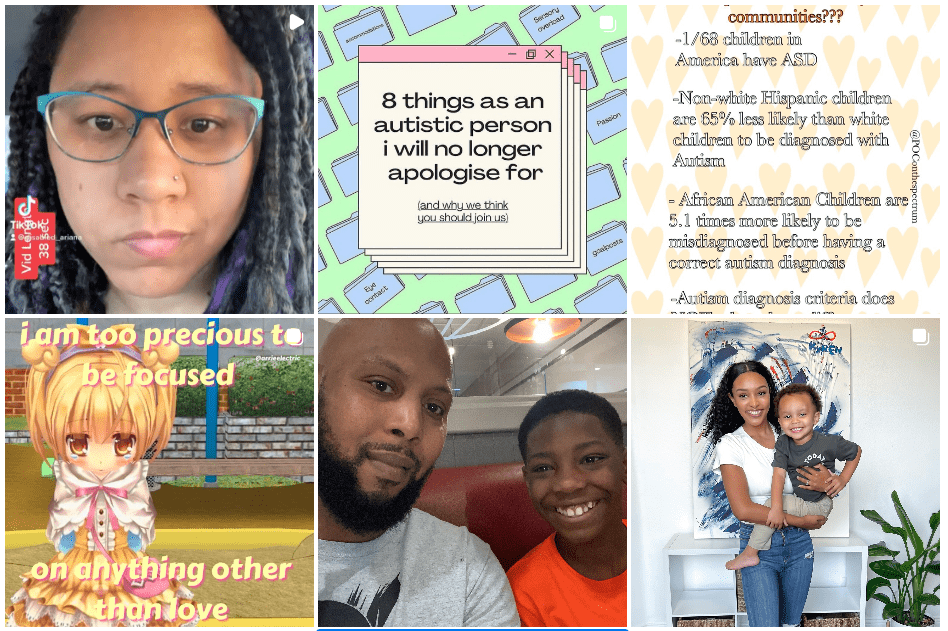 Capture d’écran du fil Instagram #Autizzy (22/05/2023)
Black autistic lives matter
Capture d’écran du fil Instagram #Autizzy (22/05/2023)
Black autistic lives matter
Si la communauté noire est confrontée depuis toujours aux violences policières, on oublie souvent de préciser que ce sont les personnes noires handicapées qui sont les plus exposées. Aux États-Unis par exemple, plus de la moitié des personnes tuées par les forces de l’ordre chaque année sont porteuses d’un handicap. Le risque est donc double pour les autistes noir·es qui doivent déjà, de par leur racisation, faire face à une répression plus violente.
Avery, militant santé mentale et créateur de contenus de sensibilisation à l’autisme noir, m’explique qu’en tant qu’homme noir et autiste aux États-Unis, il doit sans cesse faire des efforts considérables pour paraître moins autiste et donc moins menaçant : « J’ai lu un article sur un adolescent autiste et noir qui a été tué par la police. Il avait son casque antibruit et iels l’ont abattu. Je pense souvent à ma capacité à masquer correctement [fait de cacher ses traits autistiques, ndlr] afin de ne pas apparaître comme une menace pour elleux, même si ma peau noire équivaut à ce que je brandisse une arme pour la police. Je suis terrifié à l’idée de voir les choses devenir fatales très rapidement. »
Car lorsqu’ils se manifestent chez des personnes non blanches, les comportements autistiques peuvent être interprétés négativement et amplifier des stéréotypes raciaux. Certain·es d’entre nous présentent des difficultés à traiter les informations, ne supportent pas d’être touché·e, sont non-verbaux·ales ou peuvent réagir de façon « inadaptée » aux interpellations, ce qui peut rendre nos interactions avec la police extrêmement dangereuses. Nos façons de communiquer, de se tenir ou d’agir peuvent être envisagées comme extravagantes ou étranges lorsqu’il s’agit d’autistes blanc·hes, mais deviennent suspectes voire menaçantes chez les non-blanc·hes. Ainsi près de 55% des hommes noirs handicapés seront arrêtés par la police avant leurs 28 ans. Ce fut le cas pour Elijah McClain, un jeune américain de 23 ans qui, sorti pour acheter une boisson pour son frère, fut interpellé par des agents de police ayant reçu un appel décrivant son comportement comme inquiétant. Une incompréhension des comportements autistiques couplée à des biais racistes et psychophobes lui ont coûté la vie et continuent d’être des menaces bien réelles pour la communauté noire.
De plus, alors que le racisme peut avoir des effets néfastes sur notre santé mentale, on présente également en tant qu’autiste 6 à 13 fois plus de risques de mourir par suicide que les neurotypiques. Et c’est aussi pour ces raisons qu’Avery a choisi de se positionner et de s’exprimer sur les réseaux avec #Autizzy : « Je recevais des messages de personnes disant que mes vidéos les retenaient ici sur cette Terre quand les choses devenaient vraiment difficiles pour elleux. Je continue à faire cela parce que je reçois encore des messages de personnes qui perdent des membres de leur famille ou des ami·es à cause de dépressions. » Il ajoute : « J’ai réalisé que les gens avaient besoin d’un espace sûr pour se sentir moins seul·es. »
Voir cette publication sur InstagramSolitude et ostracisme
Parce que la solitude frappe durement les personnes noires sur le spectre de l’autisme, qui ont tendance à être exclues et ont du mal à être acceptées. Louise, étudiant·e en école d’art, nous parle de « ce sentiment de n’être jamais entièrement compris·e, peu importe avec qui l’on discute. C’est un sentiment d’isolation qui peut peser. » Zhaki acquiesce : « Aujourd’hui, ça reste presque impossible pour nous d’être ou de se sentir intégré·e dans une communauté. » Un constat qui va bien au-delà d’un simple ressenti personnel : d’après une étude de la DREES, la réalité pour une grande partie des personnes handicapées en France est faite de précarité, de solitude et d’exclusion. En 2015, 18% des sondé·es déclaraient se sentir seul·es « tout le temps » ou « la plupart du temps », contre 7% pour le reste de la population.
Pour les handicapé·es non-blanc·hes, le phénomène est accentué : que ce soit pour la recherche d’un appartement, d’un emploi, d’une communauté, d’un·e partenaire, ou encore lorsqu’on est confronté·e aux personnels soignants ou aux forces de l’ordre, on experimente généralement racisme et validisme simultanément. En France, alors que la majorité des autistes en âge de travailler sont exclu·es du marché du travail et que, d’un autre côté, les discriminations à l’embauche liées à l’origine ou au genre sont toujours bien présentes, les autistes noir·es n’ont presque aucune chance d’obtenir un emploi qui ne soit pas précaire. Dans les relations romantiques, le constat est le même : les noir·es cisgenres, queers, trans et/ou assignées femmes à la naissance se retrouvent, comme l’explique Christelle Murhula dans son dernier livre Amours silenciées, délaissées sur le marché de la séduction, et auront d’autant plus de mal à trouver un·e partenaire si iels ont un handicap. De manière générale, faire des rencontres s’avère complexe : la précarité, le manque d’aménagements adaptés, l’inaccessibilité et l’absence de diversité de certains événements ou lieux, notre incompréhension des codes sociaux, nos sensibilités sensorielles, les (micro)agressions racistes et validistes dont on peut être la cible ou encore la réticence qu’ont les gens à socialiser avec des personnes handicapées sont autant de facteurs qui peuvent limiter nos interactions sociales.
Face à ce constat, il y a un besoin urgent pour les autistes noir·es d’avoir enfin leurs propres espaces et communautés. Pour Louise comme pour beaucoup, #Autizzy est un bon moyen de connecter avec des personnes qui partagent des expériences similaires, tant positives que négatives : « Je me sens assez chanceux·se d’avoir eu connaissance de ce hashtag et d’avoir pu comprendre et mettre des mots sur les choses que je ressentais » ajoute-t-ielle.
On ne voit pas assez de personnes comme moi dans les médias et je veux montrer aux gens qu’on existe !
Bee
Voir cette publication sur InstagramUn besoin urgent de représentationUne publication partagée par Léi [REDACTED] | LLES (@lei_redacted_)
Notre invisibilisation est telle que dans l’imaginaire collectif, un·e noir·e autiste est quelque chose de rare, si ce n’est inexistant. Alors que la prévalence de l’autisme est la même pour toutes les catégories ethniques, beaucoup de personnes continuent de penser qu’on ne peut être les deux à la fois. Dans une lettre adressée à la jeunesse autistique noire et autochtone, l’auteur·e et artiste Wolfheart Sanchez s’exprime à ce sujet : « Ce n’est pas qu’il y a une mauvaise représentation des autistes noir·es ou autochtones : il n’y en a juste pas. Les autistes blanc·hes peuvent se plaindre d’une mauvaise représentation, mais nous n’avons même pas cela. Comment demander des améliorations à quelque chose qui n’existe pas ? Comment construire sur l’absence d’une chose ? »
Pour Bee, blogueur·se américain·e, utiliser #Autizzy est un moyen de rendre son contenu accessible et de trouver de la représentation : « Découvrir des personnes qui me ressemblent a été tellement valorisant pour moi. Je n’avais vu que des hommes blancs autistes représentés dans les médias, donc c’était difficile de me reconnaître dans ces gens. Quand il s’agit d’autisme, je veux voir des personnes qui me ressemblent et qui peuvent s’identifier à ma culture. » Alors que je ne m’étais jamais senti·e représenté·e nulle part, le fait de voir des personnes comme Bee, Zhaki, Louise, Saël, Avery ou tant d’autres s’assumer a été également une véritable libération et source d’inspiration pour moi.
Revendiquer nos identités queersS’il a été créé pour les autistes noir·es, le hashtag garantit aussi un espace virtuel safe et une certaine visibilité pour celleux d’entre nous qui n’entrent pas dans les normes cishétéro. Noir·e, autiste et queer, pour beaucoup ces identités sont indissociables : « Je ne peux pas expliquer ma queerness sans parler de ma noirité ou de mon autisme » affirme Louise. Des études ont d’ailleurs démontré que les autistes avaient plus de chance d’appartenir à des minorités sexuelles et/ou de genre que les neurotypiques. Il est donc important de prendre en compte toutes ces dimensions afin de mieux comprendre les difficultés rencontrées à une telle intersection. L’artiste pluridisciplinaire Saël le résume ainsi : « Entre discrimination raciale, homophobie/transphobie mais aussi validisme, on est en tant que personne noire, queer et autiste au plus bas de l’échelle du privilège. »
Pour iel, le mouvement #Autizzy est un moyen efficace de trouver une communauté partageant ces mêmes spécificités, tout en lui offrant l’occasion de célébrer ses identités plurielles qu’iel revendique avec fierté : « Mon identité, la personne que je suis dans mon ensemble, ma créativité et mon existence dans ce monde seraient totalement différentes si je n’étais pas autiste, noir·x et queer. Et c’est quelque chose que je n’envisage pas. Je suis fièr·x de qui je suis. »
Si ce hashtag offre un espace et un soutien moral précieux à notre communauté, permettant d’alimenter et de rendre visibles des réflexions et des échanges militants jusqu’alors invisibilisés, les réseaux sociaux ont leurs limites et s’avèrent à eux seuls insuffisants pour affronter les systèmes d’oppressions que l’on expérimente. Certain·es militant·es l’ont bien compris et s’activent à créer des initiatives communautaires en dehors des réseaux. Notamment l’abolitionniste et avocat·e communautaire Talila TL Lewis qui adopte une approche intersectionnelle du validisme, l’artiste Jennifer White-Johnson qui axe son travail sur la visibilisation des enfants noir·es neurodivergent·es, les jeunes activistes Ben-Oni et Aiyana, fondateurices respectif·ves des organisations Black Neurodiversity et Neuromancer, ou encore le collectif artistique et groupe de danse Sins Invalid qui célèbre depuis près de vingt ans les artistes handicapé·es, en mettant au centre les artistes racisé·es LGBTQIA+ et les minorités de genre. En France, les podcasts Bininga wok et H comme Handicapé.e.s ont tous deux consacré un épisode à la question du validisme et du racisme. On compte aussi sur ces sujets les collectifs afroféministes Cases rebelles et Mwasi.
Finalement mon diagnostic m’a apporté bien plus qu’une compréhension médicale de mon autisme. Il m’a permis, en même temps qu’il m’ouvrait les yeux sur la dimension sociale de mon handicap, de découvrir des mouvements anti-validistes en pleine effervescence. Mouvements qui, je l’espère seront davantage discutés dans les milieux militants en France et se feront dans le futur une réelle place dans les luttes sociales et (afro)féministes.

Relecture et édition : Léane Alestra et Sarah Diep
Image à la une : de gauche à droite, Zakhi, Louise, Avery, Sael, Bee (artwork Kaina Djaé)
Cet article Avec #Autizzy, les autistes noir·es luttent contre l’invisibilisation provient de Manifesto XXI.

Cet article Prix Utopi·e 2023 : qui sont les dix lauréat·es ? provient de Manifesto XXI.
Cette semaine, le premier prix d’art contemporain LGBTQIA+ en Europe est de retour ! La deuxième édition du Prix Utopi·e se déroulera du 24 au 28 mai 2023 aux Magasins Généraux à Pantin, avec une soirée d’ouverture dès mardi 23 mai. Le palmarès des 10 lauréat·es promet un événement varié, queer et transdisciplinaire. Voici l’essentiel à savoir sur la programmation excitante de cette exposition-festival !En 2022, les co-fondatrices du prix, Agathe Pinet et Myriama Idir, ont donné vie à un événement où les artistes sélectionné·es font part de leurs perspectives artistiques en mettant en avant des projets audacieux aux regards hétérogènes. En plus de mettre en avant une scène artistique inclusive et novatrice, le prix Utopi·e s’engage à faire de cet instant un moment de rencontres et d’échanges pour les créatif·ves marginalisé·es. Les lauréat·es ont été choisi·es par un jury composé d’Émilie Renard, directrice de Betonsalon, Clément Postec, conseiller artistique, commissaire d’exposition et cinéaste, H·Alix Sanyas (Mourrier), artiste et membre de la collective Bye Bye Binary, Adeline Rapon, artiste et photographe, et Julie Crenn, docteure en histoire de l’art, critique d’art et commissaire indépendante. Cette année, la formule change grâce aux artistes de la première édition : le prix ne met pas en compétition les artistes, mais récompense horizontalement les 10 artistes. Iels bénéficieront chacun·e d’une dotation de 1000€, d’une résidence de deux semaines à la Maison Artagon dans le Loiret, et leur travail sera exposé dans un cycle d’expositions pendant l’hiver 2023/2024 avec les galeries Balice Hertling, Praz-Delavallade et sans titre à Paris. Une soirée de programmation à la galerie that’s what x said (Bruxelles) complète les récompenses partagées.
Au programme de l’exposition des Magasins Généraux, à voir du 24 au 28 mai, vous découvrirez des broderies politiques, des installations oniriques, des peintures acidulées, ou encore des doigts d’honneur pastel recouverts de paillettes et des séries de photographies intimistes. Un prix qui met en avant l’art sous toutes ses formes en faisant la part belle aux pratiques pluridisciplinaires et performatives.
Voici les dix artistes sélectionné·es :
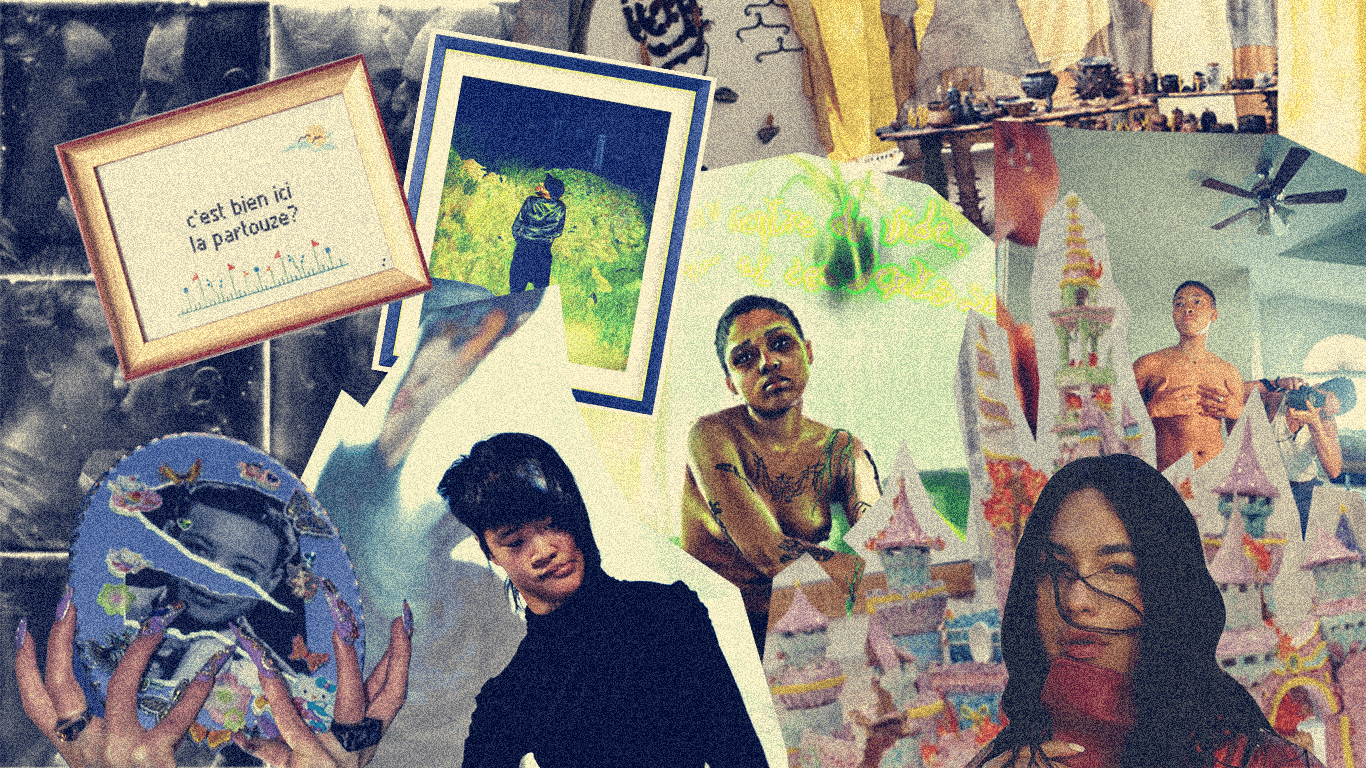
Afin de garantir une programmation qualitative et gratuite en parallèle de l’exposition, Utopi·e a mis en place une collecte participative sur Helloasso. Il reste une grosse semaine pour y participer ! Grâce à cette collecte, une soirée d’ouverture se tiendra le mardi 23 mai de 18h à 23h avec au programme plusieurs performances, proposées par Maïc Baxane, KRADEAU, No Anger, Le Kaiju et Elijah Ndoumbe. D’autres performances et stands sont aussi prévus le samedi 27 mai de 14h à 19h et une journée de clôture est organisée avec le Barboteur le dimanche 28 mai de 14h à 22h.
Suivre le Prix Utopi·e sur Instagram
Exposition-festival du 24 au 28 mai 2023 aux Magasins Généraux (Pantin), entrée libre et gratuite de 14h à 19h (mercredi-samedi) et de 14h à 22h (dimanche).
Soirée d’ouverture le mardi 23 mai, de 18h à 23h.
Relecture et édition : Apolline Bazin et Anne-Charlotte Michaut
Cet article Prix Utopi·e 2023 : qui sont les dix lauréat·es ? provient de Manifesto XXI.


Un jeune homme de 22 ans a été condamné à trente ans de réclusion criminelle ce vendredi 19 mai, pour le meurtre de Gaëtan, dit Daniel, et la tentative de meurtre commise à l’encontre d'un de ses amis, Fred, dans la nuit du 10 au 11 avril 2019 à Villejuif.
L’article 30 ans de réclusion pour le meurtre de Daniel et la tentative de meurtre de Fred à Villejuif est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra a annoncé la constitution, d’ici « l’automne prochain », d'un groupe d’experts afin de définir des préconisations pour « favoriser l'inclusion » des personnes transgenres dans le sport de haut niveau.
L’article France : Un groupe d’experts pour « favoriser l’inclusion » des athlètes transgenres est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cette décision de la plus haute instance juridique est une avancée historique pour les personnes LGBT+ dans ce pays d’Afrique australe, qui proscrit l’homosexualité depuis 1927.
L’article La Cour suprême en Namibie reconnaît les mariages de couples homosexuels conclus à l’étranger est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Maxime-Margaret Loiry, « cheffe de pôle des transidentités » chez STOP homophobie, souligne la place de ces échanges dans le cadre de l'éveil à la citoyenneté qui est au cœur de la mission de l’Éducation Nationale, en vue « de former de futur citoyens ».
L’article LGBT+phobies : « Les interventions en milieu scolaire sont indispensables » est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.


L'association a dévoilé ce 17 mai une campagne de prévention diversifiée, accompagnée d’une information valorisant les différents modes de dépistage du VIH dans le département.
L’article Shams-France inaugure sa première campagne de « santé sexuelle ciblée » en Seine-Saint-Denis est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.


Le centre LGBT de Nice Côte d’Azur organise un grand festival sur quatre jours pour sensibiliser aux LGBTphobies. Au programme : des rencontres / débats, un village associatif, des moments de convivialité et une marche militante, le dimanche après-midi. Erwann Le Hô, coordinateur du Centre, nous présente l’événement.

Cagoulés, avec fumigène et brandissant une banderole, plusieurs membres d'un groupuscule rennais ont perturbé la prestation, avant de rapidement évacuer les lieux avec l’intervention des gendarmes qui ont ouvert une enquête.
L’article A Saint-Senoux, un atelier de lecture par des drag-queens perturbé par une manifestation d’extrême droite est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

2 420 crimes ou délits et 1 620 contraventions enregistrés par les services de police et de gendarmerie, qui notent également une explosion de ces actes lgbtphobes depuis 2016.
L’article France : Hausse de 3% des infractions « anti-LGBT+ » recensées par les forces de sécurité en 2022 est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article ascendant vierge, au top : « Une nouvelle chance, c’est une transformation » provient de Manifesto XXI.
ascendant vierge, le duo formé par Mathilde Fernandez et Paul Orzoni a publié fin avril son premier album, Une nouvelle chance. Les chansons des deux artistes sont toujours aussi épiques, mais iels ont aussi su ralentir un peu pour explorer d’autres rythmes.Leur premier EP Vierge avait un peu (carrément ?) sauvé notre année covid. La pandémie aura un peu ralenti l’ascension de l’explosif duo gabber lyrique mais trois ans plus tard, ascendant vierge est de retour avec un album destiné à faire décoller leur carrière, Une nouvelle chance. Un titre qui évoque une nouvelle rencontre avec leur public, mais laisse aussi la place à plusieurs lectures. « Une nouvelle chance, c’est une transition, une transformation, c’est se donner une nouvelle chance à soi » explique Mathilde au tout début de cet entretien. Sur la couverture de l’album, co-publié avec leur label 12 Stars, Mathilde et Paul posent en rescapés d’un crash d’avion. Une nouvelle chance, c’est aussi la somme des réflexions qui ont traversé les deux artistes pendant la période passée de quasi fin du monde. Si demain tout peut s’arrêter, alors que peut-on faire de mieux que danser ? L’énergie rave d’ascendant vierge répond à un besoin vital d’optimisme et d’évasion, une rage de vivre au bord du gouffre, une soif de beau contre le vertige de la dystopie. Ce premier album posait presque un défi en soi pour ce groupe à l’esthétique hyper affirmée. À travers cette dizaine de tracks, ascendant vierge a réussi à trouver un équilibre entre ce qu’on aime de son ADN au caractère bien trempé et une ouverture sur d’autres facettes sonores. Le nouveau départ se fait en trombe avec deux dates sold out au Trianon, une belle tournée européenne derrière, et la consécration d’une date au Berghain en juin. On a discuté avec elleux juste avant leurs concerts à Paris.
Manifesto XXI – Qu’est-ce qui vous a amenés à choisir le symbole de l’avion ?
Mathilde Fernandez : Quand on est sortis du confinement, un ami nous a appelés pour nous dire de venir vite à Charleroi parce qu’il y avait un avion écrasé dans la ville. Donc on a pris tous nos habits pour faire des photos, sans savoir pourquoi ! C’était complètement providentiel. On a fait les images, d’ailleurs je crois que l’image de la pochette de l’album a été prise avec un Fujifilm jetable. À ce moment-là, on avait déjà quelques morceaux, et quelque chose se passait entre eux. L’association d’Une nouvelle chance et de la photo a été une évidence. Ça a été super intéressant de construire autour de ça ensuite.
Paul Orzoni : Il y avait l’idée aussi qu’après un crash, tu récupères la boîte noire, avec toutes les informations du vol. C’est la mémoire de l’avion mais ça peut être aussi la mémoire personnelle, quand tu as frôlé la mort et que tu as vu toute ta vie défiler. C’était marrant qu’il y ait plusieurs niveaux de lectures, avec un côté un peu mégalo, un peu Lost.
Est-ce qu’on sait où allait cet avion ?
M.F : Il faisait du sur place. (rires)
Est-ce que la réponse fait partie du live ?
M.F : On garde un peu le mystère, mais oui on va dire qu’on s’est beaucoup amusés avec toutes ces histoires, notamment sur les réseaux sociaux. On a fait un gros black out à la fin de la tournée l’année dernière, et pour reconnecter les gens, on a fait ce post qu’on a passé pas mal de temps à imaginer pour annoncer notre retour. Il y avait plein de petits indices cachés : A14 c’est le nombre de morceaux, le symbole de l’infini, une référence au Megamix… Quand tu scannais le QR code, tu tombais sur un morceau quelques jours avant la sortie en exclu. C’est comme ça qu’on a lancé la promo.
Voir cette publication sur InstagramUne publication partagée par ascendant_vierge (@ascendantvierge)
Vous avez beaucoup investi Instagram avec des productions drôles aussi pour teaser l’album. Quelle place occupe ce réseau dans votre vie ?
P.O : Comme beaucoup de personnes, on est dans un rapport hyper complexe aux réseaux sociaux. On est ultra conscient·es [de leurs limites] tout en étant pris au piège. Même pour avoir un discours de groupe, ce n’est pas simple. Tout l’aspect mise en scène de la vie privée ne nous met pas à l’aise. Donc on a pris le parti de montrer tout ce que le public voudrait voir, de nos enregistrements, nos rêves, nos peurs, mais d’ajouter une dose d’absurde, quelque chose de décalé. C’est quand même une mise à nu, une manière de se rapprocher de son public. C’est vrai que c’est pas mal de discussions, toujours en cours : comment continuer, comment exister ? Comment disparaître aussi ? Moi à titre personnel, j’ai supprimé Insta quatre ou cinq fois, j’ai eu beaucoup de « nouvelles chances » avec ce réseau. Je ne suis pas super à l’aise. En plus, avant, je taffais dans la pub, le digital.
M.F : Moi j’ai une utilisation d’Instagram façon Tumblr, à l’ancienne, je me fais des moodboards. En tout cas on se rejoint sur notre vision des réseaux. Ça m’énerve de faire un selfie, j’ai l’impression de me mettre un coup de poignard… Donc on trouve des parades pour assurer une présence et jouer avec les codes.
P.O : C’est vrai que c’est aussi une proximité géniale avec le public.
M.F : Disons que le chemin a été long pour trouver une manière de connecter en s’amusant.
J’ai la mentalité hip-hop, je suis un peu un rageux. Pas dans le sens où je bitche sur les gens mais j’ai ce truc avec la performance… Mais c’est vraiment positif, c’est une compétition avec moi-même, et pour faire plaisir à Mathilde, être mieux que la prod d’avant.
Paul Orzoni
C’est ce recul qui fait qu’« Influenceur » résonne chez tant de gens ? C’est devenu un tube emblématique de l’époque, au point même d’en agacer certain·es.
M.F : Quand j’ai écrit « Influenceur », c’était que j’avais quelque chose à régler quelque part. J’avais déjà fait quelques performances dans le milieu de l’art contemporain avec Cécile Di Giovanni sur cette addiction aux écrans, sur le narcissisme. C’était décliné en plusieurs parties : « Internet balad », « Porter la peau de sa victime »… C’était sur l’obsession de l’image de soi-même, poussé à l’extrême. C’est tombé au moment où la prod de Paul est arrivée.
P.O : Le son le plus simple à faire, enregistré dans sa chambre ! (rires)
M.F : J’étais tellement chargée de ces réflexions-là que le texte s’est écrit en une demi-journée. J’écris rarement un texte aussi vite.
Ce qui m’intéresse c’est la poésie, les ornements, les cheminements pour disséminer du sens de-ci de-là et qu’après l’auditeur fasse son travail d’aller récupérer ce qui résonne pour elle ou lui.
Mathilde Fernandez
Plusieurs chansons de l’album font référence à la compétition (« Défi », « Au top »). D’où vient cette thématique ?
P.O : On a un défi permanent entre nous.
M.F : Les paroles « C’est un défi, c’est pour te plaire », c’est pas une blague !
P.O : Deux jours après la sortie de l’album, je lui ai envoyé une nouvelle prod et j’étais tout excité, j’adore me dire qu’elle va bien aimer. Ou « Ah, elle s’y attendait pas à celle-là » ! J’ai la mentalité hip-hop, je suis un peu un rageux. Pas dans le sens où je bitche sur les gens mais j’ai ce truc avec la performance… C’est vraiment positif, c’est une compétition avec moi-même, et pour faire plaisir à Mathilde, être mieux que la prod d’avant.
M.F : On est dans un jeu permanent, on a plus envie de se faire peur que de se rassurer…
P.O : Moi je suis comme un ouf quand Mathilde est un registre vocal comme « Au top » où ça rappe presque, ou par exemple sur « Slowlita ».
M.F : Moi aussi j’essaye de te surprendre à chaque fois !
Un album c’est comme une pièce de théâtre de Molière, tu as un personnage principal et tous les personnages comptent. Si tu en enlèves un, ça ne tient plus debout.
Mathilde Fernandez
Comment l’actualité impacte-t-elle votre travail ? Les thématiques de l’urgence climatique ou une forme d’appréhension face au futur sont là en fil rouge dans les textes mais ce n’est jamais explicitement le sujet d’une chanson.
M.F : Quand j’écris, j’aime bien laisser la potentialité à ce que l’inverse du sens soit également lisible. J’aime faire des textes à double sens, miroir. Je pense que je serais gênée d’aborder les textes de manière frontale. C’est dans ma personnalité, ce qui m’intéresse c’est la poésie, les ornements, les cheminements pour disséminer du sens de-ci de-là et qu’après l’auditeur fasse son travail d’aller récupérer ce qui résonne pour elle ou lui. Si on va franco sur un sujet, ça laisse peu de place à l’interprétation.
Et toi Paul comment ça se traduit en production ?
P.O : L’époque et les messages passent plus par le texte. Je n’ai jamais demandé d’explication à Mathilde. Des fois même, je ne comprends pas. (rires) Je vais dire quelque chose de banal mais je n’ai jamais d’idée quand je commence à composer. J’ouvre le logiciel et c’est en faisant que je vois des connexions. Quand les premières tracks de l’album ont été posées et qu’on a eu une première image de l’ensemble, oui je me suis dit qu’il y avait par exemple des territoires sur lesquels on n’était pas allés. Les ajustements sont plutôt fonctionnels disons. Après bien sûr, je suis traversé par les événements de l’époque comme tout le monde.
 © Ines Ziouane
© Ines Ziouane
Il y a une forme de progression dans l’album, de votre socle sonore vers d’autres rythmes. C’est voulu ?
P.O : Oui en quelque sorte.
M.F : Un album c’est comme une pièce de théâtre de Molière, tu as un personnage principal et tous les personnages comptent. Si tu en enlèves un, ça ne tient plus debout. On avait vraiment cette volonté, pour le jour où on ferait un album avec un grand « A », de créer cette trame. Il y a plein de tracks qu’on n’a pas mis dans l’album par exemple.
P.O : On a l’approche de l’album à l’ancienne. C’est peut-être un fantasme d’artiste, mais la chanson un correspond bien à sa place dans la tracklist.
Et comment on arrive sur « T’aimer sur le long terme » qui est une chanson super reggae ?
P.O : Pendant le confinement, je me suis rapproché d’un ami qui a un show de reggae sur Kiosk Radio, et il m’a entraîné dans ses ambiances. J’écoutais aussi beaucoup de playlists sur NTS.
M.F : C’était très confortable d’écouter du reggae pendant le confinement à Bruxelles où il fait tout le temps moche. Écouter du reggae était assez thérapeutique pour contrebalancer l’ambiance morose. J’en ai beaucoup écouté gamine.
P.O : Oui moi aussi, ça ne vient pas de nulle part. Après pourquoi retenir cette influence-là plutôt que Brian Eno qu’on a beaucoup écouté par exemple ? Qu’est-ce qui fait que c’était valable pour ascendant vierge ? Parce que le reggae vient du soundsystem, de la dub, des basses. Même dans les influences des 90’s dans lesquelles on va piocher, il y a eu pas mal d’incursions reggae, par exemple « All That She Wants » d’Ace of Base. C’était cohérent dans le tableau général et c’est pour ça qu’on y est allés.
M.F : C’était un vrai challenge, on s’y est pris à plusieurs fois.
P.O : Oui c’est un morceau qui a été long à produire mais dont on est super fiers. On écoutait aussi Nightclubbing de Grace Jones, un EP de club avec des inspirations reggae.
M.F : Moi j’écoute beaucoup Leila K, une chanteuse suédoise des années 90 qui a eu pas mal de morceaux avec un petit vernis dub-reggae mais complètement destroy, avec des sons d’impacts métalliques, limite empruntés à l’indus, en même temps. On s’est rejoints sur cette envie, et ça s’est bien complété avec Lucien Krampf qui a réalisé l’album.
P.O : À un moment où on avait remis le morceau totalement à nu, les seules choses valables c’étaient les paroles de Mathilde et la ligne de basse. Par hasard, je suis arrivé chez Lucien hyper excité et il était en train de bricoler un tape delay à l’ancienne. Avec ça tu ne contrôles pas bien la manière dont vont tomber les effets, mais tout de suite on s’est lancés, on a tout ouvert et construit la rythmique ensemble. On a mis longtemps à trouver ce que devait être ce morceau.
M.F : On a rajouté des instruments organiques là-dessus, deux guitares et un pedal steel. Ça fait un peu des glides, quelque chose d’hawaïen.
Quelles sont les autres influences de l’album ?
M.F : On aime bien « Frozen » de Madonna, qui s’entend dans « Ce monde où tu n’existais pas ». C’est un morceau plus anglais, trip-hop. Là il y a eu moins de trafic, Paul m’a envoyé l’instru et j’ai posé le texte le lendemain. Je me traînais cette phrase « J’ai ressuscité dans un monde où tu n’existais pas… » depuis quelque temps. C’est un morceau qui n’a quasiment pas changé.
P.O : Moi j’avais envie de faire un morceau plus lent et ça se voit sur « Lubies ». C’est une continuité de mon EP Amoureuse, inspiré du style lento violento du DJ Gigi D’Agostino. C’est à 110 BPM mais avec des placements de hard music.
M.F : C’est le dernier morceau qu’on a ajouté à l’album, il date de décembre 2021. Il a été enregistré à New York pour la petite anecdote un peu chic !
Image à la Une : © Ines Ziouane
Cet article ascendant vierge, au top : « Une nouvelle chance, c’est une transformation » provient de Manifesto XXI.

Cet article 5 documentaires pour lutter contre les LGBTQI+ phobies provient de Manifesto XXI.
En cette journée de lutte contre les LGBTphobies, Manifesto XXI vous propose une sélection de cinq productions qui nous ont touché et donnent un aperçu de l’ampleur des combats qu’il reste à mener pour les droits de toutes et tous.
Le rapport 2023 de SOS Homophobie relève que les agressions physiques sont en « inquiétante hausse« : +28% d’agressions homophobes par rapport à 2022, et +27% pour les cas de transphobies. Au-delà des chiffres, nous vous proposons de plonger dans diverses réalités, ces films sont des manières sensibles de sensibiliser, mesurer l’étendue des oppressions mais aussi créer des solidarités et des moyens de s’organiser.
Guet-apens, des crimes invisibles (2023)Ils sont humiliés, frappés, parfois tués, dans le plus grand silence. Chaque semaine, en France, un homosexuel est attiré dans un piège. Ces guets-apens, symptômes d’une homophobie viscérale, n’ont pas disparu. Mediapart vous propose un documentaire exceptionnel sur ce phénomène, quarante ans après la dépénalisation de l’homosexualité dans notre pays.
Entre deux sexes (2017)Une société aux normes de genre binaires rigides laisse peu de place aux personnes intersexes. Entre deux sexes raconte les parcours, souvent marqués par les mutilations infantiles et les violences médicales, de celleux qu’on appelait jadis «hermaphrodite». Ce film est un florilège d’histoires de vie, et suit notamment Sarita Vincent Guillot, militant·e intersexe, cofondateur de Organisation internationale des intersexes et co-organisateur d’un forum annuel dédié à l’intersexuation à Douarnenez.
Sortir de l’ombre (2023)Quels sont les enjeux de la lutte contre les LGBTphobies hors de France métropolitaine ? Ce documentaire de 50 minutes nous emmène en Martinique où plusieurs personnes racontent leurs combats contre le en-dira-t-on et les violences, mais aussi leurs espoirs et l’amour des leurs. Des paroles rares et précieuses, qui nous parlent de traumatismes, d’héritage colonial et de retrouvailles. A travers ces cinq témoignages et les interventions de la sociologue Nadia Chonville, le documentaire dresse en finesse un tableau des ressorts de l’homophobie sur ce territoire.
Comment la droite réactionnaire construit une « question trans » ? (2022)Dans cette vidéo documentaire co-écrite et produite avec XY Media, le collectif Toutes des Femmes décrypte comment les droites et extrême-droites se saisissent de la transphobie pour créer une panique morale, mettre en place des mesures contre les droits des personnes trans dans de nombreux pays, et rassembler autour d’elles tous les transphobes.
The Archivettes (2019)« Notre histoire disparaissait aussi vite que nous la vivions » Partant de ce constat, les activistes américaines Deborah Edel et Joan Nestle ont fondé les Lesbian Herstory Archives en 1974, la plus importante collection au monde de documents et d’objets par et sur des lesbiennes. Le documentaire montre comment ce groupe de lesbiennes s’est uni pour lutter contre l’invisibilité et créer « un endroit positif, qui dit oui c’est possible ». Un documentaire qui rend encore plus urgent l’ouverture d’un centre dédié aux archives LGBTQIA+ à Paris, car pour lutter contre les LGBTphobies à long terme, il faut aussi pouvoir s’inscrire dans le temps et transmettre des luttes.
Rédaction : Apolline Bazin
Image de tête : Extrait du documentaire Sortir de l’ombre
Cet article 5 documentaires pour lutter contre les LGBTQI+ phobies provient de Manifesto XXI.


1783 témoignages, contre 1161 l'année précédente, dont 70% pour des infractions liées à la haine en ligne et 30% à des faits commis dans l’espace physique.
L’article Haine anti-LGBTI+ en France : Plus 53 % de signalements sur l’application FLAG! est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

296 procédures ont été engagées, dont près d'un tiers (34%) pour des violences commises dans des lieux publics, avec un pic au mois de juin 2022.
L’article Rapport 2022 « ligne d’écoute » : plus de 2 800 appels « et une explosion des agressions avec circonstances aggravantes » est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

L'opération était organisée dans le cadre de la 3e édition de la semaine des fiertés organisée du 17 au 28 mai avec la mairie du 5e.
L’article A Lyon, l’exposition « Les luttes LGBTQI+ en France » vandalisée en marge de l’IDAHOBIT+ est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Yannick Hoppe et son ami ont été agressés à Dijon, par un individu qui leur a lâché « C'est ta sentence », « mort aux pédérastes », avant de leur asséner des coups de couteau.
L’article L’ancien maire du Bourget et son conjoint poignardés : « En 2023, en France, l’homophobie peut tuer et tue encore ! » est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.


Cet article Aux Archives LGBTQI+, une première programmation très hot provient de Manifesto XXI.
Face à l’urgence de documenter nos luttes et vies queers, les archives LGBTQI+ ouvrent leurs portes au public dans un premier lieu et proposent des rencontres passionnantes autour des questions de mémoire et d’archivage.Si ce projet des Archives LGBTQI+ voit le jour, c’est grâce au Collectif Archives LGBTQI+, qui fut créé en 2017 par Act Up-Paris à la suite de la sortie du film 120 battements par minute. Ce dernier rassemble l’Inter-LGBT, le centre LGBTQI+ Paris Île-de-France, et 17 associations telles que SOS Homophobie, Medusa, Act Up-Paris ou FièrEs, ainsi que de nombreux·ses professionnel·les de l’archive, historien·nes, chercheur·ses, collectionneur·ses et militant·es. Une démarche salutaire, ayant l’objectif de créer et de pérenniser un Centre d’archives LGBTQI+ Paris IDF (Île-de-France). Pourtant l’idée d’un centre d’archives n’est pas née en 2017.
Ce projet se concrétise après plusieurs décennies de bras de fer entre les associations, la mairie de Paris et l’État. Pendant plus de trente ans, les militant·es et les associations LGBTQI+ se sont battu·es pour acquérir un centre d’archives géré par la communauté. Dans un article publié dans la revue Regards.fr, Cy Lecerf Maulpoix revient sur le chemin de croix vécu par la communauté LGBTQIA pour obtenir un centre d’archivage. Le journaliste rappelle combien le dossier a sans cesse été repoussé, transmis d’une équipe municipale à l’autre, au gré des ambitions des élu·es et des élections. En 2019, ces discussions ont abouti à plusieurs engagements de la part de la mairie avec notamment l’attribution de locaux, des financements accrus et la possibilité d’une gestion associative du centre, y compris concernant la conservation des archives sur place. Selon Cy Lecerf Maulpoix, l’enjeu derrière est aussi de défendre une culture de « l’archive vivante », « moderne et participative », nourrie « des expériences et de solutions éprouvées par les centres d’archives existants ». En d’autres termes, d’être en mesure de sauvegarder des photographies, textes et lettres… d’individu·es LGBTQI+ retraçant leur quotidien et non simplement des actions à dimension artistique ou politique.
Toujours dans l’attente que les engagements de la mairie de Paris soient tenus, les archives ont tout de même pu ouvrir leurs portes ! Depuis juillet 2022, le collectif a élu domicile au 13 rue Santeuil (Paris 5e), sur l’ancien site de l’université de Censier Paris Sorbonne, et régit les fonds d’archives LGBTQI+ qui leur sont confiés. Début 2023, iels ont élaboré une programmation culturelle à la fois riche et alléchante proposant une multitude d’expériences différentes.
Quelques événements sont déjà passés, mais il est toujours possible de prendre le train en marche ! Le samedi 17 juin, les archives recevront l’iconique réalisatrice Cheryl Dunye à qui l’on doit Watermelon Woman (1997) pour une session autour de la thématique « Archiver comme ». Le dimanche 18 juin, se déroulera une table ronde autour de la question « C’est quoi un·e archiviste ? » avec Céline Guyon (Association des archivistes français), Morgane Vanehuin (Aides), Catherine Gonnard (Ina et Lesbia magazine) et Sonia Dollinger (Archives municipales de Lyon). Toujours en juin, les archives présentent l’exposition Nos luttes à bout de bras avec Mikaël Zenouda et Natæn Harran, artiste-curateur. Au fil des manifestations, les deux artistes ont sauvegardé et récolté par leurs propres moyens une impressionnante collection d’ambiances sonores et de pancartes portées par les manifestant·es queers.
Pour suivre le démarrage de ce projet particulièrement précieux et nécessaire pour l’histoire de la communauté LGBTQI+, retrouvez l’intégralité de leur programmation sur leur site internet : https://archiveslgbtqi.fr.
Relecture et édition : Sarah Diep
Illustration : Léane Alestra
Cet article Aux Archives LGBTQI+, une première programmation très hot provient de Manifesto XXI.


En parallèle et complément du festival de musiques électroniques Nuits Sonores, Arty Farty propose des temps de réflexion avec des actrices et acteurs culturel·les venu·es d’Europe. C’est Nuits Sonores Lab et c’est gratuit.
Durant trois jours, du 17 au 19 mai, Nuits Sonores Lab s’installe chez Heat, au H7 et à l’Hôtel 71 pour une série d’ateliers et de conférences ponctuée – festival de musiques électroniques oblige – de DJ sets. On pourra ainsi s’interroger sur l’avenir du journalisme musical indépendant, apprendre à développer sa carrière à l’international avec – excusez du peu – Jennifer Cardini, ou encore se pencher sur le rôle que jouent les espaces culturels indépendants auprès des communautés qu’ils accueillent avec le passionnant artiste-chercheur serbe Bogomir Doringer en conversation avec la Néerlandaise Liese Kingma.
Du 17 au 19 mai, Nuits Sonores Lab : toute la programmation est en ligne.
©Tony Noel
L’article Nuits Sonores Lab : penser en dansant est apparu en premier sur Hétéroclite.

Zakaria Aboukhlal, Moussa Diarra, Farès Chaïbi et Saïd Hamulic auraient fait part à leur entraîneur de leur souhait de ne pas participer à la rencontre ce 14 mai face au FC Nantes pour ne pas porter le maillot arc-en-ciel contre l'homophobie dans le football.
L’article Ligue 1 : Des joueurs du Toulouse FC boycottent un match pour ne pas être associés à une campagne contre l’homophobie est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Le joueur a refusé de porter un maillot floqué aux couleurs de l'arc-en-ciel, validant ainsi de fait les comportements discriminatoires dans le football professionnel français.
L’article Football : Donatien Gomis, défenseur de Guingamp, refuse de participer à une campagne de sensibilisation contre l’homophobie est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Un bénévole associatif et des employés communaux ont été violemment pris à partie par des élèves, lors d'une opération de prévention contre les LGBT+phobies dans un collège technique de Genk.
L’article En Belgique, une action de sensibilisation contre les discriminations anti-LGBT+ dégénère en agression est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Eric Zemmour avait déclaré sur CNews le 15 octobre 2019 que « la minorité LGBT asservit l’Etat et désagrège la société ». Des allégations, portant atteinte à l’honneur et à la réputation des personnes LGBT, également rediffusés en replay sur le site de la chaîne.
L’article Éric Zemmour jugé pour diffamation publique homophobe est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

En marge de l'IDAHoBiT+, l'ONG dévoile son index 2023 des pays les plus « LGBT+ friendly », avec quelques préconisations pour endiguer la dégringolade française. Malte s'impose en tête pour la huitième année consécutive
L’article Droits LGBT+ : La France chute de la 7e à la 10e place du classement 2023 d’ILGA-Europe est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Le ministre des Armées a annoncé avoir signé un arrêté autorisant les personnes séropositives à intégrer l'ensemble des forces armées. Nous nous en félicitons mais restons mobilisés pour une évolution normative mettant fin à toute forme de discrimination en raison de l’état de santé dans l’ensemble des emplois des armées, sur le modèle de ce qui a été fait pour les métiers de la police nationale.
L’article Fin de l’exclusion des personnes vivant avec le VIH dans les armées, un grand pas à confirmer par l’individualisation de l’examen de l’aptitude est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Aux 20 ans de Nuits sonores, la fusion prometteuse des labels POLAAR et Shouka provient de Manifesto XXI.
POLAAR et SHOUKA, deux labels lyonnais reconnus pour leur hybridations musicales fusionnent le temps d’une soirée dans le hangar H7. Invités par Nuits sonores, ils promettent une énergie du feu avec des live de FRIGYA et Ninos Du Brasil, et un très attendu DJ set triple b2b avec Deena Abdelwahed, Flore et GLITTER55.Alors que Nuits sonores s’apprête à fêter ses 20 ans à Lyon, la soirée du 20 mai a en particulier a retenu notre attention pour sa programmation éclectique et aventureuse. Rencontre avec Khalil Epi, gérant de SHOUKA (et moitié de FRIGYA), producteur et musicien, et Flore, résidente du Sucre, co-manageuse du label lyonnais POLAAR (qui l’année prochaine célèbrera ses 10 ans), figure incontournable de la scène bass music française.
Manifesto XXI – Comment a émergé cette collaboration entre POLAAR et SHOUKA pour les 20 ans de Nuits sonores ?
Flore : Avec l’équipe de SHOUKA ça fait un moment qu’on se croise et qu’on se dit qu’on a envie de faire un évènement ensemble. Les équipes de Nuits sonores ont eu envie de faire collaborer deux structures lyonnaises et ça fait sens, parce qu’on a des visions pas identiques mais connexes.
Khalil Epi : Comme on est tous les deux résidents au Sucre, on avait déjà eu l’idée de faire quelque chose ensemble. Aussi, on s’entend bien artistiquement. On essaye de faire collaborer nos artistes entre nos deux labels. Bientôt ça s’appellera SHOUKLAAR (rires).
SHOUKA, dans votre bio twitter, on peut lire « Third World music and cultural reappropriation ». Qu’entendez-vous par ces termes et comment cela régit l’esthétique du label ?
Khalil Epi : Il y a pas mal de sarcasmes là-dedans. Beaucoup de nos artistes viennent de ce qu’on considère comme le tiers monde. On aurait pu mettre world music, mais ce sont des termes qui ont un peu la même connotation.
L’exercice de la réappropriation, on l’a commencé il y a 10 ans avec des albums de Stambali, un genre de musique d’Afrique subsaharienne, implanté dans certaines régions de Tunisie. Par la suite, ça a un peu été le mot d’ordre. Mais on a envie de s’ouvrir. Par exemple on travaillerait bien avec des artistes français qui se réapproprient des musiques occidentales, alpines, corses…
On a beaucoup de projets qui consistent à se réapproprier du patrimoine populaire et traditionnel d’où vient l’artiste, mais qui transforment ça en quelque chose de contemporain et dansant. Comme POLAAR, SHOUKA a une esthétique très bass music.
Flore, ça fait deux décennies que tu es active sur la scène lyonnaise, notamment avec le label et les soirées POLAAR. Qu’as-tu appris de ces années d’expérience et que voudrais-tu nous partager de l’évolution de la scène électronique lyonnaise ?
Flore : Lyon a toujours été vraiment intéressante d’un point de vue musical. Quand j’ai commencé il se passait déjà beaucoup de choses sur la scène dub, alternative, punk, techno…
C’était une scène hyper engagée dans la fin des années 90, début des années 2000, qui allait avec un choix de vie spécifique. Ça a complètement changé aujourd’hui. La musique électronique n’est plus underground. Elle est bien plus structurée et représente une économie conséquente.
La scène est aussi devenue plus variée qu’elle ne l’était. Il y avait bien une scène techno, mais depuis 5 ans, on observe une multiplicité d’esthétiques et un melting pot intéressant. Les gens se croisent plus qu’auparavant. C’est sûrement une conséquence du streaming, par lequel les auditeur·ices sont amené·es à écouter une multiplicité de styles et à s’ouvrir. Les frontières de genres se dissolvent beaucoup.
Aujourd’hui je trouve la scène assez dynamique. Il manque juste des lieux à jauge raisonnable, parce qu’il y a des musiques qui ne peuvent se développer et survivre que comme ça, avec des jauges de 250 personnes, par exemple. Ce sont des lieux où l’on pourrait explorer davantage, et encourager des plus petites structures à générer une économie.
Du coup, pour vous, quels sont les progrès mais aussi les limites de la scène musicale lyonnaise ? Est-ce que c’est une ville généreuse pour les musiques métisses, hybrides ?
Khalil Epi : Cet esprit de collaboration est de plus en plus présent. Les esthétiques sont beaucoup plus fluides et hybrides. On a plus tellement de soirées cantonnées à un genre, qu’on a eu pendant des décennies. Et le public est devenu plus ouvert. En ça, Lyon rassemble beaucoup et je pense qu’il faut en faire une richesse et continuer dans ce sens là.
Flore : Je suis d’accord avec Khalil. Je trouve qu’il y a de l’échange et un soutien mutuel entre les scènes. Ce qui est bien par exemple avec Le Sucre, c’est qu’iels explorent pas mal et peuvent changer de configuration.
Les limites, comme je disais, c’est toujours le manque de lieux alternatifs plus accessibles, et le manque de prises de risques des grosses structures. Je pense que le public est plus prêt qu’on ne l’imagine. Il y a un lieu comme Le Petit Salon qui a une jauge énorme et qui n’ose pas beaucoup. Sûrement parce qu’il y a des risques économiques plus conséquents mais je pense qu’on peut bousculer l’auditoire en invitant une tête d’affiche et en mettant à côté un·e artiste émergent·e, en explorant des esthétiques complémentaires, par exemple.
La même chose pourrait être dite pour le Club Transbo… Il y a des lieux dans lesquels on ne m’invite plus à jouer, parce que je pense que c’est lié à un manque de courage, de parti pris artistique, et ça dénote une fainéantise, une facilité dans la programmation.
Que peut-on attendre du triple back to back Deena Abdelwahed b2b Flore b2b Glitter55 ?
Flore : C’est un truc qu’on a fait spontanément en closing de Nuits sonores l’année dernière. Deena et Glitter55 faisaient un b2b de manière officielle. J’avais mes clefs USB avec moi, comme souvent, et j’ai passé des tracks avec elles de manière un peu pirate. Ça a beaucoup plu.
Donc Nuits sonores nous a proposé de remettre ça cette année. Je suis hyper respectueuse de ces deux artistes, et musicalement ça fonctionne parce qu’on fait à la fois des choses qui se rejoignent, tout en arrivant à se surprendre les unes les autres.
Donc j’encourage tout le monde à venir voir ce que ça donne, ça va être le feu !
En quoi inviter Ninos du Brasil est un choix curatorial / esthétique qui vous relie ?
Khalil Epi : Ça a été une découverte pour moi et en les écoutant ça a fait sens avec nos esthétiques.
Flore : Très rapidement l’idée de proposer un live est venue sur la table. Parce qu’on s’est dit qu’il y avait une complémentarité avec celui de FRIGYA. Et avec Ninos du Brasil il y a le meilleur des deux univers, il y a le truc très dancefloor, électronique et le truc très punk du live, brut de décoffrage.
C’est aussi sûrement ce qui relie POLAAR et SHOUKA, la musique est portée sur la danse et quelque chose de très viscéral, percussif. Je suis convaincue que si tu écoutes Ninos Du Brasil, même si tu ne connais pas, tu vas danser. C’est un truc qui est populaire au sens noble de la forme. Il y a un parti pris artistique radical, avec des vocalises, etc. Et en même temps, je ne vois pas comment tu peux ne pas bouger sur un truc pareil.
POLAAR x SHOUKA à H7, 70 quai Perrache 69002 Lyon. Samedi 20 Mai pour NS : 20 ans. Plus d’infos et billetterie
Les suivre sur bandcamp: SHOUKA, POLAAR
Cet article Aux 20 ans de Nuits sonores, la fusion prometteuse des labels POLAAR et Shouka provient de Manifesto XXI.

 Actuellement sur Arte, et en visionnage libre, un excellent documentaire sur Whitney Houston sorti en 2017, qui évoque notamment sa relation avec Robyn Crawford. Le 11 février 2012, Whitney Houston ...
Actuellement sur Arte, et en visionnage libre, un excellent documentaire sur Whitney Houston sorti en 2017, qui évoque notamment sa relation avec Robyn Crawford. Le 11 février 2012, Whitney Houston ... 
Cet article Stelios.exe : l’essor d’un phénix néo-baroque provient de Manifesto XXI.
Stélios Lazarou renaît de ses cendres avec son EP De Ave Phoenice, sorti début mars sur le label tchèque Unizone. Six titres à l’intersection des racines baroques et de l’univers hyperpop de l’artiste, fan de musiques traditionnelles. Manifesto XXI l’a rencontré à Marseille, son lieu de vie et de création.Qu’est-ce qui relie Shygirl à Jean-Philippe Rameau ? Tout, nous répondrait Stelios.exe. C’est sous ce pseudo que l’artiste pluridisciplinaire formé au conservatoire de Strasbourg vient de dévoiler son premier EP. Après un voyage en Europe de l’Est, qui éveille son intérêt pour les formes traditionnelles serbes et bosniaques, Stélios intègre plusieurs collectifs successifs, comme le groupe Lolomis. À la flûte et au synthé, il contribue depuis 2013 à cette épopée électroacoustique forte de trois disques habités.
Mais c’est bien en solo que le musicien a choisi de présenter son nouveau projet. Le Moyen-Âge y fait une incursion surprenante, porté par une symbolique mystique. Entre Oneohtrix Point Never et Arca, ce trublion amateur de fusion des styles a tiré parti de sa résidence à Artagon Marseille pour libérer une version inédite de lui-même. Parmi les quatre éléments, il fallait bien en choisir un pour annoncer l’arrivée du printemps : le choix de Stelios.exe s’est porté sur le feu. Développant une ambiance aussi planante que saturée, il explore à la première personne le mythe du phénix, qui entre en résonnance avec ses peines et ses joies.
De Ave Phoenice, le nouvel EP de Stelios.exe Entre Rameau et ArcaJ’avais envie de parler de la capacité qu’on a à se relever d’un événement complètement destructeur.
Stelios.exe
Manifesto XXI – C’est un plaisir de pouvoir discuter avec toi après la sortie de ton EP De Ave Phoenice. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ?
Stelios.exe – Je m’appelle Stélios. Mon projet solo, Stelios.exe, mélange des techniques de composition baroque et de l’hyperpop, de la musique hyper saturée, de l’expérimentation, des bouts de musique acoustique déchirée dans tous les sens. Je viens de ce milieu acoustique à la base et j’aime beaucoup expérimenter, donc je voulais trouver un espace pour réunir tout ce que j’aime dans quelque chose d’hybride. D’où la naissance de ce projet-là.
On sent ta volonté de faire un lien entre des courants d’époques très différentes. Tes morceaux plongent leur public dans un univers à la fois synthétique et organique, entre onirisme et visions dystopiques. Quelles sont tes grandes influences sonores et musicales, pour ce projet et en général ?
Il y a plusieurs axes. En fait, ce que j’aime bien, c’est de ne plus savoir ce qu’on entend exactement. Il y a deux approches : soit je pars d’un matériau complètement acoustique que je tords dans tous les sens jusqu’à brouiller la limite, soit c’est l’inverse et je pars d’un matériau électronique que j’essaie de rapprocher de quelque chose d’humain, d’organique. Je crois que dans les deux cas, ce que je cherche, c’est que l’oreille soit un peu perdue. Parfois, les deux s’échangent, se mêlent un peu. Même sans le vouloir, je me retrouve toujours à aller vers cette dynamique, donc je me dis que c’est mon destin et je l’accepte ! (rires)
Arca m’inspire complètement. L’année dernière, quand elle a sorti ses cinq albums [la pentalogie Kick, ndlr], chaque jour j’attendais minuit pour pouvoir écouter la suite ! Comme je suis flûtiste à la base, c’est mon entourage qui m’a amené à écouter différemment. J’avais une vision segmentée de la musique, avec une frontière très nette entre musique acoustique et électronique, et ce sont mes ami·es qui m’ont dit que je tenais un truc, que je pouvais mêler ces deux univers.
Des artistes comme Arca ont pavé le chemin. Grâce à elleux, on se dit qu’on a le droit de tout faire ! C’est évidemment précieux, parce qu’en ayant reçu une éducation de type conservatoire, très académique, t’es formaté·e depuis le début. Tu connais cette voie qui te semble toute tracée, et il y en a une autre qui est à des kilomètres et qui ne croisera jamais la tienne. Il faut du temps pour déconstruire tout ça. J’adore me confronter à d’autres visions, moins institutionnelles, qui me permettent de sortir des logiques dans lesquelles j’étais avant.
 Portrait de Stelios.exe © Robin Plus
Portrait de Stelios.exe © Robin Plus
Tu parlais de ta pratique de la flûte et de ton expérience en musique baroque. Sur tes réseaux, tu partages beaucoup de moments en lien avec ton groupe Lolomis. Est-ce que tu arrives à trouver un équilibre entre tes deux projets ?
Il y a de plus en plus de liens entre les deux. Au début, j’avais l’impression d’être deux personnes différentes. Dans un sens, c’était pas mal parce que je jonglais entre ces deux bulles, ces deux états d’esprit, ça me nourrissait. Et en même temps ça me faisait bizarre parfois. Récemment, les deux bulles ont commencé à se rapprocher et l’une déborde sur l’autre, donc je trouve ça plus cohérent. Je trouve ma place dans les deux projets à la fois, petit à petit.
Et les personnes avec qui tu travailles sur Lolomis te donnent parfois des conseils sur Stelios.exe ?
Au début, elles me disaient : « Ça a l’air super ce que tu fais, mais on ne voit pas où tu veux en venir ! » (rires). C’était pas super clair d’entrée de jeu, surtout qu’au départ je leur faisais écouter des maquettes non mixées, encore en cours… Je voyais où je voulais aller, mais je me souviens de situations où ma meilleure amie, qui est harpiste dans le groupe et avec qui j’habite depuis quinze ans, me regardait d’un air perplexe après avoir jeté une oreille. Maintenant, tout le monde comprend un peu mieux ce que je fais. Je me suis rendu compte que ce n’était pas forcément une musique accessible. De mon côté, je tenais à assumer des choix peut-être un peu tranchés, mais qui en tout cas étaient les miens. C’est la raison pour laquelle j’ai dévié des sentiers battus pour Stelios.exe.
Un guide pour traverser les ombresEn dehors de la musique, est-ce qu’il y a d’autres références à prendre en compte pour comprendre ton ambiance de travail et tes inspirations ?
Je dirais le quotidien, ce que je traverse au jour le jour. Quand je crée, il y a quelque chose d’immédiat, nourri par ce que je suis en train de vivre. Je ne m’en rends pas toujours compte sur le moment, mais avec le recul, ça m’inspire beaucoup. Et aussi, voire surtout, les failles. Une certaine vulnérabilité. Je ne les recherche pas, mais je constate qu’elles induisent un geste créatif.
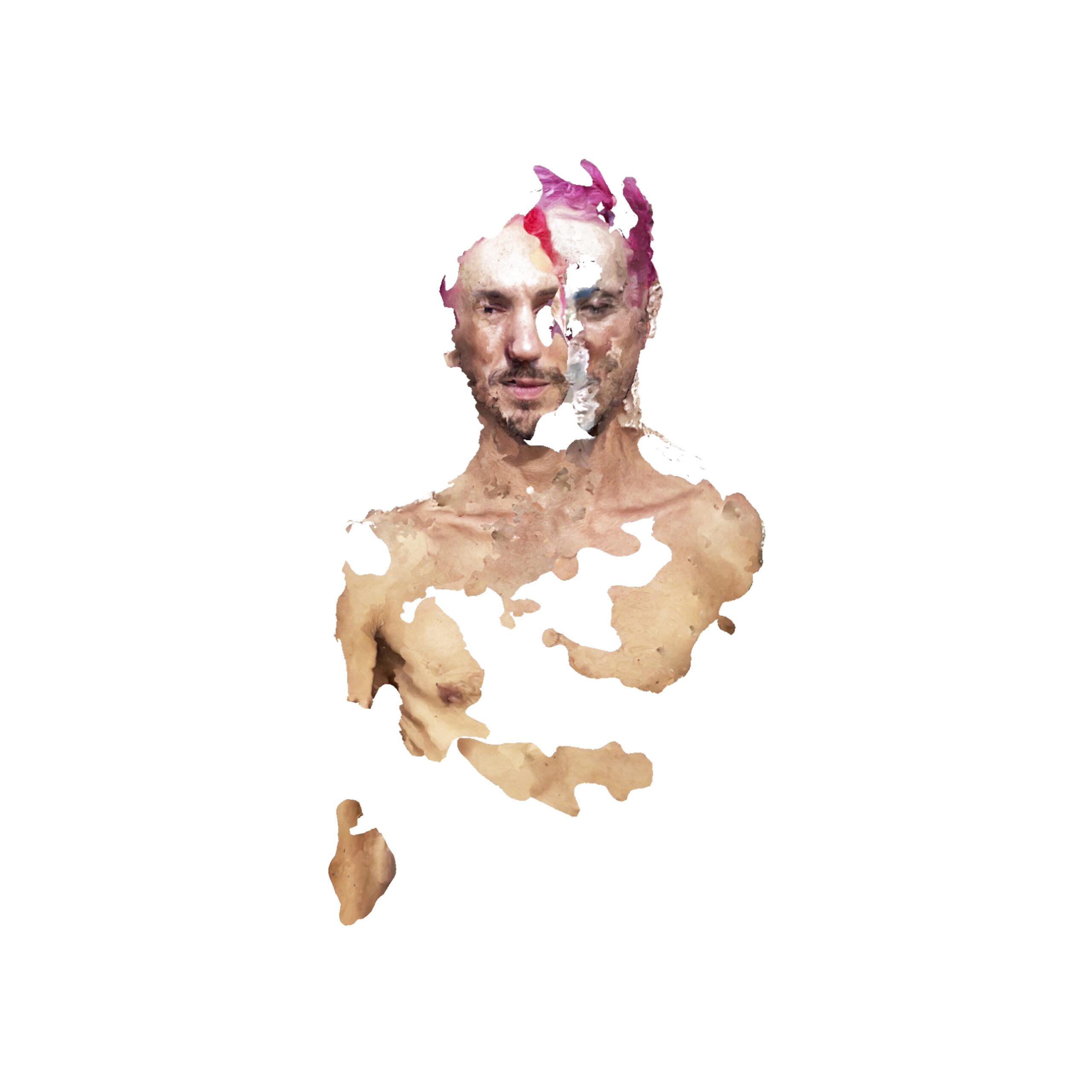 Concept art pour le projet De Ave Phoenice
Concept art pour le projet De Ave Phoenice
À ce propos, comment décrirais-tu ton processus créatif ? Plutôt expérimental, bien cadré ou un mélange de tout ça ?
C’est clairement entre les deux. Quand on s’habitue à une méthode, c’est assez difficile de la remettre en question. On essaie toujours de reproduire ce qui a marché une première fois, ce moment un peu magique, mais c’est souvent un échec. Donc il faut recommencer mille fois, jusqu’à s’y prendre autrement. C’est à la fois génial et douloureux, stimulant et destructeur. J’ai des souvenirs de mon téléphone qui vole à travers la pièce ! Ça puise tellement profondément dans ton vécu… Et tout à coup, sans savoir pourquoi, ça marche. C’est cet effet qui me fait tenir et endurer les mois de galère, c’est un peu comme une drogue. (rires)
Je vois clairement des liens entre artifices et monde vivant, dans tes créations et dans ce projet en particulier. Pour toi, la musique peut-elle être une porte d’entrée sur notre rapport à la nature en tant qu’humain·es ?
Indéniablement. J’en suis convaincu en tant que flûtiste, puisque le souffle est primordial. Ça a l’air un peu mystique dit comme ça, mais en termes de postures, d’interactions avec les éléments, le souffle est à la base de tout. En agissant sur son souffle, on peut modifier son rapport aux autres, humain·es ou non. C’est à la fois spirituel et complètement tangible, palpable, comme sentir de l’air sur ta peau. Par exemple, dans le Gaga israélien, il y a une forme de méditation par le corps. C’est une danse traditionnelle à base de mouvements très lents, qui laissent le temps de sentir ses articulations bouger, interagir avec le milieu.
La musique, pour moi, c’est un peu un équivalent en termes de méditation, mais rien n’y est hermétique puisque tout y est sensible, ancré, comme le toucher. Les grands concepts abstraits me laissent un peu froid. À l’inverse, une approche de ce type permet de ressentir, de tirer le fil de tes sensations, de laisser l’expérience t’attirer dans un univers pour aborder ensuite des questions plus métaphysiques. Dans la musique médiévale, on retrouve de nombreux thèmes du quotidien, comme la vie, la mort, la lutte… Ces questions sont universelles et intemporelles, donc le pont jeté entre les siècles n’est pas si absurde.
On s’inscrit dans un héritage qu’on bouscule…
(Rires) Oui tu as raison de le dire ! Heureusement, parce que certains codes méritent d’être bousculés.
Le titre de ton projet, en latin, s’intéresse au phénix. Qu’est-ce qui t’a attiré vers cette symbolique du cycle, du lien entre la vie et la mort ?
Je crois que c’est l’idée de travailler sur la santé mentale. J’avais envie de parler de la capacité qu’on a parfois, et on est nombreux·ses à l’expérimenter, à se relever d’un événement totalement destructeur. De ces pics et de ces gouffres qui se succèdent. Le phénix qui se crame les ailes avant de recommencer est évidemment un emblème de cette évolution constante. Il donne une sorte de précédent pour les phases difficiles, en rappelant que c’est un sale moment à passer mais qu’on a déjà réussi au moins une fois à trouver la sortie. Ça m’a aidé à tenir à la fois dans la vie et dans le projet, parce que c’est un chemin solitaire, semé de doutes. Je crois et j’espère qu’on ne reste jamais tout en bas de la pente. Après, j’aime bien que chacun·e fasse sa sauce avec ce thème. Toutes les interprétations sont possibles !
Marseille, un havre créatifTu as réalisé cet album pendant ta résidence au sein de l’antenne marseillaise d’Artagon. Comment était l’ambiance du lieu pendant ton séjour et comment a-t-elle influé sur ton processus créatif ?
Ça a tout changé pour moi. Alors que je venais d’un milieu exclusivement tourné vers la musique, la résidence m’a permis de côtoyer des plasticien·nes, des vidéastes ou encore des photographes. Entre deux studios, tu peux tomber sur des projets complètement barrés avec des écrans, des tubes… Je recherchais cette ouverture d’esprit. Pour moi, la mission d’Artagon est réussie sur ce plan. La mise en contact de personnes éloignées dans leurs pratiques et leurs approches est super précieuse : la vision de gens qui viennent des arts visuels sur la musique est radicalement différente de celleux qui la pratiquent. Ce sont les meilleurs retours que j’ai reçus, en-dehors de cadres qui peuvent se révéler étouffants.
Qui plus est, j’avais la chance de pouvoir faire écouter mon travail à mes ami·es musicien·nes en rentrant chez moi. Iels me parlaient d’aspects techniques, de modulations de la tonalité et là je savais que j’avais le meilleur des deux univers en poche. Mon passage à Artagon a duré un an et demi mais c’est passé en un clin d’œil. Je crois que ma vie marseillaise, individuellement, a vraiment commencé avec cette expérience, alors que ça fait six ans que je suis ici.
C’est ce qui m’a permis de développer un projet de mon côté, sans forcément faire partie d’un groupe. L’accompagnement est précieux, tout est fait pour que ta création aboutisse, en termes d’outils, de contacts… C’était génial. Je ne pensais pas du tout être sélectionné, ne venant pas de l’art contemporain. Mais iels sont très ouvert·es, curieux·ses de voir chaque projet se développer. Je sortais de nulle part et iels m’ont donné ma chance. Tout le monde devrait postuler !
Tes photographies officielles sont réalisées par l’artiste Robin Plus, lui aussi installé à Marseille. Comment s’est déroulée votre collaboration ?
Avec Robin, on se connaissait avant, mais on a été sélectionnés par Artagon en même temps, donc il a vraiment accompagné le projet du début à la fin. C’est même lui qui m’a poussé vers cette aventure solo. Il avait décidé qu’il ferait le visuel, j’ai pas eu le choix ! Pour moi, c’était complètement logique. J’avais hâte du shooting, parce qu’il connaissait déjà le projet par cœur, donc je n’avais pas besoin d’expliquer les choses : il était témoin des étapes de crise comme de la progression de l’EP.
 Portrait de Stelios.exe devant la raffinerie de Fos-sur-Mer © Robin Plus
Portrait de Stelios.exe devant la raffinerie de Fos-sur-Mer © Robin Plus
Dans ces photos, on retrouve beaucoup de ton personnage. Dans ces portraits de toi torse nu, cheveux rose vif, une peluche sur l’épaule devant les cheminées de la raffinerie de Fos-sur-Mer, il y a ce crash d’univers entre le synthétique et l’organique, entre esthétique kawaï et homoérotisme. Cet entre-deux appelle le regard et permet une réception spécifique de ta musique…
Avant que les photos arrivent, je savais à peu près ce qu’on voulait faire visuellement, mais quand je les ai eues sont les yeux, j’ai entendu la musique d’une autre oreille. Les liens sont devenus évidents, c’était la cerise sur le gâteau ! En plus, c’est arrivé à un moment où je n’en pouvais plus de réécouter l’EP, donc ça a renouvelé mon regard.
Marseille est un lieu d’implantation pour des communautés queer variées. Quels sont tes liens avec ces dernières, en tant qu’artiste comme en tant que personne ?
Je me suis toujours demandé si je me définissais moi-même comme une personne queer. Il y a une dimension politique à ce terme et je ne suis pas sûr de me sentir assez militant pour l’endosser. Mais en tout cas, artistiquement, il a du sens pour moi, puisque je joue avec les frontières. La musique était ma porte d’entrée dans cet univers. Je me suis senti revivre à Artagon et à Marseille plus généralement, grâce à cette solidarité communautaire. J’ai découvert beaucoup de choses sur moi que je n’exprimais pas vraiment par le passé. J’avais soudain la place d’être moi-même, ce que je n’avais jamais connu auparavant.
Je ne suis plus du tout la même personne qu’il y a deux ans. Parfois, quand tu ressors de cette bulle, le retour à la réalité est un peu violent ! Marseille reste un port d’attache pour moi, je ne me sens pas le cœur de partir, parce que je suis loin d’en avoir fait le tour. J’adore la présence de la nature, cette chance de pouvoir s’extraire rapidement de la ville en une journée. J’ai explosé plusieurs fois mon budget navettes pour les îles du Frioul !
Le titre du morceau « HELIOPOLIS », la ville du soleil, est-il un clin d’œil géographique ?
Ah je n’avais pas pensé à ça ! En fait, c’est plutôt une référence à l’endroit mythique où le phénix fait son nid et se prépare à mourir. Mais on peut le voir comme ça ! Entre le phénix et le gabian, il n’y a qu’un pas.
On parlait de ton shooting précédemment, mais le visuel de ton EP attire tout autant le regard, avec cette créature fœtale recroquevillée. Qu’est-ce qu’elle représente pour toi ?
C’est une vision de la renaissance du phénix, plus vraiment dans l’œuf, mais pas encore adulte.
Un peu comme Voldemort dans le dernier Harry Potter…
Exactement ! J’aimais bien cet aspect de petit alien hyper pop. Cette version de la pochette s’est démarquée pour le côté film d’horreur, en décalage avec la musique. Je voulais m’éloigner d’une ambiance trop dramatique. Le visuel des albums compte beaucoup pour moi, c’est un élément central des projets.
Pour terminer, est-ce que tu aurais envie de nous partager deux ou trois sons que tu écoutes en boucle en ce moment ?
J’ai beaucoup écouté un vieux truc de la Renaissance, le Cancionero de Palacio, un chansonnier espagnol du XVIe siècle, rempli d’influences nord-africaines. La place des percussions y est prépondérante et j’aime beaucoup cette propension à créer une charnière entre deux univers que tout oppose a priori, entre musique traditionnelle et musique savante. J’écoute la version du chef d’orchestre Jordi Savall, qui date des années 90.
Ah, et aussi le disque Nuove Musiche de Rolf Lislevand, qui joue du luth et du théorbe. Ça date des années 2000. C’est de la pop faite avec des instruments anciens et je trouve ça super beau. Pourtant, le monde de la musique ancienne déteste son travail, qu’il juge de mauvais goût. Je ne sais pas s’il se rendait compte que ça reviendrait au goût du jour 20 ans plus tard. C’est comme Buffy ! (Rires) J’adore la série et j’étais fan lors de la sortie, mais il a fallu une quinzaine d’années pour que ça devienne valorisé. La pop c’est génial, pourquoi ce qui est populaire serait nécessairement mauvais ?
D’ailleurs, je mène une bataille quotidienne pour défendre Charli XCX que j’aime à la folie.
Photo à la une : © Robin Plus
Relecture et corrections : Léa Simonnet
Cet article Stelios.exe : l’essor d’un phénix néo-baroque provient de Manifesto XXI.


Un jeune homme a été percuté volontairement par un conducteur, qui l'avait déjà injurié à la sortie d'une boite de nuit à Plan-de-Campagne, ce 25 mars. Il s'en est sorti avec des séquelles physiques mais surtout psychologiques. L’enquête a été confiée à la police judiciaire.
L’article <em>« Ils m’ont détruit mais je suis là </em>» : Samuel, 31 ans, victime d’une tentative d’homicide homophobe est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article PODCAST – Exposé·es, ce que le sida a fait aux corps gays provient de Manifesto XXI.
« Aussi bien mentalement, dans l’image qu’on donne et qu’on reçoit, que pour soi en réalité, prendre soin de son corps est un facteur de survie » explique Tim Madesclaire, médiateur en santé sexuelle à Aides et ancien journaliste. Jusqu’à l’arrivée des trithérapies en 1996, les HSH (« hommes ayant des rapport sexuels avec des hommes ») sont les plus touchés par l’épidémie de VIH/sida. Alors comment l’épidémie a-t-elle bouleversé le rapport au corps ? Quels sont les liens entre corps, sexualité, identité et contre-culture communautaire ? C’est ce qu’on a essayé de comprendre dans le second épisode de Exposé·es, un podcast produit en partenariat avec le Palais de Tokyo.Le corps, qu’il soit figuré ou suggéré, est un des fils rouges de l’exposition (à voir jusqu’au 14 mai au Palais de Tokyo), que le commissaire François Piron a pensée à partir de l’ouvrage Ce que le sida m’a fait. Art et activisme au XXe siècle, écrit par Elisabeth Lebovici, historienne de l’art, journaliste et militante. On s’est intéressées à la manière dont, dans un contexte épidémique marqué par une vague de panique morale, la place centrale accordée au corps et à la sexualité a permis le développement de stratégies de survie, l’affirmation d’une contre-culture communautaire gay et l’ébauche d’une santé communautaire.
Disponible aussi sur Apple podcast & Spotify
En interrogeant l’idéal athlétique présent depuis longtemps dans la culture homosexuelle, on a voulu comprendre comment le VIH/sida avait impacté ce culte du corps. « Il y a tout le temps du camp dans la culture gay, même quand elle est musclée » nous rappelle Tim Madesclaire. Quand prendre soin de son corps devient une stratégie de survie, que racontent ces corps virils et musclés ? Des corps politiques, outils de résistance à la masculinité normative, des corps qu’on expérimente pour se les réapproprier.
Dans cet épisode mêlant témoignage et analyse, nous avons tendu le micro à des personnes concernées afin de comprendre l’impact de l’épidémie sur le rapport aux corps gays et comment cela a façonné une contre-culture communautaire.
Bonne écoute !
Intervenant·es
(par ordre d’intervention)
Georges Tony Stoll – artiste
Tim Madesclaire – médiateur en santé sexuelle au SPOT (Aides) et ancien journaliste
Arthur Gillet – artiste
Ralf Marsault – anthropologue et plasticien, ami et collectionneur de Bastille
Crédits
Écriture et conception : Anne-Charlotte Michaut et Soizic Pineau, avec l’aide de Hélène Carrier
Réalisation et montage : Soizic Pineau
Habillage musical : Talita Otović
Remerciements
Merci à nos collègues Apolline, Léane, Sarah, Benjamin ainsi qu’à Pierre Laporte, Théophylle Dcx et toustes celleux qui ont rendu le projet possible.
Ressources
Ouvrages et articles
Podcast
Image à la une : Benoît Piéron, Flore hospitalière avec rehauts de cyprine, Dessin, 2022, courtesy Galerie Sultana (Paris) ; @ Benoît Piéron
Épisode 1 – Exposé·es, ce que le sida a fait aux lesbiennes
Cet article PODCAST – Exposé·es, ce que le sida a fait aux corps gays provient de Manifesto XXI.

En France, des collégiens, lycéens, étudiants meurent toujours des LGBTIphobies, sans un véritable plan d'action du gouvernement. Face à la flambée des violences et d'une idéologie inquiétante de haine, les associations présenteront au public et à la presse leurs expériences, expertises et propositions.
L’article « LGBT+ en milieu scolaire » : Conférence interassociative ce 17 mai à Paris est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.


Cet article Amix, amant·e·s, archives : les photos de Donna Gottschalk provient de Manifesto XXI.
La photographe américaine et militante lesbienne Donna Gottschalk est née en 1949 mais sa première exposition en Europe se tient actuellement à la galerie Marcelle Alix à Paris (à voir jusqu’au 20 mai). Intitulée Ce qui fait une vie, elle a été pensée par la galerie en collaboration avec l’écrivaine et théoricienne Hélène Giannecchini. Ce travail intime présente l’aperçu d’un monde jamais perdu, bien que largement méconnu. Donna Gottschalk, Marlene Elling, my best friend, Eugene, Oregon, 1974.
Donna Gottschalk, Marlene Elling, my best friend, Eugene, Oregon, 1974.
Dans les photographies de Donna Gottschalk, les bien-aimé·es de l’artiste travaillent, rient, se reposent. Iels parlent à quelqu’un·e hors champ. Iels ne regardent pas la caméra, ou quand iels le font iels sont capturé·es au milieu d’une phrase. Iels sont à l’aise, en amour, renforcé·es par les liens d’une communauté parfois incarnée par la présence des autres et parfois invisibles, mais toujours aussi forts. Ce ne sont pas des portraits pris comme des natures mortes, mais bien des extraits de vie en mouvement, avec toute la spontanéité, la surprise, l’échec et le désir qui en découlent. Grâce à sa maîtrise de la lumière et à son sens aigu du timing, Gottschalk produit des images qui reflètent fidèlement son monde et ses proches. Ce sont des personnes avec leur propre interprétation du bonheur dans une époque où il était beaucoup plus dangereux, voire inimaginable, d’y accéder.
Je veux ressembler à ce que je suis, mais je ne sais pas à quoi ressemble quelqu’un·e comme moi. Lorsque les gens me regardent, je veux qu’iels pensent – voilà une de ces personnes qui […] a sa propre interprétation du bonheur. C’est cela ce que je suis.
Lou Sullivan, c.1961-1969 (tiré de We Both Laughed in Pleasure: The Selected Diaries of Lou Sullivan, 1961-1991, Nightboat, 2019.)
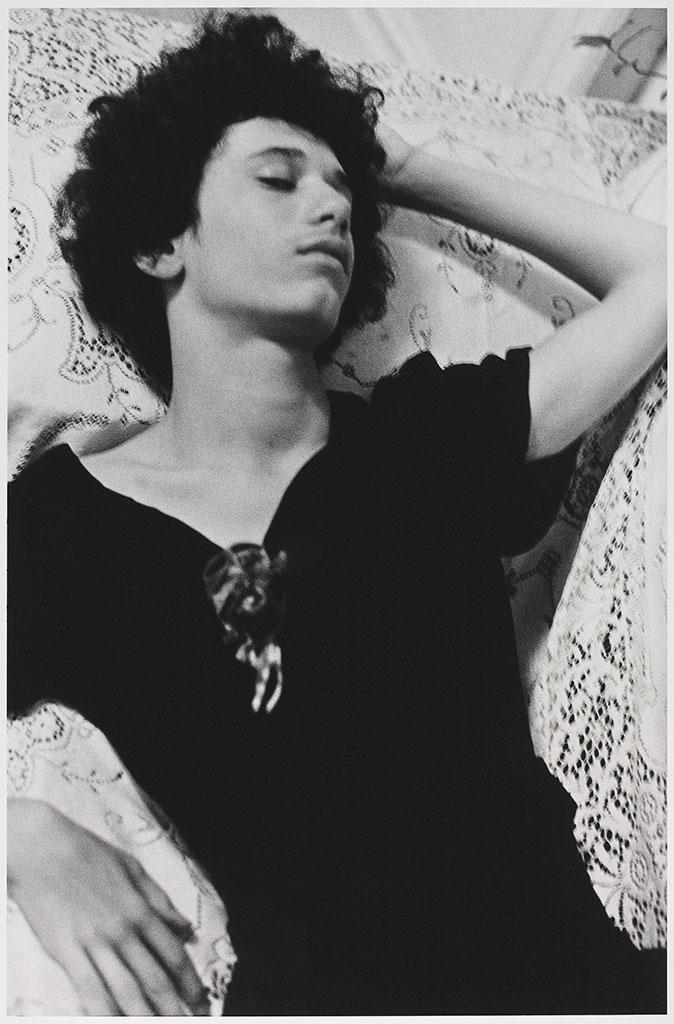 Donna Gottschalk, Myla in Mary’s dress, 16 years old, San Francisco, 1973.
Donna Gottschalk, Myla in Mary’s dress, 16 years old, San Francisco, 1973.
 Donna Gottschalk, Marlene Elling, age 23, E. 9th St., NYC, 1968.
Vers un queer kinship
Donna Gottschalk, Marlene Elling, age 23, E. 9th St., NYC, 1968.
Vers un queer kinship
Ce qui fait une vie rassemble une trentaine de photographies, certaines provenant de son exposition à New York en 2019 et d’autres montrées pour la première fois. Beaucoup de ces œuvres datent des années 1970, quand Gottschalk militait avec le Gay Liberation Front ou bien l’organisation féministe radicale et lesbienne Lavender Menace. Ses opinions politiques et sa pratique artistique sont profondément enchevêtrées. Dans ses images, on peut voir sa sœur Myla à plusieurs stades de sa transition, ou sa meilleure amie Marlene, une butch dont la puissance se teinte parfois de timidité. Ces photographies s’intègrent dans une lutte pour le droit d’exister dans les canons de l’histoire de l’art, et d’exister tout court. Si Gottschalk n’a pas reçu la reconnaissance qu’elle mérite jusqu’à présent, c’est en partie parce qu’elle voulait protéger ses proches contre le monde hostile qui n’était pas prêt pour elleux. Mais c’est aussi que Gottschalk est issue de la classe populaire. Elle devait travailler pour gagner sa vie et ne pouvait donc pas être artiste à plein temps. Comprendre la difficulté et la violence dans laquelle ces images se sont situées est essentiel. En parler ne les limite pas au traumatisme vécu, au contraire, cela met d’autant plus en évidence le courage de ces personnes dans la beauté de leurs luttes, ainsi que le respect dont Gottschalk a doté leur représentation. Nous devons voir ces images pour ce qu’elles sont : joyeuses, douces, fières.
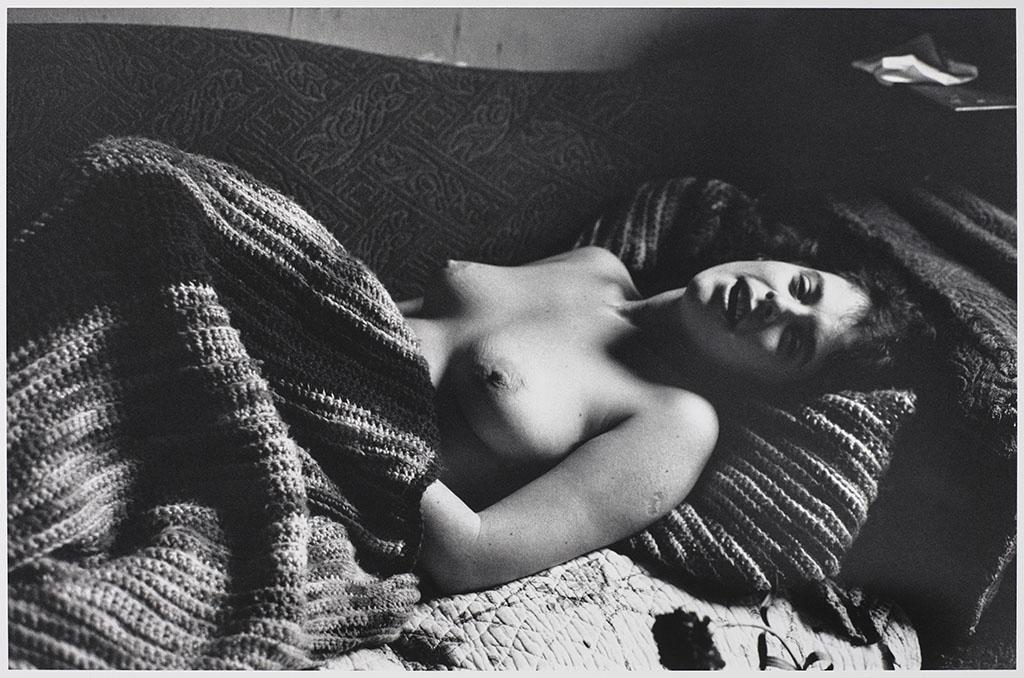 Donna Gottschalk, Joan Biren, my lover E. 9th St., 1970.
Donna Gottschalk, Joan Biren, my lover E. 9th St., 1970.
Dans la photographie intitulée Joan Biren, my lover E. 9th St. (1970), on trouve une figure allongée, torse nu, sur un canapé au soleil. L’amante éponyme – aussi appelée JEB – est photographe elle-même et célébrée pour son livre de photos, Eye to Eye: Portraits of Lesbians (1979). Sa bouche est ouverte dans une expression de plaisir ou de parole – peut-être les deux. Cette image aurait pu être tirée du film Nitrate Kisses (1991) de Barbara Hammer, une dédicace à l’amour queer en noir et blanc, dans laquelle le rituel de faire l’amour n’est ni fétichisé ni censuré, mais traité comme une tendre banalité. Les petits indices d’un romantisme ordinaire sont aussi présents dans cette image de Gottschalk : une rose partiellement coupée par le bas du plan, ou bien la marque de morsure sur le bras de l’amante. Aimer ainsi peut être aussi cliché que radical. C’est « une contemplation sentimentale en direction de l’altérité » , pour reprendre les mots de Cécilia Becanovic, co-fondatrice de la galerie, dans une conversation faisant office de communiqué de presse.
Cette image est associée à une autre, également présente dans l’exposition : c’est presque la même scène, mais cette fois un chien apparaît, couvrant parfaitement le sexe de JEB. C’est une prise sur le vif, un moment à la fois authentique et accidentel. Les animaux sont souvent présents dans les clichés de Gottschalk, ce qui montre à quel point l’idée de queer kinship ne s’arrête pas aux frontières anthropocentriques, mais englobe les non- et les au-delà d’humain·e·s, les espaces et les objets, les vivant·e·s et les mort·e·s – toustes celleux qui forment nos familles choisies.
 Donna Gottschalk, My roommate Chris during transition, 1970.
Des archives mouvantes
Donna Gottschalk, My roommate Chris during transition, 1970.
Des archives mouvantes
La plupart des personnes queers, remarque Hélène Giannecchini, sont nées dans des familles straights. Cela signifie qu’une partie de leurs histoires est manquante et qu’il faut aller la chercher ailleurs. Des expositions comme celle-ci, qui fonctionnent comme des archives vivantes, servent à combler ces vides. Ça fait du bien de voir des représentations de personnes « comme nous ». Ça fait du bien d’apprendre que nous ne sommes pas seul·e·s, même si, comme l’a écrit Sam Bourcier dans un entretien pour le 5e numéro de la revue Censored, « tout a été fait pour nous déposséder de nos archives et pour séparer corps et archives » . Il faut donc investir dans une nouvelle façon de se souvenir, et de raconter nos histoires. Boursier précise : « pas la peine d’attendre que les gens soient morts pour dire qu’iels ont de la valeur et sont elleux-mêmes des foyers d’archives qui peuvent en produire. On peut aussi archiver les affects et les émotions. On fait de l’archive en simultanéité, dans le temps présent. » Le travail de Gottschalk est une archive qui bouge, qui brille. Elle n’est pas figée dans le passé, mais demande à être mise en contact avec les problématiques qu’elle traite dans ce qu’elles ont d’actuel afin d’observer et de célébrer, tel un état des lieux de nos luttes, des chemins parcourus. À partir de ceux-ci nous pouvons ainsi discerner ce que nous devons continuer à combattre.
Ces photographies soulignent la marginalisation en continu, jusqu’à aujourd’hui, des vies qui ne sont pas solubles dans l’individualisme, la straightness, la course au progrès, la gentrification, la normalisation des corps et le désir de possession qui annihile tout autre désir.
Hélène Giannecchini
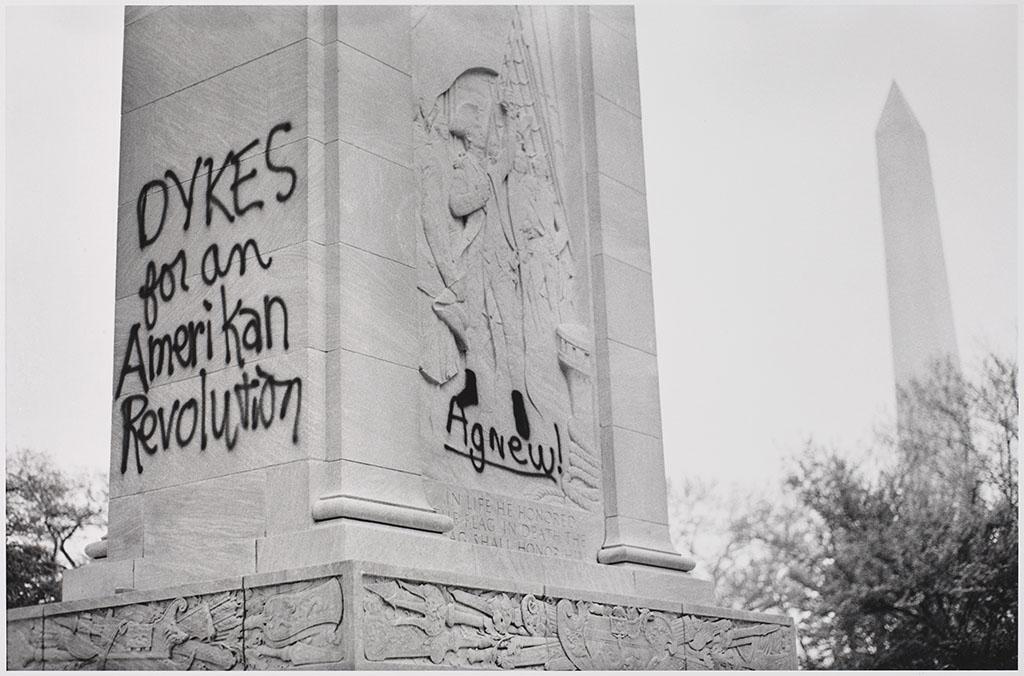 Donna Gottschalk, Dykes for an Amerikan Revolution, Washington DC, 1971.
Donna Gottschalk, Dykes for an Amerikan Revolution, Washington DC, 1971.
De la même manière que les archives reviennent au présent et définissent l’avenir, le spectre des violences passées menace à tout moment de s’installer à nouveau. Le mois dernier, la police est descendue dans un bar féministe à Paris, une action méritant des comparaisons aux émeutes de Stonewall. Un an après Stonewall, une image circulait dans laquelle Gottschalk – vingt ans à l’époque – tient une pancarte sur laquelle on lit : « I’m your worst nightmare. I’m your best fantasy » (Je suis ton pire cauchemar. Je suis ton meilleur fantasme). De telles photographies et de tels événements parlent donc de leur époque tout en interrogeant le moment présent, et soulignent, selon Hélène Giannecchini, « la marginalisation en continu, jusqu’à aujourd’hui, des vies qui ne sont pas solubles dans l’individualisme, la straightness, la course au progrès, la gentrification, la normalisation des corps et le désir de possession qui annihile tout autre désir. »
La seule image explicitement violente dans l’exposition, Myla Gottschalk, gay bashing (1977) confirme la conséquence de cette insolubilité dans un ordre dominant. Dans un plan inhabituellement rapproché, comme une preuve quasi médico-légale, on voit le visage tuméfié de Myla. La photo est accrochée seule sur un mur blanc, un peu décalée du centre, comme un fragment qui fait référence aux lacunes qui l’entourent. Ces histoires nous hantent, on n’a pas besoin de les voir sur-représentées pour les connaître. Mais pourtant, c’est sous la lumière crue de la douleur que nous voyons ce qui compte, ce qui a compté. Le titre de l’exposition, Ce qui fait une vie, fait référence à l’essai du même nom de Judith Butler, dans lequel l’auteur·e écrit que la valeur d’une vie apparaît précisément quand sa disparition aurait de l’importance. C’est notre capacité à faire le deuil, à pleurer une perte, qui montre à quel point une vie – cette vie – nous tient à cœur. Les larmes, comme les photographies, nous permettent de nous souvenir.
 Donna Gottschalk, Myla, 16 years old, 1973 San Francisco, California, 1973.
Les amix comme les amant·e·s
Donna Gottschalk, Myla, 16 years old, 1973 San Francisco, California, 1973.
Les amix comme les amant·e·s
Depuis son regard à la fois documentaire et participatif, Gottschalk traite ses amix comme ses amantes, en les mettant toustes sur le même plan affectif, en attribuant à chacun·e une valeur irremplaçable. En même temps, il y a une dimension plus large qui apparaît dans ces œuvres : celle du collectif. Une mère lesbienne avec son enfant, des militant·e·s faisant une sieste ensemble… Ce sont des relations à la fois politiques et affectives qui sont montrées ici, une sélection qui fait écho à celle de l’exposition collective Exposé·es au Palais du Tokyo, à propos de laquelle François Piron, son commissaire, nous confiait : « plutôt que de montrer des figures individuelles, nous montrons des réseaux, des affinités, des amitiés. » En 2019, Gottschalk participe déjà à une exposition collective chez Marcelle Alix, intitulée de l’amitié. Dans son travail, on trouve souvent la représentation de l’amitié et de la solidarité, ce qu’Hélène Giannecchini appelle « des liens que l’on invente pour se protéger et pour être libre. »
Cette façon de libérer l’intime, d’explorer et de reconstruire des structures affectives, peut servir à tout·e le monde. L’une des plus grandes joies que j’ai connues dans la queerness, et que le travail de Gottschalk me rappelle, est précisément cette invitation à tout transformer : les codes que nous suivons, les mots que nous nous attribuons et les façons dont nous (nous) aimons. C’est le plaisir d’être ensemble, de témoigner de la vie des autres, de se laisser surprendre par soi-même, d’inventer nos propres définitions du bonheur, et bien plus. C’est ce qui fait une vie.
 Donna Gottschalk, Maine self-portrait, 1975.
Donna Gottschalk, Maine self-portrait, 1975.
Ce qui fait une vie, Donna Gottschalk, du 6 avril au 20 mai à la galerie Marcelle Alix, Paris. Des visites guidées de l’exposition sont proposées par Hélène Giannecchini, commissaire de l’exposition, tous les samedis du mois de mai à 15h.
Image à la une : Donna Gottschalk, Sleepers, Revolutionary Women’s Conference, Limerick, PA, 1970.
Toutes les images © Donna Gottschalk.
Relecture et édition : Anne-Charlotte Michaut
Cet article Amix, amant·e·s, archives : les photos de Donna Gottschalk provient de Manifesto XXI.

L'arrêté, sur proposition du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, s'appliquera à l'ensemble des forces, y compris « à la gendarmerie et aux sapeurs-pompiers de Paris et de Marseille », qui sont rattachés à l'Armée.
L’article « Les personnes séropositives vont pouvoir intégrer l’ensemble des forces armées », annonce Sébastien Lecornu est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Dancing Pina, dans les pas d’un héritage de liberté provient de Manifesto XXI.
En suivant deux troupes qui reprennent des pièces majeures de l’œuvre de la célèbre chorégraphe Pina Bausch, Florian Heinzen-Ziob signe un magnifique film, émouvant par sa bienveillance et sa beauté, tant visuelle que philosophique.Pina Bausch, on peut le dire sans trop de prudence, a largement participé à construire la danse contemporaine. Danseuse et chorégraphe incontournable de son époque, elle laisse aujourd’hui un héritage qui influence nos façons d’aborder la danse, en pratique et en théorie. C’est à cet héritage que le documentaire Dancing Pina rend hommage, et le perpétue.
École des sables, près de Dakar. Une scène, grande ouverte sur une forêt de cimes. Des danseur·euses, venu·es de 14 pays d’Afrique reprennent Le Sacre du Printemps. À quelques milliers de kilomètres, au Semperoper, à Dresde en Allemagne, on reprend Iphigénie en Tauride. Deux pièces majeures de Pina, montées à nouveau, sous la direction d’ancien·nes danseur·euses du Tanztheater, sa troupe. Nous suivons ces deux groupes – dans ce que le mot groupe a de plus essentiel – qui, fouillant dans les mémoires individuelles et collectives, cherchent à comprendre et reproduire ces chorégraphies majestueuses où se jouent la philosophie du sacrifice et les rapports entre hommes et femmes.
Il s’agit de reconstruire une mémoire. Dancing Pina se déroule comme une réflexion sur la vie d’une œuvre, sur sa façon de traverser le temps et les gens. Que reste-t-il, dans les cœurs de celleux qui campaient les rôles principaux, des indications de la chorégraphe décédée en 2009 ? Comment retranscrire ses intentions, sa vision de la danse, sa mise en scène ? Et comment se la réapproprier ? La magie de Pina Bausch tenait dans son attachement aux imperfections, sa capacité à laisser aux danseur·euses la place d’être elleux-mêmes au sein de ces chorégraphies, d’être des individu·es entier·es au sein du groupe. Il faudra les faire siennes, pour les comprendre. « Si c’était une copie, ce ne serait pas du Pina » affirme l’une de ses anciennes collaboratrices.
Parce que la plus grande œuvre de Pina a été de léguer à toute une génération de danseur·euses la capacité de s’émanciper des diktats autour des corps. Petite, elle se cache sous les tables du bistrot de l’hôtel tenu par ses parents et dans lequel elle a grandi. Là, protégée des regards et à hauteur de genoux, elle observe les gens. C’est précisément cet amour et cette fascination pour l’humain qui va construire toute sa philosophie de la danse. Toute sa vie, elle ira à l’encontre d’une danse qui bafoue, écrase, questionne ou critique les corps des danseuses et la masculinité des hommes. La force de ce documentaire réside justement dans sa capacité à perpétuer cet effort. Florian Heinzen-Ziob filme et écoute ces femmes et ces hommes qui, au fil des répétitions et de cette transmission, se réapproprient leur corps, comme espace intime et politique pour aller vers le renouement. Iels parlent d’elleux, des autres, de leurs complexes, de leurs fiertés, de toutes ces choses que danser du Pina Bausch remue et remet en question.
Dancing Pina est avant tout à l’image du travail de la chorégraphe : d’une grande beauté, émouvant de sincérité, intime et universel, et mû par un amour immense de la danse comme espace de liberté et d’émancipation. Avec ce film, Florian Heinzen-Ziob entretient avec brio l’héritage de Pina Bausch.
Cet article Dancing Pina, dans les pas d’un héritage de liberté provient de Manifesto XXI.

Le Griffon, centre de santé sexuelle, nous a ouvert les portes de ses nouveaux locaux, l’occasion pour nous de faire un point sur cet endroit unique et essentiel à la communauté LGBT+ lyonnaise. Aurélien Charnay, directeur du Griffon à répondu à nos questions.
Votre présence rue des Capucins n’est pas une simple coïncidence, pourquoi avoir choisi de vous installer ici ?
Aurélien Charnay : Ce n’est effectivement pas un hasard, il existait déjà un centre de santé sexuelle dans le même quartier (rue du Griffon) mais le local était petit. Il reposait sur le travail des bénévoles et les horaires étaient plus contraignants. Pouvoir investir l’ancien poste de police, rue des Capucins, s’est présenté comme une réelle opportunité, d’autant plus que nous sommes à présent dans la même rue que le Centre LGBTI+. Maintenant, nous sommes ouverts de 12h à 21h du lundi au vendredi et un samedi par mois. Sur place, il y a un médecin, un infirmier, un médiateur et une personne pour accueillir les patient·es. Nous avons de vrais locaux médicaux et surtout nous avons un laboratoire interne.
Proposer une prise en charge complète est au cœur du projet initial du Griffon, pourquoi ?
Aujourd’hui cela paraît logique car la santé sexuelle est envisagée dans sa globalité en termes de politique de santé publique. Mais en 2016, aux prémices du projet du Griffon, ce n’était pas encore une évidence. Il y avait vraiment une segmentation dans la façon de prendre en charge les patient·es dans le monde médical (séparation entre addicto, IST, VIH…). L’idée originelle était de créer un lieu qui prendrait en compte tous les volets de la santé sexuelle.

Pourriez-vous revenir sur les associations avec lesquelles vous travaillez au quotidien ?
Nous travaillons main dans la main avec l’Enipse. Nous collaborons également avec Keep Smiling, l’ALS, Cabiria et l’ALSM. Le Griffon a pour but de réunir au maximum les associations locales, ayant chacune leurs publics, qu’elles redirigent ensuite vers le Griffon. Nous faisons du soin, les associations nous permettent de nous mettre en relation avec les différentes communautés.
Vous décrivez le Griffon comme un espace de santé expérimental, en quoi cette structure se différencie-t-elle des centres de dépistage plus conventionnels ?
Concrètement, la différence entre un CeGIDD et le Griffon se fait au niveau de notre approche communautaire. Nous n’accueillons pas tous les publics, nous priorisons la communauté LGBT+ et les TDS. Les pays anglo-saxons ont d’ailleurs déjà opté depuis plusieurs années pour cette approche communautaire et observent des résultats très positifs.
Êtes-vous satisfait·es de la fréquentation de votre centre ? Quels retours avez-vous eu de la part de la communauté LGBT+ ?
Globalement nous avons de très bons retours, mais nous faisons surtout attention à la satisfaction des patients. Nous commençons toujours par faire un balayage complet de la situation en discutant avec un médiateur communautaire ( bien-être mental, sexualité, consommation de produit), ce sont des véritables pivots du parcours de soin. Nous co-construisons avec le patient les modalités de la prise en charge.
Comment vous assurez-vous que les professionnel·les de santé, à l’œuvre dans votre centre, soient bienveillant·es à l’égard des minorités qu’il cible ?
Tous·tes les salarié·es dans le centre sont issu·es de la communauté ou/et sont spécialistes de la santé sexuelle. Nous veillons à mettre en place un safe place où tous les professionnel·les de santé ont une approche de non-jugement.
Les travailleu·ses du sexe sont encore très stigmatisées dans la sphère médicale, comment permettez-vous à ces personnes, d’avoir accès à une prise en charge et un suivi régulier ?
Cabiria nous permet d’établir une relation de confiance entre les TDS et notre centre de santé. Ensuite, les TDS souhaitent effectuer des dépistages mais en majorité ne veulent pas de prise en charge plus globale. Le dépistage complet en 90 minutes que nous proposons permet un gain de temps énorme pour ces personnes particulièrement exposées.

Nous avons abordé de nombreuses spécificités liées à votre centre de santé sexuelle et à son ancrage local, êtes-vous présent·es ailleurs que dans vos locaux ?
Nous faisons déjà un peu d’hors les murs, avec notamment l’association Enipse, mais nous souhaitons développer davantage cet axe. Par exemple, nous nous rendons régulièrement au sauna l’Oasis. Les agents de prévention de l’Enispe informent et dirigent les usagers vers nos infirmier·ères qui les accompagnent sur place.
Dans votre centre de santé sexuelle, vous avez choisi de développer tout un axe autour du chemsex, quel service avez-vous mis en place pour accompagner ces utilisateurs ?
Nous avons un lien historique avec le CSAPA (Centre de Soins d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) de Croix-Rousse, une fois par semaine et une soirée par mois, un médecin et un infirmier spécialistes occupent nos locaux. Nous allons également mettre en place des groupes de parole autour du chemsex avec l’équipe du CSAPA et une psychologue de L’Enipse.
Quel avenir pour votre centre de santé sexuelle ?
Nous sommes encore en phase de test. Nous espérons, à la fin de l’année, être reconnu comme le centre de santé sexuelle à approche communautaire de Lyon afin de pouvoir continuer notre travail mais aussi élargir nos champs d’action.
Pour préparer votre visite :
Le Griffon, 23 rue des Capucins, Lyon 1 / 04.28.29.04.87
@ Misha Faber
L’article Le Griffon : la santé sexuelle sans stigmatisation est apparu en premier sur Hétéroclite.

 J’ai longtemps travaillé dans la musique et voilà, il est temps de l’avouer, depuis quelques années la musique majoritairement m’emmerde. Pas tous et pas tout le monde hein, mais globalement, ...
J’ai longtemps travaillé dans la musique et voilà, il est temps de l’avouer, depuis quelques années la musique majoritairement m’emmerde. Pas tous et pas tout le monde hein, mais globalement, ... 

C’est la deuxième fois en trois mois que la haute juridiction népalaise passe un tel jugement, confirmant ainsi sa vision progressiste, en Asie du Sud.
L’article La Cour suprême du Népal reconnaît le mariage d’un couple homosexuel enregistré à l’étranger est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Depuis l’abrogation fin 2022 d’un arrêté les discriminant à l’embauche, les personnes vivant avec le VIH sont admises dans les rangs de la police mais pas au sein des armées, qui pourraient toutefois s'aligner à la demande du ministre de l'Intérieur.
L’article Gérald Darmanin enjoint à l’armée de lever les exclusions liées au VIH est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Majeurs à l'époque des faits, ils ont été condamnés par le tribunal judiciaire à trois ans, dont dix-huit mois ferme pour le principal accusé, et douze mois sous bracelet électronique pour ses complices.
L’article Besançon : Prison pour trois des auteurs présumés des guet-apens homophobes du parc Micaud est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Féminisme et start-up nation sont vraiment incompatibles, Sandrine Holin le démontre provient de Manifesto XXI.
Ex-salariée du CAC 40, Sandrine Holin analyse l’engouement des grandes entreprises pour les questions d’égalité des genres dans son premier essai Chères collaboratrices.À quoi ressemble le féminisme reconfiguré par le néolibéralisme ? Si l’on devait tirer le portrait de cette idéologie, nous pourrions imaginer la vie d’une girlboss hyper perfectionniste qui, depuis son salon en rotin, développe son auto-entreprise tout en s’occupant des enfants. Ce discours individualiste est particulièrement fort chez les cadres supérieures qui sont parvenues à briser la première glace du plafond de verre. Sheryl Sandberg (ancienne directrice des opérations de Facebook), Christine Lagarde (ancienne directrice du FMI) ou encore Ivanka Trump (cadre supérieure de la Trump Organization) sont tant d’exemples sur lequel le féminisme néolibéral s’appuie et que Sandrine Holin décortique dans son essai intitulé Chères collaboratrices. D’abord sensibilisée aux enjeux climatiques, elle intègre les luttes féministes en s’intéressant aux questions LGBTQIA+. Deux lectures vont enclencher son processus d’écriture : King-Kong Théorie de Virginie Despentes et Naissance de la biopolitique de Michel Foucault. Convoquant de multiples références, l’ouvrage dissèque le discours féministe néolibéral, afin d’en mesurer l’influence sur les individu·e·s. Nous avons rencontré l’autrice.
Manifesto XXI – Sur quels critères la rationalité néolibérale hiérarchise-t-elle les femmes ?
Sandrine Holin : Pour répondre à cette question, je pense qu’il faut revenir sur deux points clés. Premièrement, la rationalité néolibérale considère que notre force de travail peut être assimilée à du capital humain. Les compétences que nous acquérons, par exemple, sont une manière d’augmenter son capital sur le marché. Deuxièmement, il faut aussi avoir en tête que, pour le néolibéralisme, les individu·e·s deviennent des entrepreneur·e·s d’eux-mêmes. Ce qui va hiérarchiser les femmes entre elles – et même les femmes par rapport aux hommes puisque cette rationalité a tendance à effacer la question de genre –, c’est leur valeur actuelle ou potentielle pour l’économie. Or, on sait très bien que certaines personnes naissent avec un capital, économique mais aussi social ou culturel, plus élevé. Elles ont alors des opportunités plus vastes parce qu’elles restent dans telle famille et vont avoir la possibilité d’aller dans telle école.
Donc les femmes qui se trouvent en haut de la pyramide sont des femmes blanches, bourgeoises, cisgenres, etc.
Oui, essentiellement. Cependant, notre société essaie d’entretenir le mythe de la méritocratie. Quelques exceptions montrent qu’effectivement, il y a une possibilité d’ascension sociale. Sauf que lorsque l’on étudie le parcours des transclasses, on voit que c’est extrêmement difficile de sortir des inégalités. Par ailleurs, la rationalité néolibérale s’inscrit dans un système capitaliste fondé sur un régime extractiviste. Ce système vient également d’un régime colonial (qui à certains égards l’est encore) et se trouve toujours dans un régime patriarcal. Il s’appuie donc très fortement sur les hiérarchies de classes sociales, de races et autres. Et il s’en sert pour parvenir à l’accumulation du capital.
Ce qui est dommage, je crois, c’est qu’on ne veut pas reconnaître les interdépendances que l’on a les un·e·s avec les autres. En écrivant ce livre, je voulais justement dénoncer cette fable du mérite, cette idée que nous y arrivons seul·e.
Sandrine Holin
D’ailleurs, vous expliquez que c’est cette société extractiviste qui pousse certaines femmes à en exploiter d’autres pour s’émanciper.
L’idée centrale du livre revient à dire que le féminisme néolibéral perçoit l’égalité de genre comme libre concurrence entre hommes et femmes. Dans ce système, nous n’avons que la possibilité d’être en concurrence les un·e·s avec les autres. C’est une logique compétitive dans laquelle « tu m’exploites ou je t’exploite » [titre du chapitre 7 du livre, ndlr]. Il faut bien voir que les femmes cadres supérieures touchent un salaire très élevé sont déjà en haut de la pyramide. Et elles exploitent des personnes qui sont en bas. Je ne dis pas que tout leur tombe du ciel mais elles sont obligées de collaborer avec le système si elles souhaitent s’émanciper.
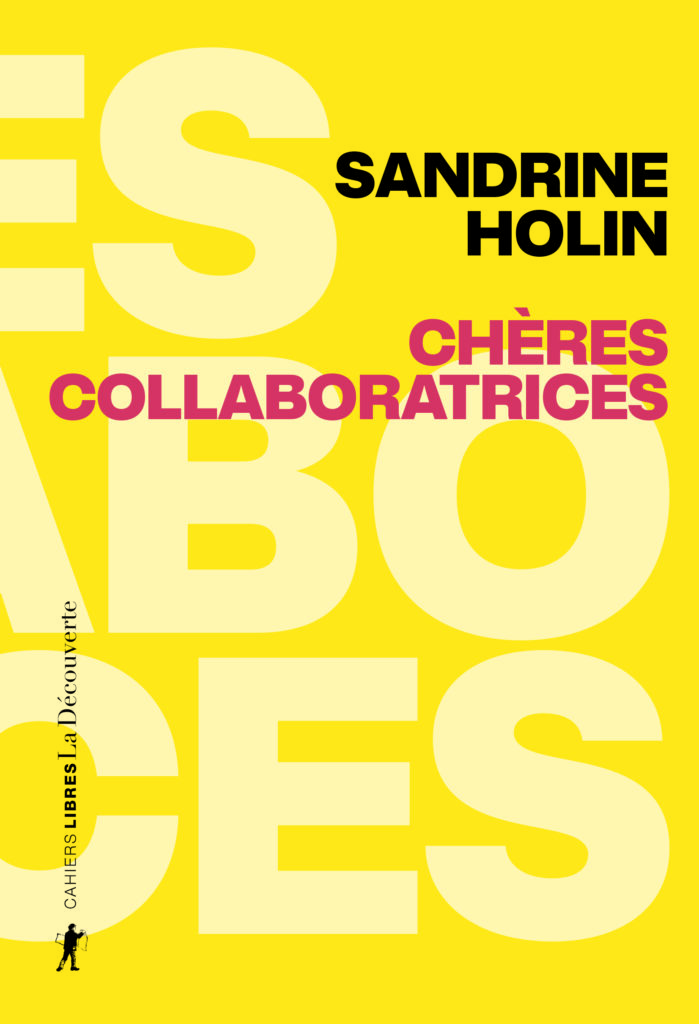
Pourtant, cet ordre ne peut tenir qu’à la condition que les métiers du care soient pris en charge par d’autres personnes, le plus souvent des femmes, racisées, issues de classes populaires, parfois migrantes…
Oui, les personnes payées pour garder les enfants, faire le ménage ou fournir d’autres services libèrent du temps à leurs employeur·se·s. Ces dernier·e·s peuvent alors se consacrer pleinement à un travail censé les émanciper. Simplement, ces métiers du care n’ont pas de grande valeur pour l’économie puisqu’ils ne permettent pas aux actionnaires de générer beaucoup d’argent. Aujourd’hui, le système capitaliste néolibéral essaie de faire en sorte qu’ils rapportent en les rationalisant. On dit alors aux infirmier·e·s : « Essayez d’être performant·e·s, de voir plus de patient·e·s par heure ». C’est vraiment très extractiviste dans le sens où on va extraire au maximum l’énergie de ces personnes pour que cela crée plus d’argent, tout en ne les payant pas plus. Ce qui est dommage, je crois, c’est qu’on ne veut pas reconnaître les interdépendances que l’on a les un·e·s avec les autres. En écrivant ce livre, je voulais justement dénoncer cette fable du mérite, cette idée que nous y arrivons seul·e.
Il ne faut pas rester coincé dans la problématique des inégalités de genre mais plutôt essayer de visualiser toutes les problématiques ensemble notamment celle du changement climatique qui est urgente et criante.
Sandrine Holin
Vous écrivez également que cette rationalité rend les individu·e·s responsables des inégalités systémiques en leur disant qu’il suffirait de « changer les mentalités » pour que la société aille mieux. Faut-il se demander si le coaching va remplacer le militantisme, voire les syndicats ?
En fait, le coach est à mi-chemin entre le psy et l’entraîneur de sport. Iel est payé·e pour vous aider à atteindre des objectifs que vous vous êtes fixé·e. Sauf que, généralement, vous le·la consultez sur une très courte durée (contrairement à un psy). Cela répond à une volonté d’avoir une solution rapide et efficace face à un problème qu’on ne traite pas vraiment à la racine. Le problème, c’est que nous vivons dans une société de la rapidité où l’on veut tout avoir tout de suite.
Vous parlez du terme « joint-venture » [faire coentreprise avec son/sa conjoint·e, ndlr] pour expliquer la manière dont les femmes choisissent leur partenaire de vie. De quelle manière le néolibéralisme reconfigure-t-il l’amour queer ou hétéro ?
Dans cette vision néolibérale de la vie, toutes les décisions sont calculées. Nous apprenons très vite à penser les coûts et les bénéfices des choses. Chaque décision est vue comme un investissement, or l’amour n’y échappe pas. D’ailleurs, dans le livre, je ne parle pas forcément d’amour mais plutôt de « mise en couple ». Quand on se met en couple avec quelqu’un·e, il y a tout un tas de « pour » et de « contre » que l’on pèse. La décision ne se base pas que sur les sentiments. Ce qui est intéressant, c’est de voir que nous revenons vers une pratique assez ancienne. Cela reste très récent de vouloir se mettre en couple avec quelqu’un·e parce que l’on est amoureux·se. Au cours de l’histoire, nous avons plus souvent été dans des configurations de couples et de familles qui prenaient la forme de partenariats.
Aujourd’hui, nous retrouvons cette idée d’intéressement à se mettre en couple avec telle personne. Cependant, il faut toujours donner l’impression de prendre cette décision uniquement sur la base des sentiments sinon ça ne passerait pas du tout socialement. Je pense qu’il y a effectivement des sentiments en jeux, mais à côté de cela se greffent des questions économiques. Dès lors, est-ce que quelqu’un·.e qui tomberait amoureux·se d’une personne économiquement désavantagée se mettrait en couple avec ? C’est la question qu’il faut se poser.
Donc la rationalité néolibérale encourage l’endogamie.
Exactement. Nous pourrions aussi tout à fait imaginer qu’une femme qui appartient à un milieu culturellement libertaire et qui souhaite faire carrière soit très contente d’être avec un homme père au foyer. Toutes les configurations sont possibles. En fait, ce n’est pas quelque chose de conscient mais en analysant certains discours et certaines pratiques, nous nous rendons compte que derrière les relations, il y a toute une logique de « est-ce que c’est stratégiquement intéressant de se mettre en couple avec cette personne ». Par ailleurs, la rationalité néolibérale encourage toujours le modèle du couple monogame avec des enfants car cela serait la configuration la plus stable économiquement.
D’où la politique du zéro compromis qui incite les femmes à mener de front leur carrière ainsi que leur vie de famille. Justement, quelle retraite et quelle vieillesse attendent ces femmes à qui on a dit qu’il fallait tout avoir ?
Cette question me fait penser au discours mobilisé par les plateformes de finance féministes qui incitent les femmes à investir leur épargne en bourse. Parmi leurs arguments, il y a ce constat qu’à la retraite, l’écart de richesse entre les genres est immense. Cela serait dû aux inégalités de revenus mais aussi au fait que les femmes investissent moins. Pour compenser cet écart, il faudrait placer son épargne dès maintenant afin de percevoir une retraite décente. Ce que vous disent ces plateformes, c’est qu’il vaut mieux choisir une solution pour vous-même plutôt que d’attendre que la société vous aide à bien vieillir. C’est une solution problématique et très individualiste.
Il y a plein de féminismes qui se trouvent en dehors de cette rationalité. On peut avoir l’impression que ce sont des utopies mais c’est bien, aussi, de créer des utopies !
Sandrine Holin
Là, nous parlons en termes financiers. Mais en matière d’agentivité, comment vont-elles gérer la perte de pouvoir lorsqu’elles ne travailleront plus ?
Celles qui sont tout en haut de la pyramide ne s’arrêtent pas de travailler. Je pense à Christine Lagarde ou Sheryl Sandberg par exemple. En fait, ces femmes sont dans des milieux de pouvoir et d’influence qui doivent les captiver. Il n’y a donc aucune raison pour qu’elles s’arrêtent. Elles peuvent peut-être réduire le rythme. Certaines le feront sans doute mais la plupart aura l’occasion de bien vieillir quitte à se lancer dans une nouvelle carrière. Je les vois bien écrire des livres, donner des conseils aux jeunes femmes et continuer à entretenir leur fondation. Le pouvoir et l’intérêt médiatique portés sur elles doivent être grisants donc si cela s’arrête, leur monde s’arrête. Je pense qu’il doit y avoir une certaine accoutumance au pouvoir…
Au début de votre essai, vous vous demandez si un féminisme banal peut être révolutionnaire. Est-il possible de penser un ou des féminismes populaires qui ne soient pas dictés par la rationalité néolibérale ?
L’une des premières choses serait de bien comprendre le fonctionnement du régime néolibéral et la façon dont il nous transforme de l’intérieur. Ce serait une manière de voir ce vers quoi nous ne voulons pas aller. L’autre point important, c’est de bien penser les systèmes. Il ne faut pas rester coincé dans la problématique des inégalités de genre mais plutôt essayer de visualiser toutes les problématiques ensemble notamment celle du changement climatique qui est urgente et criante. En arrivant à penser tout cela ensemble, nous pouvons visualiser les actions vers lesquelles tendre. Après, il y a plein de féminismes qui se trouvent en dehors de cette rationalité. On peut avoir l’impression que ce sont des utopies mais c’est bien, aussi, de créer des utopies !
J’ai été assez surprise de voir la place que prenaient les cabinets de conseil dans la construction du discours féministe néolibéral. Vous mettez en avant les chiffres qu’ils renseignent sur ce que rapporterait la concurrence pure et parfaite entre les genres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la production et l’interprétation de ces chiffres ?
Les cabinets de conseil tels que McKinsey aiguillent toutes les grandes et moyennes entreprises dans le monde. Leur recours est très fréquent, on l’a vu avec l’État français. Cela s’explique par la logique de rationalisation des coûts en entreprises qui entraîne une réduction de la masse salariale. Les entreprises consultent ces cabinets pour des besoins précis car elles ne disposent plus des ressources en interne. Les cabinets de conseil sont aussi sollicités car nous pensons que, puisqu’ils sont extérieurs, ils seraient davantage neutres. Ils sont consultés sur quasiment toutes les décisions économiques des entreprises.
Cependant, aujourd’hui, ils se positionnent également sur toutes les problématiques sociales : je parle des inégalités de genre mais ils croisent les questions de races, d’orientations sexuelles, de handicaps, etc. Leurs chiffres montrent, par exemple, qu’une femme racisée, lesbienne, qui vit avec un handicap a peu de chance d’accéder aux plus hauts postes. Derrière, ils tirent la conclusion qu’il faudrait mieux intégrer les personnes minorisées car cela serait bénéfique pour les performances d’entreprises. Je trouve cela assez problématique parce que si l’on s’aperçoit que ces politiques d’inclusion ne rapportent rien alors il y a un risque de retour en arrière.
Chères collaboratrices, de Sandrine Holin, éditions La Découverte, 240 p.
Image à la Une : © Noé Adaam
Edition et relecture : Benjamin Delaveau, Sarah Diep et Apolline Bazin
Cet article Féminisme et start-up nation sont vraiment incompatibles, Sandrine Holin le démontre provient de Manifesto XXI.

Cet article La FdS mute avec délices pour une 11ème édition foisonnante provient de Manifesto XXI.
Du 18 au 21 mai, la FdS (feu la Fête du Slip) revient en force pour une nouvelle année placée sous le signe des racines et des rhyzomes, symboles des liens qui nous unissent, affaire de fluides souterrains, et synonyme de culture vivante. Manifesto XXI est partenaire du festival et voici une petite sélection réjouie de performances, soirées et discussions.Cette année, la Fête du Slip est devenue « Festival artistique des affects, des genres et des sexualités » une manière de dire la place accordée à l’amour et aux émotions dans la curation de la FdS. « Notre festival est centré sur des thématiques mouvantes, qui évoluent vite, et il s’adapte donc en conséquence. Le festival se donne la liberté de changer plutôt que de s’institutionnaliser de manière définitive et rigide. » explique Valentina D’Avenia à la direction artistique dans le communiqué de presse. Ce choix s’explique aussi par l’urgence de mettre l’amour, comme force révolutionnaire positive, au centre des imaginaires dans un moment politique où les droits LGBTQI+ sont menacés partout dans le monde. Les affects donc, comme manière d’être en résistance, mais pas seulement : « Parler d’affects, c’est parler de comment faire famille et comment créer des liens hors du schéma patriarcal, qui hiérarchise les relations et qui donne une place secondaire à l’amitié, par exemple. » Dans cette optique, le festival a choisi aussi d’aborder la thématique du vieillir queer.
La FdS reste résolument ancrée dans une curation érotique, avec une sélection de courts-métrages et de performances qui font la part belle à la mécanique des fluides. Inspirée par la radical softness, l’artiste brésilienne Helena Araujo présentera sa création « My gentle wild squirts » vendredi 19 mai. Le lendemain, tout droit venue du Mexique, la ligue interplanétaire Lucha Lub proposera une joyeuse performance pour se réapproprier l’imaginaire de la lutte, avec force lubrifiant. La fluidité se retrouve aussi dans les réflexions autour des modes de narration : « Mermaid Escape Room » de l’artiste taïwannaise Betty Apple propose un jeu immersif pour explorer le pouvoir de la science fiction dans la contexte post-colonial.
La FdS fera aussi remuer les corps et les méninges avec des temps forts comme la soirée Black Technique qui promet un cocktail détonnant de sons ballroom, kuduro et ampiano.
Le dimanche, aura lieu une originale Guinguette Queer, moment de rencontre intergénérationel au sein de DJ Set des Mondiales Moquettes. En amont de ce moment inédit, la Karaoké-Jay Amal Alpha animera un atelier d’écriture/détournement de chanson pour seniorxs LGBTIQ+ sur le thème de vieillir queer. Voilà qui promet !
Côté discussions (appelées médiations) et ateliers, la FdS propose une table-ronde qui promet d’être passionnante sur le courant du matérialisme trans avec les chercheur·euses Joao Gabriel et Pauline Clochec comme invité·es, Cynthia Kraus et Nayansafaku Mufwankolo à la modération. Manifesto XXI est partenaire de cette édition où Audrey Couppé de Kermadec animera le workshop « Prendre soin de soi et de sa communauté » le samedi 20, dans la continuité d’une discussion de l’édition précédente sur le capital beauté dans le milieu queer à laquelle avait participé Costanza Spina, fondatrice du media. En avant-première, Audrey co-animera aussi juste avant une lecture participative du livre de Costanza, Manifeste pour une démocratie déviante, à paraître le 9 juin.
Vous ne pouvez pas être au festival mais vous êtes séduit·e par cette prog ? Qu’à cela ne tienne, pour la première fois, la programmation cinéma de la FdS est accessible via leur plateforme de stream. La table-ronde sur les matérialismes trans sera diffusée sur Radio 40.
Toute la programmation
Image à la Une : © C. Mahalia Giot
Cet article La FdS mute avec délices pour une 11ème édition foisonnante provient de Manifesto XXI.

 Retour en images sur nos 15 ans ! Le 21 et 22 avril dernier, pour la première fois dans l’histoire de la Wet for Me, nous avons investi la Machine ...
Retour en images sur nos 15 ans ! Le 21 et 22 avril dernier, pour la première fois dans l’histoire de la Wet for Me, nous avons investi la Machine ... 
Cet article Le dîner – Des amis qui vous veulent du bien, par Fania Noël provient de Manifesto XXI.
Avez-vous déjà vécu une situation sexiste sans réussir à mettre le doigt sur ce qui clochait exactement ? La remarque anodine d’un camarade militant qui reste en travers de la gorge, une réaction véhémente d’un ami pourtant progressiste ou bien la « blague » cringe d’un collègue ? Le diable est dans les détails, le sexisme le plus difficile à dénoncer et peut-être celui qu’on appelle « bienveillant », celui des hommes « bien », bien diplômés, bien gentils, bien entourés et bien « féministes ». Dans ce cycle de 8 chroniques, la chercheuse et militante afroféministe Fania Noël vous propose de décortiquer des situations quotidiennes avec une courte fiction éclairée ensuite par une notion de critical feminist theory. [2/8]Désolé ! On est super en retard. » Le dîner était prévu à 19h, il est 19h06 et comme à son habitude, Julien tient à s’excuser. Pas par perfectionnisme, mais pour souligner son sens de la bienséance. Il claque deux grosses bises à Laure, prend la veste de Julien et les invite à faire « comme chez eux ». C’est d’ailleurs presque chez eux, ce duplex où ils ont vécu dix ans avant d’opter pour une maison à Mairie des Lilas après le premier confinement.
19h15
« Chloé vient à peine de rentrer, de toute façon », lance Paul, tire-bouchon et bouteille à la main. Laure incline légèrement la tête, suivant des yeux le bruit des allées et venues des jumeaux à l’étage.
19h27
« Je suis là, je suis là ! » Triomphante, Chloé dévale l’escalier. Bien que ce soit une bataille quotidienne, la victoire sur le coucher n’est jamais assurée. Laure et Julien affichent un air déçu de ne pas voir leurs filleuls ce soir.
19h39
La commande du traiteur thaïlandais du coin de la rue arrivée à 19h17 peut enfin être entamée et la discussion prend son rythme :
Laure : Là on a encore une merde avec le toit, et les devis sont ridiculement chers.
Julien : On va finir par le faire nous-mêmes, en regardant des tutos sur YouTube.
Chloé : Au cabinet, on a un client qui a une entreprise de rénovation, je peux lui en toucher deux mots et voir s’il peut vous faire un prix.
Julien : Tu es sûre, ça ne te pose pas problème ?
Chloé : Mais n…
« Bien sûr que non, en plus c’est pas tous les jours que les cabinets comptables peuvent faire du pro-bono », interrompt Paul d’un ton jovial.
Chloé : Je lui en parle demain… Ohlala si vous saviez ! Son dossier est un casse-tête, il…
Paul, lui passant la main sur le dos : « Chouchou, jeudi soir, pas de casse-tête au programme. » Il ponctue la phrase par une bise dans le cou et poursuit : « J’ai pas trouvé la sauce vietnamienne. »
Chloé se lève pour prendre la sauce.
19h58
Chloé est de retour à table avec la sauce qui se trouvait dans le placard des sauces.
Julien : Je t’avais dit ! Elle est géniale.
Chloé : Qui ?
Julien : Une ancienne collègue, le top du top dans tout ce qui est ESS, campaigning.
Paul : Là, on veut lancer une nouvelle campagne sur les énergies fossiles et si on peut avoir des soutiens à Bruxelles, ce serait merveilleux.
Laure : Oh putain, j’ai complètement oublié d’envoyer les derniers drafts pour la rencontre de la semaine pro.
Paul : Oh t’inquiète, ça peut attendre lundi, surtout qu’on va se taper plein d’allers-retours.
20h05
Le téléphone de Paul sonne.
Paul : Ah, c’est la nounou. Allô ?
Chloé : Alors, la pièce vous l’avez trouvée comment ?
Laure et Julien, à l’unisson : Extraordinaire !
Chloé : Je savais ! Je l’ai recommandée à au moins cinquante personnes. Ils m’ont carrément donné envie de reprendre le théâtre, et vous savez que c’est un mélange entre…
Paul, en lui tendant le téléphone : Il y a un problème d’horaire pour demain, Mathilde va devoir partir avant que Louisa arrive.
20h08
Chloé s’éclipse sur le canapé, prend la tablette pour avoir sous les yeux l’agenda des activités des jumeaux et convient que le mieux est qu’ils restent en activités périscolaires et que Louisa, la femme de ménage, les récupère à 17h30. Elle écrit un message WhatsApp à Louisa pour l’informer, et rappellera à Paul de prévenir l’école en les déposant le matin.
20h26
Chloé revient à table.
Paul : Non mais c’est génial !
Chloé : Quoi ?
Laure : Un projet d’insertion pro pour des femmes migrantes. Tu te souviens de Victor ? Petit, un peu chauve. Ben il a lancé sa propre structure ESS et ça cartonne.
Chloé : Et elles sont insérées dans quel secteur ?
Julien : Dans le tertiaire : cantines collectives dans les entreprises, collectivités, entretien.
Chloé : Mais elles n’avaient pas déjà un métier avant d’arriver ?
Paul : Évidemment, mais dans leur situation, l’urgence c’est vraiment de pouvoir les insérer le plus rapidement, pour monter des dossiers solides de régularisation.
Chloé : Ben justement ça n’irait pas plus vite si elles n’avaient pas besoin de se former à un nouveau métier ?
Paul : C’est pas comme si la formation durait trois ans, et c’est plus court que de faire reconnaître les diplômes, expériences… Tu vois.
Laure et Julien acquiescent.
Chloé : Mmmh…
Paul : C’est bon avec Mathilde ?
Chloé : Oui, faut juste que tu préviennes pour qu’ils restent en périscolaire, et Louisa passera les prendre.
Paul : Oki doki. Oh, mais peut-être que je pourrais en parler à Louisa !
Chloé : De quoi ?
Paul : Du projet de Pierre. Elle cherchait d’autres contrats.
Se tournant vers Laure et Julien : « Vous savez, sa situation est compliquée. »
Chloé : Je pense pas que ça l’intéresserait, elle est très déterminée à devenir fleuriste.
Paul : Fleuriste ?
Chloé : C’est ce qu’elle faisait en Angola, fleuriste, et ses enfants l’aident à trouver une formation.
Laure : Oh, c’est super !
Paul : Ben je savais pas, alors qu’on papote souvent avec Louisa pendant la pause de midi avec les petits monstres.
Laure : Ils restent pas à la cantine ?
Paul : Seulement quand je vais au bureau, bon parfois je regrette… Ce midi, un vrai bordel, un cinéma pas possible, parce qu’il n’y avait plus de Mini Babybel et de Dinosaurus.
Chloé : Il n’y en a plus ?
Paul : Nope.
Chloé : T’es passé au Monop ?
Paul, prenant une gorgée de vin et secouant la tête pour signifier un non : Hmm hmm. Digne du caca nerveux de Fred à la conférence à Ber…
21h00
Chloé prend son smartphone, clique sur l’application Monoprix, duplique le panier d’il y a deux semaines.
Chloé : Tu vas au bureau pour 11h, c’est ça ?
Paul : Oui, par là.
Chloé : Par là, 10h30, ou midi ?
Paul : Hmm midi.
Chloé valide la livraison pour le lendemain entre 8h et 11h.
21h10
Chloé reprend le fil de la conversation.
Laure : Toute ton équipe y va ?
Paul : Affirmatif.
Chloé : Va où ?
Laure : À la manif du 8 mars.
Paul : On a préparé une bonne mobilisation avec un groupe éco-féministe extra.
Julien : Celle du matin ou la marche de nuit ?
Paul : Celle du matin, bon c’est pas génial politiquement mais il y a tous les acteurs politiques et la presse pour la campagne.
Laure : Tu viens avec moi à celle de nuit ?
Chloé : Je vais essayer mais je suis sur les rotules.
Paul : Ça va te booster cette manif, tu retrouves pas cette énergie au boulot.
Chloé : C’est un autre type d’énergie.
Paul : Mais tu vois ce que veux dire, c’est pas là où se joue la bataille contre le patriarcat.
Julien, levant son verre : Sur les pavés, camarade !
Paul : Oh non ! J’ai zappé, j’ai le petit-déj inter-asso à 9h.
Julien : Trop bien que tu viennes ! En plus, drama en perspective avec Gre…
22h00
Chloé reprend son téléphone : « Changer l’heure de livraison ». Pas de créneau disponible après 17h. « Annuler la commande ». Elle laissera de l’argent liquide à Louisa qui passera au Monoprix avant d’aller récupérer les petits. Elle programme le SMS pour que Louisa le reçoive à 9h le lendemain. Pour ne pas oublier, elle se lève pour déposer un billet de 20 euros dans le vide-poche de l’entrée.
22h09
Chloé retourne à table, au moment de demander qui a divorcé de qui, elle est prise d’une soudaine fatigue. Son verre à la main, elle sourit en essayant de s’aligner sur l’effervescence générale et se fait un rappel mentalement : « voir si Louisa peut être payée moitié au black pour plein temps première semaine vacances de Pâques ».
Ce qu’en dit Rose-Myrlie Joseph :
[Les femmes] qui peuvent externaliser le travail domestique entretiennent une autre forme d’illusion de l’égalité qui consiste à décrire un modèle d’organisation domestique inégalitaire sans questionner l’implication des hommes dans l’installation et la perpétuation de cette organisation injuste. Elles nient ainsi le rapport inégalitaire qu’elles entretiennent avec leur conjoint, font comme s’il n’y avait plus de lutte à mener, alors que c’est aussi leur exploitation dans le domestique qui reproduit et renforce celle des migrantes pauvres et racisées.
Rose-Myrlie Joseph est une sociologue haïtienne, dont les recherches portent sur les parcours migratoires de femmes haïtiennes devenues travailleuses domestiques en France. Son travail analyse les rapports de domination, d’exploitation et de pouvoir qui se jouent à l’intérieur du couple et dans les discours féministes autour du travail domestique – majoritairement dévolu aux femmes – défini par sa gratuité, le service domestique des personnes employées par des familles et le travail non domestique.
Paul et Chloé sont tous·tes les deux salarié·es, et bien que Chloé semble avoir des horaires moins flexibles, elle est en charge de la grande partie du travail domestique. Dans le cas des couples de catégories sociales moyennes et supérieures, le travail domestique qui est imposé aux femmes dans la division genrée du travail est médié par les femmes de classes populaires, souvent non blanches. On peut constater comment Paul entretient l’illusion d’égalité, en mettant en avant le temps passé avec les enfants, en assumant son féminisme. Il se pose même comme plus féministe que son épouse, en adoptant une une posture paternaliste et moralement supérieure : employé d’une organisation à but non lucratif, son poste lui confère un statut d’expert de l’égalité et la justice sociale, tandis que la vie professionnelle de Chloé est vite évacuée comme étant trop casse-tête pour la catégorie entre-ami·es.
Chloé est une ombre de ce moment de sociabilité entre adultes, car même si elle n’accomplit pas certaines parties du travail domestique, elle est la « manager domestique » – ce qui sous-tend souvent la charge mentale. D’après la définition de la sociologue, Chloé est la seule à se montrer responsable « dans la recherche d’arrangements entre “management” et “ménagérisation” ». Ces arrangements passent par le transfert de la charge de travail sur une femme plus pauvre et non blanche. Dans le cas présent, Chloé est le principal intermédiaire : Paul est absent du travail mais aussi distancié des rapports de domination.
Le duo de Paul et Chloé est censé refléter une image de couple progressiste, mais on constate que cette illusion d’égalité repose sur leur capacité à externaliser une partie du travail domestique, l’évitement de confrontation concernant le désinvestissement de Julien et son incompétence stratégique (passer le téléphone quand le nounou appelle, ne pas penser à acheter les biscuits, ne pas savoir que la sauce est dans le placard, à sa place habituelle), et le récit de soi entretenu, selon lequel il serait le plus féministe des deux.
Dans cette chorégraphie, Louisa est une variable d’ajustement de temps pour le travail qu’elle effectue, mais aussi pour les positions morales et politiques que revendique Paul et dont bénéficie Chloé mais qu’elle tolère plus ou moins. En effet, cette illusion d’égalité se retrouve dans certains discours féministes mainstream où le patriarcat serait incarné par une certaine catégorie d’hommes, souvent pauvres et non blancs ou de certaines cultures.
Pour aller plus loin : Joseph, Rose-Myrlie. « Les paradoxes et les illusions de l’égalité dans le travail : l’occultation des dominations », in Recherches féministes, volume 30, n° 2, 2017, p. 197–216.
Édition et relecture : Apolline Bazin et Sarah Diep
Illustration : Léane Alestra
Prochaine chronique le 5 juin
Relire : Note de bas de page [1/8]
Cet article Le dîner – Des amis qui vous veulent du bien, par Fania Noël provient de Manifesto XXI.



L'initiative était soutenue par l'opposition qui dénonce « un blocage de la majorité mécanique », qui elle estime qu'il n'est « ni courageux ni pertinent » de voter une loi « sur la base d'émotions » et « à la réalité insignifiante », sinon pour encombrer davantage les prisons.
L’article Au Sénégal, le Parlement rejette une nouvelle proposition de loi durcissant la répression de l’homosexualité est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article Lesbien·nes au coin du feu, Ep 4 : Les enfants du printemps provient de Manifesto XXI.
Bienvenue dans Lesbien·nes au coin du feu. Ici, on tend le micro à des femmes et personnes lesbiennes, bies ou pans, seules ou à plusieurs, pour qu’elles nous racontent un souvenir heureux de leur vie amoureuse. Histoires d’amour en cours ou passées, rencontres d’une nuit ou amourettes de vacances… Nous voulons diffuser des histoires lesbiennes pour donner le sourire, émouvoir et faire rêver.Voici la retranscription du quatrième épisode de Lesbien·nes au coin du feu, pour lequel Eden a accepté de nous raconter son histoire.
Pour Eden, la relation avec Joy a été trop intense. Mais elle n’en reste pas moins bouleversante. Ensemble, iels se sont accompagné·es dans le chemin de leurs identités, et ont partagé leurs passions.
Écouter aussi sur Apple Podcast, Spotify et Deezer
Moi j’étais en fac de cinéma et Joy était en fac d’anglais. Et en fait, on s’est rencontré·es dans une salle de spectacle par une amie interposée. On faisait partie du même groupe d’ami·es et en fait, elle est sortie pendant deux ans je crois, avec l’un de mes meilleurs potes de l’époque. C’était un couple un peu drama et ils se sont mis ensemble, ils se sont séparés, ils se sont remis ensemble. On regardait ça un peu de loin en fait, nous les potes. Mais c’était un peu le couple dans notre groupe qui faisait n’importe quoi.
La première fois que je l’ai rencontrée, elle était (enfin elle est toujours) grande, très élancée. Elle a une forme de légèreté dans le mouvement, une forme de grâce. Par la suite, elle fera des cours de danse. Maintenant, elle est danseuse et elle fait de la musique aussi. Mais oui, c’est ça qui m’a frappé. La première fois que j’ai rencontrée, c’est sa grâce. On dirait un oiseau un peu. Puis elle a un côté un peu papillonnant, elle va voir les gens. C’est très facile pour elle de se faire des potes, d’avoir un contact facile. Et la première fois, je l’ai trouvée assez solaire, mais il y avait quelque chose en dessous qui était émouvant pour moi. Une forme de profondeur et aussi peut être de tristesse en fait, en dessous d’un vernis assez joyeux.
C’était juste avant l’été 2007. On était au mois de juin et je faisais une soirée chez moi avec quelques ami·es. On écoute des vinyles. Au final, je ne sais plus. Vers 1h, 2h, tout le monde finit pas rentrer et du coup Joy décide de rester. On continue à écouter un peu de musique je crois, et on continue à boire du vin. Finalement, il est assez tard et on va se coucher. Et là, je crois que je lui montre un film de Gregg Araki, trois jeunes dans un road trip qui va qui vont vers la mort, enfin qui sont dans une fuite du désir et qui vont vers la mort. Un de mes films préférés.
Et je ne sais pas trop ce qui s’est passé en fait, on s’est chopés à ce moment-là. Après ce film. À l’époque on était potes quoi. Enfin, depuis la première rencontre, ça a toujours été quelqu’un qui me touchait beaucoup. Et même quand on se voyait avec nos ami·es, j’avais une relation particulière avec elle. Et parfois on était un peu à part du groupe et on parlait d’autres choses. Notamment on parlait de musique et là, c’était la première fois que l’occasion se présentait et voilà.
Du coup, le lendemain, je devais aller au travail assez tôt et j’étais completement dans une autre dimension quoi. Il y avait une nouvelle collègue, on se dit bonjour et je me rappelle très bien, j’étais complètement genre sur un nuage. J’avais un sourire jusqu’à là, je comprenais rien à ce qu’il se passait. J’étais complètement stone. Je planais en fait.
Au final, c’était que quelques heures, et il y avait les potes de la veille qui viennent me voir au ciné, et on mange ensemble, et après on décide d’aller chez moi. Mais en fait, à ce moment-là, je ne savais pas si Joy était encore chez moi. Je prends la voiture, je conduis et dans la voiture je dis à ma pote que du coup il s’est passé ça avec Joy. On arrive chez moi, on était quatre personnes à rentrer, et finalement je me rends compte qu’elle est encore chez moi. Et on est dans le salon. Et là du coup, il y a Joy qui sort. Je crois qu’elle était nue ou qu’elle avait un drap sur elle, je ne sais plus, et du coup ça m’a fait rire. C’était hyper gênant comme situation. Enfin ça me faisait pas rire sur le moment parce que j’étais un peu gêné quand même, avec mes potes. Mais ça m’a fait rire après.
Et après on est allé·es se faire une balade au jardin. Et moi à ce moment-là, je me posais déjà tout un tas de questions. Je suis une personne qui a tendance à se prendre beaucoup la tête en terme d’amour. Je me suis dit : « Comment faire pour la revoir ? » Parce que pour moi, c’était c’était comme une évidence ce qu’il s’était passé cette nuit là, je voulais la revoir. On s’était fait une balade et on était deux à ce moment-là. Et je lui demande : « Est ce que tu veux qu’on se revoit ? » Et elle m’avait dit « Non, peut être pas ce soir, je sais pas ». Enfin bref, je me suis pris un vent, c’était horrible et je suis rentré chez moi. J’étais hyper triste et j’étais en mode déjà le cœur brisé quoi.
Je m’endors et je crois que le lendemain matin, je vois qu’elle m’écrit, qu’elle m’envoie une chanson. On avait plein de groupes communs qu’on écoutait et qu’on adorait. C’était l’une des personnes avec qui j’ai partagé le plus de découvertes musicales de toute ma vie je pense. On s’envoyait tout le temps des musiques. On a découvert plein de groupes ensemble et en fait, la musique c’était c’était aussi un langage qu’on partageait ensemble, à deux. On s’envoyait énormément de musiques. Et notamment on aimait des groupes comme Cocteau Twin ou Slow Dive. Et elle par la suite, elle a commencé à mixer et je ne sais pas, c’était une très belle connexion.
Et du coup elle m’envoie ce message le matin, avec une chanson de Cocteau Twins qu’on avait écoutée quelques jours avant. Elle me propose de se revoir et le soir arrive, on décide qu’on va se retrouver chez moi. Je crois qu’il est assez tard, je ne sais plus vers quelle heure, peut être minuit, 1h du mat. Je l’attendais chez moi, et en fait j’avais laissé toutes les lumières éteintes. Je l’attendais comme ça, comme un vampire. Dans l’obscurité, il y avait juste les lampadaires jaunes comme ça, qui éclairaient le salon. J’étais dans cette lueur en l’attendant. Elle sonne à la porte, donc j’allume toujours pas la lumière et je l’accueille. Et c’est assez beau. C’est un moment assez délicat, et assez silencieux en fait. J’ai ce souvenir assez beau, de retrouver mon amante dans la nuit. On se pose dans le canapé et là on commence à parler. Et moi j’ai tendance à parler beaucoup, très longtemps. Et je crois qu’en fait à un moment donné, elle en a marre et du coup elle se casse dans la chambre direct. Et du coup je la rejoins, et c’est comme ça que tout a commencé.
Quelques jours passent, et on arrive à son anniversaire. Elle est née le 20 juin, donc c’est la veille du premier jour de l’été. Le mois de juin aura toute son importance dans toute la durée de notre relation. À chaque fois que le mois de juin arrivait, il se passait quelque chose, comme une note qui revient. Le jour de son anniversaire, je décide de l’emmener à la mer. À l’époque j’avais une voiture, et on habitait pas trop loin de la mer. Je passe la prendre en bas de chez elle, elle monte dans la voiture et là, en fait, je crois qu’elle avait du maquillage bleu sur ses yeux ou sur ses sourcils. Et en fait, je me rappelle de ce regard qu’on s’est échangé au moment et elle est rentrée dans la voiture.
Je m’en rappelle très bien parce que moi à l’époque j’avais peur. Enfin la peur, c’était une composante qui était assez omniprésente, et la peur était mélangée au désir. Elle venait du fait que c’était la première fois que je vivais cette chose, qui était l’amour, avec une fille en fait. Et c’était complètement nouveau, et pour elle aussi. Mais c’est vrai que j’ai l’impression qu’il m’a fallu m’affranchir de cette peur à chaque instant avec elle. Après cet échange de regards qui m’aura beaucoup marqué, on part sur la route et on va vers le grand air marin. On va vers l’océan, et on écoute cet album de Cocteau Twins en boucle. Et c’est un moment qui est très beau, où je me sens libre. Je pense qu’elle se sentait libre aussi avec moi et on se sentait libre ensemble, de pouvoir rouler, d’écouter la musique très fort comme ça et d’avoir l’horizon à perte de vue. On passe l’après-midi à la plage et on rentre dans la nuit. Par la suite elle m’enverra un poème qu’elle a écrit sur ce moment là. C’est là que je me rends compte que c’était pas fort que de mon côté, et que pour elle aussi ça avait été marquant, cette journée-là.
On commence une relation ensemble, elle et moi, à travers l’été où j’allais la voir souvent à vélo le soir. On se retrouvait toujours le soir. Je me rappelle, je prenais mon vélo rouge. Je longeais le bord de l’Orne et j’allais la retrouver. En fait, on a commencé par être des amant·es et voilà, on commence une relation assez passionnelle et on vivait du corps, de la poésie, de la musique, je crois que ça suffit, quand on a 20 ans, l’été. Il y avait un sentiment de liberté, de toute puissance en fait, dans ces rituels qu’on avait de se retrouver que dans la nuit, comme si on pouvait avoir des vies parallèles la journée et en fait la nuit on se retrouvait. C’était notre moment à nous.
J’avais été assez bouleversée parce qu’avant j’avais eu que des expériences avec des mecs. Donc tout ça, c’est aussi en lien avec une longue réflexion sur ma sexualité. Je pense que ça a bouleversé ma vie en fait. C’était la première fois que je couchais avec une fille. Je pense que ça a tout changé. Il y a ce que tu peux penser en terme de intellectuellement, ce que c’est d’être queer. Et il y a aussi la pratique. Je trouve que la premiere fois que tu touches un corps comme ça, ouais, ça change complètement ta vision de l’amour et de la vie. C’était hyper beau. Elle non plus elle n’avait jamais été avec une personne queer avant, mais moi à l’époque, je me définissais pas encore comme queer.
En fait, quand j’étais ado, je pensais que j’étais bi et après, rapidement, je crois que quand j’avais ça 17, j’avais quand même ce truc avec les filles, les femmes notamment. J’ai regardé beaucoup de films lesbiens, genre dans ma chambre, j’ai fait plein de films lesbiens. Ils n’avaient pas beaucoup en fait, et je les regardais en boucle. C’est pour dire à quel point il manquait des représentations aussi de personnes lesbiennes dans la fiction quoi. Donc à cette époque là, dans ma tête, en fait, j’étais lesbien·ne, mais dans la pratique, je ne savais pas si vraiment je l’étais. Je me suis beaucoup forcé aussi avec des garçons à me dire peut être que au final, je n’étais pas tombé sur le bon garçon. Je m’en suis rendu compte que j’ai perdu beaucoup, beaucoup de temps à essayer d’avoir du désir pour eux alors que j’en avais aucun, en fait. J’ai perdu des années de ma vie, je pense, dans cette quête. Parce que je n’arrivais pas à assumer ma sexualité aussi.
Sans doute parce que je suis né en Chine et que je suis arrivé en France jeune, quand j’avais dix ans, et que ma famille vit en Chine. Il y a tout ce truc de. Voilà. En France, je peux vivre cette sexualité. En fait, il y a une partie de moi qui habite toujours en Chine et qui ne peut pas vraiment accepter ça. Et à l’époque, je n’avais pas fait mon coming out à ma famille en Chine. D’ailleurs, je l’ai dit à ma mère aujourd’hui, mon père ne le sait pas. J’ai vécu tout avec une forme de décalage. Donc la première histoire d’amour, elle est arrivée assez tard dans ma vie et ça a été bouleversant.
Moi je suis arrivé en France quand j’avais dix ans et elle, elle est née en France, mais ses parents sont nés au Maroc et ils ont émigré vers la France quand ils étaient assez jeune je crois. Du coup on partageait un peu la maladie de les gens qui sont entre deux, ou plusieurs cultures. Le sentiment, quelque part un peu inachevé, d’être toujours sur deux mondes. Deux territoires, deux langues, deux espaces de temporalité. D’être toujours in between et de ressentir toujours le vide quelque part. Ce que j’appelle le vide, c’est c’est le fait de se sentir toujours incomplet et en fait, qu’il nous manque toujours une partie de nous. De ne pas tout à fait dans le bon territoire ou pas tout à fait dans le bon espace. Par « espace », j’entends aussi « espace queer » et « espace non-queer ». Enfin si je peux parler de ça comme ça. Espace blanc, espace non-blanc, tout ça… Je ne sais pas si je peux extrapoler pour elle, mais je me sens et je me sens toujours aujourd’hui entre plusieurs mondes quoi. La brèche de plusieurs frontières. Il faut que j’arrive à en faire une force. Mais c’est vrai que c’est quelque chose qui nous a beaucoup rapproché·es.
Joy et moi on était racisé·es, et par la suite j’ai relationné avec d’autres personnes qui n’étaient pas racisées et c’est des choses dont je ne pouvais pas parler avec elles, parce qu’elles ne comprenaient, pas tout simplement, ces problématiques. Le fait de faire partie d’une forme de -entre guillemets- minorité et sexuelle et raciale, ça nous donnait une forme de solidarité partagée. Même si je n’aime pas le terme minorité parce que je vois pas en quoi on est minoritaires. Mais en termes de politique, on l’était. Et aussi le fait qu’on venait de familles qui n’étaient pas du tout ouvertes à l’homosexualité, en fait, ça nous rapprochait énormément. On se soutenait beaucoup dans le fait de se stand up par rapport à nos familles, le fait de pouvoir énoncer tout ça, de mettre des mots sur nos ressentis, sur nos désirs. Parce que je pense qu’il faut nommer tout ça. En fait, il faut mettre des mots sur ce qu’on vit, sur les ressentis et sur l’amour aussi. C’est très important parce que l’amour est politique et il est d’autant plus politique quand il est queer, parce qu’on vit en marge de ce monde-là, même si on est pas minorités en soi. Mais la société fait qu’on est minoritaires en termes de pouvoir, de positionnement, de oui d’existence.
L’un des points communs qui nous réunissait, c’était notamment l’amour qu’on portait aux arts, donc forcément la musique, l’écriture, la poésie. Mais de mon côté, j’ai toujours voulu faire du cinéma. C’était mon grand rêve de rentrer dans une école de cinéma et de faire du cinéma par la suite. Quand j’avais 17 ans, j’ai vu un film qui m’a complètement bouleversé, qui s’appelle Naissance des pieuvres de Céline Sciamma. C’est l’histoire de trois jeunes filles qui découvrent leurs premiers désirs, des désirs qui sont entremêlés, des désirs assumés, non-assumés, dans leur rapport au corps. J’ai compris beaucoup de choses avec ce film-là à cette époque. Et du coup, après ce film, je me suis dit « c’est ça qu’il faut que je fasse » quoi. Le cinéma qui m’appelait et que c’était ma mission d’y aller.
Et elle, elle avait une mission aussi, mais c’était autre chose. C’était plus par le corps. C’était la danse. Et je crois que d’une certaine manière, on se complétait assez bien. Parce que moi je crois que c’est quelqu’un d’assez intello. Le rapport au corps il a pas toujours été simple pour moi. Et elle avait une forme d’aisance avec son corps, dans sa puissance de déploiement, dans la grâce du geste, dans la légèreté de se mouvoir.
Concrètement, en fait, on ne venait pas d’une famille d’intellectuels ou d’artistes. On avait ce rêve de rentrer dans le milieu de l’art, elle à travers la danse, la musique, moi à travers le cinéma. Et on s’est beaucoup porté·es quand on était ensemble, par ce rêve en commun quelque part. De pouvoir tracer un chemin, un sillon vers ce monde qui nous appartenait pas. Qui nous faisait de l’oeil, et dans lequel on se disait qu’on pouvait potentiellement avoir notre place. Et qu’on avait surtout quelque chose à raconter de par notre vécu, notre double culture. Moi par ma culture chinoise et française, elle par sa culture marocaine et française. Donc oui, c’est quelque chose qui nous a beaucoup relié·es. Je crois que oui, on souffrait tous·tes les deux de ça, de vivre deux vies et un métier qui n’étaient pas poreux, et on avait envie de les concilier ensemble.
Après à peu près deux mois de relation passionnelle, je décide de venir à Paris pour tenter ma chance. C’était un peu mon grand rêve et j’avais aussi beaucoup d’incertitudes dans le ventre et beaucoup peur. Mais voilà, je décide de prendre mon courage à deux mains et de rejoindre la capitale. A ce moment-là, elle est partie dans un festival de musique, les festivals de musique d’importance assez marquante dans notre relation aussi, comme les mois de juin. Et au final, on se retrouve à un moment donné à Paris. À ce moment-là, je cherchais un appartement et là on ne s’est pas revu·es depuis quelques semaines je crois. Et en fait, son énergie avait complètement été transformée et par l’été, et par le festival, et par la mer. Et du coup, ces retrouvailles étaient amères et acides. On s’est retrouvé·es. J’avais pleuré tout le temps, je pleurais tout le temps avant même que la tristesse arrive. Mais c’était comme une manière d’anticiper la tristesse qui allait venir. Et effectivement, quelques jours après, elle m’écrit que ce serait mieux qu’on se revoit pas pour le moment. Je crois qu’un truc comme ça, d’une phrase par sms. J’étais dans le parc et je me suis mis à pleurer. Donc après 3h de larmes ininterrompues, je rentre chez moi.
Ça, c’était mon été à Paris en 2017. C’était horrible. A côté, professionnellement, il se passe plein de choses. À l’époque, je rejoignais aussi un magazine qui était basé à Paris, je commençais à être journaliste pour eux. Je rencontrais aussi plein de nouvelles personnes qui allaient rentrer dans ma vie et beaucoup compter. C’est aussi des personnes qui allaient m’introduire à la vie parisienne, au monde de la nuit, de la fête, au monde queer. Août se passe, il y a Rock en Seine qui arrive et je vais programmer quelques interviews avec des musiciens, des groupes que j’adorais. Et là, j’avais fait ma première interview de Slow Dive, à Rock en Seine. C’était l’un des groupes qu’on adorait le plus. Et je me rappelle de la force qu’il a fallu de m’extirper de la tristesse qui me collait à la peau à ce moment-là, pour aller interviewer le groupe que je préférais au monde quoi. Enfin, c’était quand même un cadeau, un privilège de les rencontrer. Et même ça, c’était un moment qui était beau, mais c’était tellement noyé dans la tristesse que c’était un sentiment très diffus, très mélangé. A quel moment tu décides que l’amour contamine tout comme ça, même les moments les plus beaux de ta vie ? La passion, c’est bien, mais il faut aussi mesurer la hauteur de ta tristesse quoi. J’ai l’impression que dans la passion, il y a un peu ce truc mathématique qui fait que plus tu vas dans les hauteurs, dans les montagnes, dans les choses du plus extraordinaires et les plus immenses, plus tu vas aussi tomber. C’est un peu comme un roller coaster d’addictions, et j’ai mis des années mois à m’en défaire de cette addiction.
A partir de cette rupture, la passion dévorante a duré un peu plus de deux ans. C’était comme un cercle quoi. On n’arrivait pas à se quitter, mais quand on se remettait ensemble, on n’arrivait pas à juste continuer à être ensemble. Il y avait quelque chose qui était assez étrange de l’intermittence dans notre relation. C’était un fils qui ne pouvait pas être continu dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. Et on n’arrivait pas à mettre en œuvre l’idée qu’on avait de notre amour, qui était grandiose, poétique, éternel, à travers nos corps inscrits dans cette vie terrienne, de tous les jours. Il y avait une impossibilité de s’aimer simplement, alors que tout le monde, tous les autres autour de nous arrivait à le faire. Et ensemble, on se comprenait pas non plus. Le langage était rompu. On se faisait du mal quoi.
Mais ce qui est assez drôle, c’est que j’ai l’impression que la chose qui nous attiré le plus chez une personne au début de la relation, à la fin, c’est ce qui nous rebute le plus. Et à travers Joy, ce qui m’attirait le plus, c’était le fait qu’elle était hyper spontanée, qu’elle avait une énergie très juvénile. C’était comme un enfant. Et quelque part, on ne peut jamais en vouloir un enfant de ses comportements. Cette forme de légèreté, d’être, de nonchalance. C’est marrant comment une qualité peut toujours devenir un défaut et vice versa. En fait, ça dépend où est ce que le cœur se place. C’est la personne la plus libre que j’ai rencontrée, mais aussi, par extension, cette liberté peut porter une certaine forme d’égoïsme. Donc par la suite, ça m’a permis de réfléchir aussi sur : « qu’est ce qu’être libre ? » A quel endroit ta liberté atteint celle des autres, et le prix de l’indépendance.
Et oui, dans notre relation, j’avais l’impression que la dynamique était la suivante : elle avait besoin d’être libre et de faire ce qu’elle voulait tout le temps, et d’avoir aucun plan. Elle faisait des promesses à personne et du coup, personne ne pouvait lui en vouloir qu’elle ne réponde pas aux exigences des autres. Donc elle faisait ses bails et après elle revenait chez moi, sur mon territoire. Et moi je devais être comme une espèce d’aéroport qui allait accueillir son avion, et son avion, allait décoller n’importe quand et revenait n’importe quand aussi. Et moi je devais être un aéroport ouvert H24, nuit et jour, qui était là, soit à l’attendre, soit l’accueillir. Elle me racontait ses aventures, donc c’était ça la dynamique pendant quasiment deux ans. Et moi j’avais l’impression que c’était ma mission de quelque part, entre guillemets, de la sauver, donc de la réparer. C’est ce que j’essayais de faire au mieux. Et par la suite, j’ai compris que ce n’était pas mon rôle forcément de faire ça. Et de deux, en fait, il faut qu’elle se répare d’elle même. C’était ça et que peut être que moi aussi j’avais besoin d’être réparé. Et deux avions qui sont défaillants tous les deux, ça crée des accidents. Et parfois on se retrouvrait en vol, ça faisait des étincelles, et d’autres fois, ça faisait un crash. Je pense que je suis encore en réparation, mais ça va un peu mieux avec le temps.
On est toujours en 2017, c’est mon anniversaire, je suis né le début de l’été. Et elle m’amène chez le tatoueur, parce qu’à l’époque j’avais pas encore de tatouage et je voulais ça faire mon premier tatouage. Et je voulais une lune, commencer par faire un croissant de lune sur mon corps. Et elle m’emmène chez la tatoueuse. Et en fait, elle a réussi à prendre un rendez vous comme ça, du jour au lendemain. J’ai pas compris comment, et j’y vais. Et là elle me dit : « Je t’offre la lune ». Et du coup je me retrouve avec une lune qui est là, au poignet. Il y a tout un truc autour des saisons. En fait, à chaque fois, nos histoires se passaient au printemps jusqu’au début de l’été. On était les enfants du printemps et de l’été, donc impossible pour nous de passer à l’automne en hiver. Mais c’est marrant de ce que ça raconte, parce que le printemps et l’été, c’est le début de la vie sur terre. C’est les feuilles qui commencent à repousser, c’est le début de la floraison, et nous, on était comme des bourgeons, plein de potentiel à venir. Et une fois que l’été passe, j’ai toujours senti que c’était plus le déclin. Je sentais que notre relation avait une date de péremption.
Donc je sais toujours dans ce roller coaster émotionnel. On s’attache, on se détache… Entre temps, Joy part vivre à Bruxelles, moi je rentre dans une école de cinéma. J’entre dans une nouvelle phase de ma vie aussi. Je rentre en Chine. Voilà. On grandit l’un·e sans l’autre, mais on grandit quand même. Et même si on a eu des grandes périodes où on parlait plus du tout, on avait coupé complètement le contact, je savais que… Je sais pas. Qu’on avait comme une connexion quoi. Comme de l’ordre d’une connexion de type astrale.
Tout ça, ça nous ramène à un évènement mondial planétaire inédit, qui est le le Covid 19, et par extension le confinement en France qui arrive au moment du printemps. On s’était séparé·es quelques mois avant, et moi, le fait que la terre s’arrête comme ça de tourner, et que toutes nos habitudes soient chamboulées, ça m’a fait me poser les bonnes questions qui étaient : « qu’est ce que j’ai envie de faire ? À quel endroit j’ai envie d’investir mon énergie ? » Et je me suis dit que cette histoire était peut être pas encore terminée. Donc au final, je la relance. Je romps le silence. Je lui avais écrit sur Facebook, un truc assez dramatique. Et en fait, on avait recommencé à se parler et à se faire des appels, à se faire des appels vidéo. On avait recommencé une relation comme ça, à distance, et c’était extraordinaire.
En fait, à chaque fois qu’on se remettait ensemble, il y avait une forme d’excitation nouvelle, de se redécouvrir et aussi une forme d’espoir de se dire qu’on n’allait pas refaire les mêmes erreurs, qu’on avait grandi, qu’on avait appris et qu’on était plus prêts pour l’avenir. Dans tout cas, il y avait le désir en commun de quand même de continuer à s’aimer. Voilà, le confinement passe. Je revis cette nouvelle histoire d’amour complètement inédite, à distance. Elle à Bruxelles, moi à Paris. Et c’est complètement fou. C’était encore plus fort, c’était encore plus intense. Pour le coup, c’était vraiment l’éloge de la poésie, quoi. On s’écrivait tout le temps, on se faisait des vocaux, on n’avait jamais aussi bien communiqué qu’à ce moment-là. Parce qu’on était dans une impossibilité de se déplacer. Ça nous a donné une grande liberté le confinement.
Et moi j’ai eu une révélation à ce moment-là. Avec le confinement, ça a changé assez radicalement ma manière de penser le monde et de la vivre. Et un matin, je me suis réveillé avec une évidence, je devais changer de prénom. Enfin que je l’avais même déjà changé et que j’étais déjà dans ce nouveau prénom, Eden. Et je lui annonce. Et je lui annonce aussi que maintenant, ce sera « il ». Ça faisait déjà un bout de temps que je me posais des questions sur mon identité de genre. Et là, avec le confinement, c’est comme si tout était devenu plus limpide. Elle me soutient dans ma démarche avec mon nouveau prénom, mon nouveau pronom, dans mon nouveau corps. C’est assez extraordinaire. Elle me soutient dans mon geste d’émancipation d’être qui je suis, dans ce coming-out non-binaire.
Alors, le bilan de tout ça, à travers ces quatre ans d’aller-retours perpétuels, de tourbillon avec une intensité maximale et des brèches de vide absolu, ce que je retiens, c’est que le véritable amour dépasse les frontières jamais écrites. Et que même si aujourd’hui on se parle plus, je porte toujours quelque chose en moi, et je crois qu’il y a des choses qui peuvent exister, même si elles ne peuvent pas s’incarner dans une forme de réalité terrienne, là, à l’instant T quoi. Mais ça ne veut pas dire qu’elles n’existent pas. Je pense qu’il y a d’autres réalités qui existaient et peut-être probablement, dans une des réalités parallèles, on est toujours ensemble. Il y a des moments où on fait tous des choix et en fait, c’est des choix qui t’emmènent vers une branche de ta réalité. Et il y a plein de réalités qui coexistent ensemble.
Et ce que je retiens aussi, c’est qu’il y a de l’amitié dans l’amour et que j’ai aussi perdu une amie. Et après ça, pendant deux ans, j’ai énormément réévalué ce que j’étais capable de donner aux autres, autre que dans le cadre d’un amour romantique. Globalement, j’ai repensé ma définition de l’amour. Et là, pendant deux ans, j’ai fait des rencontres merveilleuses. Je crois que j’ai jamais autant donné de moi, aussi dans les amitiés. Enfin, je crois que la frontière entre amitié amour est beaucoup plus poreuse en fait aujourd’hui. Et j’aime mes ami·es d’amour, très fort.
J’ai plus envie de vivre ces up and down de manière aussi radicale. Je pense que je cherche de l’intensité, certes, et aussi de la poésie, beaucoup de beauté, du sublime, mais peut-être dans une forme un peu plus stable en fait. Je suis attiré par aussi une forme d’instabilité parce que moi même, je suis quelqu’un d’instable. J’ai l’impression que c’est quand c’est instable, quand c’est friable, que c’est là, à cet endroit-là, ce que la vie a à t’offrir de plus beaux quoi. Mais peut-être que c’est une idéologie erronée, et qu’il y a aussi de la beauté dans les choses stables, durables. Et peut être que c’est beau aussi de construire un refuge un peu plus solide que dans celui dans lequel j’ai évolué. Je crois que c’est ça en fait. J’ai envie de créer des refuges pour moi, pour mes ami·es, pour les gens que j’aime. Et dans ce refuge là, j’ai envie qu’il y ait de l’amour, de la liberté, de la créativité. Un refuge peut-être pour plus équilibrer les choses, et mieux s’entourer aussi. Mais en tout cas non, je ne rejette pas les intensités. Enfin, je suis la recherche d’intensité tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais peut-être que l’intensité, elle est pas incompatible avec la durée. Et ce que j’ai compris aussi là-dedans, c’est que moi-même j’ai besoin de stabilité. Quand je parlais d’aéroport tout à l’heure, c’est que moi aussi j’ai besoin de me poser dans un aéroport. Oui, de mieux se connaître. Je crois que j’ai mieux appris aussi mes limites, ce que je pouvais donner. Souvent, quand on est mû par un désir d’aider les autres, de les sauver, c’est que nous-même en fait, on a besoin d’être sauvés. C’est ça aussi que j’ai compris, que moi aussi j’avais besoin de guérison. Peut être oui, encore, de me réparer, de me guérir avant d’aimer à nouveau.
La vie est bien assez grande pour accueillir encore plein d’avions. Et plein d’oiseaux. Et plein de voyages.
Vous venez de lire le 4ème témoignage de Lesbien·nes au coin du feu, un podcast Manifesto XXI signé Athina Gendry. Merci à Eden de nous avoir partagé son histoire. Cet épisode a été monté par Jeanne Chaucheyras, qui a assuré la réalisation, le sound design et la musique originale. Il a été produit par Soizic Pineau, avec Apolline Bazin à la distribution et promotion, et Coco Spina à la direction éditoriale. L’identité visuelle et la direction artistique de ce podcast ont été imaginées par Dana Galindo. Léane Delanchy anime le compte Instagram @lesbaucoindufeu et a réalisé l’illustration de cet épisode.
Merci au média Hétéroclite ainsi qu’à ACAST pour la diffusion du podcast. On vous retrouve bientôt pour un nouveau témoignage. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n’hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous.
Si vous souhaitez vous aussi raconter une belle histoire au micro de Lesbiennes au coin du feu, vous pouvez nous la partager à l’adresse mail suivante : lesbiennesaucoindufeu@gmail.com
Lesbien·nes au coin du feu, Ep 3: Boucler la boucle
Cet article Lesbien·nes au coin du feu, Ep 4 : Les enfants du printemps provient de Manifesto XXI.

Promu en quatrième division espagnole avec son équipe de Marbella, Alberto Lejárraga, 28 ans, a célébré son classement en embrassant son compagnon avant de partager les photos, saluée sur les réseaux.
L’article Football : Alberto Lejárraga, gardien espagnol, fait son coming-out sur le terrain est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Ses parents l'ont emmené à des rassemblements de La Manif pour tous, entre 2012/2013. Depuis, il a fait son coming out et regrette qu’on les fait manifester contre ses propres droits.
L’article « J’ai manifesté contre moi-même », Amaury, 23 ans, enfant de La Manif pour tous, regrettant d’y avoir été associée est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

 Un rêve se réalise enfin … Pour cette édition, on investit Virage pour une soirée sous le périph et au grand air, pour accueillir ENFIN nos idoles de toujours, Miss ...
Un rêve se réalise enfin … Pour cette édition, on investit Virage pour une soirée sous le périph et au grand air, pour accueillir ENFIN nos idoles de toujours, Miss ... 
Cet article Avec « Disconnected », Hildegarde illustre l’enfer du cyber-harcèlement provient de Manifesto XXI.
« Aux confins de mes sentiments, tout le monde piaille tout le temps » chante Hildegarde dans ce clip qui traduit les émotions douloureuses que l’artiste a ressenti quand ael a subi un cyber-harcèlement massif.Il y a deux jours, Hildegarde écrit ces mots sur son compte Instagram à propos de « Disconnected »: « Ce clip me rend de ma force, il donne du sens à une souffrance qui n’en n’avait pas. » La vidéo qui illustre ce titre, tiré de son album Inside, est la traduction d’une expérience traumatisante: au printemps l’année dernière, Hildegarde, artiste queer qui se compose souvent un personnage avec des prothèses d’oreilles d’elfes, accepte de tourner une vidéo avec Konbini. A la publication, le titre de la vidéo présente de manière réductrice son travail artistique et déclenche une violente vague de cyber-harcèlement. Le shitstorm est tel qu’un journal d’extrême droite publie une caricature d’Hildegarde. L’artiste tient le choc face à ces épreuves, jusqu’à ce que la violence monte encore d’un cran.
Après des torrents commentaires insultants, tous ses réseaux et comptes en ligne, « d’Instagram à Steam en passant par Ameli », sont hackés. La perte de ses moyens de communication est le coup de grâce et Hildegarde s’arrête pendant deux mois… Grâce à son entourage ael remonte la pente et se lance dans le tournage du clip avec le réalisateur GoG. Avec sa multiplication d’avatars, la profusion de textures et de tableaux, la vidéo traduit l’expérience du tourbillon infernal du cyber-harcèlement. L’artiste explique : « Le clip de Disconnected rend très bien compte de la perte de contrôle d’une figure qui n’est finalement pas vraiment soi mais un avatar, submergé, distordu, mais quelle est la distance entre l’avatar et soi, si on se retrouve aussi saturé.e d’informations et d’émotions ? »
Cet article Avec « Disconnected », Hildegarde illustre l’enfer du cyber-harcèlement provient de Manifesto XXI.



Cet article Musique Magique : un festival pour faire planer Marseille provient de Manifesto XXI.
Le festival Musique Magique déferle sur Marseille avec 8 événements mettant la musique de niche à l’honneur. Lives expérimentaux, dj sets grande vitesse et concerts bubblegum rythmeront ces deux semaines, du 4 au 20 mai. Interview avec son fondateur, l’artiste Sasha.Une vague de mignonnerie expérimentale s’apprête à déferler sur Marseille. Du 4 au 20 mai, Musique Magique propose des lives, des dj sets, une exposition et un atelier DIY, au fil de 8 événements dans différents lieux de Marseille. Initié par Sasha, qu’on connaissait déjà comme membre du collectif de fête PailletteS et moitié du couple d’artistes Dasha et Sasha, le festival met à l’honneur des artistes « de niche », des bedroom nerds à l’énergie sincère, souvent rapide, toujours joyeuse.
Après une inauguration au SOMA avec le live machine IDM du représentant local Poborsk et le b2b d’Anna Superlasziv & Zeroday [exploit], Coco Velten accueillera une longue fin de journée noise expérimentale avec le live du duo marseillais Agelena Armour. On touchera probablement le climax de la sorcellerie le jeudi 11 mai au Molotov, avec un line up explosif : la première date dans le sud de Cheval de Trait, le prometteur duo gabber-folklorique breton, accompagné de Nadou le rdv ou encore DJ Raxxas, « jeune espoir de la musique qui fait galoper » comme nous le décrit le fondateur du festival. La course poursuite se prolongera dans l’antre du mythique Meta, avec une nuit à grande vitesse réunissant Dr Dr4kken, le boss du label Safe Cloud Records, aux côtés de Turbo Torši (le projet solo de la moitié de Baja Frequencia) et de la jeune queen Bettinananass. La redescente se fera également en bonne compagnie, avec les lives pop bubblegum de Kevin Colin et Slurpflrup à la Brasserie communale, puis un all stars avec les copaines aux 9 Salopards. Sans oublier l’atelier de fabrication de synthétiseur mené par Ritual Electronics, et l’exposition de peintures, sculptures et sérigraphies de Dasha, XXX OXO et Margot Canhoto à l’atelier La Grenade.
À quelques jours du coup d’envoi, on a papoté avec Sasha, qui nous a raconté les origines et la vision de Musique Magique.
Ça vient d’un instinct de survie, du besoin de se créer des espaces « safest as possible », en offrant de la douceur, de la générosité, pour nous aider à survivre jusqu’au prochain weekend !
 Sasha arborant fièrement un des tshirts Musique Magique 2023
Sasha arborant fièrement un des tshirts Musique Magique 2023
Manifesto XXI – Pourquoi avoir eu envie de réunir deux semaines de « musique magique » sur Marseille ?
Sasha : C’était un vieux rêve d’organiser un festival, je dirais même une fantaisie, parce que ça n’a pas vraiment de sens. Un festival, c’est avant tout plein de rencontres, autant entre les artistes qu’avec le public. Des artistes qui jouent sur une certaine soirée vont quand même se sentir impliqué·es en se rendant à d’autres événements du festival. Ça crée beaucoup d’échanges, ce qui est à peu près le sens de la vie je crois.
Il y avait aussi quelque chose d’un peu plus politique dans l’idée de ce festival, dans le rapport à l’égalité entre les artistes. J’avais envie qu’iels soient tous·tes logé·es à la même enseigne, au moins sur le papier. Il y a peut-être des créneaux un peu plus chic que d’autres, mais tout le monde apparaît par ordre alphabétique sur une même affiche, sans qu’on sache d’emblée qui joue à quel endroit ou à quelle heure. Et iels sont tous·tes payé·es pareil. C’est aussi ce que permet le festival : si l’économie d’un des événements marche moins bien, on arrive à équilibrer grâce aux autres pour que tout le monde ait le même cachet.
C’est quoi de la « musique magique » pour toi ?
Pour moi ça évoque l’aspect « drogue » de la musique, qui te met dans un état second. J’écoute certain·es artistes à la maison et je pleure, d’autres me font rire, d’autres me réveillent, m’endorment… Ce sont les mêmes effets secondaires des drogues dures que la musique peut provoquer, des émotions, des madeleines de Proust. Le potentiel pouvoir magique vient avant tout du contexte : si tu mets le bon son, les bon·nes gens, au bon endroit, il se passe un truc de l’ordre du magique. Tu peux écouter Francky Vincent sur la plage avec ta meilleure amie, si ça te rappelle des souvenirs, ça sera magique.
 Cheval de Trait, programmé par Musique Magique le 11 mai au Molotov, Marseille
Cheval de Trait, programmé par Musique Magique le 11 mai au Molotov, Marseille
Le line up est éclectique, brassant beaucoup de genres différents, et les formats d’événements aussi : l’idée c’était de pouvoir parler à des publics différents ? Qu’est-ce qui lie tout ça ?
Alors, je n’ai pas du tout envie d’avoir plein de publics différents : j’ai envie d’un public de gauche, curieux et sympa, pas de hooligans de droite ni de vieilles familles cathos ! (rires) Je voulais qu’il y ait des formats différents oui, pas tant pour que ça parle à différents publics, mais plutôt à une seule et même personne : si elle vient à deux ou trois événements en ayant confiance, en acceptant se laisser emporter, elle pourra vivre des expériences différentes – certaines chill, d’autres plus intenses voire agressives. Je crois que le public doit jouer le jeu de venir en se laissant aller. J’ai construit le festival en pensant à des moods : par exemple, à Coco Velten, ce sera chill et mignon, pour rêver un peu, boire des coups. À d’autres endroits comme au Meta, les gens vont danser toute la nuit. J’ai essayé de créer des atmosphères spécifiques pour chaque moment.
Il n’y a pas grand-chose qui lie tout ça mais c’est cohérent. En fait, je me suis justement demandé : c’est quoi la cohérence ? Je crois que c’est quand on met des choses différentes ensemble et que c’est quand même agréable. On vit dans une époque où plus rien n’a vraiment de sens : manger des sushis en Espagne, on pourrait se dire que ce n’est pas cohérent, mais a priori si on aime les sushis, c’est plutôt agréable. Alors c’est cohérent.
Tu évolues dans une scène marseillaise dynamique que tu as eu envie de mettre à l’honneur, mais tu as aussi invité des artistes de plus loin : raconte-nous d’où sont venus tes coups de cœur ? Comment as-tu construit ce line up ?
Depuis le tout début du projet, c’était important pour moi de mettre en avant la scène locale, déjà parce que ça m’évite de payer des billets de train, en toute transparence ! (rires) Je connais à peu près tous·tes les artistes personnellement, ce sont des gens avec qui j’ai un bon feeling, que j’ai rencontré·es à la plage, en after, en festival. Il y a d’autres artistes de la scène locale que j’aime aussi mais qui sont plus connu·es ou qui tournent bien actuellement. Moi j’avais envie de mettre en avant la musique de niche, des artistes plus discret·es et moins expert·es en communication, qu’on voit rarement jouer mais qui méritent clairement de figurer à l’affiche d’un festival. Ce sont des personnes généreuses musicalement, qui sont intègres et qui font ça pour la passion, un peu geeks, qui font de la musique dans leur chambre, de manière pas toujours professionnelle même si ça devrait l’être !
Les artistes qui viennent d’ailleurs sont aussi des coups de cœur, par exemple j’ai découvert Cheval de Trait cinq jours avant de finaliser l’affiche du festival. On m’a montré une vidéo de leur live à Paris, je me suis dit « oui c’est magique » et je leur ai proposé de jouer. Il y a aussi beaucoup d’artistes proches de toute la grande famille de Dimension Bonus, qui est un mouvement artistique que je définirais également d’intègre et généreux, une forme de poésie contemporaine qui se donne des airs naïfs mais qui est en fait très sincère.
 Dr Dr4kken, programmé par Musique Magique le 13 mai au Meta, Marseille
Dr Dr4kken, programmé par Musique Magique le 13 mai au Meta, Marseille
L’événement distille effectivement une joie de vivre presque candide, autant dans le titre, les visuels que les descriptions, ou le choix des artistes invité·es. C’était important pour toi d’amener cette énergie positive ?
Ce n’est pas très conscient ! J’aime naturellement les bébés chats, les smoothies et les yaourts glacés, les choses douces et agréables, je ne fais pas exprès. Beaucoup des artistes invité·es sont assez mignon·nes – il y a juste Agelena Armour qui est plus dark, le seul mouton noir du festival ! Ce n’est pas totalement par hasard : en tant qu’artiste mais aussi en tant qu’humain, je pense que j’appartiens à ce mouvement artistique. Gajeb (du groupe Slurpflrup), Kevin Colin, Nadou le rdv, Bettinananass, ce sont des… « woke » : des gens éveillé·es, attentionné·es, qui veillent à ce que tout aille bien pour tout le monde même quand iels sont juste client·es d’une soirée, et qui ont la même énergie en tant qu’artistes, sans être complètement naïf·ves pour autant. Ça doit venir d’un instinct de survie, du besoin de se créer des espaces, pas « safe » parce que je crois que ça n’existe pas, mais « safest as possible », en offrant de la douceur, de la générosité, pour nous aider à survivre jusqu’au prochain weekend !
Tu as monté ce festival tout seul, c’est un gros défi pour un jeune artiste. Comment tu t’es organisé pour y arriver ?
D’abord, j’ai tout mon temps ! Je suis au chômage, donc je mets absolument toutes mes journées là-dedans parce que ça me fait super kiffer, je ne compte pas mes heures. Je suis le seul bénévole du festival. Sinon, ce sont tous ces lieux qui me font confiance et qui ont accepté de me donner carte blanche. Je pense que c’est grâce à mes bagages avec PailletteS, Abribus, Soirée Pizza… Tous les deals que j’ai eus avec des salles de concert de Marseille se sont toujours bien passés, donc quand je suis revenu vers elleux avec ce projet, j’ai été accueilli avec des grands sourires. Je les remercie beaucoup ! C’est le sang. Finalement, pareil que les artistes, tous les lieux sont logés à la même enseigne dans le festival.
 XXX OXO, exposée lors du festival Musique Magique à La Grenade, Marseille
XXX OXO, exposée lors du festival Musique Magique à La Grenade, Marseille
Il y aura aussi une exposition, un peu dans la continuité des soirées PailletteS qui mêlaient musique, fête et arts visuels ?
À la base je suis dans l’art, j’ai été diplômé des beaux-arts avant de m’égarer dans la techno. Je trouve ça important, et aussi magique. Pendant le festival il y aura une exposition de trois jeunes artistes résident·es à La Grenade, qui ont carte blanche. Pourquoi des arts visuels dans un festival de musique ? La question, ça devrait être plutôt : pourquoi il y en a si peu ? L’an prochain, j’aimerais bien qu’il y ait plutôt quatre ou cinq expos. Je trouve ça totalement logique qu’on regarde des pièces artistiques tout en écoutant de la musique. Ce sont deux moyens d’expression, avec des langages différents mais qui disent les mêmes choses. C’est dans la continuité de ce qu’on faisait avec PailletteS oui, même si ça relevait plus de la scéno que d’une vraie expo. Là je voulais encore plus de générosité, que t’en aies pour les yeux, les oreilles, pour la bouche aussi parce qu’il y aura à boire ! L’objectif l’an prochain, c’est de recommencer avec toujours plus de lieux.

Toute la programmation de Musique Magique ici et sur Instagram
Relecture : Apolline Bazin
Cet article Musique Magique : un festival pour faire planer Marseille provient de Manifesto XXI.


Un jeune gay a été frappé et chassé d'une station, dans la soirée du vendredi 24 avril, et un couple de femmes a été menacé de mort le lundi suivant, parce qu'elles s'étaient brièvement enlacé, en attendant le métro.
L’article Deux agressions, lesbophobe et homophobe, en quatre jours dans le métro de Lyon est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Déjà condamné pour homophobie en 2020, le blogueur a de nouveau publié des injures et propos violents à l'encontre des personnes LGBT+, notamment qualifiées de « chiens galeux, sidaïques, et venant de l'enfer », qu'il appelle à « écraser ».
L’article Nouvelle plainte contre Bassem Braïki après ses propos homophobes sur Snapchat est apparu en premier sur Association STOP Homophobie.

Cet article PODCAST – Exposé·es, ce que le sida a fait aux lesbiennes provient de Manifesto XXI.
« Ce qui m’intéresse dans cette histoire, c’est comment on s’est mobilisées contre l’indifférence politique, l’homophobie structurelle, contre le fait qu’on laissait crever des populations dont on se foutait, quand bien même nous, on n’était pas en train de crever » déclare Clémence Allezard, journaliste et autrice de plusieurs enquêtes sur la place des lesbiennes dans la lutte contre le sida. Alors pourquoi, et comment, certaines lesbiennes ont-elles marqué la lutte contre le VIH/sida en France ? Et quels en sont les héritages dans le militantisme lesbien aujourd’hui ? C’est le sujet du premier épisode de notre podcast Exposé·es, produit en partenariat avec le Palais de Tokyo.Durant les années 1980-1990, l’épidémie de VIH/sida, d’abord qualifiée de « cancer gay » puis de « maladie des 4H » (Haïtien, Homosexuel, Héroïnomane et Hémophile), touche principalement les HSH (« hommes ayant des rapport sexuels avec des hommes ») et les usager·ères de drogue. Beaucoup moins vulnérables au virus, des lesbiennes s’engagent néanmoins dans la lutte contre l’épidémie.
Disponible aussi sur Apple podcast & Spotify
Elisabeth Lebovici, historienne de l’art, journaliste, militante féministe et lesbienne, est l’une d’entre elles. Elle a notamment rejoint l’association Act Up-Paris dans les années 1990. En 2017, elle publie Ce que le sida m’a fait. Art et activisme au XXe siècle, ouvrage dans lequel elle s’intéresse aux traces laissées par le sida dans les pratiques culturelles. Le virus, au-delà d’affecter les corps, a transformé les espaces sociaux, politiques et artistiques dans un contexte où la disparition et la mort sont des réalités quotidiennes. C’est à partir de ce livre que l’exposition, à découvrir jusqu’au 14 mai au Palais de Tokyo, a été pensée par le commissaire François Piron.
Dans cet épisode, nous avons voulu partager le récit des luttes lesbiennes d’hier et d’aujourd’hui. Nous avons tendu le micro à des militantes, afin de comprendre le rôle que les lesbiennes ont joué dans la lutte contre le VIH/sida et, surtout, ce qu’il en reste dans le militantisme actuel, des manifestations à l’art thérapie, en passant par les terrains de foot. Bonne écoute !
Intervenant·esClémence Allezard – documentariste radio et journaliste
Isabelle Sentis – activiste, Sœur de la Perpétuelle Indulgence, art thérapeute, fondatrice de Fabric’Art Thérapie et de Queer code
Cécile Chartrain – militante lesbienne et féministe, fondatrice des Dégommeuses, salariée à Sidaction
Veronica Noseda – militante lesbienne et féministe, membre des Dégommeuses
Mimosa – militante gouine, membre des Inverti·es
Écriture et conception : Anne-Charlotte Michaut et Soizic Pineau, avec l’aide de Hélène Carrier
Réalisation et montage : Soizic Pineau
Habillage musical et mixage : Talita Otović
Merci aux Inverti·es, aux Dégommeuses et à la Rainbow Cup. Merci à Sarah, Théo, Coco et Collin ainsi qu’à toustes celleux qui ont rendu le projet possible.
RessourcesOuvrages et articles
Podcasts et documentaires
Image à la une : Benoît Piéron, Flore hospitalière avec rehauts de cyprine, Dessin, 2022, courtesy Galerie Sultana (Paris) ; @ Benoît Piéron
Cet article PODCAST – Exposé·es, ce que le sida a fait aux lesbiennes provient de Manifesto XXI.