Rencontre avec Amandine Gay, réalisatrice du documentaire
Ouvrir la voix, militante aux multiples identités, qui se définit elle-même comme «
Noire, née sous X, cis, afroféministe, pansexuelle, anti-hétéro-normativité, pro-choix…».
Après avoir grandi dans la banlieue lyonnaise dans les années 90, Amandine Gay a fait des études à Sciences Po Lyon puis est devenue comédienne. Lassée de ne se voir proposer que des rôles stéréotypés, elle a décidé de passer derrière la caméra pour réaliser un documentaire, Ouvrir la voix, qui donne la parole à plus d’une vingtaine de femmes afro-descendantes. C’est l’occasion d’une discussion passionnante sur le racisme sous toutes ses formes (du plus frontal au plus insidieux), mais aussi sur le sexisme ou l’homophobie qui visent les femmes noires.
Vous vivez aujourd’hui à Montréal. Ressentez-vous une différence entre la France et le Québec dans le traitement des personnes noires (et notamment des femmes noires) ? Le racisme s’exprime-t-il différemment, est-il plus fort ou plus faible de l’autre côté de l’Atlantique ?
Amandine Gay : Si j’ai choisi de m’installer au Québec (j’y fais actuellement des études avant de m’y installer définitivement), c’est en effet parce que le racisme ne s’y articule pas de la même façon qu’en France.
Et ce d’autant moins que, en ce qui me concerne, dans cet espace-là, je suis perçue comme Française avant d’être perçue comme Noire. En habitant dans un quartier où vivent beaucoup de Français, je ne suis pas du tout traitée comme le sont par exemple les primo-arrivants haïtiens. Lorsqu’on se déplace, notre situation sociale change aussi très souvent et c’est comme ça que j’ai acquis au Québec des privilèges que je n’ai pas en France. De ce fait, ma vie quotidienne est beaucoup plus reposante à Montréal qu’en France.
Au-delà de mon cas personnel, le racisme se joue en effet différemment au Canada, sans doute parce que c’est une société anglo-saxonne. Au quotidien, il est moins frontal. Mais surtout, le contexte colonial n’est pas le même. Au Québec, on compte ainsi onze nations autochtones, qui sont structurellement plus touchées par le racisme, la pauvreté, les problèmes de santé… L’enjeu du traitement de ce qu’on appelle au Canada «les Premières nations» vient donc se rajouter aux questions de négrophobie, de xénophobie, etc. Il y a là-bas une sorte de déplacement de la violence d’État qui s’exerce très durement sur les nations autochtones.
Mais il existe néanmoins une négrophobie spécifique au Québec ?
Amandine Gay : Oui, complètement. De façon générale, chaque espace où les Noirs sont minoritaires connaît une négrophobie particulière, en fonction de sa propre histoire.
L’esclavage a aussi existé au Québec, mais plutôt sous une forme domestique, citadine, dans les maisons bourgeoises de Québec et de Montréal. C’est par exemple une esclave noire qui a été accusée d’avoir allumé l’un des plus grands incendies qu’ait connu Montréal, en 1734. Et au Québec, il y avait des esclaves noirs, mais aussi autochtones, issus des Premières nations.
C’est donc une histoire très différente de l’esclavage de plantation, essentiellement rural, qu’ont connu les États-Unis ou la France (hors du territoire métropolitain). Et les esclaves étaient évidemment beaucoup plus nombreux dans la Caraïbe ou dans le sud des États-Unis qu’au Québec.
Ces passés différents expliquent que les formes que prend aujourd’hui la négrophobie aux États-Unis, en France et au Québec soient différentes.
Diriez-vous, de la même façon, que les problématiques
queers et raciales ou décoloniales s’articulent différemment au Québec et en France ? On a l’impression que les réflexions sur ces questions sont plus avancées là-bas que chez nous…
Amandine Gay : Oui, elles sont plus avancées, mais les enjeux ne sont pas forcément les mêmes. Par exemple, l’espace nord-américain a encore du mal à se poser les questions de classe et d’homonationalisme. Au Québec, les problématiques queers pour les personnes blanches sont très avancées, mais les réflexions sur le racisme dans les communautés LGBT blanches se trouvent au même point qu’en France.
C’est surtout du point de vue institutionnel que le contraste est saisissant. Le mariage a été ouvert aux couples de même sexe dès 2005 et l’adoption par des personnes ou des couples homosexuels est également légale depuis plusieurs années. Bref, l’homosexualité est beaucoup plus banalisée, du moins à Montréal qui, il est vrai, n’est pas tout le Québec.
Surtout, il y a beaucoup plus d’organisations de queers racisé-e-s, qui tentent de prendre en compte les enjeux coloniaux locaux. Ça se traduit par exemple par une réflexion sur la bispiritualité, une notion présente chez les communautés autochtones d’Amérique du Nord et qu’on pourrait désigner comme une sorte de troisième genre auquel appartiennent les personnes two-spirits. Cela rappelle que la non-binarité de genre n’est pas un concept qui aurait émergé récemment dans le monde occidental queer.
Parmi ces organisations montréalaises de queers racisé-e-s, on trouve par exemple l’association Arc-en-Ciel d’Afrique, qui existe depuis 2004, et aussi des groupes plus radicaux, ou en tout cas un peu différents, comme Qouleurs (Queers of Color et personnes autochtones), qui organise un festival.
De façon générale, il y a plus de diversité dans les communautés LGBTQIA au Québec qu’en France. Il y a par exemple une Pride (Fierté Montréal), mais aussi Pervers/cité, un événement beaucoup plus queer et radical que la Pride, qui est devenu un rassemblement très institutionnel, auquel participent les banques ou la police, ce qui est très critiqué dans certains cercles queers. L’écosystème LGBTQIA est donc beaucoup plus diversifié, c’est certain.
Ce qui me semble être la condition d’émergence de certaines associations (et donc de cette diversité), c’est le fait que ces thématiques LGBTQIA soient débattues à l’université, dans les sphères médiatiques, et pas seulement une fois par an à l’occasion de la Pride. C’est ça qui permet d’élargir le spectre des questions sur tous les enjeux.
À quels enjeux en particulier pensez-vous ?
Amandine Gay : Et bien, par exemple, je travaille beaucoup sur l’adoption et ses enjeux éthiques. Dans les communautés LGBT anglo-saxonnes, il est possible d’avoir cette conversation, même si c’est parfois compliqué. Le 25 septembre, j’ai ainsi participé (par Skype, car j’étais en France) à une table ronde à la CUNY (City University of New York), intitulée Queer/Trans/National Adoption Politics. Le débat portait sur ce que c’est que d’être une personne queer adoptée, sur la façon dont on peut apporter notre expérience de l’adoption dans les communautés queers pour qu’elles évitent de reproduire les erreurs qu’ont commises les hétéros – par exemple un utilisant un vocabulaire de droit à l’enfant qui évacue complètement le droit de l’enfant.
En France, on est si peu avancés sur ces questions d’homoparentalité, de possibilité pour les couples queers de fonder une famille, que c’est très difficile d’avoir une discussion posée sur les enjeux éthiques de l’adoption, de la procréation médicalement assistée (PMA) ou de la gestation pour autrui (GPA). La Manif Pour Tous a totalement polarisé les débats et les a orientés sur la question de savoir si les couples homos devaient être autorisés à fonder une famille, alors qu’évidemment, il aurait fallu plutôt se demander comment. Ce sont des conversations importantes qu’on ne peut pas avoir ici.
Les enjeux éthiques ne sont pourtant pas les mêmes pour l’adoption, la PMA ou la GPA.
Amandine Gay : Il y a des thématiques communes, par exemple l’accès aux origines. Moi qui suis née sous X, je ne connais pas les miennes. Quand on a recours à un donneur de sperme anonyme, il faut se préparer, quinze ou vingt ans plus tard, à faire face à une personne adolescente ou adulte qui voudra peut-être savoir qui est la personne qui lui a permis de venir au monde. Qu’elle veuille ou non entretenir une relation avec elle, ce devrait être à elle de pouvoir en décider.
Ce sont des questionnements que nous, personnes adoptées, pouvons apporter dans la communauté LGBT. Refuser l’anonymat du donneur, cela ne signifie pas forcément lui laisser une place dans la structure familiale. Mais il faut se poser la question du droit de la personne qui va naître à connaître ses origines. C’est important, par exemple pour pouvoir établir ses antécédents médicaux. Je fais partie de cette génération de personnes nées sous X qui n’ont aucun antécédent médical. Depuis, la loi concernant les enfants nés sous X a évolué, mais en ce qui me concerne, je ne sais rien par exemple des risques héréditaires que j’ai de développer un cancer du sein.
Par ailleurs, les premiers parents (une expression que je préfère à celle de «parents biologiques», car il y a toujours des conditions politiques, sociales et économiques à l’adoption) sont souvent des personnes pauvres ou qui sont dans un moment de vulnérabilité de leur vie. Elles peuvent plus tard changer d’avis et vouloir retrouver leur enfant. Est-ce qu’on est préparés psychologiquement, lorsqu’on adopte à l’étranger, à ce que des jeunes soient retrouvés à l’adolescence par leur famille d’origine grâce à Facebook, comme cela se voit de plus en plus souvent ? Ce n’est pas parce qu’on est queers qu’on ne doit pas se poser ces questions.
Tout comme on doit se demander ce que cela veut dire de prendre un enfant racisé venu d’un pays du Sud pour l’amener au sein d’un couple d’hommes gays blancs d’un pays du Nord. Pour cet enfant, cela signifie changer de langue, de culture, se retrouver racisé alors qu’il aurait appartenu à la norme dans son pays d’origine…
Je crois qu’il est très important pour cet enfant que ses parents adoptifs (qu’ils soient homos ou hétéros, cela ne change rien) aient conscience qu’ils sont blancs. Et honnêtement, quand je vois comment on appréhende le racisme dans les communautés LGBT (et surtout dans leurs composantes majoritaires, à savoir les gays et les lesbiennes blanc-he-s), cela m’inquiète un peu de penser que ces personnes-là vont se retrouver avec des enfants non-blancs. Cela me pose question et je ne vois absolument pas ce débat se dérouler.
Au Québec, en matière d’adoption, il y a eu la génération des «fillettes chinoises». Énormément de jeunes filles asiatiques qui ont aujourd’hui entre vingt-cinq et trente-cinq ans ont grandi dans coins reculés du Québec au milieu de gens qui demandaient à leurs parents, devant elles : «et alors, vous êtes allés la chercher où ? Elle ne vous a pas coûté trop cher ?». Parce que c’est ça, ce qu’il se passe. Les gens n’ont aucun filtre ! Donc il faut être capable de répondre et de soutenir son enfant dans ces cas-là. Il faut être prêt à accueillir un enfant d’une autre couleur, d’une autre culture…
Bref, ces questions soulèvent énormément d’enjeux, que je vois très peu thématisés dans nos communautés parce qu’à l’heure actuelle, en effet, l’urgence, c’est d’avoir le droit d’être des parents. Et je suis évidemment tout à fait d’accord avec cela, mais je dis simplement qu’on n’est pas les parents d’une personne théorique, d’un enfant rêvé. On est les parents d’un adulte en devenir et on doit penser à ce qu’il va arriver à cette personne lorsqu’elle va se poser des questions sur ses origines.
Beaucoup d’intervenantes de
Ouvrir la voix expliquent qu’elles ont longtemps eu une mauvaise image d’elles-mêmes et de leurs corps à cause du stigmate qui pèse sur les peaux noires. Ce stigmate, on le retrouve aussi sur les applications de rencontres gays, où il n’est pas rare de croiser des profils indiquant «no blacks». Beaucoup de ces profils se justifient en disant qu’il ne s’agit pas de racisme, mais d’une simple préférence individuelle. Qu’en pensez-vous ?
Amandine Gay : Ce que je voulais montrer avec Ouvrir la voix, c’est que le privé est politique. Et donc la question du désir est éminemment politique. L’une des intervenantes, Maboula Soumahoro, le dit d’ailleurs : «on désire ce qui est puissant». Pour moi, c’est vraiment ça. Je voulais montrer que les préférences, elles ont aussi une origine, surtout quand elles se recoupent avec la norme et ce qui est valorisé dans un temps et dans un espace donné (ici, chez les gays en 2017).
Cela vaut pour la couleur de peau mais pas seulement, puisqu’à côté des «no blacks», on trouve aussi sur les applications de rencontre des «no fems», «no fats»… Si tout le monde se retrouve à aimer la norme, alors ce n’est pas juste une préférence. Cela dit quelque chose de ce qui est considéré comme désirable et de celles et ceux qui ont le pouvoir de définir qui est désirable et qui ne l’est pas.
La question se pose aussi pour les personnes racisées. On est nombreux et nombreuses à s’être rendu compte à un moment donné qu’on n’était sorti-e-s qu’avec des Blanc-he-s et à se demander ce que cela voulait dire de nous. Quand on me l’a fait remarquer la première fois, j’avais vingt ans et je n’avais pas de réponse à apporter à cela. Il a fallu que je me demande ce que voulait dire le fait que même moi, je ne désirais pas les gens qui me ressemblent. À partir de là, un travail de déconstruction s’opère.
C’est certain que les images qu’on nous propose restent dans un coin de notre tête. Et pour les personnes qui grandissent dans un monde où elles sont rarement représentées, et quasiment jamais de façon valorisante (dans le monde de la publicité, de la beauté, de la fiction…) mais le plus souvent via des images misérabilistes, c’est compliqué de se dire qu’elles sont belles et désirables. Et ça l’est aussi pour le reste de la société. C’est pour cela que pour moi, l’excuse de la simple préférence ne tient pas.
Le plus choquant dans ces «no blacks», c’est que c’est une forme de déshumanisation. C’est refuser l’individualité aux personnes noires. Il y a quelque chose d’absurde à considérer que tous les Noir-e-s, dans leur ensemble, ne vous plaisent pas. Cela veut dire qu’on n’a pas de personnalité et qu’on est Noir-e-s avant tout. C’est partir du principe qu’on serait tous pareils, que n’importe quel Noir équivaudrait à n’importe quel autre et qu’on serait interchangeables. C’est très dur à recevoir comme perspective. Moi j’estime qu’il n’y en a qu’une, des comme moi !
Je suis un être humain et il se trouve que je suis noire. Si quelqu’un me voit comme un bloc monolithique, uniquement comme une Noire, et que c’est sensé définir l’intégralité de mon identité, alors cette personne est en train de me réifier. Elle ne me considère pas comme un être humain.
À l’inverse, si nous, les personnes racisées, on s’amusait à dire : «tous les Blancs sont comme ci ou comme ça», on nous tomberait dessus en deux secondes en nous rétorquant : «c’est absurde, tu ne peux pas dire «tous les Blancs», etc.». Donc la question que posent ces soi-disant «préférences», c’est aussi celle des rapports de pouvoir : qui peut se permettre de rejeter un groupe sous prétexte de non-désirabilité ? C’est le groupe majoritaire qui définit les règles.
Pour moi, c’est important de dénaturaliser nos pratiques sociales et se rendre compte que beaucoup de choses qu’on fait, on les fait par mimétisme, par socialisation, parce qu’on a appris à les faire comme ça, mais pas parce que c’est « naturel ». Ce sont des faits construits, et le désir en fait partie. C’est ce que montre par exemple un livre comme L’Invention de l’hétérosexualité de Jonathan Katz, qui rappelle qu’il s’agit-là d’une idée très récente à l’échelle de l’histoire humaine ! En ce qui me concerne, je ne crois pas en l’exclusivité sexuelle et je ne la pratique pas. Et il me semble que je m’inscris plutôt dans le temps long de l’histoire de l’Humanité ! L’hétérosexualité, le couple, la maternité… sont des constructions sociales – donc politiques – qu’on nous présente comme naturelles.
La première édition de la Paris Black Pride, en 2016, rendait hommage à James Baldwin et Joséphine Baker. Quelles sont les personnalités noires et
queers qui ont particulièrement compté pour vous ?
Amandine Gay : Ce sont des figures que j’ai découvert assez tard dans ma vie. Je suis née en 1984. Autant vous dire qu’à la campagne lyonnaise, dans les années 90, les icônes LGBT noires n’étaient pas très visibles…
En grandissant, j’ai développé une grande passion pour Billie Holiday, Big Mama Thornton, Bessie Smith, Rosetta Tharpe… Ce sont toutes des musiciennes et chanteuses de blues et du début du rock afro-américaines qui étaient ouvertement bisexuelles, le chantait dans leurs chansons, ont vécu ou fait des tournées avec des femmes qui étaient leurs maîtresses… Elles se sont affirmées des décennies avant le moindre mouvement qui aborde ces questions-là de façon politique. C’étaient mes premières icônes.
Ensuite, il y a eu toutes les auteures de la galaxie afroféministe des années 80, à commencer par Audre Lorde, notre grande prêtresse à toutes ! Si je l’aime tant, c’est aussi pour sa poésie. Dans son œuvre, on ne trouve pas seulement une réflexion théorique, mais aussi une écriture.
Pour parler d’artistes plus contemporaines, j’adore le travail de la cinéaste lesbienne afro-américaine Dee Rees, qui a réalisé par exemple Pariah (2011). Ou encore l’actrice Lena Waithe, qui joue dans la série Netflix Master of None et qui en a coécrit un très bel épisode (Thanksgiving) sur son coming-out et sa relation à sa famille.
Donc mes icônes sont surtout des artistes américaines. Il faut dire que des figures noires et queers françaises que j’aurais pu adorer quand j’étais plus jeune, je n’en vois pas. Même maintenant, elles ne sont pas très nombreuses en France, à part Shirley Souagnon peut-être.
Peut-être est-ce aussi parce qu’ici, nous avons souvent l’impression que la lutte contre le racisme anti-noir nous concerne moins, que c’est davantage un phénomène américain…
Amandine Gay : C’est toujours plus facile d’aller voir ce qui va mal chez son voisin que de balayer devant sa porte ! Ce n’est pas propre à la France : maintenant que je vis à Montréal, je me rends compte que beaucoup de Québécois se disent «nous au moins, on n’est pas racistes comme les Français…» ! C’est pour cela que, lorsque j’ai présenté le film à l’étranger, en Suisse, au Québec et en Belgique, j’ai veillé à inviter des collectifs noirs locaux à venir parler lors des débats qui suivent les projections. Je ne voulais pas tomber dans ce travers que je reproche souvent aux Afro-Américains qui, lorsqu’ils viennent parler en France, ont l’impression que tout va beaucoup mieux pour les Noirs ici que chez eux et effacent complètement les luttes locales contre la négrophobie.
Et donc, lors de ces débats à l’étranger, systématiquement, les militants antiracistes locaux disaient : «chez nous, c’est pareil ! Ici, on nous montre toujours la France en contre-exemple mais nous aussi, on a nos problèmes !». Donc en France, on aime bien s’intéresser au sort des Afro-Américains pour mieux passer sous silence le racisme d’ici. Et à l’étranger, à l’inverse, c’est la France qui fait figure de repoussoir afin d’éviter de parler des problèmes locaux de négrophobie.
Notre pays n’aime pas regarder les parties honteuses de son histoire. Ça vaut pour le racisme, la colonisation, l’esclavage, mais aussi pour la collaboration durant la Seconde Guerre mondiale, la participation de la France à Shoah… On ne peut pas dire qu’on soit très à l’aise sur ces sujets. Personnellement, il a fallu que je sois à Sciences Po pour vraiment étudier la période de la collaboration et le gouvernement de Vichy, sur lequel on passe rapidement à l’école (en tout cas, à mon époque). Il y a une réticence française à se confronter à cette histoire-là, une histoire de violence, de rejet, de déshumanisation et d’une volonté violente d’homogénéisation et d’assimilation.
La colonisation anglaise n’était pas moins brutale que la française, mais elle était nettement moins déterminée à homogénéiser les personnes colonisés. Les Anglais avaient plutôt une volonté de ségrégation : à chacun sa vie. La colonisation française, à l’inverse, a cherché à effacer tout ce qui la précédait et à imposer autre chose. C’est très violent et c’est rare qu’on se penche sur cette violence-là. Dans un article que j’ai écrit pour l’université américaine de Stanford, je parle d’une histoire française de la violence cachée. L’histoire de la violence de la conquête des États-Unis est assumée par les Américains et très connue et visible à l’étranger. À l’inverse, la violence d’État française ne l’est pas.
C’est très frappant en ce qui concerne l’histoire de la colonisation et de l’esclavage. À Bordeaux et à Nantes, par exemple, on n’aime pas du tout se poser cette question. Quand j’ai présenté le film à Nantes, j’ai bien entendu rappelé que la ville était l’un des trois plus grands ports négriers à l’époque de l’esclavage et ce n’était pas une conversation facile. Mais Nantes et Bordeaux ne seraient pas riches comme elles le sont aujourd’hui, et leurs grandes familles ne seraient pas ce qu’elles sont, s’il n’y avait pas eu l’esclavage.
Mais personne n’a vraiment envie d’aller regarder cette histoire-là. Ce n’est pas agréable de se dire que son grand-père ou son arrière-grand-père était un collabo ou que son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère était une maîtresse sur une plantation et que ça ne le dérangeait pas de voir d’autres femmes être violée par les maîtres ou les esclaves et que parfois, même, elle pouvait être la proxénète de ces esclaves.
Que peut-on faire pour la cause afroféministe quand on n’est pas femme ou pas noire ou ni l’un ni l’autre ? Comment peut-on être un-e bon-ne allié-e ?
Amandine Gay : En conscientisant les personnes blanches sur leur propre privilège blanc. Le grand travail des allié-e-s, quels qu’ils soient, doit se faire dans leur communauté. Par exemple, les enjeux des préférences raciales sur les sites de rencontres gay, c’est un bon sujet de conversation, lorsqu’on est un homme gay blanc, à amener auprès d’autres hommes gays blancs.
Pour nous, c’est très fatigant de devoir toujours faire de la pédagogie. En plus, cela nous met tout de suite dans une situation confrontationnelle : notre interlocuteur n’entend pas que son propos est problématique ou raciste mais qu’on l’a traité, lui, de raciste ! Et là, il n’y a plus de discussion possible. Alors que lorsque cela vient d’un pair, en général, la remise en question est plus facile.
Donc pour moi, les allié-e-s, si ils et elles ont compris ce qu’il se passe, doivent faire comprendre à plus de gens qui leur ressemblent qu’il y a un problème. Parce que nous, personnes racisées, on le sait déjà et on est fatiguées de devoir faire de l’éducation gratuitement, sur notre temps libre, alors qu’on on est déjà discriminées.
Ouvrir la voix d’Amandine Gay. Sortie en salles mercredi 11 octobre.
Projection en présence de la réalisatrice mercredi 13 décembre à 20h au cinéma Gérard Philippe, 12 avenue Jean Cagne-Vénissieux / 04.78.70.40.47 / www.ville-venissieux.fr/cinema
Portrait Amandine Gay © Maya Mihindou
The post Amandine Gay : « la question du désir est éminemment politique » appeared first on Heteroclite.













 RT + stay tuned!
RT + stay tuned!  (@forestbonnie_)
(@forestbonnie_)  Cotton Candy Forest
Cotton Candy Forest 
 (@Damp__Sandwich)
(@Damp__Sandwich) 
 OcTEAber
OcTEAber (@heyashleytea)
(@heyashleytea)  ❤️
❤️ 



 (@_LindseyLove)
(@_LindseyLove)  🤤
🤤  🃏
🃏 ☁️
☁️ (@shycloud_CB)
(@shycloud_CB)  (@mutinaea)
(@mutinaea)  come join me:
come join me: 

 Good Morning
Good Morning 




























 $pooky$lut
$pooky$lut (@RabbitMagick)
(@RabbitMagick) 


 LeoLulu (@LeoLulu_XXX)
LeoLulu (@LeoLulu_XXX)  (@officialcclion)
(@officialcclion) 


 (@iamjasonluv)
(@iamjasonluv) 










 (@misslouisecb)
(@misslouisecb) 











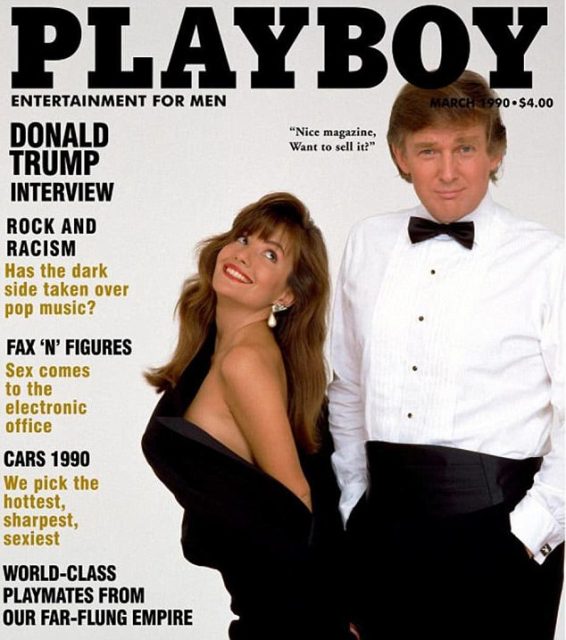

















 ♂️
♂️ 












 (@emerson_cane)
(@emerson_cane) 
 ☺️
☺️ 







