LE MANUSCRIT TROUVE A SARAGOSSE (Wojciech HaS – 1965)
Drôle de carrière pour ce film de 180 minutes, petite merveille du cinoche polonais distribué chez nous à l’époque dans des versions charcutées. La restauration de l’ultime copie intégrale, retrouvée dans le grenier de Has, a été financée par M. Scorsese il y a peu : à nous les trois heures de bagenaudes dans le roman alambiqué de Jan Potocki.

LE MANUSCRIT est, à l’origine, un roman bizarre du début du XVIIIè siècle, écrit en français par un Polack et dont l’action prend place en Espagne. C’est à la fois une sorte d’hommage au QUICHOTTE et un formidable récit-monde, à la manière du DECAMERON ou des MILLE ET UNE NUIT. Sur le récit principal, celui du voyage d’un noble Wallon dans les montagnes d’Estramadure, les histoires parallèles pullulent et se contaminent. Au sein d’un rêve, le héros fait la connaissance d’un personnage qui raconte le récit de sa vie, au cours de laquelle il a fait la connaissance d’un quidam qui, partageant des épisodes de son passé, lui révèle avoir lié amitié avec un bavard, qui s’est empressé de lui narrer, etc.
Le film de Has, s’il ne reprend qu’une infime partie du livre, parvient tout de même, dans son dernier tiers, à un quintuple enchâssement, dans lequel on ne cesse de monter et de descendre de niveau. Et ça se complique encore quand on réalise que les histoires s’interpénètrent, que les récits s’entrecroisent, les chutes de l’une éclairent à rebours le déroulé de l’autre, ou viennent contredire une version précédente du récit… Le résultat, grisant, relève à la fois du récit sur le récit et du grand huit, duquel on redescend ravi, bouldingué par le cours torrentiel des narrations. Avec l’impression confuse, aussi, qu’une fois la machine emballée, il n’y a aucune nécessité à ce qu’elle s’arrête un jour.
La mise en scène de l’adaptation est virtuose et étonnante, aucun procédé autre que le montage ne venant signaler les changements de mode de récit. On pense aux grands Fellini, pour l’élégance de la photo noir et blanc, l’énergie, l’aspect hétérodoxe. Il paraît clair, aussi, que ce film a largement inspiré la TRILOGIE DE LA VIE de Pasolini, tant dans son rapport à la littérature qu’au propos qui tenu, sur la griserie du conteur, la joie de vivre, le plaisir de dire. On s’amuse également de ce procédé que reprendra P.P. qui consiste à faire causer ses personnages en V.O. : les bandoleros causent polonais comme Shéhérazade jactera rital, ce n’est qu’un pas de plus de notre plongée dans le rêve.
Les acteurs, amenés à parcourir tous les registres des aventures possibles, offrent des compositions remarquables, allant du jeu nuancé à la farce outrancière, au fur qu’ils passent de la bluette à la farce au drame au récit édifiant. Les scènes, souvent filmées de derrière une fenêtre, au travers d’un cadre, signalent en permanence l’importance la mise en abyme et la rendant, tout en la rendant inopérante. Le spectateur ne pense plus qu’on lui raconte une histoire : il est en plein rêve et ne veut pas connaître le terme.
Pourquoi raconter des histoires ? Le XVIIIème, auquel le livre de Potocki se rattache entièrement (on pense aux MEMOIRES de Casanova, aux œuvres métaleptiques Diderot), a accouché du genre romanesque en posant et reposant cette unique question. Et si la plupart des récits que rapportent les films sont en réalité de l’ordre de la nouvelle (« une bonne histoire, une bonne histoire, une bonne histoire »), LE MANUSCRIT fait un vrai hommage à ce qui constitue le roman : l’élaboration d’un monde, univers clos, artificiel, au sein duquel les histoires peuvent s’ébattre, croître, vivre. Un film-labyrinthe, oui, dans le sens ou L’ETE DE LA DERNIER ETREINTE n’est PAS un film-labyrinthe. Ni LA CHAMBRE NOIRE, d’ailleurs.

L’ETE DE LA DERNIER ETREINTE (Nureta Shumatsu, 1979)
LA CHAMBRE NOIRE (Kirio Uriyama, 1983)
Les « romans pornos » de la Nikkatsu, films érotiques nippons, ont gagné en notoriété ces dernières années, avec la reconnaissance progressive du boulard comme genre cinématographique respectable. Après le western, le giallo, le gore et etc., c’est le cul qui se taille doucement une place dans le monde très select de la critique critiquante. Adoubement simplifié, dans le cas de ces films particuliers, par le fait qu’ils restent très à-côté du porno archétypal, puisqu’ils sont scénarisés, joués et réalisés avec un assez grand soin. Ils sont aussi souvent porteurs de récits dans lequel le sexe n’est pas nécessairement au centre.
Dans l’ETE, on suit les tribulations sensuelles, socioprofessionnelles et existentielles d’une secrétaire de direction que son boss a pris pour maîtresse. A la fois partenaire du moustachu, amie de sa femme et nurse de leur gamine, elle attend que Monsieur veuille bien faire son coming out et changer de foyer. La trentaine fond sur elle, accompagnée des préjugés sociaux à l’égard des femmes célibataires. Heureusement, un jeune trotskyste débile cherche à la cambrioler un soir de solitude, mettant un peu de piment dans sa vie.
Le cul, dans ce petit film, n’est que prétexte, qu’outil. Si les corps que l’on y croise sont jolis et plutôt mis en valeur dans les scènes nues, on sent que le propos n’est pas là. Que le désir de notre héroïne de prendre en main sa sexualité est moins fort que celui de gérer sa vie, entièrement, de s’émanciper des pressions et du qu’en dira-t-on. On gratouille, semble-t-il, quelque chose de sensible dans la mentalité d’alors, le film oscillant dans le jugement à porter sur la gueuse, en même temps encouragée à fuir et dénoncée pour sa monstruosité.
LA CHAMBRE NOIRE est plus long, plus pénible, et toujours aussi peu explicite. Là on est carrément dans l’existentiel mou, avec la présentation des affres d’un écrivain quarantenaire, hanté par une infidélité potentielle de sa femme, décédée depuis dix ans.
Le film suit ses aventures, enchaînées à un rythme de tortue sous valium, et avec une telle subtilité scénaristique que le récit en devient filandreux, presque abstrait. Le personnage principal n’engendrant aucune sympathie, on a du mal à le suivre sans bâiller dans ses pérégrinations artistico-érotiques. D’autant que, plus encore que dans l’ETE, le pacte narratif porno est trahi par des scènes grossièrement simulée : on y baise bruyamment et à côté des trous.
Le rapport à la sexualité est dans les deux cas, très marqué par le rapport à la société. On parle beaucoup de mariage, de concubinage, d’avortement, et beaucoup moins d’amour, de plaisir. Les femmes tentent de jouer un rôle plus complexe que celui d’objet de plaisir, on sent que la révolution sexuelle est passée par là. Mais la vision du cul reste assez désespérément machistes. Les rapports forcés y sont légions et toujours satisfaisants pour celles qui les subissent. L’évolution des relations passe invariablement par la soumission, les coups, la trahison par l’amant. Les lesbiennes sont contre-nature, l’homosexualité masculine jamais évoquée, et si l’héroïne de l’ETE revendique son droit à jouir, elle semble ne pouvoir le faire que dans la contrainte et avec ceux qu’elle n’aime pas…
Histoires étranges, donc, de ces films qui ne parlent pas de ce dont ils causent. En tant que témoignage schizophrénique, l’ETE n’est vraiment bon que dans ses séquences Kean Loach, où l’on découvre les faubourgs de Tokyo, les banlieues pauvres, l’envers de la success story des seventies. Quant à LA CHAMBRE NOIRE, les rares beaux moments sont dans les creux, dans une scène onirique en bord de mer, une vadrouille à la campagne, des visions psychés d’une mort en approche.
L’un comme l’autre sont des récits angoissés, imprégnée sans doute de l’esprit de leur temps, dans lequel le plaisir est toujours contrarié, l’ordre social instable et la sexualité entachée de violence et de morbidité.
*
A ma droite un film rêveur, alambiqué, léger, dans lequel on épouse deux femmes à la fois, on fait la nique à l’Inquisition et se régale de mets fantômes. A ma gauche des récits programmatiques et linéaires qui, sous prétexte de nous exciter, tiennent un discours inquiet sur le monde tel-qu’il-est. A quinze ans et des milliers de kilomètres d’écart, la joie de raconter s’est muée en nécessité inquiète. On ne célèbre plus les histoires sans fin, on se préoccupe de deviner comment cela va bien pouvoir finir.
C’est le XVIIIè le plus libertin qui a engendré le romantisme et la vague de de pudibonderie du XIXè. A peine la décennie 1960 achevée, voilà que les émancipations recommencent à calcifier, que ce qui semblait évident se remet à poser question. Et où sommes-nous à présent ?
Qui sommes-nous ? Quand est-ce qu’on mange ?
*
LES CINQ CONTEURS DE BAGDAD de Fabien Vehlmann (scénar) et Franck Duchazeau (dessin), a paru chez Dargaud en 2006. C’est un one-shot d’environ 80 planches, qui vaut largement son pesant d’houmous.
LE MANUSCRIT TROUVE A SARAGOSSE de Wojciech Has (réal) a été édité en DVD il y a un an ou deux, distribué par Malavida. Une édition de référence du roman de POTOCKI a été établie dans les années 2000 pour José Corti, on en trouve aussi des versions moins complètes et moins chères en poche.
L’ETE DE LA DERNIER ETREINTE et LA CHAMBRE NOIRE sont des films pas très coquins produits par la Nikkatsu et édités en DVD l’an dernier par Wild Side, dans leur collection L’Âge d’or du Roman Porno Japonais.






















 Du 18 octobre au 3 décembre 2001, Pascal Vanhoecke présente au sein de sa galerie parisienne « Sexe et Convenances III ».
Du 18 octobre au 3 décembre 2001, Pascal Vanhoecke présente au sein de sa galerie parisienne « Sexe et Convenances III ».


















































































































.jpg)



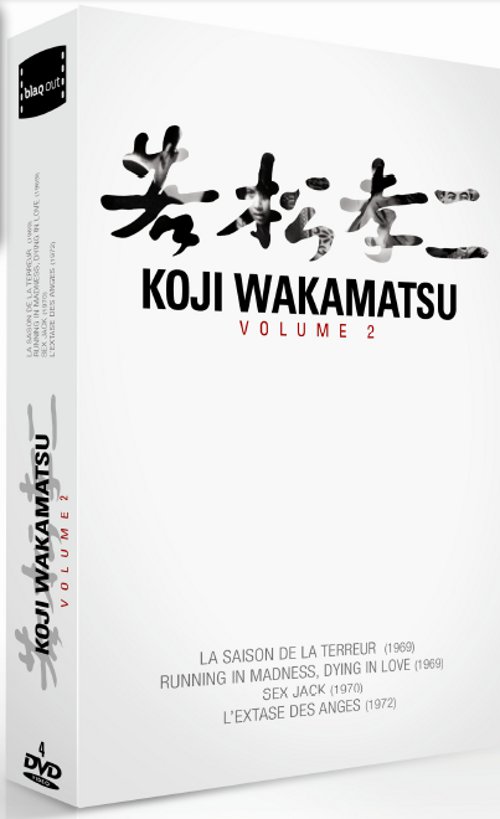


 Edité chez
Edité chez 

 Collection « L’age d’or du x américain ».
Collection « L’age d’or du x américain ».








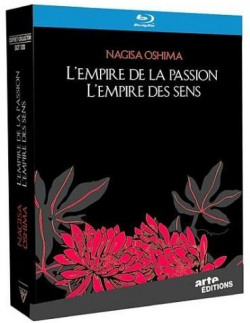 Le support blu-ray est un superbe écrin pour ce film. On y gagne bien sûr en définition et en précision d’image. On pourra observer les imperfections de la peau, le tatouage de scorpion sur le lobe de l’actrice et bien sûr tous les détails anatomiques. Les couleurs des décors et des costumes sont chatoyantes. Seuls quelques plans sont un peu fourmillants et d’autres de nuit sont plus bleus que noirs. Mais étant l’âge du film, le transfert reste exceptionnel.
Le support blu-ray est un superbe écrin pour ce film. On y gagne bien sûr en définition et en précision d’image. On pourra observer les imperfections de la peau, le tatouage de scorpion sur le lobe de l’actrice et bien sûr tous les détails anatomiques. Les couleurs des décors et des costumes sont chatoyantes. Seuls quelques plans sont un peu fourmillants et d’autres de nuit sont plus bleus que noirs. Mais étant l’âge du film, le transfert reste exceptionnel.


